


ANNEXES
| Retour | Journal de Marie Bashkirtseff t. 2 | Tome 1 |
Fourni par Gallica, complété, et mis en page par nos soins.
La carte, la table des matières et les illustrations sont également de notre fait.
Table dynamique, les éléments sont des liens.

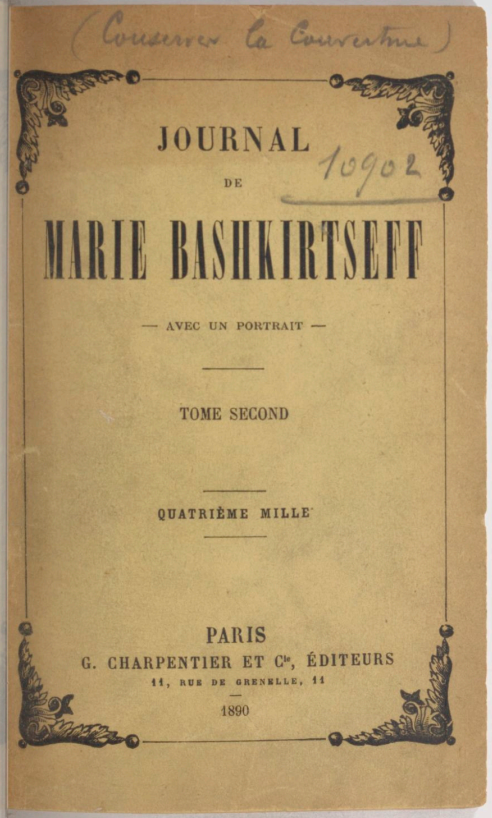
1877
Dimanche 9 septembre 77.
J'ai pleuré dans la journée. Le commencement de ma vie saccagée me fait de la peine. Dieu me garde de passer pour une divinité incomprise, mais je suis malheureuse ! Bien des fois j'ai voulu me reconnaître « frappée d'un mauvais sort », et chaque fois je me suis révoltée contre cette horrible pensée…
Nunquam anathematis vinculis exuenda !
Il y en a à qui tout réussit, tandis qu'à d'autres tout devient mauvais. Et contre cette vérité il n'y a rien à dire. Et c'est justement là l'horreur de la chose !
J'aurais pu depuis trois ans travailler sérieusement, mais à treize ans, je courais après l'ombre du duc de H..., chose déplorable à avouer. Je ne m'accuse pas, parce que je ne me gaspillais pas sciemment. Je me regrette, mais je ne me reproche pas tout. Les circonstances combinées avec mon libre arbitre, continuellement gêné pourtant, avec mon ignorance ; mon exaltation qui se croyait du scepticisme acquis par une expérience de quarante ans, m'ont ballottée on ne sait où et le diable sait comment ! D'autres, dans des circonstances semblables, auraient pu rencontrer des appuis solides qui auraient permis le travail à Rome ou ailleurs, ou bien un mariage. Moi, rien.
Je ne regrette pas d'avoir vécu à ma guise, il serait étrange de le regretter, sachant bien qu'aucun conseil ne me sert à rien. Je ne crois qu'à ce que j'éprouve.
Lundi 10 septembre 77.
Demain matin nous partons. J'aime bien Schlangenbad. Les arbres sont superbes, l'air doux. On ne rencontre personne si on veut.
Je connais tous les sentiers, toutes les allées. On serait heureux, si on pouvait se contenter de Schlangenbad.
Mes mères ne me comprennent pas. Dans mon désir d'aller à Rome, elles voient les promenades du Pincio, l'Opéra, et « des leçons de peinture ». Et si je passais toute ma vie à leur expliquer mon enthousiasme, elles le comprendraient peut-être, mais comme une chose inutile, une fantaisie à moi... Les petites misères de tous les jours les ont absorbées... et puis on dit qu'il faut être né avec l'amour de tout cela, autrement on ne comprend jamais, quelque spirituel, distingué et excellent qu'on soit. Mais, n'est-ce pas moi plutôt qui suis bête ?
Je voudrais être fataliste.
Paris. — Mercredi 19 septembre 77.
J'ai relu mes tripotages avec A...(Pietro Antonelli) et j'ai bien peur qu'on ne me prenne pour une idiote ou pour une personne un tant soit peu légère. Légère, non. Je suis d'une honnête famille... qu'est-ce que je dis ?
Je n'étais que bête. Ne pensez pas que je me dise bête par gentillesse ou coquetterie. Je le dis avec la plus profonde tristesse, car j'en suis convaincue.
Et c'est moi qui voulais avaler le monde ?... A dix-sept ans je suis un être blasé, on ne sait pas ce que je suis. Je sais que je suis bête, A... en est la preuve.
Et pourtant quand je parle, j'ai de l'esprit; jamais quand il en faut, c'est vrai, mais…
Jeudi 20. — Vendredi 21 septembre 77.
Profond dégoût de moi-même. Je hais tout ce que j'ai fait, dit et écrit. Je me déteste parce que je n'ai justifié aucune de mes espérances. Je me suis trompée.
Je suis bête, je manque de tact et j'en ai toujours manqué. Désignez-moi une parole d'esprit ou un acte raisonnable de moi. Rien que de la bêtise ! Je me croyais spirituelle, je suis absurde. Je me croyais hardie et je suis peureuse. Je me croyais du talent et je ne sais où je l'ai mis. Et avec ça, la prétention d'écrire des choses charmantes ! Ah l mon Empereur ! vous prendrez peut-être pour de l 'esprit ce que je viens de dire; ça en a l'air, mais ça n'en est pas. J'ai l'adresse de me juger exactement, ce qui fait croire à de la modestie et à un tas de choses. Je me hais !
Samedi 22 septembre 77.
Je ne sais comment cela se fait, mais je crois que j'ai envie de rester à Paris. Il me semble qu'une année d'atelier Julian ferait bien comme base.

Mardi 2 octobre 77.
C'est aujourd'hui que nous déménageons au 71 des Champs-Élysées. Malgré tout ce remue-ménage, j'ai eu le temps d’aller à l’atelier Julian, le seul sérieux pour les femmes. On y travaille tous les jours de huit heures à midi et d'une heure à cinq heures. Un homme nu posait, lorsque M. Julian m'a conduite dans la salle.
Mercredi 3 octobre 77.
Le mercredi m'étant un jour favorable et celui d'aujourd'hui n'étant pas un 4, qui m'est défavorable, je m'empresse de commencer autant de choses que possible.
J'ai ébauché au crayon une tête de trois quarts chez Julian, en dix minutes, et il me dit qu'il ne s'attendait pas à voir si bien pour une commençante. Je suis partie de bonne heure, je tenais seulement à commencer aujourd'hui. Nous allons au Bois ; je cueille cinq feuilles de chêne et vais chez Doucet qui en une demi-heure me fait un délicieux petit scapulaire bleu. Mais que désirer ?... — Être millionnaire ? Retrouver ma voix ? Obtenir le prix de Rome, en me présentant sous un nom d'homme ? Épouser Napoléon IV ? Entrer dans le grand monde ?
Je désire le prompt retour de ma voix.
Jeudi 4 octobre 77.
La journée est vite passée quand on dessine de huit heures à midi et d'une à cinq. Le trajet seul mange presqu’une heure et demie, et puis j'ai été un peu en retard, de sorte qu'il n'y eu que six heures de travail.
Quand je pense aux années, des années entières que j'ai perdues ! De colère on est tenté de tout envoyer au diable..... Mais ce serait encore pis. — Allons, être misérable et abominable, sois contente d'être enfin arrivée à commencer ? A treize ans j'aurais pu commencer ! Quatre ans !
J'aurais fait des tableaux d'histoire, si j'avais commencé il y a quatre ans. Ce que je sais ne fait que me nuire. C'est à refaire.
J'ai été obligée de recommencer deux fois la tête de face avant de satisfaire. Quant à l'académie, cela se fit de soi-même et M. Julian n'a pas corrigé une ligne. Il n'était pas là quand j'arrivai, c'est une élève qui me dit comment commencer ; je n'avais jamais vu d'académie.
Tout ce que je faisais jusqu'à présent n'était qu'une mauvaise blague !
Enfin je travaille avec des artistes, de vrais artistes qui ont exposé au Salon et dont on paye les tableaux et les portraits, qui donnent même des leçons.
Julian est content, de mon début. « A la fin de l'hiver vous pourrez faire de très beaux portraits » m'a-t-il dit.
Il dit que ses élèves femmes sont quelquefois aussi fortes que ses élèves hommes. J'aurais travaillé avec ces derniers, mais ils fument, et d'ailleurs il n'y a pas de différence. Il y en avait lorsque les femmes n'avaient, que le modèle habillé ; mais du moment qu'elles font l'académie, l'homme nu, c'est la même chose.
La bonne de l'atelier est comme on les décrit dans les romans.
— J'ai été toujours avec les artistes, dit-elle, et je ne suis plus du tout bourgeoise, je suis artiste.
Je suis contente, contente !
Vendredi 5 octobre 77.
— Vous avez fait ça seule ? demandé M. Julian en entrant dans l'atelier.
— Oui, monsieur.
J'étais rouge comme si j'avais menti.
— Eh bien... je suis très content, très content.
— Oui ?
— Très content.
Et moi donc ! Sans conseils.... Je suis encore éblouie de la supériorité des autres sur moi, mais j'ai déjà moins peur. Ce sont des femmes qui ont trois, quatre ans d'atelier, de Louvre, d'études sérieuses.
Samedi 6 octobre 77.
Je n'ai vu personne, puisque j'étais à l'atelier.
— Soyez tranquille, me dit Julian, vous ne resterez pas longtemps en route.
Et lorsque maman est venue me chercher à cinq heures du soir, il lui a dit à peu près ceci :
« J'ai cru que c'était un caprice d'enfant gâtée, mais je dois avouer qu'elle travaille vraiment, qu'elle a de la volonté et qu'elle est bien douée. Si cela continue, dans trois mois ses dessins pourront être reçus au Salon. »
Chaque fois qu'il vient corriger mon dessin, il demande si je l'ai fait seule, avec une certaine défiance.
Je crois bien, seule ! Je n'ai jamais demandé de conseil à aucune des élèves que pour commencer l'académie.
Je me fais un peu à leurs façons... artistiques.
A l'atelier tout disparaît ; on n'a ni nom ni famille ; on n'est plus la fille de sa mère, on est soi-même, on est un individu et on a devant soi l'art, et rien d'autre. On se sent si content, si libre, si fier !

W.D. Hamilton
12è duc de Hamilton
Enfin, me voilà comme je voulais être depuis longtemps. Je l'ai si longtemps désiré que je ne crois pas encore y être.
A propos ! savez-vous qui j'ai rencontré aux Champs-Elysées ?
Tout bonnement le duc de H... (Hamilton) occupant tout un fiacre. Le beau jeune homme un peu fort, aux cheveux cuivrés et à la moustache fine est devenu un gros Anglais très rouge avec des favoris roux à partir de l'oreille jusqu'au milieu de la joue que ...
Quatre ans pourtant... changent un homme. Au bout d'une demi-heure je n'y pensais plus.
Sic transit gloria Ducis.
Comme j'étais exaltée !
Lundi 8 octobre 77.
Pour la tête, un nouveau modèle, c'est-à-dire le matin. Une espèce de chanteuse de café-chantant qui a chanté pendant les repos. Et l'après-midi une jeune fille pour l'académie.
On dit qu'elle n'a que dix-sept ans, mais je vous assure que sa taille est joliment endommagée. On dit que ces gredines mènent une vie impossible.
La pose est difficile, j'ai de la peine.
Ce qui rend les hommes honteux de leur nudité, c'est qu'ils ne se croient pas parfaits. Si on était sûr de n'avoir ni une tache sur la peau ni un muscle mal fait, ni des pieds déformés, on se promènerait sans vêtement et on n'aurait pas honte. On ne s'en rend pas bien compte, mais c'est cela, et pas autre chose, qui rend honteux. Peut-on résister de montrer quelque chose de vraiment beau et dont on peut être fier ? Qui a jamais gardé pour soi un trésor où une beauté sans s'en vanter, à commencer par le roi Candaule ? Mais autant on se contente facilement de sa figure, autant on est instinctivement scrupuleux quant à son corps.
La pudeur ne disparaît que devant la perfection, la beauté étant toute-puissante. Et du moment où l'on trouve à dire autre chose que : « C'est beau ! » c'est que ça ne l'est pas tout à fait. Et il y a place pour le blâme et pour tout.
La coquine de l'atelier avait les doigts droits et jolis, mais gros et tout le pied empâté, quoique régulier et pas grand.
Je disais tout à l'heure que la beauté complète affranchissait de tout, et c'est ainsi pour chaque chose parfaite. Une musique qui vous laisse remarquer les défauts de la mise en scène n'est pas parfaite. Un acte d'héroïsme qui, sur le moment, laisse dans vos sens quelque place pour autre chose que l'admiration, n'est pas l'acte le plus héroïque que vous ayez rêvé. Il faut que ce que vous voyez ou entendez soit assez grand pour occuper tout votre être, alors c'est tout-puissant.
Du moment qu'en voyant une femme nue vous vous dites que c'est mal, cette femme n'est pas la dernière expression de la beauté, puisque vous avez de la place pour une autre idée que celle qui devrait vous passer au cerveau par les yeux. Vous oubliez que c'est beau pour remarquer que c'est nu. La beauté n'était donc pas assez complète pour vous occuper tout à fait. Alors ceux qui se montrent ont honte et ceux qui regardent sont choqués.
On a honte parce qu'on sait que les autres trouvent cela mal ; mais s'ils ne le trouvaient pas mal, c'est que ce serait une chose reçue, dont par conséquent on n'aurait pas honte.
Donc voici : La perfection et la beauté absolues anéantissent et même empêchent le blâme de naître, et par conséquent suppriment la pudeur.
Mardi 9 octobre 77.
J'ai dessiné ma chanteuse de tout près et en raccourci. J'ai la plus mauvaise place de l'atelier pour cette semaine, étant venue tard lundi.
— Mais ce n'est pas du tout mal, a dit Julian, je suis même étonné que vous l'ayez faite ainsi. C'est la pose la plus difficile, et comment pouvez-vous travailler de si près ? Allons, je vois que ça marchera sur des roulettes.
Voilà mon monde. Les miens sortent et vont au théâtre, moi, je dessine en attendant le carnaval à Naples, si mes idées ne changent pas et si rien de nouveau ne survient.
Mercredi 10 octobre 77.
Ne pensez pas que je fasse des merveilles parce que M. Julian s'étonne. Il s'étonne parce qu'il s'attendait à des fantaisies de fille riche et de commençante. L'expérience me manque, mais ce que je fais est juste et ressemblant. Quant à l’exécution, elle est ce qu'elle peut être au bout de huit jours de travail.
Toutes mes camarades dessinent mieux que moi, mais aucune ne fait aussi ressemblant et aussi juste. Ce qui me fait croire que je ferai mieux qu'elles, c’est que tout en sentant leurs mérites je ne me contenterai pas de faire comme elles, tandis que généralement celles qui commencent, disent toujours : Si seulement je pouvais dessiner comme telle ou telle !
Elles ont la pratique, l'étude, l'expérience, mais ces filles de quarante ans ne feront jamais plus qu'elles ne font aujourd'hui. Celles qui sont jeunes... dessinent bien et ont du temps, mais pas d'avenir.
Je n'arriverai peut-être pas, mais ce ne serait que par impatience. Je me tuerais pour ne pas avoir commencé il y a quatre ans et il me semble que c'est trop tard.
Nous verrons.
Jeudi 11 octobre 77.
On a beau se dire que cela ne sert à rien de regretter ce qui est passé, à chaque instant je me dis : Comme tout serait bien si j'avais étudié depuis trois ans! A présent je serais déjà une grande artiste et je pourrais, etc., etc.
M. Julian a dit à la bonne de l'atelier que Schaeppi et moi donnions le plus d'espérances. Vous ne savez pas qui est Schaeppi ? Schaeppi, c'est la Suissesse. Hein ! quel langage ! Donc, M. Julian a ajouté que je puis devenir une grande artiste.
Je sais cela par Rosalie.
Il fait si froid, je me suis enrhumée, mais je pardonne tout cela pourvu que je dessine.
Et dessiner, pourquoi ?
Pour... tout ce que je pleure depuis le commencement du monde ! Pour tout ce qui m'a manqué et me manque ! Pour arriver par mon talent, par... par tout ce que vous voulez, mais arriver ! Si j'avais tout cela, peut-être ne ferais-je rien ?
Vendredi 12 octobre 77.
— Vous savez, monsieur, dis-je à Julian, je suis toute découragée. Une dame me disait hier encore que je ne devais pas travailler, n'ayant aucun talent.
— Elle a dit ça, cette dame ?
— Mais oui, et sérieusement.
— Eh bien, vous pouvez lui dire que si dans trois mois, trois mois ce n'est pas bien long, que si dans trois mois vous ne faites pas son portrait de face, de trois quarts ou de profil, comme elle veut enfin, et un portrait pas mal fait, entendez-vous ? ressemblant et pas mal fait ? Eh bien, elle verra. Dans trois mois, et si je le dis ici de façon que toutes ces dames peuvent m'entendre, c'est que je ne dis pas une chose bien colossale, mais sûre.
Ce sont ses propres paroles, dites avec ce reste d'accent marseillais que vingt ans de Paris n'ont pu effacer complètement, et tant mieux. J'aime bien l'accent méridional.

Samedi 13 octobre 77.
C'est le samedi que vient à l'atelier M. Tony Robert-Fleury, le peintre qui a fait le dernier Jour de Corinthe, acheté par l'État et placé au Luxembourg. D'ailleurs les premiers artistes de Paris viennent de temps en temps nous donner des conseils.
J'ai commencé mercredi passé et samedi de la même semaine il n'a pas pu venir, de sorte que c'est la première fois pour moi. Quand il fut arrivé à mon chevalet et énonça ses observations, je l'interrompis :
— Pardon Monsieur..., j'ai commencé il y a dix jours...
— Où avez-vous dessiné avant ? demanda-t-il en regardant mon dessin.
— Mais nulle part.
— Comment, nulle part ?
— Oui, j'ai pris trente-deux leçons de peinture pour m'amuser...
— Ça ne s'appelle pas étudier.
— Je sais monsieur, aussi...
— Vous n'avez jamais dessiné d'après nature avant de venir ici ?
— Jamais, monsieur.
— Ce n'est pas possible.
— Mais je vous assure...
— Vous n'avez jamais eu de conseils ?
— Si... Il y a quatre ans j'ai pris des leçons comme une petite fille, on me faisait copier des gravures.
— Ce n'est rien cela, ce n'est pas de cela que je parle.
Et comme il paraissait encore incrédule, j'ai dû ajouter :
— Je vous en donne ma parole d'honneur, si vous le voulez.
— Eh bien, c'est que vous avez des dispositions tout à fait extraordinaires, vous êtes particulièrement douée et je vous conseille de travailler.
— Je ne fais que ça depuis dix jours... Voulez-vous voir ce que j'ai fait avant cette tête ?
— Oui, je vais finir avec ces demoiselles et je reviens.
— Eh bien, dit-il, ayant visité trois ou quatre chevalets, montrez, mademoiselle.
— Voici, monsieur, dis-je, en commençant par la tête d'Archangélo, et comme je ne voulais lui en montrer que deux, il me dit :
— Non, non, montrez-moi tout ce que vous avez fait.
Je montrai donc l'académie homme, pas finie, puisque commencée jeudi passé ; la tête de la chanteuse vue en dessous, à laquelle il trouva beaucoup de caractère ; un pied, une main et l'académie d'Augustine.
— Vous avez fait cette académie-là, seule ?

(l'Espagnole)
— Oui, et je n'avais jamais non seulement fait, mais vu des académies...
Il souriait et n'en croyait rien, de sorte que j'ai dû de, nouveau donner ma parole d'honneur, et il dit de nouveau :
— C'est étonnant et ce sont là des dispositions tout à fait extraordinaires. Cette académie n'est pas du tout mal, du tout, et cette partie-là est même bien. Travaillez, mademoiselle..... etc., etc.
Suivent les conseils. Les autres ont entendu tout cela et j'ai excité des jalousies, parce qu'aucune d'entre elles n'a rien entendu d'équivalent, elles, des élèves de un an, deux, trois ans, qui font des académies avec des modelés superbes et qui peignent au Louvre ! Sans doute on leur en demande plus qu'à moi, mais aussi on pouvait leur dire l'équivalent dans un autre genre...
C'est donc vrai et je ne... je ne veux rien dire, je n'aurais qu'à me porter malheur... mais je me recommande à Dieu. J'ai si peur !...
Cela m'a valu dans l'après-midi une ruade à la troisième personne. L'Espagnole, — bonne fille d'ailleurs, la plus complaisante du monde, avec la rage de la peinture dans la tête, ne voyant pas très juste pourtant, — donc l'Espagnole, parlant d'une Hollandaise quelconque, dit que lorsqu'on arrivait dans un atelier, on étonnait toujours en faisant de rapides progrès ; que ce peu, qui est beaucoup pour ceux qui ne savent rien, s'acquérait vite, que ce n'est que lorsqu'on savait quelque chose, qu'on avait le plus à apprendre.
Avec ça qu'il n'y a pas deux ou trois commençantes en ce moment ! Est-ce qu'elles progressent comme moi ?
Samedi 13 octobre 77.
Résumons et terminons nos succès.
— Eh bien, mademoiselle ? s'écria Julian en se croisant les bras devant moi.
J'eus même comme peur et lui demandai en rougissant ce qu'il y avait.
— Mais c'est magnifique : vous travaillez le samedi jusqu'au soir quand, tout le monde fait un peu relâche !
— Et oui ! monsieur, je n'ai rien à faire, il faut bien que je fasse quelque chose.
— C'est beau. Vous savez que M. Robert-Fleury n'a pas été du tout mécontent de vous ?
— Oui, il me l'a dit.
— Ce pauvre Robert-Fleury, il est encore un peu souffrant.
Et le maître, s'installant au milieu de nous, se mit à causer... ce qu'il fait rarement et ce qu'on apprécie beaucoup.
Après sa visite chez nous, ce pauvre Robert-Fleury a causé avec ce bon Julian. Or, je voulais savoir encore quelque chose, ne m'attendant qu'à des choses flatteuses.
J'allai donc trouver le maître comme il venait corriger le dessin d'une adorable petite blonde qui commence dans le salon supplémentaire.
— Monsieur Julian..... dites-moi ce que M. Robert-Fleury vous a dit de moi... Je sais, je sais que je ne sais rien, mais il a pu juger... un peu, comment je commence, et si...
— Si vous saviez ce qu'il m'a dit de vous, mademoiselle, vous rougiriez un peu...
— Allez toujours, monsieur, je vais tâcher d'écouter sans trop...
— Il m'a dit que c'était très intelligemment fait, que...
— Il ne voulait pas croire que je n'avais jamais dessiné.
— Mon Dieu, non. Et en me parlant il était encore un peu incrédule, de sorte que j'ai dû lui dire comment vous m'aviez fait la tête d'Archangelo, que je vous avais fait recommencer... Vous vous souvenez, c'était tout comme ça... comme de quelqu'un qui ne sait rien, enfin.
— Oui, monsieur.
Et nous rions. Ah ! c'est si amusant !
Maintenant que les surprises, les étonnements, les encouragements, les incrédulités, toutes ces choses ravissantes pour moi sont passées, maintenant va commencer le travail.
Madame D... (Doubelt) a dîné chez nous. J'ai été calme, réservée, silencieuse, à peine aimable. Je n'ai plus de pensée que pour le dessin.
Tout en écrivant, je m'arrêtais et songeais à tout le travail qu'il faudra, au temps, à la patience, aux difficultés...
On ne devient pas grand peintre comme on le dit ; outre le talent, le génie, il y a encore cet impitoyable travail mécanique … Et une voix m'a dit : Tu ne sentiras ni le temps, ni les difficultés, et tu arriveras sans t'en douter !
Et tenez, je crois à cette voix ! Elle ne m'a jamais trompée et elle m'a annoncé bien assez de malheurs pour que cette fois elle mente. J'y crois et je sens que j'ai raison d'y croire.
Je serai prix de Rome !
Lundi 15 octobre 77.
Voici nos modèles pour la semaine :
Le matin, une enfant de onze ans aux cheveux cuivrés d'une nuance casserole, très intéressante, pour la tète.
Pour l'après-midi, c'est un nommé Percichini pour l'académie.
Et le soir, — car, ce soir, il y eut l'ouverture des cours du soir, de huit à dix heures, — un autre homme aussi pour l'académie.
M. Julian a été tout ébahi de me voir là. Le soir il a travaillé avec nous et cela m'a bien amusée.
On a un peu plaisanté sur la politique et sur toute ces choses. Les actualités sont facilement piquantes. Mais comme il ne voulait pas dire son opinion, je lui ai joué la Marseillaise.
Voyons, combien étions-nous ce soir ? Moi, la Polonaise, Farhammer, une Française, Amélie (l'Espagnole) et une Américaine, et puis le maître.
Dina assistait. C'est si intéressant. La lumière frappe si bien sur le modèle, les ombres sont si simples !
Mardi 16 octobre 77.
M. Robert-Fleury est venu dans l'après-midi et m'a accordé une attention spéciale.
J'ai, comme d'habitude, passé toute la journée à l'atelier, de neuf heures à midi et demi. Je ne parviens pas encore à arriver à huit heures justes.
A midi, je pars, déjeune, et reviens à une heure vingt jusqu'à cinq heures, et le soir de huit à dix. Celai me fait neuf heures par jour.
Cela ne me fatigue pas du tout ; si on pouvait matériellement plus, je ferais plus. Il y a des gens qui appellent cela travailler. Je vous assure que, pour moi, c'est un jeu, je le dis sans fanfaronnade. C'est si peu, neuf heures, et dire que je ne pourrai pas le faire tous les jours, parce que c'est loin des Champs-Élysées à la rue Vivienne, et puis, parce que souvent, personne ne veut m'accompagner le soir, que cela me fait rentrer à dix heures et demie, et jusqu'à ce que je m'endorme il est minuit et le lendemain je perds une heure. D'ailleurs, en faisant régulièrement le cours de huit à midi et d'une heure à cinq, j'aurai huit heures.
L'hiver, il fera sombre à quatre heures ; eh ! bien, alors, je viendrai le soir absolument.
Nous avons toujours un coupé le matin et le landau pour le reste de la journée.
C'est que, voyez-vous, il s'agit de faire, en une année, le travail de trois. Et comme je vais vite, ces trois années renfermées en une seule représenteront six années au minimum d'une intelligence ordinaire.
Je parle comme les imbéciles qui disent : Ce qu'une autre ferait en deux ans, elle le fera en six mois. C'est tout ce qu'il y a de plus faux.
Il ne s'agit pas de vitesse. A ce compte-là, il n'y aurait qu'à y mettre le temps. Sans doute, avec de la patience, on arrive à un certain résultat. Mais ce que je ferai, moi, au bout d'un ou deux ans, la Danoise ne le fera jamais. Quand je me mets à redresser les erreurs humaines, je m'embrouille et m'agace, parce que je n'ai jamais le temps de finir une phrase commencée.
Bref, si j'avais commencé il y a trois ans, je pourrais me contenter de six heures par jour ; mais à présent, il m'en faut neuf, dix, douze, autant que possible enfin. Certes, même en commençant il y a trois ans, je ferais mieux de travailler autant que possible, mais enfin, ce qui est passé... assez !....
Gordigiani m'a dit avoir travaillé douze heures par jour.
De vingt-quatre heures prenons sept heures pour dormir, deux pour se déshabiller, prier Dieu, se laver les mains à différentes reprises, s'habiller, se coiffer, tout ça enfin ; deux pour manger et respirer un peu, cela fait onze heures.
C'est que c'est vrai, il en reste treize.
Oui, mais les trajets, pour moi, me prennent une heure et quart.
Eh bien, oui, je perds trois heures à peu près.
Quand je travaillerai chez moi, je ne les perdrai plus. Et puis... et puis, s'il y a du monde à voir, la promenade, le théâtre ?
Nous tâcherons d'éviter tout cela, car au degré où je puis en jouir, ce n'est qu'un ennui.
Jeudi 18 octobre 77.
Mon académie a semblé si bien à Julian, qu'il a dit que c'était tout à fait extraordinaire et prodigieux pour une commençante. — Mais voyez donc, si ce n'est pas étonnant, il y a des plans et le torse n'est pas mal, et c'est bien proportionné vraiment, pour une commençante...
Toutes les élèves se levèrent et vinrent voir mon dessin, pendant que je rougissais.
Dieu que je suis contente !
L'académie du soir a été si mauvaise que M. Julian m'a conseillé de la refaire. Voulant trop bien faire, je l'ai gâtée ce soir. Avant-hier, elle n'était pas mal.
Samedi 20 octobre 77.
Breslau a reçu beaucoup de compliments de Robert-Fleury, moi pas. L'académie était assez bonne, mais la tête pas. Je me demande avec terreur quand j'arriverai à bien dessiner.
Il y a juste quinze jours que je travaille, naturellement, excepté les deux dimanches. Quinze jours !
Breslau travaille depuis deux ans à l'atelier, et elle a vingt ans, j'en ai dix-sept ; mais Breslau a beaucoup dessiné avant de venir ici.
Et moi ! Misérable ?
Je ne dessine que depuis quinze jours...
Comme cette Breslau dessine bien !
Lundi 22 octobre 77.
Le modèle était laid et tout l'atelier refusa de le faire. Je proposai d'aller voir les prix de Rome exposés aux Beaux-Arts. La moitié à pied et nous, Breslau, Mme Simonides, Zilhardt et moi, en voiture.
L'exposition est finie d'hier. On se promène à pied sur les quais, on regarde les vieux livres et les vieilles gravures, on cause art. Puis, en un fiacre découvert, on va au Bois. Me voyez-vous ? Je ne voulais rien dire, c'eût été gâter leur plaisir. Elles étaient si gentilles, si convenables, et nous commencions juste à ne plus nous gêner. Enfin, tout n'aurait pas été trop mal, si on n'avait pas rencontré le landau avec ma famille qui se mit à nous suivre.
Je faisais signe au cocher de ne pas devancer, on me voyait et je le savais, mais je ne me souciais pas de leur parler devant mes artistes. J'avais ma calotte sur la tête, j'avais un air échevelé et gêné.
Naturellement, ma famille était furieuse, et surtout vexée.
J'étais terriblement embêtée.
Bref... une chose ennuyeuse.
Mercredi 24 octobre 77.
Pour le soir, nous avons une jeune femme, pas mal faite.
M. Robert-Fleury est venu hier soir et a dit que j'avais tort de manquer la séance, puisque j'étais une des plus travailleuses. Bref, M. Julian m'a transmis cela d'une façon assez flatteuse.
C'est déjà très flatteur que mon absence soit remarquée par un professeur comme Robert-Fleury.
Enfin ! quand je pense que j'aurais pu travailler depuis quatre ans, au moins, au moins ! ... et j’y pense toujours.
Samedi 27 octobre 77.
J'ai eu beaucoup de compliments, comme on dit à l'atelier.
M. Robert-Fleury m'a exprimé un étonnement satisfait, m'a dit que je faisais des progrès surprenants et que bien véritablement j'avais des dispositions extraordinaires.
— Il y en a bien, qui ayant si peu dessiné, n'en font pas autant. Ce dessin est très bien, entendons-nous, très bien pour vous. Je vous conseille de travailler mademoiselle, et si vous travaillez, je vous assure que vous arriverez à quelque chose de pas mal du tout.
Pas mal du tout est le terme consacré.
Je crois qu'il a dit : « Il y en a bien qui ayant déjà dessiné n'en font pas autant, » mais je ne suis pas assez sûre pour écrire une phrase-aussi flatteuse.
J'avais perdu Pincio, et le pauvre animal, ne sachant que devenir, est revenu m'attendre à l'atelier où il a l'habitude de m'accompagner. Pincio est un petit chien romain, chien loup, blanc comme la neige, les oreilles droites, des yeux et un nez noirs comme de l'encre.
Je déteste les petits chiens blancs frisés.
Pincio n'est pas du tout frisé, et il a des poses si étonnantes, si gracieuses, tellement comme une chèvre sur un rocher, que je n'ai encore vu personne qui ne l'admirât pas.
Il est presque aussi intelligent que Rosalie est bornée. Rosalie est à la noce de sa sœur, elle est partie ce matin après m'avoir accompagnée.
— Comment, Rosalie, lui a dit maman, vous avez laissé mademoiselle seule à l'atelier ?
— Oh ! non, madame, mademoiselle est restée avec Pincio.
Je vous assure qu'elle l'a dit sérieusement.
Mais, comme je suis un peu folle, j'ai égaré ou oublié mon gardien.
Dimanche 28 octobre 77.
Schœppi a commencé mon portrait.
Je croyais que de pareilles créatures n'existaient pas. Il ne lui viendrait jamais à la tête qu'une personne qui lui est sympathique porte des faux cheveux et se mette de la poudre.
Un homme qui ne dit pas toujours la vérité toute nue est un imposteur, un menteur, une horreur. Elle le méprise.
Hier, elle et Breslau, songeant à mon inquiétude (je déjeunais), voulaient me rapporter Pincio de suite, mais l’Espagnole et d'autres se sont mises à crier qu'on se faisait mes servantes parce que j'étais riche. Je l'ai beaucoup questionnée sur ce que l'on pensait de moi à l'atelier.
— On vous aimerait beaucoup, si vous aviez moins de talent — « et puis » — on ne fait que vous discuter quand vous n'êtes pas là.
Ce sera donc partout la même chose, je ne pourrai donc jamais passer inaperçue ou comme les autres ! C’est flatteur et triste.
L'Espagnole est une fille de vingt-cinq ans qui s'en donne vingt-deux, qui a une passion pour la peinture et pas de talent. Avec ça excellente, serviable envers tous jusqu'à l'impossible. On dirait qu'elle est payée pour servir tout le monde et soigner l'atelier. Elle tremble quand Robert-Fleury ou Julian font attention à quelque élève... Elle est jalouse même de moi, qui ai à peine commencé et qui ne sais pas autant qu'elle, pour sûr, mais qui malheureusement ai quelques dispositions.
Samedi 3 novembre 77.
M. Robert-Fleury avait déjà corrigé tout le monde quand je suis arrivée. Je lui ai présenté mes dessins et me suis cachée derrière ou sous son tabouret comme d'habitude. Eh bien, j'ai été forcée d'en sortir, tant il m'a dit de choses agréables.
— C'est encore naïf dans les contours, sans doute, mais c'est étonnant de souplesse et de vérité. Ce mouvement là est vraiment très bien. Maintenant, sans doute, vous manquez d'expérience, mais vous avez tout ce qui ne s'apprend pas. Comprenez-vous ? Tout ce qui ne s'apprend pas. Ce que vous n'avez pas s'apprend, et vous l'apprendrez.
— Oui... c'est étonnant et si seulement vous voulez travailler, vous ferez des choses très bien, c'est moi qui vous le garantis.
— Et moi aussi, monsieur.
Il est deux heures, je jouis de mon dimanche. De temps en temps, j'interromps cette chronique historique pour regarder une anatomie et des dessins d'écorché achetés aujourd'hui.
Mercredi 7 novembre 77.
Il fait gris et humide je ne vis que dans le mauvais air de l'atelier. La ville le bois, c'est la mort.
Je ne travaille pas assez.
Je suis jeune, oui, très jeune, je sais, mais pour ce que je voulais, non... Je voulais être célèbre à l'âge que j'ai, pour n'avoir besoin d'aucune lettre de recommandation. Je l'ai sottement et mal voulu, puisque je n'ai fait que le vouloir.
J'arriverai, quand la plus charmante des trois jeunesses sera passée, celle pour laquelle je voulais tout. Pour moi, il y a trois jeunesses ; de seize à vingt, de vingt à vingt-cinq et de vingt-cinq à... à comme on veut. Les autres jeunesses qu'on a inventées ne sont que des consolations et des bêtises.
A trente ans commence l'âge mûr. Après trente ans, on peut être belle, jeune, plus jeune même, mais ce n'est plus le même tabac, comme dit Alexandre Lautrec le fils de celui de Wiesbaden.
Jeudi 8 novembre 77.
Il n'y a qu'une chose qui pouvait m'arracher de l'atelier avant l'heure et pour toute l'après-midi, c'est Versailles. Sitôt les billets reçus, on m'a expédié Chocolat et je suis rentrée pour changer de robe.
Dans l'escalier, je rencontre Julian qui est étonné de me voir partir de si bonne heure, je lui explique et répète que rien autre que Versailles ne pouvait me faire quitter l'atelier. Il me dit que c'était d'autant plus admirable, que je pourrais si facilement aller m'amuser.
— Je ne m'amuse qu'ici, monsieur.
— Et que vous avez raison ! Vous verrez comme cela vous fera plaisir dans deux mois.
— Vous savez que je veux devenir très forte et que je ne dessine pas pour... rire...
— Il faut l'espérer ! Ce serait agir avec un lingot d'or comme avec du cuivre, ce serait un péché. Je vous assure qu'avec les dispositions que vous avez, je le voie par les choses étonnantes que vous faites, eh bien, il ne vous faut pas plus d'un an et demi pour avoir un talent !
— Oh !
— Je le répète, un talent !
— Prenez garde, monsieur, je vais partir enchantée.
— Je dis la vérité, vous le verrez vous-même. A la fin de cet hiver, vous ferez des dessins, tout à fait bien, puis vous dessinerez encore, et je vous donne six mois pour vous familiariser avec les couleurs, pour avoir un talent, enfin !
Miséricorde du ciel ! Tout en roulant vers la maison, je souriais et pleurais de joie et je rêvais qu'on me donnait cinq mille francs par portrait.
Des dames seules à la gare et... jusqu'à ce que nous soyons installées dans notre mauvaise tribune, c'est un enfer. Il pleut.
Il n'a été question que de validations. Mais les validations ont produit des incidents, de sorte que la séance a été intéressante.
Il ne faut pas aller souvent à la Chambre, cela pourrait me détacher de l'atelier ; on s'intéresse et on vit, on va, chaque jour c'est une page nouvelle d'un même livre. Je pourrais me passionner pour la politique à en perdre le sommeil... Mais ma politique est là-bas, rue Vivienne, c'est par là que j'arriverai à aller à la Chambre autrement qu'à présent. Un an et demi ; mais ce n'est rien !
Tant de bonheur me fait peur.
Un an et demi pour des portraits, mais des tableaux ?.. Mettons deux ou trois ans... Nous verrons.
J'étais jolie, mais vers huit heures, très fatiguée, ce qui ne m'empêcha pas d'aller dessiner au moins pour une heure.
Samedi 10 novembre 77.
M. Robert-Fleury était mal disposé, fatigué, il a à peine corrigé la moitié de nos dessins. Personne n'a eu de compliments, moi non plus. J'en suis un peu étonnée, Julian trouvait bien ce que j'ai fait. Oui, mais moi j'en étais en moi-même mécontente. Je suis chagrinée.
Ensuite nous avons fait des croquis, un d'eux un peu en caricature a eu du succès, Julian me l'a fait signer et l'a mis dans son album.
Comme les choses désagréables frappent plus que les bonnes !
Depuis un mois je n'entends que des encouragements, sauf une fois, il y a quinze jours de cela : ce matin on me gronde et je ne me souviens que de ce matin, mais c'est en tout et toujours ainsi. Mille personnes applaudissent, un seul chute ou siffle et on l'entend plus que les mille.
Les académies du soir et de l'après-midi n'ont pas été corrigées. Ah ! mais je suis excusable ! Vous vous souvenez que les modèles me déplaisaient et que nous n’avons commencé que mardi ; le lundi, il y eut des désordres à cause des modèles et puis surtout c'est que, j’étais placée en face de l'homme, tout près et en dessous. La pose la plus difficile. Peu importe; c'est mauvais signe, Bijou, quand on se cherche des excuses.
Mardi 13 novembre 77.
Le jugement de M. Robert-Fleury n'est jamais d'accord avec celui de Julian, de sorte que celui-ci s'abstient souvent de dire ce qu’il pense. Les messieurs d'en bas ont Robert-Fleury, Boulanger et encore un autre, et nous Robert-Fleury seulement : ce n'est pas juste.
Il va y avoir un concours. D'abord un concours de places pour que le hasard ne donne pas quelquefois une place désavantageuse à la plus forte, et le contraire qui n'en saura pas tirer parti. Et puis un concours d’une semaine entière. Il y en aura un tous les deux mois, je crois, et Breslau me conseille beaucoup de concourir pour les places, ce qui me servira dans deux mois, si ce n'est pas pour cette fois.
En attendant le coupé qui arrive à huit heures moins quart ce soir, j'étudie mon écorché.
Mercredi 14 novembre 77.
J'ai été dans le quartier de l'École de Médecine, chercher divers livres et plâtres. Chez Vasser, vous savez bien Vasser qui vend toute espèce de formes humaines, squelettes, etc. Eh bien, j'ai là des protections et on a parlé de moi à M. Mathias Duval, professeur d'anatomie aux Beaux-Arts, et à d'autres, et il va venir. quelqu'un pour me donner des leçons.
Je suis ravie ; les rues étaient pleines d'étudiants qui sortaient des écoles ; ces rues étroites, ces boutiques de luthiers, tout cela enfin. Ah ! sapristi, j'ai compris la magie, si l'on peut s'exprimer ainsi, du quartier Latin.
Je n'ai de la femme que l'enveloppe, et cette enveloppe est diablement féminine ; quant au reste, il est diablement autre chose. Ce n'est pas moi qui le dit puisque je m'imagine que toutes les femmes sont comme moi.
Parlez-moi du quartier Latin, à la bonne heure, c'est là que je me réconcilie avec Paris ; on se croirait loin, presque en Italie... ; dans un autre genre, je m'entends.
Les gens du monde, autrement dit les bourgeois, ne me comprendront jamais. Aussi c'est aux nôtres que je m'adresse.
Jeunes misérables, lisez-moi !
Ainsi ma mère est horrifiée de me voir dans une boutique où on voit des choses... oh ! des choses ! Des « paysans nus », Bourgeoise ! quand je ferai un beau tableau, on ne verra que la poésie, la fleur, le fruit. On ne songe jamais au fumier.
Je ne vois que le but, la fin. Et je marche vers ce but.
J'adore aller chez des libraires et des gens qui me prennent, grâce à mon costume modeste, pour une Breslau quelconque ; on vous regarde d'une certain façon bienveillante, encourageante, tout autrement qu'avant.
Un matin je suis allée avec Rosalie à l'atelier, en fiacre. Pour le payer je lui donne une pièce de vingt francs.
— Oh ! ma pauvre enfant, je n'ai pas à vous rendre.
C’est si amusant !
Jeudi 15 novembre 77.
On a fait le concours des places, une esquisse de tête en une heure.
Ce sera jugé samedi ; je n'ai pas d'inquiétude d'ailleurs, si je suis la dernière, ce ne sera que justice. J'ai trente jours d'étude, les autres ont bien une année chacune pour faire un compte rond, sans parler de ce qu'elles ont étudié en dehors de cet atelier ; elles ont étudié sérieusement, étant artistes par profession.
C'est cette canaille de Breslau qui m'inquiète. Elle est admirablement organisée et je vous assure qu'elle percera, et pas mal du tout. Je ne peux pas me fourrer dans la tête qu'elle dessine chez Julian depuis près de cinq cents jours et moi, depuis trente jours, c'est à dire, que chez Julian seulement elle a étudié plus de quinze fois ce que j'ai étudié, moi. Si je suis vraiment bien douée, dans six mois, je ferai comme elle. Il y a les choses étonnantes, mais il n'y a pas de miracles dans ces choses-là, et moi, j'en voudrais !
Je suis mal à l'aise de n'être pas la plus forte au bout d'un mois.
Vendredi 16 novembre 77.
Je suis allée voir cette pauvre Schœppi dans une pension de l'avenue de la Grande-Armée.
Une mansarde tout à fait artistique et d'une propreté qui lui donne presqu’un air opulent.
Breslau loge là et plusieurs autres artistes en herbe.
Des croquis, des études, un tas de choses intéressantes. Rien que ce contact artistique, rien que cette atmosphère font du bien.....
Je ne me pardonne pas de ne pas en savoir autant que Breslau... C'est que ..... je n'ai rien approfondi dans la vie, je sais un peu de tout et j'ai peur d'en faire autant ici ; mais non, de la façon dont j'y vais, ce sera sérieux. Pour n'avoir pas fait une chose avant, on n'est pas tenu de ne plus la faire du tout. A chaque première fois, je suis incrédule.
Samedi 17 novembre 77.
Ce dont a été mécontent M. Robert-Fleury a été le manque de ressemblance or, comme j'attrape bien les ressemblances et qu'on ne perd pas les qualités qu'on a, je ne m'en inquiète pas. Je me referai.
On a jugé le concours, dix-huit concurrentes. Je suis treizième ; il y en a donc cinq après moi, ce n'est pas trop mal. La Polonaise première ; pas juste, ça ! J'ai reçu des compliments pour mes académies.
J'ai acheté des écorchés, des anatomies, des squelettes et toute la nuit j'ai rêvé qu'on m'apportait des cadavres à disséquer.
Que voulez-vous ? je suis abrutie, mes mains ne savent plus que dessiner et pincer de la harpe.
Pourtant, c'est..... absurde que Breslau dessine mieux que moi.
Mon esquisse était la plus avancée.
— Tout ça, en une heure, s'est écrié M. Robert Fleury, mais elle doit être enragée !
Et puis, je dois vous annoncer que M. Julian et les autres ont dit à l’atelier des messieurs que je n'avais ni la main, ni la manière, ni les dispositions d'une femme et que l'on voudrait bien savoir si dans ma famille j'ai de qui tenir tant de talent et de force, de brutalité même, dans le dessin et de courage au travail.
Tout de même, est-ce absurde que je ne puisse pas encore faire des compositions ?
Je ne sais pas placer mes personnages d'aplomb. J'ai essayé de dessiner une scène de l'atelier. Eh bien, ça ne se tient pas, ça n'a l'air de rien. Il est vrai que je le fais purement de chic, de fantaisie, et que je n'ai jamais fait attention comment marchent mes bonshommes. Non.... c'est affreux !
Dimanche 18 novembre.
Le soir, j'ai fait un croquis de mon lavabo, ou plutôt de Rosalie devant le lavabo. Ça se tient et c'est assez vraisemblable ; la mise en scène me plaît ; quand je saurai mieux dessiner, je referai la chose, peut-être même en peinture. On a jamais fait un lavabo et une femme de chambre sans amour, sans fleur, sans vase cassé, sans plumeau, etc., etc.
Vendredi 23 novembre 77.
Cette canaille de Breslau a fait une composition : le Lundi matin ou le Choix du modèle. Tout l'atelier est là et Julian à côté de moi et Amélie, etc., etc.
C'est correctement fait, la perspective est bien, les ressemblances, tout.
Quand on sait faire une chose comme ça, on sera un grand artiste.
Vous devinez, n'est-ce pas ? je suis jalouse. C'est bon, parce que cela me poussera.
Mais il y a six semaines déjà que je dessine. Breslau sera toujours avant moi, ayant commencé avant. Non, dans deux ou trois mois, je saurai dessiner comme elle, c'est-à-dire très bien. Je suis contente, d'ailleurs, de trouver une rivale digne de moi ; avec les autres, je me serais endormie.
Ah ! c'est affreux de vouloir dessiner comme un maître au bout de six semaines d'études.
Grand-papa est malade et Dina est à son poste de dévouement et de soins. Elle a beaucoup embelli, et si bonne ! Si le ciel ne lui envoie pas un peu de bonheur…. Sapristi ! Je dirai des impertinences au bon Dieu.
Samedi 24 novembre 77.
Ce soir, à l'atelier, il n'y avait qu’Amélie, moi et Julian, la bonne et Rosalie.
M. Julian nous a fait apporter les dessins de concours de ces messieurs, les nôtres, les caricatures de ces messieurs.
On se mit à examiner et à juger notre concours en attendant le vrai jugement qui aura lieu mardi, et sera fait par MM. Robert-Fleury, Lefebvre et Boulanger.
Il y aura lutte entre Breslau et une Française (quatre ans d'atelier, des profils toujours et pas de feu sacré, mais un dessin parfait) et une autre encore. Amélie, la Polonaise et la grosse Jenny ont des peintures. Arrivé à ma tête, Julian a dit à peu près ceci :
— Vous pouvez être mal placée parce que vous luttez contre des jeunes filles qui ont trois ou quatre ans d'atelier, qui sont fortes enfin ; mais votre tête est tout bonnement une des plus ressemblantes. Ce que vous faites est phénoménal. Prenez ce dessin, portez-le chez un des grands maîtres que vous voudrez et demandez-lui combien de temps il faut pour dessiner comme ça d'après nature, et personne, personne, entendez-vous, ne vous dira moins qu'un an. Maintenant, certes, c'est plein de défauts…
Et il me fit une leçon en comparant mon dessin avec celui de la Française.
— Et vos académies sont pleines de défauts, mais il n'y a aucune faute perceptible. Allez donc raconter qu'au bout d'un mois ou six semaines vous faites des bonshommes campés et d'aplomb comme ça, et d'après nature. On vous dira que vous voulez vous moquer des gens.
— Eh bien, monsieur, je ne suis pas contente de moi !
Et je le disais, je vous le jure, avec conviction.
— Pas contente ?
— Non ! J'espère bien faire un peu mieux...
— Si vous continuez, vous ferez des choses extraordinaires ; ce que vous faites est, je l'ai dit, phénoménal.
Il ne s'exprime, jamais comme ça devant beaucoup de monde ; cela ferait une révolution.
Oui, je serai sans doute mal placée ; ces bourreaux ne savent pas depuis combien de temps je dessine et, ne voyant pas le modèle, ne pourront pas apprécier la ressemblance.
J'avais besoin d'un petit encouragement, car ce matin, je vous assure, j'étais bien bas.
Lundi 26 novembre 77.
J'ai enfin pris ma première leçon d'anatomie de quatre heures à quatre heures et demie, juste après le dessin.
C'est M. Cuyer qui m'enseigne ; il m'est envoyé par Mathias Duval, qui promet de me faire visiter l'école des beaux-arts. J'ai commencé par les os, naturellement, et un des tiroirs de mon bureau est plein de vertèbres... naturelles..
C'est hideux, quand on pense que les deux autres contiennent du papier parfumé et des cartes de visite de Naples, etc.
C'est en rentrant de l'atelier que j'ai trouvé M. Cuyer attendant dans le crépuscule du salon, et sur le canapé opposé j'ai trouvé maman et le plus suisse de tous les commandeurs : Marcuard revenu pour dix jours, qui a baisé ma main pleine de charbon et... qui avait touché des vertèbres, puisque je m'étais dérobée du salon pour prendre ma leçon.
Mardi 27 novembre 77.
M. Julian est monté chez nous, un peu démonté, après le jugement de MM. Robert-Fleury, Boulanger et Lefebvre, et nous a tenu à peu près ce discours :
— « Mesdames, ces messieurs n’ont classé que six têtes après la médaille, qui a été gagnée par Mlle Delsarte (la Française) comme vous le savez déjà. Les autres sont classées tout bonnement pour avoir des places au concours prochain et les trois dernières tireront au sort, afin sans doute de ménager l'amour propre de ces dames...
Une voix me dit que je tirerai au sort ; ça aurait été tout naturel, j'en suis restée contrariée.
Après ce petit discours, qui a produit sur tout le monde une impression considérable, il ajouta ces mots :
— Je ne saurai pas reconnaître à qui sont les têtes. Qu'une de ces dames veuille bien inscrire les noms au fur et à mesure. Première, qui ?
— Mlle Wick.
— Deuxième ?
— Mlle Bang.
— Troisième ?
— Mlle Breslau.
— Quatrième ?
— Mlle Nordtlander.
— Cinquième?
— Mlle Forchammer.
— Sixième ?
— C'est Mlle Marie ! s'écria la Polonaise.
— Moi, monsieur ?
— Oui, mademoiselle.
— Mais c'est ridicule !
Je suis dans les six premières, Amélie, Zilhardt, la Polonaise sont après moi. Je suis la dernière arrivée à l'atelier, puisque je n'y suis que depuis le 3 octobre. Sapristi !
Tout le monde est venu me féliciter. Mlle Delsarte est venue me dire des choses aimables et sa sœur Marie nous a nommées les deux héroïnes du concours.
— Ce que vous avez là au bout de si peu de temps est mieux qu'une médaille au bout de quatre ans d'études.
Un succès, et quel charmant succès !
Vendredi 30 novembre 77.
J'ai enfin porté ma mandoline à l'atelier et cet instrument charmant a charmé tout le monde, d'autant plus que pour ceux qui n'en ont jamais entendu, je joue bien. Et le soir, comme j'en jouais au repos et qu'Amélie m'accompagnait sur le piano, le maître entra et se mit à écouter. Si vous pouviez le voir, vous verriez un homme ravi.
— Moi, qui croyais que la mandoline était une espèce de guitare dont on grattait, je ne savais pas qu'elle chantait, je ne pouvais pas me figurer qu'on pouvait en tirer de pareils sons et c'est gracieux ! Ah ! sapristi, je n'en dirai plus de mal. J'ai passé là, le croiriez-vous, un bon moment. Ah ! c'est beau. On rira, si on veut, mais je vous assure que cela... gratte quelque chose dans le cœur. C'est drôle !
Ah ! misérable, tu le sens donc !
Cette même mandoline n'a eu aucun succès, un soir que j’en jouais chez nous devant les gens du monde, les dames et les messieurs, et pourtant c'étaient des gens qui devraient faire des compliments quand même. Beaucoup de lumières, des gilets en cœur et de la poudre de riz, tout cela détruit le charme. Tandis que la rampe de l'atelier, le calme, le soir, l'escalier noir, la fatigue, vous disposent à ce qu’il y a dans le monde de doux, de... drôle, de gentil, de charmant.
C'est un métier terrible que le mien. Huit heures de travail par jour, les trajets, mais surtout un travail consciencieux et intelligent. Pardieu ! rien de plus bête que de dessiner sans penser à ce que l’on fait, sans comparer, sans se souvenir, sans étudier et cela ne fatiguerait pas.
Que les journées soient plus longues et je travaillerai plus ; c'est pour retourner en Italie.
Je veux arriver.
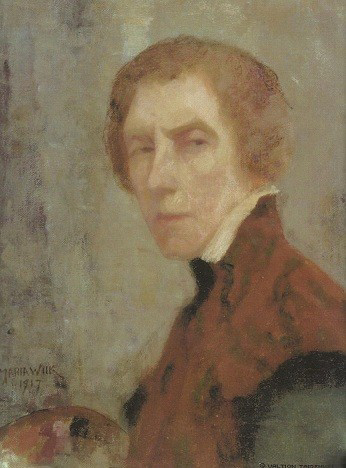
Mercredi 5 décembre 77.
Il a fait noir toute la journée, on ne pouvait pas dessiner et je suis allée au Louvre avec une Finlandaise (Maria Wiik), et comme elle ressemble à une institutrice anglaise, je fais le trajet à pied, enchantée du chic de mon bonnet de loutre et de mon paletot de loutre long jusqu’à terre.
Ça apprend de regarder les belles choses avec quelqu'un qui sait quelque chose.
Samedi 8 décembre 77.
Je suis allée au théâtre ; c'était très drôle, on a ri tout le temps, temps perdu que je regrette.
J'ai mal travaillé cette semaine.
Il y aurait bien des tripotages d'atelier à raconter, mais je prends mon atelier par le côté sérieux et ne m'occupe de rien d'autre, ce serait au-dessous de moi. Je regrette cette soirée, je ne me suis pas montrée et je n'ai pas étudié. J'ai ri, c'est vrai, mais cette satisfaction en dedans ne me sert à rien ; donc, elle m'est désagréable puisqu'elle ne m'a pas fait plaisir.
Dimanche 9 décembre 77.
Le Docteur Charcot sort d'ici ; j'ai assisté à la consultation et à ce que se sont dit ensuite les médecins, puisque je suis la seule calme et qu'on me traite comme un troisième médecin. En tout cas, pas de catastrophe pour le moment.
Pauvre grand-papa j’aurais été désolée s'il était mort tout de suite, parce que nous nous sommes souvent querellés ; mais comme sa maladie se prolonge, j'ai le temps de racheter mes vivacités. Je suis restée dans sa chambre au moment où il allait le plus mal... D'ailleurs, mon apparition auprès des malades est toujours un signe d'urgence, parce que je déteste les empressements inutiles, et ne parais troublée que lorsque je me le permets.
Vous voyez comme à chaque occasion je fais ma louange.
J'ai vu la nouvelle lune de l'œil gauche, cela me contrarie.
Ne pensez pas de grâce que j'aie été brutale avec grand-papa, je l'ai seulement traité en égal ; mais comme il est malade, bien malade, je le regrette et voudrais avoir tout enduré sans rien dire.
Nous ne le quittons pas, il appelle tout de suite celui qui n'est pas là. Georges est auprès de lui, Dina est toujours près du lit, cela va sans dire ; maman est malade d'inquiétude, Walitsky, le cher Walitsky court et soigne et grogne et console.
J'ai dit que j'aurais voulu tout endurer sans rien dire ; j’ai l'air d'une malheureuse qu'on maltraitait ; il n'y avait rien à endurer, mais je suis agacée et agaçante, et comme grand-papa l'était aussi, je m'impatientais et répondais vivement et quelquefois j'avais tort. Je ne veux pas me poser pour un ange qui se cache sous une enveloppe de méchanceté.
Mardi 11 décembre 77.
Grand-papa ne peut plus parler... C'est horrible de voir cet homme qui, il y a si peu de temps, était encore fort, énergique, jeune, de le voir comme ça... presque un cadavre !...
Je continue à dessiner les os. Je suis plus que jamais avec Breslau, Schœppi, etc., la Suisse enfin.
Mercredi 12 décembre 77.
A une heure le prêtre et le diacre sont venus et l'on a administré grand-papa. Maman pleurait et priait tout haut ; après... je suis allée déjeuner. Ce que c'est que la bête qui est forcément dans chaque homme.
Samedi 15 décembre 77.
Naturellement Breslau a eu un succès énorme ; c'est qu'elle dessine bien. Et moi on a trouvé du très bon dans ma tête et du pas mal dans l'académie.
Je suis... je ne sais quoi. Breslau dessine depuis trois ans et moi depuis deux mois..... c'est égal ! c'est indigne. Ah ! si j'avais commencé il y a trois ans, il y a trois ans seulement, ce n'est pas énorme, je serais connue à l'heure qu’il est !
Il se joue à l'atelier une comédie. On avait organisé une quête pour offrir à M. Robert-Fleury et à Julian, la photographie de toutes les élèves de l'atelier. Juste au même moment, l’Espagnole s'oubliant à force de vouloir être une sorte de directrice, fait une impertinence à Breslau ; celle-ci riposte et l'atelier se divise.
Les Suissesses, au nombre de cinq, une pour toutes, toutes pour une ! On ne parle plus à l'Espagnole. Les descendantes de Guillaume Tell refusent de prendre part à la souscription et se fâchent tout à fait ; je les ramasse dans l’antichambre et leur tiens un discours qui leur démontre la stupidité de leur conduite ; en agissant ainsi, elles font un affront au maître et comblent de joie l’Espagnole en lui accordant une importance extrême.
Bref, elles reviennent sur leur décision. Alors, pour mieux faire voir à l’Espagnole que je me refuse absolument à la reconnaître comme supérieure, j'offre de briser la tire-lire, ce matin, à neuf heures. C'était avant l'arrivée de la terrible Espagnole. On appuie la proposition, on l'exécute et je compte cent sept francs et un sou. Puis je vais annoncer le résultat dans le salon des plâtres.
— Est-ce que Mlle A... est là ?... me demande une sorte de fruitière qui fait apprendre à sa fille le dessin.
— Non, madame.
— C’est étrange, j'ai cru que c'était elle qui avait...
— Ce sont toutes les élèves, madame, qui ont donné ; ce sont également toutes les élèves qui ont voulu savoir le résultat et c'est devant elles que l'on a brisé la tire-lire. Bonjour, madame.
L'Espagnole est arrivée et n'a rien dit, mais je puis me vanter d'avoir une haine de plus contre moi.
Je puis aussi me vanter que je m'en fiche tout à fait.
Samedi 22 décembre 77.
Robert-Fleury m'a dit ceci : — Il ne faut jamais être content de soi. — Julian aussi. Or, comme je n'ai jamais été contente de moi, je me suis mise à réfléchir sur ces mots. Et quand Robert-Fleury m'eut dit beaucoup de bonnes choses, je lui répondis qu'il faisait bien de me les dire, parce que j'étais tout à fait mécontente de moi, découragée, désespérée, ce qui lui fit ouvrir de grands yeux.
Et en vérité, j'étais découragée. Du moment où je n'étonne pas, je suis découragée ; c'est malheureux.
Enfin, j'ai fait des progrès inouïs ; j'ai, on me le répète « des dispositions extraordinaires ». Je fais « ressemblant », « d'ensemble », « juste ». — « Que voulez-vous de plus, mademoiselle ? Soyez raisonnable », a-t-il dit pour finir.
Il est resté très longtemps devant mon chevalet.
— Quand on dessine comme ça, dit-il, en montrant la tête puis les épaules, on n'a pas le droit de faire de pareilles épaules.
Les Suissesses et moi, déguisées, nous allons chez Bonnat pour qu'il nous prenne dans son atelier d'hommes. Naturellement, il nous explique que, cent cinquante jeunes gens n'étant pas surveillés, c'est absolument impossible. Ensuite, nous allons chez Munkacsy, je ne sais pas si je l'écris bien, un peintre hongrois, qui a un magnifique hôtel et un grand talent.
Il connaît les Suissesses : elles ont eu une lettre de recommandation pour lui, il y a un an.
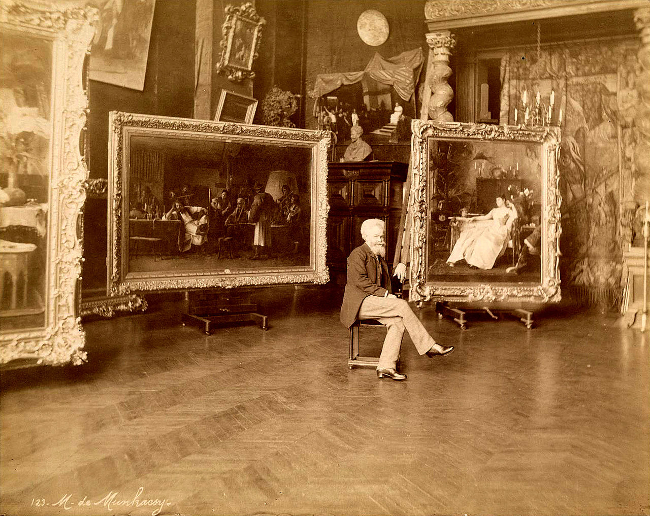
Samedi 29 décembre 77.
M. Robert-Fleury a été très content de moi. Il est resté une demi-heure au moins devant une paire de pieds grandeur nature que j'ai faits, m'a redemandé si j'avais jamais peint, m’a dit que je voulais donc faire sérieusement de la peinture ? Combien de temps je pourrais rester à Paris ? m'a exprimé le désir de voir mes premières choses ; la couleur, m'a demandé comment j’avais fait ? Je répondis que je l'ai fait pour m'amuser. Comme cela se prolongeait, tout le monde est venu se mettre derrière lui pour écouter, et au milieu (j'ose le dire) de la stupéfaction générale, il a déclaré que si j'en avais envie, je pouvais peindre.
A cela, j'ai répondu que je n'en mourais pas d'envie et que je préférais me perfectionner en dessin.
Dimanche 30 et lundi 31 décembre 77.
Je suis triste ; les fêtes chez nous ne se fêtent pas et cela rend triste. J'ai été à l'arbre de Noël chez les Suissesses ; c'était gai et gentil, mais j'avais envie de dormir, ayant travaillé jusqu'à dix heures du soir. Nous avons fait la bonne aventure. Breslau aura des couronnes, moi le prix de Rome, et les autres des fours. C'est tout de même drôle.
1878

Vendredi 4 janvier 78.
Comme c'est drôle que l'ancienne créature soit si bien endormie ! Il n'en reste presque rien, un souvenir de temps en temps qui réveille les amertumes passées, mais aussitôt je pense à…. à quoi ? A l'art ? Ça me fait rire.
C'est ça la machine définitive ? J'ai si longtemps et si terriblement cherché cette fin ou ce moyen d'exister sans me maudire ou sans maudire le reste de la création toute la journée, que j’ai peine à croire que je l'aie trouvée.
Avec ma blouse noire, j'ai quelque chose qui rappelle Marie-Antoinette au Temple.
Je commence à devenir comme je désirais être. Sûre de moi, tranquille au dehors, j'évite les tracasseries et les chicanes ; je fais peu de choses inutiles.
Bref, je me perfectionne peu à peu. Entendons-nous sur le mot perfection : perfection pour moi.
Oh ! le temps ! Il en faut pour tout.
Le temps est plus terrible, plus énervant, plus écrasant que jamais, lorsqu'il n'y a pas d'autres obstacles.
Quoi qu'il m'arrive, je suis plus préparée qu'avant, qu'au temps où je rageais d'être obligée de convenir que je n'étais pas parfaitement heureuse.
Dimanche 6 janvier 78.
Bien ! Je suis de votre avis, le temps passe et il serait cent fois plus amusant de l'employer comme je voulais avant, mais puisque c'est impossible, attendons le résultat de mon talent, il sera toujours temps...
Nous avons changé de logement, nous sommes au 67 de l'avenue de l'Alma. De mes fenêtres, on voit passer les voitures des Champs-Élysées. J'ai un salon-atelier à moi.
On a transporté grand-papa, c'était si triste à voir !.. A peine dans sa chambre, Dina et moi, nous l'avons entouré et l'avons servi et le pauvre grand-papa nous a baisé les mains.
Ma chambre à coucher me rappelle Naples. On a cassé une glace chez grand-papa.
Oui, ma chambre me rappelle Naples. L'époque du voyage approche et je sens comme le parfum de l'ancienne oisiveté qui m'envahit... En vain !…
Lundi 7 janvier 78.
Croire ou ne pas croire à un avenir artistique ?? Deux ans ne sont pas la mort et, dans deux ans, on peut recommencer l'existence oisive, les théâtres, les voyages…. Je veux devenir célèbre !
Je le serai.
Samedi 12 janvier 78.
Walitski est mort cette nuit à deux heures.
Hier soir, comme je venais le voir, il me dit, moitié plaisantant et moitié triste : — « Addio, signorina. » pour me rappeler l’Italie.
Peut-être était-ce la première fois de ma vie que j'ai versé des larmes exemptes d'égoïsme et de colère ?
Il y a quelque chose de particulièrement navrant dans la mort d'un être entièrement inoffensif, entièrement bon ; c'est comme un pauvre chien qui n'avait jamais fait de mal à personne.
Comme, vers une heure, il s'était senti soulagé, les dames rentrèrent dans leurs chambres ; ma tante seule restait là, lorsqu'il manqua d'air au point qu'on dut lui jeter de l'eau au visage.
Un peu revenu, il se leva, car il voulait absolument aller dire adieu à grand-papa ; mais à peine dans le corridor, il n'eut que le temps de se signer trois fois et de crier en russe : Adieu ! mais d'une voix si forte que maman et Dina se réveillèrent et accoururent pour le voir tomber entre les bras de ma tante et de Tryphon.
Je ne me rends pas compte, cela me semble impossible ; c'est si terrible !
Walitski est mort ! C'est une perte irréparable, on ne se fera jamais à l'idée qu'il puisse exister dans la vie réelle un pareil caractère.
Attaché comme un chien à toute notre famille, et platoniquement. Oh ! mon Dieu, oui, plutôt dix fois qu'une.
On voit des gens comme ça dans les livres. Eh bien, qu'il entende ma pensée ; j'espère que Dieu lui fait la grâce de sentir ce qu'on pense et dit de lui. Qu'il m'entende donc, de l'endroit où il se trouve, et si jamais il a eu à se plaindre de moi, il me pardonnera pour ma profonde estime, mon amitié sincère et mes regrets du fond de l'âme !
Lundi 28 janvier 78.
Le concours sera jugé demain ; j'ai si peur d’être mal placée... !
Mardi 29 janvier 78.
J'avais une telle peur du concours, qu'il fallut des efforts surhumains à cette pauvre Rosalie pour me faire lever.
Je m'attendais à recevoir la médaille ou à n'être classée que parmi les toutes dernières.
Ni l'un ni l'autre. Je suis restée à la même place qu'il y a deux mois ; par conséquent, c'est un four.
Je suis allée voir Breslau, qui est toujours malade.
Mardi 12 février 78.
On m'a trompée sur l'heure pour me prendre ma place, et puis une Espagnole et deux autres ont assuré qu'elles ne m'avaient rien dit et que je m'étais trompée moi-même. Ce mensonge, comme tous les mensonges, m'a révoltée d'autant plus que, je dois le dire à la louange de l'espèce humaine, celles que j'avais défendues lors de l'affaire des Suissesses, n'ont seulement pas prononcé un mot pour dire que j'avais raison.
Je le dis pour qu'on le sache ; autrement je n'ai pas besoin de protection, ne criant que lorsque je suis dans mon droit.
Ce matin déjà je ne pouvais pas du tout travailler, je ne voyais rien ; et, l'après-midi, Berthe est venue et je me suis donné congé.
Ce soir, aux Italiens, on chantait la Traviata : Albani, Capoul et Pandolfini. Grands artistes, mais cela ne m'a pas plu ; pourtant au dernier acte j'avais non pas envie de mourir, mais je me disais que j'allais souffrir et mourir au moment où tout pourrait s'arranger.
C'est une prédiction que je m'offre. J'étais habillée comme un bébé, ce qui est très gracieux quand on est mince et bien faite. Les nœuds blancs sur les épaules, le cou et les bras nus me faisaient ressembler à une enfante de Velasquez.
Mourir ?.... Ce serait absurde, et pourtant il me semble que je vais mourir. Je ne peux pas vivre ; je ne suis pas créée régulièrement, j'ai un tas de choses de trop, puis un tas qui manquent, et un caractère qui ne peut pas durer. Si j'étais déesse et si tout l'univers était à mon service, je trouverais le service mal fait. On n'est pas plus fantasque, plus exigeante, plus impatiente ; quelquefois, ou peut-être même toujours, j'ai un certain fonds de raison, de calme, mais je ne m'explique pas bien, je vous dis seulement que ma vie ne peut pas durer. Mes projets, mes espérances, mes petites vanités écroulées !... je me suis trompée en tout !
Mercredi 13 février 78.
Mon dessin ne va pas et il me semble qu'il va m'arriver quelque malheur, comme si j'avais fait quelque chose de mal et en craignais les suites ou quelque injure. Je me fais pitié, mais j'ai comme peur.
Maman se rend tout à fait malheureuse par sa faute ; il y a une chose que je la prie et supplie de ne pas faire, c'est de ne pas ranger mes affaires, de ne pas mettre en ordre mes chambres. Eh bien, quoi que je dise, elle le fait avec une obstination qui est comme une maladie. Et si vous saviez comme c'est exaspérant et comme cela augmente mes impatiences et mes façons brusques de parler, qui n'ont pas besoin d'être augmentées !
Je crois qu'elle m'aime beaucoup, je l'aime beaucoup aussi, mais nous ne pouvons pas rester deux minutes ensemble sans nous exaspérer jusqu’aux larmes. Bref, nous sommes bien tourmentées ensemble, nous serions tristes séparées.
Je veux tout me refuser pour le dessin. Il faut m'en souvenir, c'est là la vie.
Par là, je me ferai une indépendance et alors ce qui devra venir viendra.
Vendredi 15 février 78.
Je n'irai pas à l'Opéra demain.
Je dessine comme d'habitude, ce qui ne m'empêche pas d'être très mécontente de moi. Je l'ai dit à Robert-Fleury il y a quelque temps et, samedi, comme il corrigeait nos académies :
— C'est vous qui avez fait cela ?
— Oui, Monsieur.
— Vous n'avez pas dessiné d'ensemble avant de venir ici ?
— Mais non.
— Je crois que vous vous plaignez ?
— Oui, monsieur.
— D'aller trop lentement ?
— Oh ! oui, Monsieur.
— Eh bien, moi, à votre place, je serais très content.
C'était dit avec une gaieté très bienveillante et valait bien des compliments.
Oui ! mais quand pourrai-je... peindre des portraits ?... Dans un an....je l'espère du moins.
Dimanche 24 février 78.
J'irai... à l'atelier et je prouverai qu'on arrive, quand on le veut bien et qu'on est désespérée, meurtrie et furieuse comme moi.
Ah ! la route est longue ! on s'impatiente, c'est naturel ; oui je m'impatiente, mais... à vingt ans je ne serai pas trop vieille pour commencer à me montrer, et à vingt ans, je verrai déjà si mes espérances sont fondées.
Samedi 2 mars.
Robert-Fleury a été bien content de moi ce matin.
Lundi 4 mars 78.
Depuis samedi mon chien est perdu. J'espérais toujours qu'il reviendrait.
Mon pauvre chien, si j'avais de la place pour quelque sentiment, j'en serais désolée.
Mon pauvre chien perdu !
Si je devais mourir pour tout ce qui me manque, pour tout ce que je n'ai pas !
Maintenant, je crois que je suis un être incompris !
C'est la chose la plus abominable qu'on puisse penser de soi.
Cent mille prétentions dont aucune n'est justifiée. On se cogne partout et l'on se fait des bleus.
Mardi 12 mars 78.
Quand je pense à Pincio, qui est bien perdu maintenant, mon cœur se serre.
Je l'aimais beaucoup et le perdre me fait presque autant de peine que la mort de Walitzki.
Surtout quand je pense que l'animal est entre des mains étrangères, qu'il s'ennuie après moi, et que je ne verrai plus sa petite physionomie et ces yeux et ce nez noirs si extraordinaires... Bon, je me fais pleurer à présent.
Oh ! sapristi, mille noms d'un tout ce que vous voudrez ! je crois bien que j'aimerais mieux voir C... (Paul Granier de Cassagnac qu'elle appelle parfois Popaul !) ou n'importe qui blessé, malade, au diable, que de ne plus voir mon chien qui m'aimait tant. J'en ai du vrai chagrin et je me moque de tout le reste.
Mercredi 13 mars 78.
Julian a admiré en plaisantant mon stoïcisme, et l'Espagnole a remarqué que les gens qui travaillent froidement ne feront que des choses ordinaires. Quant à elle, elle y met tant de passions que voilà bientôt quatre ans qu'elle travaille nuit et jour ; elle ne peut parvenir à mettre ensemble une tête ou une académie, tout en ayant des qualités pour empâter.
Si j'étais homme je ne voudrais pas l'épouser, elle ne produit que des œuvres disloquées.
Mes oncles en personne, qui ne se connaissent pas, en amitié, telle qu'elle se pratique entre des gens comme C... et moi, supposent que je m'intéresse à lui tendrement ; on voit bien qu'ils ne comprennent pas, car, mettre son amour dans C... c'est vouloir se créer un intérieur sur.... le pont d'Avignon.
Samedi 16 mars 78.
Je suis allée voir l'exposition aux Mirlitons. J'aime vraiment mon métier et je suis heureuse de m'en assurer toujours davantage. — Depuis quelque temps, m'a dit Robert-Fleury ce matin, il y a une certaine limite que vous ne pouvez franchir ; ce n'est pas bien. Avec vos dispositions vraiment réelles vous ne devriez pas vous arrêter aux choses faciles ; d'autant plus que le plus difficile, vous l'avez.
Je le sais pardieu bien ! Un portrait à faire à la maison, et puis les tracas domestiques... Mais cela ne me troublera plus, je ne le veux pas. C... ne me donnera rien, tandis que la peinture me donnera quelque chose.
Mais lundi ! comme je franchirai la limite dont parle Robert-Fleury ! Il faut surtout être bien persuadée qu'il faut arriver et que l'on arrivera.
Samedi 23 mars 78.
Je vous avais promis de franchir cette limite dont me parlait Robert-Fleury.
J'ai tenu ma parole. On a été excessivement content le moi. On a répété que cela valait la peine de travailler avec des dispositions aussi sérieuses, que j'avais fait des progrès étonnants et que dans un mois ou deux…
— Vous serez parmi les plus fortes et notez, ajouta Robert-Fleury en regardant la toile de Breslau absente, notez que je parle de celles qui n'y sont pas.
— Attendez-vous, me dit tout bas Julian, attendez-vous à être détestée ici, car je n'ai vu personne faire une trouée comme vous en cinq mois.
— Julian, dit Robert-Fleury devant tout le monde, je viens de faire les plus grands compliments à Mademoiselle, qui est merveilleusement douée.
Julian, malgré son assez gros corps, semblait voltiger. Car Robert-Fleury n'est pas payé et ne corrige que par amitié, de sorte que Julian est heureux, quand les élèves intéressent le maître.
Julian a assisté à la correction de l'académie (ce qu'il ne fait jamais) ; mais je l'ai vu suivre curieusement la mienne depuis lundi.
Bref, avec ma modestie ordinaire, je ne m'appesantis pas davantage sur les choses flatteuses, me bornant à constater une augmentation de cinquante pour cent d'envie chez les unes, et d'envie et d'inquiétude chez les autre.
Les autres commencent à peindre à peu près quand elles veulent ; mais comme je me suis placée sous la direction toute spéciale de Robert-Fleury, qui le veut bien ainsi, je ne fais rien sans qu'il me l'ordonne. Et aujourd'hui il m'ordonne de faire de temps en temps des natures mortes quelconques, fort simples, pour m'habituer à manier les couleurs. C'est déjà la seconde fois qu'il me parle de peindre.
Je lui ferai la semaine prochaine ou l'autre, sur une toile de huit, la tête de mon squelette avec un livre, ou n'importe quoi, bien arrangé.
Lundi 25 mars 78.
Nous sommes au concours. Une femme qui ressemble un peu à Croizette.
J'ai une assez bonne place, et je crois que je suis en train. Je compte d'ailleurs ne pas me fatiguer en veillant tard.
Robert-Fleury est venu ce soir, il est très content de moi décidément; il m'a questionnée sur l'anatomie, et naturellement j'ai répondu sans hésiter.
C'est odieux d'être comme moi ; mais je remercie Dieu d'être sage et de n'être amoureuse de personne. Si je l'étais, je me tuerais de rage.
Samedi 30 mars 78.
Je n'avais pas calculé que, de ma place, il me faudrait toujours tourner la tête pour voir le modèle. Ce manège m'énerve beaucoup, et mon concours est aussi mauvais que possible. Je suis: convaincue d'être la dernière et je l'ai dit bien haut.
Les cours du soir sont finis, il faudra m'organiser un travail à la maison.
Jeudi 4 avril 78.
Je suis allée à l'atelier de bonne heure, j'ai appris le jugement qui est absolument insensé et qui a bouleversé tous les esprits.
Vick a la médaille (ceci est assez naturel). Puis vient Madeleine (celle qui a presque toujours la médaille) et puis moi. Je suis si surprise que je ne suis même pas contente.
C'était si surprenant que Julian est allé demander à Lefebvre (celui qui a été élu premier par le jury du Salon) pourquoi il nous avait ainsi placées. Et Lefebvre et les élèves d'en bas, ont dit qu'on m'avait placée troisième, parce qu'on voyait que j'avais le sentiment juste du dessin. Quant à Breslau, il paraît que son dessin était entaché de chic. Elle était loin du modèle, et il y avait par conséquent un peu de mollesse ; mais comme les professeurs sont prévenus contre les femmes, ils ont pris cela pour du chic.
Heureusement pour moi, Robert-Fleury était absent ; Lefebvre et Boulanger ont jugé seuls, sans cela on aurait dit que j'ai été troisième par protection de Robert-Fleury.
Je ne sais que faire de mes soirées, depuis que le cours du soir est fermé, et cela me fatigue.
Samedi 6 avril 78.
Robert-Fleury m'encourage vraiment trop, il a trouvé que la deuxième place m’était due, et que cela ne l'étonnait pas du tout.
C'était bête de voir la fureur des autres. Je suis allée au Luxembourg et puis au Louvre avec Schæppi. Quand on pense que M... (Paul-Marie-Alfred comte Multedo) en sortant de chez nous, va rentrer probablement chez lui, va rêver de mes bras, à moi ? et va penser que je pense probablement à lui.
Tandis que moi, déshabillée, en désordre, les cheveux bouleversés, les souliers par terre, je me demandais si je l'avais assez ensorcelé, et que ne me bornant pas à me le demander, je l'ai demandé à Dina.
Voyez, pourtant ! ô jeunesse, il y a deux ans, j'aurais pensé que cela était de l'amour. Maintenant, je suis raisonnable, et je comprends que c'est amusant lorsque vous sentez que vous vous faites aimer, ou plutôt lorsque vous croyez voir que l'on devient amoureux le vous. L'amour qu'on inspire est un sentiment à part, que l'on éprouve soi-même, et que j'ai confondu avant.
Mon Dieu, mon Dieu, et j'ai cru aimer A..., avec son nez un peu gros qui rappelle celui de M... Fi ! l'horreur !
C'est que je suis contente de me justifier ! Si contente, non, non, je n'ai jamais aimé... et si vous pouviez vous imaginer comme je me sens heureuse, libre, fière, digne... de celui qui doit venir !
Mardi 9 avril 78.
Aujourd'hui, j'ai heureusement travaillé le matin ; quant à l'après-midi, je suis restée couchée, j'étais souffrante. Cela a duré deux heure après lesquelles je me suis levée presque contente d'avoir souffert ; c'est si bon après, on est si content de se moquer du mal ; que c'est beau la jeunesse ! !
Dans vingt ans, j'en aurais pour toute une journée.
J'ai fini Le Lys dans la Vallée ; c'est un livre très fatigant malgré ses beautés.
La lettre de Nathalie de Manerville, qui termine le livre, est charmante et vraie.
Lire Balzac, au détriment de moi-même ; car enfin ce temps employé à travailler m'aiderait à devenir moi-même un Balzac en peinture !
Vendredi 12 avril 78.
Hier, Julian a rencontré Robert-Fleury au café, et Robert-Fleury a dit que j'étais une élève vraiment intéressante et étonnante, et qu'il espérait beaucoup de moi. C'est à cela qu'il faut me rattacher, surtout dans les moments où toute mon intelligence est envahie par cette terreur inexplicable et affreuse, et où je me sens sombrer dans un gouffre de doute, de tourments de tous genres sans cause réelle !
Très souvent, depuis quelque temps, il y a trois bougies chez moi; c'est signe de mort.
Est-ce moi qui vais m'en aller dans l'autre monde ? Il me semble que oui. Et mon avenir, et ma gloire ? Oh ! bien, ils seront fichus.
S'il y avait un homme quelconque dans le paysage, je croirais que je suis encore amoureuse, tellement je suis inquiète; mais outre qu'il n'y en a pas, je suis dégoûtée...
Pourtant, il y a des jours où je trouve que l'on ne déroge pas en suivant ses caprices ; au contraire, on fait preuve de fierté ou de mépris pour les autres, en ne voulant pas se contrarier. Oh ! mais ils sont si bas et si indignes tous, que je suis incapable de m'en occuper un seul instant. D'abord ils ont tous des cors aux pieds, et je ne le pardonnerais pas à un roi ! Imaginez-vous que je rêve à un homme qui a des cors aux pieds !
Je commence à croire à une passion sérieuse pour mon métier, ce qui me rassure et me console. Je ne veux rien d'autre; et je suis trop dégoûtée de tout pour qu'il puisse y avoir autre chose.
S'il n'y avait pas cette inquiétude, et celte peur, je serais heureuse !
Il fait tout à fait beau, c'est le printemps enfin; on le sent autant que c'est possible à Paris, où, même dans les bois les plus charmants, sous des arbres qui semblent mystérieux et poétiques, on est toujours sûr de trouver un garçon avec son tablier blanc retroussé et un bock à la main.
Je me lève avec le soleil, et suis à l'atelier avant le modèle ; pourvu que je n'aie pIus cette peur, cette maudite superstition.
Je me souviens, dans mon enfance, j’avais un pressentiment et une peur à peu près pareils ; il me semblait que je ne pourrais jamais apprendre que le français, et que les autres langues ne s'apprennent pas. Eh bien ! vous voyez, qu'il n'en est absolument rien. Et pourtant c'était une vraie peur superstitieuse comme à présent.
J'espère que cet exemple me rassurera.
J'ai cru que la Recherche de l'absolu était tout autrement, parce que moi aussi je cherche l'absolu. Mais l'absolu des sentiments est l'absolu en toutes choses C'est ce qui me fait penser et écrire quarante mille tâtonnements à la suite desquels j'arrive bien, mais à côté et jamais juste.
Samedi 13 avril 78.
A vingt-deux ans, je serai célèbre ou morte.
Vous croyez peut-être qu'on ne travaille qu'avec les yeux et les doigts ? Vous qui êtes des bourgeois, vous ne saurez jamais ce qu'il faut d'attention soutenue, de comparaisons continuelles, de calcul, de sentiment, de réflexion pour arriver à quelque chose.
Oui, oui, ce que vous dites... vous ne dites rien d'ailleurs, mais je vous jure sur la tète de Pincio (ça vous paraît bête, à moi, non) que je serai célèbre ; je vous jure, je vous jure sérieusement, je vous jure sur l'Evangile, sur la passion du Christ, sur moi-même, que dans quatre ans je serai célèbre.
Dimanche 14 avril 78.
Pauvre grand-papa, il prend intérêt à tout, il souffre tant de ne pouvoir parler. Je le devine le mieux, il était si heureux ce soir ; je lui ai lu les journaux et nous avons toutes causé dans sa chambre. C'était pour moi une peine, une joie, un attendrissement.
Et maintenant mon dépit, ma rage, mon désespoir, n'ont pas d'expression dans la langue humaine ! ! Si j'avais dessiné depuis l'âge de quinze ans je serais déjà célèbre ! !
Comprenez-vous ?…
Samedi 20 avril 78.
Hier soir, en serrant ce cahier j’ai ouvert le soixante-deuxième, j'ai lu quelques pages et enfin suis tombée sur la lettre d’A...
Cela m'a fait longtemps rêver et sourire, puis, encore rêver. Je me suis couchée tard, mais ce n'est pas du temps perdu, on n'a pas de ces moments perdus quand on veut, on n'en a que quand on est jeune ; il faut en profiter, les apprécier, et en jouir comme de tout ce que Dieu nous donne. Les jeunes ne savent pas l’apprécier, mais moi je suis comme une vieille qui sait tout ce que cela vaut et qui ne veut perdre aucune jouissance.
A cause de Robert-Fleury, je n'ai pas pu me confesser avant la messe, ce qui fait remettre la communion à demain. La confession a été originale, la voici :
— Vous n'êtes pas sans quelques péchés, dit le prêtre, après la prière d'usage, n'êtes-vous pas sujette à la paresse ?
— Jamais.
— A l'orgueil ?
— Toujours.
— Vous ne faites pas maigre ?
— Jamais.
— Vous avez offensé quelqu'un ?
— Je ne crois pas, mais cela se peut, beaucoup de petites choses, mon père, rien de grave.
— Que Dieu vous pardonne alors, ma fille, etc., etc.
Mon esprit est présent, je l'ai prouvé ce soir en causant et en ne blaguant pas ; je suis calme et n'ai absolument peur de rien, au moral comme au physique... Souvent il m'arrive de dire : j'avais une peur atroce d'aller là ou de faire ceci. C'est une exagération de langage qui est commune à presque tout le monde et qui ne veut rien dire. Ce qui me fait plaisir c'est que je prends l'habitude de causer avec tout monde : c'est nécessaire si l'on veut avoir un salon convenable. Avant j'en prenais un et je laissais là les autres, ou à peu près.
Samedi 27 — Dimanche 28 avril 78.
J'ai eu la folle idée de laisser inviter des hommes à la messe de minuit de notre église.
A droite, se tenait l'ambassadeur, le duc de Leuchtemberg et sa femme, Mme Akenfieff, le duc est le fils de la grande-duchesse Marie, morte à Florence, et neveu de l'Empereur. Ce couple était à Rome lorsque j’y étais et on ne recevait pas Mme Akenfieff à l'ambassade. A présent, elle joue parfaitement la grande-duchesse ; d'ailleurs c'est une femme encore belle et très majestueuse quoique très maigre. Eh bien, le mari est toujours aux petits soins pour la femme ; c'est admirable et tout à fait charmant.
L'ambassade a offert un souper de Pâques qui a eu lieu après la messe à 2 heures après minuit, dans la maison du prêtre, qui étant tout près de l'église a été préférée pour ce soir-là. Mais c'est l'ambassadeur qui envoie les invitations et qui reçoit ; nous avons donc eu la chance de nous asseoir à la mème table que le grand duc, sa femme, l'ambassadeur et tout ce qu'il y a de mieux en fait de Russes, à Paris.
J’étais triste et pas fâchée au fond, parce que ça va me rejeter dans mes études avec une ardeur nouvelle.
Pourquoi le prince Orloff, qui est veuf, ne tombe-t-il pas amoureux de moi, et ne m'épouse-t-il pas ? Je serais ambassadrice à Paris, presque Impératrice. M. Anitchkoff, qui était ambassadeur à Téhéran, a bien épousé une petite personne par amour, étant âgé de plus de cinquante-cinq ans.
Je n'ai pas produit tout l'effet voulu ; Laferrière était en retard, et j'ai dû mettre une robe qui m'allait mal ; j’ai dû improviser une chemisette, la robe était décolletée et il fallait changer cela. De la robe dépendait mon humeur, de l'humeur, ma tenue et l'expression de mon visage, — tout.
Lundi 29 avril 78.
De huit heures du matin à six meures du soir, desquelles il faut ôter une heure et demie, pour aller déjeuner, il n'y a rien de bon comme un travail régulier.
Pour parler d'autre chose, je vous dirai que je crois que je ne serai jamais sérieusement amoureuse. Je découvre toujours, toujours quelque chose de comique dans l'homme et alors tout est perdu. Si ce n'est ridicule, c'est maladroit, ou bête, ou ennuyeux ; bref, il y a toujours un côté, le bout de l'oreille.
C'est vrai, tant que je ne trouverai mon maître, je ne me laisserai prendre à aucun charme ; grâce à cette manie de dénicher les défauts des gens, cela m'empêchera de m'éprendre de tous les Adonis de la terre...
Que les gens qui vont au bois sont bêtes et que je ne puis donc pas comprendre leur existence vide et stupide !
Vendredi 3 mai 78.
Il y a des moments où l’on enverrait au diable la fournaise intellectuelle, la gloire et la peinture pour aller vivre en Italie, vivre de soleil, de musique et d'amour.
Samedi 4 mai 78.
J'adore tout ce qui est simple, la peinture, les sentiments, etc., tout. Je n'ai jamais eu de sentiments simples et je n'en aurai jamais car ils sont impossibles là où il y a des doutes et des appréhensions fondées sur les faits antérieurs. Les sentiments simples ne peuvent exister que dans le bonheur ou à la campagne, dans l'ignorance de toute ces choses qui...
Je suis un caractère essentiellement tripoteur, tant par un excès de finesse que par amour-propre, désir d'analyse, recherche du vrai, crainte de faire fausse route, de non-réussite.
Eh bien, quand le cœur ou l'esprit est tourmenté par toutes ces choses, on n'arrive qu'à des résultats fatigués qui peuvent sans doute être violents, mais aussi sujets à des retours étranges, à des exaltations, à des chutes, bref, une inégalité absolue et tourmentante ; somme toute, c'est préférable à une absolue égalité qui, comme on le dit, fatigue. Cette égalité exclu les nuances extrêmement délicates qui doivent donner des jouissances suprêmes aux délicats, aux tripoteurs qui veulent des finesses dans le grand, même dans le sublime et sans lesquelles on n'obtient jamais des effets aussi puissants et aussi colorés…
On dirait,que j'en sais quelque chose. Je sais seulement que j'écris mes fantaisies et ne vole rien à personne.

Dimanche 5 mai 78.
J'ai sept mois d'atelier.
Je suis retournée à l'exposition avec Anna Noggren. Nous avons parcouru très à la légère tout, excepté les tableaux qui nous intéressaient seuls.
J'ai été très surprise du portrait de Don Carlos, mal dessiné, faux de ton et peu ressemblant. Quant au fameux portrait de M. Thiers, je ne l'ai pas vu au salon, je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois, mais suis sûre qu'il a noirci.
C'est Carolus Duran que j'aime le mieux comme vie, Bonnat comme savoir.
Les mains de Bonnat sont des merveilles.
Jeudi 9 mai 78.
J'aurais pu avoir une main ravissante, si les doigts n'étaient indignement abîmés par les instruments à cordes et si je ne me mangeais les ongles. Mais les instruments célestes ne feraient rien si j’avais les ongles convenables.
Mon corps de déesse antique, mes hanches trop espagnoles, mon sein petit et parfait de forme, mes pieds, mes mains et ma tête d'enfant. A quoi bon ? puisqu'on ne m'aime pas.
Mon pauvre Pincio et ce pauvre Walitsky... j'y ai pensé aujourd'hui.
Samedi 11 mai 78.
Moi, Schaeppi et la tante Marie, allons à l’exposition voir les tableaux et admirer Don Carlos, qui est l'homme le plus magnifique et plus royal que j'aie jamais vu. Il dépasse en distinction nos grands-ducs et notre empereur.
Qu'on l'habille comme on veut, qu'on le mette n'importe où, chacun demandera : Qui est cet homme ?
Il n est pas possible de nier la race et lorsque les gens de race sont laids ou n'en ont pas l'air, c'est, croyez-le, qu’il y a quelque tricherie dans les provenances.
On ne peut pas être plus souverain, plus haut et plus racé que Don Carlos. Si cet homme était intelligent comme un autre, il serait trop. Il n'est pas tout à fait bête, mais endormi.
Dimanche 12 mai 78.
J'ai peint ma première nature morte. Un vase en porcelaine bleue avec un bouquet de violettes et un petit livre rouge et usé, à côté sur une toile de 3. Comme cela je ne cesserai pas de dessiner et je m'habituerai aux couleurs en y consacrant deux ou trois heures le dimanche. Chaque dimanche je ferai quelque chose d'autre.
Hier, j'ai dit des sottises à ma mère. Puis je suis rentrée dans mon petit salon où il faisait noir, et tombant à genoux, j'ai juré devant Dieu de ne plus répondre à ma mère et, lorsqu'elle me mettra hors de moi de me taire ou de m'en aller.
Elle est bien malade, un malheur est vite arrivé et je ne me consolerais jamais des torts que j'ai pu avoir envers elle.
Lundi 13 mai 78.
Pour les places de l'après-midi on a tiré au sort qui m'avait désignée première comme je n'étais pas encore là, celle qui venait après moi prit la place.
Là-dessus j'arrive et Breslau me signifie que j'aie à me placer après tout le monde, ayant perdu ma place. Cela ne s'est jamais, jamais fait, on laissait la personne placée et on se plaçait après elle, mais on n'était jamais reléguée à la queue, quoique ce soit la règle. J'ai fait demander à M. Julian. M. Julian a répondu que la règle existait, mais qu'on ne l'avait jamais appliquée et qu’il trouvait qu'il était affreux de me faire un pareil tour. J'étais partie furieuse, mais je revins pour dire que mon absence ferait trop plaisir à un tas d'imbéciles, de jalouses.
L'Espagnole vient me calmer parce que je menaçais de quitter l'atelier ; la bonne arrive avec des consolations et je leur réponds qu'elles n'ont pas à s'inquiéter, que certainement je travaillerai, et que je serais bien bête de perdre mon temps, puisqu'on en serait enchanté. Il manquait vingt-cinq minutes jusqu'à l'heure. — On est parvenu, dis-je, à me faire perdre de une heure à deux ; mais ces vingt-cinq minutes, je les emploierai à me calmer pour bien dessiner et pour faire enrager les misérables qui, par jalousie, ont recours à de telles misères.— Ces vingt-cinq minutes, je les emploie à les mener comme des nègres.
Jeudi 16 mai 78.
Pendant que je m'apprêtais à peindre ma tête de mort, ayant selon mon caractère tambouriné préalablement ce projet, Breslau en a peint une cette semaine. Cela m'apprend à être moins bavarde. Cela m'a fait dire en causant avec les autres que vraiment mes idées doivent valoir quelque chose, puisqu'il se trouve des imbéciles pour ramasser les plus mauvaises et les plus jetées.
Vendredi 17 mai 78.
Je me ferais bien communarde, rien que pour faire sauter toutes les maisons, les intérieurs de famille !...
On devrait l'aimer, son intérieur ; il n'y a rien de plus doux que de s'y reposer, d'y rêver aux autres choses qu'on a faites, aux personnes qu'on a vues... mais se reposer éternellement !...
La journée de huit à six heures se passe tant bien que mal en travaillant, mais le soir ! !
Je vais sculpter le soir... pour ne pas penser que je suis jeune et que le temps passe, que je m 'ennuie, que je me révolte, que c'est affreux !
Comme c'est drôle pourtant, les gens qui n'ont pas de chance, ni en amour, ni en affaires. En amour, c'était ma faute, je me montais la tête pour les uns, j’abandonnais les autres... Mais en affaires !…
J'irai maintenant pleurer et prier Dieu pour qu'il m'arrange cette affaire. C'est très original de converser avec le bon Dieu, mais ça ne le rend pas meilleur pour moi.
Mais les autres ne savent pas demander. J'ai la foi, moi, je supplie…
Je ne mérite sans doute pas.
Je crois que je mourrai bientôt.
Jeudi 23 mai 78.
J'ai commencé à peindre à l'atelier. Deux oranges et un couteau. Depuis ma rupture avec Breslau, je suis polie avec l'Espagnole, qui est la créature la plus obligeante, qui se dérange pour moi, m'arrange ma nature morte, et me donne des conseils.
On ne travaille pas aussi bien au printemps qu'en hiver.
Samedi 25 mai 78.
— Cela ne va pas assez bien pour vous, me dit Robert-Fleury.
Je le sentais moi-même et s'il ne m'avait encouragée pour mes natures mortes, je serais tombée du haut de mes espérances, ce qui serait grave.
Nous sommes allées au Français voir les Fourchambault. On admire beaucoup la pièce, mais je n'en suis pas folle.
J’avais un chapeau... mais cela ne m'intéresse plus.. Ce que je cherche c'est d'avoir l'air distingué.... Je l'avais un peu oublié ces derniers temps.
Décidément je serai une grande artiste... Chaque fois que je sors de mes études, j'y suis réintégrée par des coups de fouet de toutes sortes.
N’ai-je pas rêvé à des salons politiques, puis au monde, puis à un mariage riche, puis encore à la politique?
Tout cela dans les moments où je rêvais, où j'espérais la possibilité des quelques arrangements féminins, humains, naturels. Mais non, rien !
Cela ne me fait même plus rire, cette déveine constante, imperturbable, étonnante.
J’y ai gagné un grand sang-froid, un mépris énorme pour tous, du raisonnement, de la sagesse, un tas de choses enfin qui me composent un caractère froid, dédaigneux, insensible et en même temps remuant, brusque, énergique. Quant au feu sacré, il est caché et les vulgaires spectateurs, les profanes ne le soupçonnent même pas. Pour eux je me « fiche » de tout, je n'ai pas de cœur; je critique, je méprise, je me moque.
Et toutes les tendresses refoulées au plus profond de moi-même, que disent-elles de cet affichage hautain ? Elles ne disent rien... elles murmurent et se cachent davantage, offensées et chagrinées.
Je passe ma vie à dire des choses sauvages qui me plaisent et qui étonnent les autres... Ce serait bien, si cela ne prenait un accent amer, si ce n'était le fruit de cette inimaginable déveine dans toutes les choses.
Ainsi lorsque je fis la fameuse demande au bon Dieu, le prêtre me donna le vin et le pain que je pris, puis le morceau de pain sans vin comme c'est l'usage. Et ce pain me tomba des mains à deux reprises. J'en fus peinée, mais n'en dis rien, espérant, que ce n'était pas un refus...
C'en était un, à ce qu'il paraît.
Tout cela prouve qu'il y a mon art auquel je dois me vouer... Par saccade j'en sortirai encore sans doute, mais pendant des heures seulement, après quoi j'y retournerai châtiée et sage.
Lundi 27 mai 78.
J'arrive avant sept heures à l'atelier et vais déjeuner pour trois sous dans une , crémerie avec les Suédoises. J'ai vu les ouvriers, les gamins en blouse venir prendre leur pauvre chocolat,. le même que j'ai pris, moi.
— Commencer la peinture par des natures mortes, pour vous, Mademoiselle, c'est comme si on ordonnait à un homme robuste de prendre de l'exercice en maniant cela (et Julian se mit à hausser et à abaisser son porte-plume). Ne faites pas encore la figure, d’accord ; mais peignez des pieds, des morceaux, du modèle enfin ; il n'y a rien de mieux que cela.
Il a parfaitement raison, aussi vais-je peindre un pied.
J'ai déjeuné à l'atelier ; on m'a apporté des choses de la maison, car j’ai calculé qu'en allant déjeuner chez nous, je perdais tous les jours une heure ; ce qui fait six heures ou un jour par semaine, = quatre jours par mois = quarante-huit jours par an.
Quant aux soirées... je veux faire de la sculpture ; j'en ai parlé à Julian qui en parlera ou en fera parler à Dubois, de façon à l'intéresser.
Je m'étais donné quatre ans, sept mois sont passés, Je crois que trois ans suffiront; il me reste donc encore deux ans et cinq mois.
J'aurai de vingt à vingt et un ans alors.
Julian dit que dans un an je peindrai très bien, çà se peut ; mais pas assez bien.
— Ce travail n'est pas naturel, dit-il en riant. Vous abandonnez le monde, la promenade, tout enfin ! Il doit y avoir un but, une pensée cachée...
Il n'est par méridional pour rien.
Il s'est présenté aujourd'hui à peu près le même cas que celui de ma rupture avec la Suisse, seulement c'est moi qui étais Breslau et une vieille dame, moi.
— Madame, lui dis-je tout haut, je suis dans mon droit et je pourrais garder celte place, s'il était dans mes habitudes de chercher chicane aux honnêtes gens. Prenez cette place, madame, d'après les règles de la courtoisie elle est à vous. Je suis, Dieu merci, bien élevée et n'ai rien de commun avec certains (pardon pour l'expression) animaux, qui ne savent pas se conduire.
Et comme elle ne voulait pas accepter, la pauvre vieille dame, j'ajoutai :
— Prenez donc, Madame, je la donne autant pour vous, que pour me glorifier; je commets cette belle action parce que je me respecte.
Voilà ma vengeance, quoique à moitié blague.
Jeudi 30 mai 78.
Habituellement, les parents et l'entourage ne croient pas au génie des grands hommes... Chez nous, on croit trop en ma valeur, c'est à-dire qu'on ne serait pas étonné, si je peignais un tableau grand comme le radeau de la Méduse, et si l'on me donnait la Légion d'honneur. Est-ce mauvais signe ? Non, j'espère.
Vendredi 31 mai 78.
Les miens vont voir une féerie au Châtelet, je vais avec eux. Quand on a vu une féerie, on les a vues toutes. Je me suis ennuyée et tout en regardant machinalement les réclames sur la toile, je pensais que ma vie est étiolée, fanée et... fichue. C'est dommage de sentir un tel vide, une telle désolation autour de soi. Au fait... j'y suis maintenant. Je me croyais née pour être heureuse en tout, à présent je vois que je suis malheureuse en tout. C'est exactement la même chose, excepté que c'est tout le contraire. Du moment que je sais à quoi m'en tenir, c'est fort supportable, et cela ne me cause plus de chagrin, puisque je le sais d'avance. Je vous assure que je dis ce que je pense. Ce qui était atroce, c'est la désillusion constante ; trouver des serpents là où l'on s'attendait à voir des fleurs, voila ce qui est horrible... Mais ces chocs m'ont formée à l'indifférence. Tout passe autour de moi, je ne mets seulement pas la tête à la portière quand je vais à l'atelier.
Je ferme les yeux ou lis un journal.
Vous croyez peut-être que cette résignation est désespérée... Elle est causée par le désespoir, mais elle est calme et douce, quoique triste.
Au lieu du rose, c'est du gris, voilà tout. On en prend son parti et l'on est tranquille.
Je ne me reconnais plus... Ce n’est pas le sentiment d'une heure, mais je suis devenue comme ça. Cela me semble drôle ; mais ça n'en est pas moins vrai. Je n'ai pas même besoin de fortune, deux blouses noires par an, du linge que je laverais le dimanche pour la semaine ; une nourriture très simple, pourvu qu'il n'y ait pas d'oignons et que cela soit frais et... le moyen de travailler.
Pas de voitures, l'omnibus ou les pieds ; je porte des souliers sans talon à l'atelier.
Pourquoi vivre alors ? Pourquoi ? Eh ! Parbleu ! dans l'espérance de jours meilleurs, et cette espérance-là ne nous quitte jamais.
Tout est relatif. — Ainsi, par rapport à mes tourments passés, le présent c'est le bien-être ; j'en jouis comme d'un événement agréable. Au mois de janvier j'aurai dix-neuf ans. Moussia aura dix-neuf ans ! c'est absurde, impossible. C'est effrayant.
Par moment, il me prend des envies de faire toilette, de me promener, de me montrer à l'Opéra, au bois, au salon, à l'exposition. Mais je me dis aussitôt : A quoi bon ? Et tout retombe dans le néant.
Entre chaque mot que j'écris je pense un million de choses, je n'exprime que par lambeau mes pensées.
Quel malheur pour la postérité !
Ce n'est pas un malheur pour la postérité, mais cela m’empêche de me faire comprendre.
Je suis jalouse de Breslau, elle ne dessine pas du tout comme une femme. La semaine prochaine, je travaillerai tant, que vous verrez !... Les après-midi seront consacrées à l'exposition et au Salon. Mais l'autre semaine... Je veux bien dessiner, et ce sera.
Lundi 3 juin 78.
Une nuit sans sommeil, le travail depuis huit heures et des courses de deux à sept heures du soir, tantôt au Salon, tantôt à la recherche d'hôtels...
Et cette diable de santé ne sert à rien ! Cette énergie s’use à n'être utile à rien !
Je travaille... Oh ! la belle affaire, sept à huit misérables heures par jour qui ne me font pas plus d'effet que sept à huit minutes.
Nous avons visité un bel atelier, je frémissais d'aise en le parcourant ; c'est que la vue seule d'un grand atelier bien éclairé, vous fait croire qu'on va faire de belles choses.
Demain je vous dirai sérieusement ma vraie opinion, mon opinion intime qui n'est créée ni par les choses, ni par les hommes ; je le dirai même ce soir !
Dans mon cœur, mon âme, mon esprit, je suis républicaine.
Maintien des titres, égalité devant la loi ; toute autre égalité est impossible. Respect aux anciennes familles, honneur aux princes étrangers. Protection aux arts, luxe et élégance. ?
Ces dynasties, ces ministres qui prennent racine et qui pourrissent sur place infestent le pays ; ces protections de cour... voilà le malheur, voilà la ruine ; tandis qu'un chef constamment renouvelé, changé, les ministères souvent balayés, les fonctionnaires aérés, à la bonne heure, voilà qui rend un pays blanc et rose, et bien portant ; par conséquent capable de tout, s'il a l'intelligence, et cette chose-là ne manquera pas aux Français.
On reproche le sang, la boue et mille autres choses à la République. Que diable I regardez le commencement de tout, surtout quand la moitié gâte, empêche la lutte... Plusieurs essais ont échoué, il y avait des souvenirs napoléoniens, il y avait Sainte-Hélène.
Qu'y a-t-il à présent ?... Le stérile M. de Chambord, après lui les d'Orléans... les d'Orléans ne m'amusent pas, on n'aime pas les choses avilies, bâtardes. Quant à Napoléon III, il a à tout jamais perdu sa race. La République de maintenant est la vraie, la longtemps attendue, la définitive bénédiction du ciel, enfin venue.
Qu'importent quelques libres penseurs qui existent sous tous les régimes, qu'importent les exagérations Le pays n'est pas un salon.
Que les gens des partis choisissent leurs invités mais la République n'est pas un parti, c'est le pays tout entier, et, plus on viendra à elle, plus elle ouvrira ses bras, et quand tout le monde sera venu, il n'y aura ni proscrit, ni délaissé, ni choisi, il n'y aura plus de partis. Il y aura la France.
Pour le moment la République a trop à faire pour s'occuper des particuliers.
On fait un crime aux républicains d'avoir des misérables dans leurs rangs, et quelle est la nation qui n'en a pas ?
Si la France entière devenait légitimiste ou impériale, seraient-ils donc tous purs, tous sans tâche ? Bonsoir, je radote presque, parce que je me dépêche en diable.
Mercredi 12 juin 78.
Demain, je reprends mon travail, si négligé depuis samedi ; j'ai des remords et demain tout rentrera dans l'ordre accoutumé. J'aurai assez du soir pour mes affaires.
M. Rouher m'a étonnée en plusieurs choses. D'abord par sa verdeur ; lui que je croyais grave, lent, décrépit, il sautait de la voiture, offrant le bras, payait le fiacre, montait le perron en courant ; — et puis, par ses idées. — La demi-instruction, dit-il, produit la négation absolue de toute autorité. Il proclame les bienfaits de l'ignorance (tout en disant que c'est bien difficile à décider) et prétend que les journaux sont du poison jeté sur la voie publique.
Vous pensez bien si je l'ai examiné et écouté avec curiosité, le vice-empereur !
Mais je n'ai pas besoin ici de vous donner mes appréciations, d'abord parce que je ne l'ai pas assez vu, et ensuite parce que je n'y suis pas disposée ce soir. Il nous a raconté plusieurs choses curieuses et qu'il est à même de savoir parfaitement, sur l'attentat de 1867 contre notre empereur, et puis des choses de la famille impériale, m'a demandé si nous connaissions le prince impérial. Vous pensez bien que j’ai été orthodoxe avec le maître des Bonaparteux.
Je suis même étonnée de mes flatteries délicates et de mon tact. Gavini et le baron semblaient m'approuver tout à fait, et M. Rouher lui-même était content, mais... quel feu d'artifice mouillé ! ! !
On a parlé de votes, de lois, de brochures, de fidèle, de traîtres, devant moi ; j'écoutais ? Oh ! je croîs bien. C'était comme une porte ouverte sur le paradis. J'ai dit pourtant que les femmes ne devaient se mêler de rien, ne pouvant faire que du mai, et n'étant pas assez sérieuses pour n'être pas excessives (?).
Je regrette d'être femme, et M. Rouher d'être homme. — Les femmes, dit-il, n'ont pas les ennuis et les tracas que nous avons.
— Voulez-vous me permettre de vous dire, Monsieur que les unes et les autres en ont également. Seulement les ennuis des hommes leur rapportent des honneurs, de la gloire, de la popularité, tandis que ceux des femmes ne leur rapportent rien.
— Vous, croyez donc, mademoiselle, que cela rapporte toujours toutes ces choses ?
— Je crois, monsieur, que cela dépend des hommes.
Il ne faut pas penser que je l'ai abordé comme ça tout d 'un coup ; je suis restée pendant dix minutes au coin, assez perplexe, car le vieux renard n'avait pas l'air d'être ravi de la présentation.
Voulez-vous savoir une chose ?
Je suis ravie.
Maintenant, j’ai envie de vous raconter toutes les jolies choses que j'ai dites... Il ne faut pas. Je vous dirai que j’ai fait tous mes efforts pour ne pas dire des choses banales et pour paraître pleine de bon sens, comme ça vous vous imaginerez mieux ce que c'était.
Gavini disait que les bonapartistes étaient heureux d'avoir les sympathies des jolies femmes en s'inclinant devant moi.
— Monsieur, lui répondis-je, en m'adressant à M. Rouher, je ne donne pas mes sympathies à votre parti comme femme, je vous les donne comme honnête homme.
Samedi 15 juin 78.
Pensez donc ! Robert-Fleury n'a rien voulu me dire, tellement mon dessin était mauvais. Alors je lui ai montré celui de la semaine passée et j'ai eu des compliments, ce n'est pas malheureux. Il y a des jours où tout fatigue.
Mercredi 3 juillet 78.
M... est venu faire ses adieux, comme il pleut, il propose de nous accompagner à l’exposition.
J’ai accepté, mais avant cela, comme nous restons seuls, il me supplie d'être moins dure, etc., etc.
— Vous savez que je vous aime follement, que je souffre... Si vous saviez combien c'est terrible de ne voir que des sourires moqueurs, que de n'entendre que des railleries, quand on aime véritablement.
— Vous vous montez la tète.
— Oh ! non, je vous le jure, je suis prêt à vous donner toutes les preuves... le dévouement le plus absolu, une fidélité, une patience de chien, enfin ! Dites un mot, dites que vous avez un peu confiance en moi.. Pourquoi me traiter comme un bouffon, comme un être de race inférieure ?
— Je vous traite comme tout le monde.
— Pourquoi ? puisque vous savez que je ne vous aime pas comme tout le monde, que je vous suis tout dévoué.
— J'ai l'habitude d'inspirer ce sentiment.
— Mais pas comme à moi... Laissez-moi croire que vous n’avez pas à mon égard des sentiments affreux…
— Oh ! affreux, je vous assure que non.
— Ce qui est affreux pour moi, c'est l'indifférence.
— Ah ! dame...
— Promettez-moi de ne pas m'oublier pendant les quelques mois que je serai absent.
— Ce n'est pas en mon pouvoir.
— Permettez-moi de vous rappeler de temps en temps que j'existe... Peut-être vous amuserai-je, peut être vous ferai-je sourire ?... Permettez-moi de... d’espérer que quelquefois, rarement, vous m'enverrez un mot, un seul.
— Vous dites ?
— Oh ! sans signer, simplement ceci : « je me porte bien. » Et ce sera tout, et cela me rendra si heureux.
— Je signe tout ce que j'écris, et je fais honneur à ma signature.
— Vous m'accordez cette permission ?
— Je suis comme le Figaro, je reçois toutes les correspondances...
— Dieu ! Si vous saviez ce que c'est terrible de ne jamais obtenir un mot sérieux, d'être toujours bafoué. Non, dites, parlons sérieusement, il ne sera pas dit que vous n'aurez pas eu pitié de moi au moment où je vous quitte ! Puis-je espérer que mon dévouement sans bornes, mon attachement, mon amour..... Imposez-moi les conditions, les épreuves que vous voudrez, puis-je espérer qu'un jour vous serez plus... douce et que vous ne rirez pas toujours ?...
— En fait de preuves, dis-je assez sérieuse. il n'y en a qu'une.
— Laquelle ? Je suis prêt à tout !
— Le temps.
— Soit, le temps. Vous verrez .....
— Cela me fera bien plaisir.
— Mais dites-moi, vous avez confiance en moi ?
— Comment ? J'ai confiance eh vous au point de vous confier une lettre, avec la certitude que vous ne l’ouvrirez pas.
— Quelle horreur ! Non, mais une confiance absolue...
Quels grands mots !
— Et si le sentiment est grand ? dit-il doucement.
— Je ne demande qu'a le croire, ces choses-là flattent notre vanité. Et tenez, je veux bien avoir un peu le confiance en vous.
— Bien vrai ?
— Bien vrai.
Cela vous suffit, n'est-ce pas ? Nous allons à l'Exposition. Je suis impatientée parce que M... est heureux et me fait la cour comme si je l'avais accepté.
*
* *
Je ressens une vraie satisfaction ce soir ; l’amour de M... me fait absolument la même impression que celui d’A... Vous voyez bien que je n'ai pas aimé Pietro ! Je n'en ai même pas été amoureuse ! J'ai été tout près d'aimer..: mais vous savez quel horrible désenchantement cela a été.
Vous comprenez bien que je n'ai pas l’intention d'épouser M...
— L'amour vrai est toujours respectable, lui ai-je dit, vous n'avez pas à en être honteux, seulement, ne tous montez pas trop la tète.
— Votre amitié !
— Vain mot.
— Alors votre...
— Vous êtes exorbitant !
— Mais que dire puisque vous ne voulez pas que j'y arrive peu à peu, que je commence par l’amitié...
— Chimère !
— Amour, alors ?
— Vous êtes insensé.
— Pourquoi ?
— Parce que je vous exècre.
Vendredi 5 juillet 78.
Au Concert des bohémiens russes. — Je ne veux pas partir et laisser une mauvaise impression. Nous sommes six, ma tante, Dina, Etienne, Philippini, M... et moi. Le concert fini, nous allons prendre des glaces, et appelons deux des plus jolies bohémiennes, et deux enfants bohémiens auxquels on donne des glaces et. du vin. C'était très amusant de causer avec ces filles toutes jeunes et vertueuses ; on les surveille de près.
Après, ma tante donne le bras à Etienne, Dina à Philippini, et moi, à l'autre. Nous allons à pied, jusqu'à chez nous, il fait si beau ; M... calmé, me parle de son amour... C'est toujours la même chose, je ne l'aime pas, mais son feu me donne chaud ; c'est ce que je prenais pour de l'amour il y a deux ans !…
Il en parle bien... Il a même pleuré. En m'approchant de la maison, je riais moins, j'étais amollie par cette belle nuit, et par ce chant d'amour. Ah ! que c'est bon d'être aimée !... Il n'y a rien au monde de bon comme cela... Maintenant, je sais que M... m'aime. On ne joue pas la comédie comme cela… Et s'il en voulait à mon argent, mes dédains l'auraient déjà rebuté et puis, il y a Dina qu'on croit aussi riche, et bien d'autres filles à marier... M... n'est pas un gueux, et c’est un parfait gentilhomme. Il aurait trouvé, et il trouvera autre chose que moi.
M... est bien gentil, j’ai peut-être eu tort d'oublier ma main dans la sienne au moment de nous séparer. Il m'a baisé la main. Je lui devais bien cela. Et puis, il m’aime et me respecte tant, pauvre homme ! Je l'ai questionné comme un enfant, je voulais savoir comment cela lui était arrivé ; depuis quand ? Il paraît qu’il m’a de suite aimée. — Mais c'est un amour étrange, dit-il ; les autres sont des femmes, vous êtes au-dessus de l'humanité, c'est un sentiment bizarre ; je sais que vous me traitez comme un bouffon bossu, que vous avez pas de bonté, pas de cœur, et pourtant je vous aime ; on admire toujours un peu le cœur de la femme qu'on aime. Et moi... je n'ai pour ainsi dire pas de sympathie pour vous, tout en vous adorant.
J'écoutais toujours, car je vous le dis, en vérité, les paroles d'amour valent tous les spectacles de la terre, excepté ceux auxquels on va pour se montrer. Mais alors, c'est encore une espèce de chant, de manifestation amoureuse ; on vous regarde, on vous admire, et vous vous épanouissez comme une fleur au soleil.
Soden. — Dimanche 7 juillet 78.
A sept heures nous partons. Grand-papa voulait que je reste ; mais je lui dis adieu ; alors, il m'embrassa, et tout à coup il se mit à pleurer, le nez froncé, la bouche ouverte, les yeux fermés, comme un enfant ! Avant sa maladie, ce n'était rien, mais maintenant je l'adore. Si vous saviez comme il s'intéresse aux moindres choses, comme il nous aime tous, depuis qu'il est dans cet affreux état. Encore un instant, et je serais restée... Quelle folie d'être si sensible toujours ! Imaginez-vous un être transporté de Paris à Soden. Silence de mort ne rend que faiblement le calme qui règne à Soden. J’en suis étourdie comme on le serait d'un grand tapage.
Ici il y aura du temps pour méditer et pour écrire.
Quel calme énervant ! En allez-vous lire assez de dissertations !
Le docteur Tilénius sort d'ici, il a fait les questions nécessaires sur ma maladie et n'a pas dit comme le Français :
— « Bon, ce ne sera rien, dans huit jours nous vous guérirons, Mademoiselle. »
Demain, je commence la cure.
Les arbres sont beaux ici, l'air est pur. La campagne va à ma figure. A Paris je ne suis que jolie, si je le suis ; ici, je parais suave, poétique ; mes yeux son plus grands et mes joues plus maigres.
Soden. — Mardi 9 juillet 78.
Ils m'ennuient tous, les docteurs ! j'ai fait examiner mon gosier : pharyngite, laryngite et catarrhe. Rien que cela !…
Je m'amuse à lire Tite-Live et à prendre des notes le soir. Je compte le faire tous les soirs, j'ai besoin de lire de l’histoire romaine.
Mardi 16 juillet 78.
Je veux parvenir par la peinture ou par quoi que ce soit... Ne pensez pourtant pas que je ne m'occupe d'art que par vanité. Il y a peut-être peu de créatures aussi artistes que moi dans tout. Vous vous en êtes d'ailleurs aperçu, vous qui êtes la partie intelligente de mes lecteurs ; les autres je m'en moque. Les autres ne me verront qu'extravagante, parce que je suis bizarre dans tout, sans le vouloir.
Mercredi 24 juillet.
Le docteur Tomachewsky qui est le médecin de l'Opéra de Pétersbourg, doit savoir quelque chose ; en outre, ses avis sont d'accord avec le docteur Fauvel et d'autres et puis, moi-même je sais que les eaux de Soden par leur composition chimique, n'ont presque pas de rapport avec ma maladie. Si vous n'êtes pas des ignorants, vous devez savoir qu'on envoie à Soden les convalescents et les poitrinaires.
Hier, à six heures du matin, ma tante et moi accompagnées du docteur Tomachewsky, nous allons à Ems pour consulter les médecins de là-bas.
Nous sommes de retour.
L'Impératrice Eugénie est à Ems. Pauvre femme !
Jeudi 1er août 78.
Je me suis déguisée en vieille allemande aux allures bizarres, aux petites manies, et comme l'apparition de chaque nouvelle figure passionne les habitants du Kurhaus, j'ai fait sensation. Seulement je commets l'imprudence de ne rien demander au garçon; des soupçons s'éveillent, on me suit, on me poursuit, et c'est fini.
Je vous assure que c'est triste de faire crever de rire vingt-cinq personnes et de ne pas s'amuser soi-même.
Vendredi 2 août 78.
Je pense à Nice, ces derniers jours... J'avais quinze ans et comme j'étais jolie ! Ma taille, mes pieds, mes mains n'étaient peut-être pas formés, mais ma figure était ravissante... Depuis, elle ne l'a jamais été... A mon retour de Rome, le comte, Laurenti m'a fait presque une scène...
— Votre figure a changé, me disait-il, les traits, la couleur sont comme avant ; mais ce n'est plus la même chose... Vous ne serez plus jamais comme sur ce portrait.
Il parlait du portrait où j'ai les coudes sur la table et la joue appuyée sur les mains. — Vous avez l'air d'être arrivée là, de vous être appuyée, vos yeux fixés sur l'avenir, et, moitié effrayée, de vous dire : c'est çà la vie ?
A quinze ans, j'avais de l'enfant dans la figure, ce que je n'ai eu, ni avant quinze ans, ni après. Et cette expression est tout ce qu'il y a de plus ravissant au monde.
*
* *
J'ai découvert des promenades dans Soden... Je ne parle pas des promenades vulgaires où chaque étranger se croit obligé de grimper, mais des allées et des bois où il n'y a personne.
J'adore ce calme. Ou bien Paris, ou bien le désert. Je ne parle pas de Rome, cela me ferait pleurer tout de suite..
Le vieux Tite-Live raconte si bien et lorsque, dans certain passage, on sent qu'il travestit une défaite, ou excuse une humiliation... c'est presque touchant... Tenez, jusqu’à présent je n'ai jamais aimé que Rome.
Imaginez-vous mon plaisir quand j'entends ces dames causer de leurs nerfs, de leurs connaissances, de leurs docteurs, de leurs robes, de leurs enfants ! Mais je m’isole, je vais dans les bois, je ferme les yeux et je suis où je veux.
Mardi 6 août 78.
Mon chapeau m'amuse et amuse Soden... J 'ai acheté à la dispensatrice des verres d'eau de la Source, un bas de laine bleue qu'elle venait de commencer ; en même temps, elle me montre comment cela se fait. Je saisis de suite la théorie et le bas, et m'installe avec Mme Dutine en face des fenêtres de l'hôtel, à tricoter le bas, pendant que ma tante et les autres s'en vont je ne sais où.
Je change d’allure, je deviens calme, très tranquille, douce ; je deviens Allemande, je tricote des bas, un bas lui durera toujours, car je ne sais comment faire le talon ; je ne le ferai jamais et le bas sera long, long, long.
*
* *
Il ne sera même pas long.
Il pleut très fort. J'ai infiniment d'esprit ! douce Allemagne !
Mes promenades sont utiles, je lis et je ne perds pas mon temps. Sages, glorifiez-moi !
Mercredi 7 août 78.
Mon Dieu, faites que j'aille à Rome. Si vous saviez, mon Dieu, comme j'en ai envie ! Mon Dieu, soyez trop bon pour votre créature indigne ! Mon Dieu! faites que j'aille à Rome... c'est impossible, sans doute... car ce serait être heureuse !...
Ce n'est pas Tite-Live qui me monte la tête, car mon vieil ami est négligé depuis plusieurs jours.
Non, mais rien que le souvenir de la campagne, de la place du peuple, du Pincio et de la coupole au soleil couchant...
Et ce divin, cet adorable crépuscule du matin, quand le soleil se lève et quand on distingue peu à peu... Quel vide partout ailleurs !... Et quelle sainte émotion au souvenir de la ville miraculeuse, fascinatrice !... Je crois que je ne suis pas la seule et qu'elle inspire à chacun les sentiments inexplicables, qui tiennent à quelque mystérieuse influence... à quelque combinaison de... du passé fabuleux avec le présent sanctifié, ou bien... Je ne sais pas dire… Si j'aimais un homme, je voudrais le conduire à Rome pour le lui dire en face du soleil couchant derrière la divine coupole:..
Si j'étais frappée de quelque immense malheur j'irais pleurer et prier les yeux fixés sur cette coupole Si, je devenais la plus heureuse des femmes-et des hommes, c'est aussi là que j'irais...
Quel aplatissement bourgeois en pensant qu'on habite Paris... qui est cependant la seule ville au monde possible après Rome !
Paris. — Samedi 17 août 78.
Encore ce matin nous étions à Soden.
J'ai promis cinq cents saluts par terre si je trouvais grand-papa vivant. J'ai exécuté ma promesse. Il n'est pas mort, mais il n'en vaut guère mieux. Tout de même... voici ma cure d'Ems fichue.
Je déteste Paris ! On peut y être heureux et content et satisfait mieux qu'ailleurs ; à Paris, la vie peut être complète, intelligente, glorieuse, je suis loin de le nier. Mais pour l'existence que je mène, on a besoin d'aimer la ville elle-même. Les villes comme les personnes me sont sympathiques ou antipathiques, et je ne puis faire que Paris me plaise.
Lundi 19 août 78.
Mlle E..., celle qui était gouvernante chez Mme Anitskoff, est maintenant chez nous ce sera une sorte de gouvernante.
Je lui montrerai un grand respect dans les magasins, pour en imposer, car elle n'est pas imposante, petite, rousse, jeune, triste. Une figure ronde qui a l'air de la lune, quand la lune est triste. Cette impression de physionomie fait rire.
Des yeux d'une rêverie comique ; mais avec un chapeau à mon idée, cela ira, et j'irai à l'atelier avec elle.
Je me console d'Ems en voyant combien grand-papa est heureux de me revoir, tout mourant qu'il est.
*
* *
J'ai une terrible maladie. Je suis dégoûtée de moi. Ce est pas la première fois que je me déteste, mais cela n’en est pas moins terrible.
Détester une autre qu'on peut éviter, mais se détester soi-même; voilà un supplice.
Samedi 24 août 78.
J'ai mis une heure à faire une esquisse de grand-papa couché. C'est sur une toile de 3. On dit que c'est très réussi. Seulement vous savez, ces oreillers blancs, cette chemise blanche, les cheveux blancs et les yeux mi-clos, c'est très difficile à peindre.
Il n'y a bien entendu que la tête et les épaules. Je suis contente d'avoir ce souvenir.
Après demain, je vais aller à l'atelier ; pour moins m'impatienter, j'ai nettoyé mes boîtes, rangé les couleurs, taillé les fusains. En cette semaine j'ai fait toutes mes courses.
Jeudi 29 août 78.
Je ne sais par quelle providence j'étais en retard et, à neuf heures, je n'étais pas encore habillée, lorsqu'on vint me dire que grand-papa allait plus mal ; je me suis habillée et suis allée à plusieurs reprises le voir. Maman, ma tante, Dina, pleurent. M. G... s'est promené librement. Je ne lui dis rien, il n’avait pas à faire de la morale dans ces moments affreux. A dix heures le prêtre est arrivé, et au bout de quelques minutes tout a été fini.
Je suis restée là jusqu'à la fin, à genoux, et tantôt passant une main sur ce pauvre front, tantôt tâtant le pouls. Je l'ai vu mourir, pauvre cher grand-papa.… après tant de souffrances. Je n'aime pas dire des banalités : pendant le service qui a eu lieu près du lit maman est tombée dans mes bras, on dut l'emporter et la coucher dans sa chambre. Tout le monde pleurait tout haut, même Nicolas ; je pleurais aussi, mais tranquillement. On l'avait couché sur son lit, mal arrangé, ces domestiques sont abominables, ils y mettent un zèle qui fait mal ; j'ai arrangé moi-même les oreiller les couvrant de batiste bordée de dentelles, et j'ai drapé un châle autour du lit qu'il aimait — en fer — ce qui paraîtrait pauvre aux autres. Tout autour, de la mousseline blanche ; cette blancheur va à l'honnêteté de l'âme qui s'est envolée et à la pureté du cœur qui ne bat plus. Je lui ai touché le front, quand il était déjà froid et je n'ai eu ni peur, ni dégoût.
On s'attendait au coup, mais on est assommé quand même.
J'ai rédigé les dépêches et les lettres de faire part. Mais il fallait aussi donner des soins à maman qui eut une violente attaque de nerfs. Je crois que j'ai été tout à fait convenable et que, pour ne pas crier, je n'ai pas plus mauvais cœur que les autres.
Je ne sais plus distinguer mes rêves de mes sentiments réels.
Il a fallu aller chercher des faiseurs de deuil, etc. etc. Ma famille serait capable de ne pas mettre de deuil extérieur, ne voulant pas comprendre qu'on ne tient aucun compte du deuil de l'âme et que plus on met de crêpe,. plus on est bonne mère, bonne fille, veuve inconsolable.
L'atmosphère offre un affreux mélange de fleurs de terre et d'encens. Il fait chaud et l'on a fermé les volets.
A 2 heures, je me suis mise à peindre, le portrait du pauvre mort, mais le soleil est venu à quatre heures ; il faut s'interrompre, ce ne sera qu'une esquisse.
Je ne sais pas comment tout doit se passer, mais je tache instinctivement d'observer l'étiquette, tout en ayant bon cœur.
A chaque instant j'ouvre ce livre pour y enregistrer quelques événements.
Vendredi 30 août 78.
La vie réelle est un détestable et ennuyeux rêve... pourtant, comme je pourrais être heureuse avec seulement un peu de bonheur ; je possède au suprême degré l'art de faire beaucoup de rien, et puis rien de ce qui affecte les autres ne m'affecte.
Dimanche 1er septembre 78.
Et je ne vois rien… rien que la peinture. Si je devenais un grand peintre, ce serait une compensation divine, j'aurais le droit d'avoir des sentiments, des opinions (devant moi même), je ne me mépriserais pas en écrivant toutes ces misères ! Je serais quelque chose… Je pouvais n'être rien et je serais heureuse de n'être rien, qu'aimée d'un homme qui serait ma gloire... Mais, à présent, il faut être quelqu'un par soi-même.
Mercredi 4 septembre 78.
Kant prétend que les choses n'existent que par notre imagination. C'est aller trop loin ; mais j'admets son système dans le domaine du sentiment... Au fait, les sentiments sont produits par l'impression que produisent les objets ou les êtres ; et puisqu'il dit que les objets ne sont tels ou tels, qu'ils n'ont en un mot aucune valeur objective et n'ont de réalité que dans notre esprit... Pour concilier tout cela, il ne faudrait pas être pressée se coucher et penser à l'heure où il faut commencer à dessiner pour avoir fini samedi.
Dans le langage courant, on nomme imagination autre chose que ce que je pense ; on dit imagination pour dire folie, bêtise, sans cela... l'amour peut-il exister autrement que dans l'imagination ? Ainsi de tous les autres sentiments. Voyez-vous, cet échafaudage philosophique est admirable, mais une simple femme comme moi peut en démontrer la fausseté.
Les choses n'ont de réalité que dans notre esprit. Bien, et moi, je vous dis : que l'objet frappe la vue, que le son, l'ouïe, et que ces... mettons choses déterminent tout... Autrement rien n'aurait besoin d'exister, nous inventerions tout. Si dans ce monde rien n'existe, où donc existe-t-il quelque chose ? Car pour affirmer qur rien n'existe, il faut avoir connaissance de l'existence réelle de quoi que ce soit, n'importe où, quand cela ne serait que pour se rendre compte de la différence entre les valeurs objectives et imaginaires. Certes... les habitants d'une autre planète voient peut-être autrement que nous et dans ce cas on a raison ; mais nous sommes sur la terre, restons-y, étudions ce qui est dessus ou dessous et c'est bien assez.
Je m'enthousiasme pour ces savantes, patientes extraordinaires, abracadabrantes folies ; ces raisonnements, ces déductions, si serrées, si savantes... Il n'y a qu une chose qui me désole, c'est que je sens que c'est faux, et que je n 'ai pas le temps, ni la volonté de trouver pourquoi.
Je voudrais en causer avec quelqu'un, je suis bien seule. Mais je vous jure que ce que j'avance n'a pas l'intention de s'imposer aux gens, je dis naïvement mes idées idées et me rendrais volontiers à toutes les bonnes raisons qu'on me donnerait…
Il me faudrait, je voudrais sans me rendre ridicule par trop de prétention, je voudrais entendre des hommes instruits ; je voudrais tant, tant, tant pénétrer dans le monde savant, voir, écouter, apprendre… Mais, je ne sais ni à qui, ni comment le.demander, et je reste là stupide, émerveillée, ne sachant où me jeter et entrevoyant de tous les côtés des trésors d'intérêt : les histoires, les langues, les sciences, toute la terre enfin ;... je voudrais voir tout ensemble et tout connaître, tout apprendre !
Vendredi 13 septembre 78.
Je suis déplacée, je dépense en futilité ce qui aurait pu faire un homme ; je fais des discours pour répondre à des noises domestiques et absolument oiseuses ; je ne suis rien et ce qui aurait pu être des qualités, n'est pour la plupart du temps, qu'inutile ou déplacé.
Il y a de grandes statues qui sont admirables sur un piédestal, au milieu d'une grande place ; mais mettez-les dans votre chambre et vous verrez comme c'est bête et comme c'est encombrant ! Vous vous y cognerez le front et les coudes dix fois par jour et finirez par maudire et trouver insupportable ce qui ferait l'admiration de tous, bien placé.
Si vous trouvez que la « statue » est trop flatteuse pour moi, je veux tout aussi bien que ce soit... ce que vous voudrez.
Samedi 21 septembre 78.
J'ai eu des compliments et des encouragements. Breslau, qui est revenue de la mer, a rapporté des études de bonnes femmes, des têtes de pêcheurs.
C'est d'une charmante couleur et la pauvre A... qui se consolait en disant que Breslau n'avait pas la couleur a fait une triste figure. Breslau sera un grand peintre, un vrai grand peintre, et si vous saviez comme je juge sévèrement et comme je méprise les prétentions des femelles, et leurs adorations pour R... parce que, paraît-il, il est beau, vous comprendriez que je ne m'extasie pas pour rien ; d'ailleurs, à l'heure où vous me lirez, la prédiction sera accomplie. Il faut que je m’efforce à dessiner par cœur, autrement je ne saurai jamais composer. Breslau fait toujours des croquis et des pochades, un tas de choses. Elle en faisait déjà deux ans avant de venir à l'atelier, où elle est depuis deux ans et plus. Elle y est entrée vers le mois de juin 1876 , à l'époque où je me gaspillais en Russie... Misère ! !
Lundi 23 septembre.
Julian est venu me dire que M. Robert-Fleury est très content de moi, et, récapitulant le tout, il estime que je fais des choses étonnantes pour le peu de temps, et enfin qu'il a beaucoup d'espoir et que certainement je pourrai lui faire grand honneur.
C'est bête d'écrire tous les jours quand il n'y a ries à dire. J'ai acheté dans la section russe un loup pour tapis, qui fait horriblement peur au Pincio II.
Est-ce que je deviendrai vraiment peintre ? Le fait est que je ne sors de l'atelier que pour lire les histoires romaines à gravures, notes, cartes géographiques textes, traductions..
C'est encore bête, personne ne s'occupe de cela, et ma conversation serait plus brillante, si je lisais des choses plus nouvelles. Qui est-ce qui s'inquiète des premières institutions, du nombre des citoyens sous Tullus Hostilius, des rites sacrés de Numa, des luttes des tribuns et des consuls ?
La grande histoire de Duruy qui paraît par livraisons est un trésor.
*
* *
Quand j'aurai fini Tite-Live, je lirai l'histoire de France de Michelet et puis, je lirai les Grecs que je ne connais que par ouï-dire et par citations d'autres livres, et puis... Mes livres sont dans des caisses et il faudra prendre un logement un peu plus définitif que celui-ci pour déballer.
Je connais Aristophane, Plutarque, Hérodote, un peu Xénophon, et c'est je crois tout. Epictète encore, mais ce n'est vraiment pas assez. Et puis Homère, je le connais très bien, un petit peu aussi Platon.
Vendredi 27 septembre 78.
On discute partout et souvent sur les torts des hommes et des femmes ; on s'exténue à prouver que c'est l'un ou l'autre qui est le plus coupable. Faut-il donc que je m'en mêle pour éclairer les pauvres citoyens de la terre ?
L'homme, ayant en quelque sorte l'initiative d'à peu près tout, doit être regardé comme le plus coupable, sans être pour cela plus méchant que la femme qui, étant en quelque sorte un être passif, échappe à une certaine responsabilité, sans être pour cela meilleure que l'homme.
Samedi 28 septembre 78.
Robert-Fleury a encore été content de moi et m'a demandé si j'ai fait de la peinture.
— Non, Monsieur.
— Ah ! Mademoiselle, ce n'est pas bien, vous savez bien que c'était convenu. Vous êtes vraiment coupable, si vous ne travaillez pas beaucoup.
Et si vous saviez ce qu'il est sobre d'éloges, un pas mal est déjà très fort et j'ai eu des : bon, bien, très bien.
Lundi 30 septembre 78.
J'ai fait ma première peinture officielle.
Je devais faire des natures mortes ; j'ai donc peint comme vous savez, un vase bleu et deux oranges. Et puis, un pied d'homme et c’est tout.
Je me suis dispensée de dessiner le plâtre, je me passerai peut-être de nature morte.
J'écris à Collignon que je voudrais être homme. Je sais que je pourrais devenir quelqu'un ; mais avec des jupes où voulez-vous qu'on aille ? Le mariage est la seule carrière des femmes ; les hommes ont trente-six chances, la femme n'en a qu'une, le zéro comme la Banque. Mais la Banque gagne quand même ; on prétend qu'il en est de même de la femme ; non, car il y a gagner et gagner. Comment voulez-vous donc qu'on n'y regarde pas d'excessivement près pour choisir un époux ? Jamais je n'ai été si révoltée contre l'état de femmes. Je ne suis pas assez folle pour réclamer cette bête d'égalité qui est une utopie (et puis, c'est mauvais genre), parce qu'il ne peut y avoir égalité entre deux êtres différents comme l'homme et la femme. Je ne demande rien, parce que la femme a déjà tout ce qu'elle doit avoir, mais je grogne d'être femme, parce que je n'en ai que la peau.
Jeudi 3 octobre 78.
Aujourd'hui nous sommes restées près de quatre heures à une matinée dramatique musicale, internationale. On a donné des morceaux d'Aristophane en d'affreux costumes et puis tellement abrégés, arrangés et refaits que c'était hideux.
Ce qui a été superbe, c'est un récit dramatique, Christophe Colomb dit par Rossi, en italien. Quel organe, quelle intonation, quelle expression, quel naturel ! C'était mieux que la musique. Je crois que cela paraîtrait admirable, même si l'on ne comprenait pas l'italien.
Pendant que je l'écoutais, je l'adorais presque.
Ah ! quelle puissance que la parole, même quand elle est apprise, même quand cela n’est pas de l'éloquence ! Le beau Mounet-Sully a récité ensuite... mais, je n'en parlerai pas. Rossi fait du grand art, c'est un grand artiste dans l'âme ; je l'ai vu à la sortie parlant à deux autres hommes, il est commun. C’est un acteur, mais un artiste à ce point doit avoir une certaine grandeur de caractère, même dans la vie de tous les jours. Je l'ai vu dans ses yeux, ça ne peut pas être un homme tout à fait ordinaire, mais le charme n'existe que tant qu'il parle... Oh ! alors, c’est merveilleux ... Les nihilistes qui se moquent des arts !
Quelle affreuse existence ! Si j’étais intelligente, je saurais bien me tirer de là, mais je ne suis intelligente que sur parole et encore, rien que ma parole à moi. Où ai-je prouvé, montré mon esprit ?
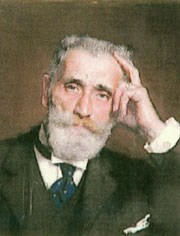
Autoportrait
Samedi 5 octobre 78.
C'est aujourd'hui que Robert-Fleury vient corriger à l'atelier. Eh bien, j'ai eu une peur affreuse. Il a fait : oh ! oh ! ah ! ah ! oh ! oh ! sur plusieurs tons différents, et puis...
— Vous faites de la peinture ?
— Pas tout à fait, Monsieur, je ne peindrai qu'une fois par mois....
— Non, vous avez raison de commencer, vous pouvez peindre. Et il y a du bon, il y a du bon...
— Je craignais de n'être pas assez avancée pour peindre.
— Du tout, vous êtes assez avancée ; continuez ce n'est pas mal, etc., etc.
Et là-dessus une longue leçon qui prouve que ce n'est pas sans espoir, comme on dit à l'atelier. On ne m'aime pas à l'atelier et à chaque malheureux succès B... a des regards furieux tout à fait risibles.
Mais Robert-Fleury ne croit pas que je n'aie jamais appris à peindre.
Il est resté longtemps, corrigeant, causant et fumant comme s'il était Carolus.
J'ai reçu plusieurs conseils extra et puis, il m'a demandé comment j'ai été placée au dernier concours de l'année passée. Et quand je dis deuxième.
— Et cette année, dit-il, il faudra…
Hum ?
C’est si bête, il a déjà dit à Julian qu'il pensait que j'aurais une médaille.
Enfin, me voilà sans aucun tirage, autorisée à peindre la nature, sans avoir peint des natures mortes, je les passe comme j'ai passé les plâtres.
Lundi 7 octobre 78.
Les bêtes vont se dire que j'ai l'intention de continuer Balzac, non ; mais savez-vous ce qui lui permet d’être si admirable ? C'est qu'il verse sur le papier tout ce qu'il conçoit dans son esprit, tout naturellement, sans crainte, sans affectation. Presque toutes les personnes intelligentes ont pensé ce qu'il a su écrire, mais qui a pu l'exprimer comme lui ? Cette faculté donnée à un autre esprit, n'eût certainement produit rien de semblable.
Non, presque toutes les personnes n'ont pas pensé ainsi ; mais en lisant Balzac, elles ont été tellement saisies du côté vrai, du côté nature, qu'elles ont cru l'avoir pensé. Mais moi, il m'est arrivé cent fois, en parlant ou pensant à une chose, d'être horriblement tourmentée par des idées que je sentais là, et que je n'avais pas la force de débrouiller et de retirer de l'épouvantable chaos de ma tête.
Moi, j'ai aussi une autre prétention, c'est lorsque je dis quelque chose de bien, une observation très fine, il me semble qu'on ne comprendra pas.
Peut-être vraiment ne comprendra-t-on pas comme je l'entends.
Bonsoir, bonnes gens !
Robert-Fleury et Julian bâtissent sur ma tête tout un édifice, ils me soignent comme un cheval qui peut gagner le grand prix. Julian n'a que des gestes disant cela me gâtera ; mais, je l'ai assuré que cela m'encourage énormément ; ce qui est la vérité.
Mecredi 9 octobre 78.
Les succès obtenus au concours des Beaux-Arts par les élèves de chez Julian ont posé son atelier sur un bon pied.
Il y a plus d'élèves qu'il n'en faut ; chacun s'imagine obtenir un prix de Rome, ou du moins concourir à l'École.
L'atelier des femmes participe de cet éclat et Robert-Fleury rivalise avec Lefebvre et Boulanger. A chaque chose Julian dit : — Que dirait-on en bas ? ou, je voudrais montrer cela aux messieurs d'en bas.
Je soupire bien après l'honneur de voir un de mes dessins descendu. C'est qu'on ne leur descend des dessins que pour se vanter et pour les faire rager, parce qu’ils disent que des femmes ça n'est pas sérieux. Il y a déjà quelque temps que je pense à honneur de descendre.
Eh bien ! aujourd'hui, Julian est entré et, ayant examiné mon académie, il parla ainsi :
— Finissez-moi ça bien, et je le descendrai en bas.
Samedi 12 octobre 78.
Mon académie a été trouvé très bien, très bien, très bien.
— Ah ! vous êtes bien organisée vous, et si vous travaillez, vous ferez ce que vous voudrez.
Je suis blasée sur les louanges (je dis blasée pour la forme) et la preuve que R... ne ment pas, c’est qu’on m'envie de tous côtés. Et c'est bête, mais cela me fait de la peine. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on me dise de telles choses chaque fois, surtout quand celui qui les dit est un homme aussi sérieux aussi consciencieux que R...
Quant à Julian, il ajoute que si je savais tout ce qu'on dit de moi, cela me tournerait la tête.
— Cela vous griserait, Mademoiselle Marie, dit la bonne.
Je crains toujours que ceux qui me liront pensent qu'on me flatte parce que je suis riche. Cela ne fait rien, je ne paie pas plus que les autres et les autres ont des protections, des amitiés, des parentés avec les professeurs. D'ailleurs, à l'heure où vous me lirez, il n'y aura plus de doute sur ce que je vaudrai. Ah ! Il faut bien que je sois compensée de ce côté !
C'est bon de voir le respect qu'on vous accorde pour votre mérite personnel.
R... commence à faire son Carolus ; il va, il vient (il a reçu une grande médaille à l'Exposition universelle), il cause après avoir corrigé, il allume une cigarette, il se jette dans un fauteuil. Ça m'est égal le sofa, je sais qu'il m'adore comme élève, Julian aussi.
L'autre jour la Suédoise m'a donné un conseil, alors Julian m'a appelée dans son cabinet, m'a dit que je devais suivre ma nature, que la peinture serait faible au commencement, mais que cela serait moi, « tandis que si vous écoutez les autres, je ne réponds plus de rien. »
Il veut bien que j'essaie de sculpter et va demander à Dubois de me donner des conseils.
Pour la première fois à Paris, je me suis promenée avec plaisir. J'étais habillée, coiffée, propre, j'avais pris mon temps, je ne m'étais pas pressée. Dina restant avec maman, j'ai eu la place d'honneur.
Tourner le dos aux chevaux est un supplice au lieu d’une promenade. Tous les samedis je ferai comme cela. C'est si bête d'aller au Bois, n'importe comment. Aujourd'hui, je me suis retrouvée, j'ai eu du succès, tout le monde m'a regardée.
Une robe de deuil, un chapeau de feutre à plumes, ensemble élégant, et comme il faut, et chaste.
Lundi 14 octobre 78.
— C'est bondé en bas, dit Julian, je m'en vais descendre votre académie, donnez-la-moi.
Je sais bien que ce sont de petites choses, mais c'est quand même agréable.
Mercredi 16 octobre 78.
C'est bête, mais l'envie de ces femmes me fait de la peine. C'est si petit, si vilain, si bas ! Je n'ai jamais su envier. Je regrette de ne pas être ce qu'est une autre.
Je m'incline devant la supériorité ; j'en suis fâchée, mais je m'incline ; tandis que ces créatures... ce sont des conversations préparées, de petits sourires quand on parle de quelqu'un de qui le professeur est content, des mots à mon adresse en parlant d'une autre, par lesquels on démontre que les succès d'atelier ne veulent rien dire.
On est enfin arrivé à cette conclusion que les concours sont une bêtise, d'autant plus que Lefebvre a mauvais goût et n'aime que les dessins copiés bêtement sur nature, et que Robert-Fleury n'est pas coloriste.
Bref, les maîtres sont incapables malgré leur célébrité, et c'est l'Espagnole, Breslau et Noggren qui l'ont jugé ainsi. Je suis bien de leur avis quand elles disent que les gloires d'atelier ne sont rien, car en voilà au moins deux sur trois qui resteront de déplorables médiocrités, tout en passant pour des artistes de premier ordre auprès des autres élèves.
Moi, les élèves ne m'aiment pas du tout, mais les maîtres sont contents.
C'est si amusant d'entendre ces femmes dire tout le contraire de ce qu'elles disaient il y a dix mois, quand elles étaient sûres d'être médaillées en première. C'est amusant parce que c'est une de ces comédies qui se jouent partout dans le monde, mais cela me donne sur les nerfs. Peut-être est-ce parce qu'après tout j'ai une nature honnête ?
Ces misères d'atelier m'ennuient, m'agacent en dépit de mes raisonnements. Je suis bien impatiente de les devancer en effet !
Dimanche 20 octobre 78.
J'ai ordonné la voiture à neuf heures et, accompagnée de ma demoiselle d'honneur, Mlle Elsnitz, je suis allée visiter Saint-Philippe, Saint-Thomas d'Aquin, Notre-Dame. Je suis montée tout en haut, j'ai visité les cloches, comme une Anglaise. Eh bien, voilà, il y a un Paris adorable, c'est le vieux Paris; et l'on peut y être heureux, mais à condition d'éviter les boulevards et les Champs Elysées, tous les nouveaux, les beaux quartiers, enfin, que j'exècre, qui me donnent sur les nerfs. Mais là-bas, dans le faubourg Saint-Germain, on se sent tout autrement.
On voyait l'école des Beaux-Arts. C'est à faire crier.
Pourquoi ne puis-je aller étudier là ? Où peut-on avoir un enseignement aussi complet que là ? ! Je suis allée voir l'exposition des prix de Rome. Le second a été gagné par un élève de chez Julian. Julian est très heureux. Si jamais je suis riche, je fonderai une école pour les femmes.
Samedi 26 octobre 78.
Ma peinture est beaucoup mieux et mon académie très bien. M. T... a jugé le concours : première, Breslau, deuxième, moi.
Bref, je dois être contente.
Ce matin, comme Robert-Fleury me parlait, dans le coin, des cartons pour ma sculpture, je l'écoutais comme un bébé, l'air ingénu, les joues changeant de couleur, les mains embarrassées; il ne pouvait s'empêcher de sourire tout en parlant, et moi aussi, car je pensais que je sentais la violette fraîche, que mes cheveux naturellement ondulés, secs et légers, étaient délicieusement éclairés et que mes mains tenant je ne sais quoi avaient des poses amusantes.
Breslau dit que la façon dont mes mains touchent les objets est une beauté, quoique je n'aie pas les mains classiquement belles.
Mais il faut être artiste pour démêler cette beauté ; les bourgeois ou les gens du monde ne font pas attention à la façon dont on empoigne les objets, et préféreront des mains potelées et même grasses aux miennes.
Entre dix et onze heures, j'ai eu le temps de lire cinq journaux et deux livraisons de Duruy !
Je crains que ces succès d'école ne me nuisent, je suis presque honteuse que cela marche-bien et par ce qu'on me dit : beaucoup mieux ou très bien, je ne sens, ni la difficulté, ni le progrès ; et quand on le dit à Breslau,.il me semble qu'elle est une grande artiste. Voilà ce qui devrait rassurer un peu.
Dimanche 3 novembre 78.
Maman, Dina, Mme X et moi, nous nous promenons ensemble. On veut me marier, mais pour qu'on ne se serve pas de moi pour enrichir quelque monsieur, je déclare nettement que je veux bien me marier avec plaisir, mais à condition que ce monsieur soit riche, en belle position et beau, ou bien, un homme intelligent, remarquable, et laid. Quant au caractère, fût-ce le diable, je m'en charge.
Mme G... parle des arts d'une façon si profane que je m'en irai si elle en reparle devant moi. Elle cite des dames qui font de la peinture chez elles, qui ont des professeurs, et elle dit que je pourrai en faire autant quand je serai mariée. Dans ces tons détachés de la femme du monde, de la bourgeoise ; il y a quelque chose d'affreusement brutal, qui fait honte à tous les sentiments artistiques et élevés.
Vous comprenez, je me fais un raisonnement sensé et parfaitement juste.
Je tâcherai de faire le mariage de mes rêves d'abord. Si je n'y arrive pas, je me marierai, comme tout le monde, à l'aide de ma dot. Me voilà donc tranquille.
Il faut songer, en se mariant, que ce n'est pas un appartement qu'on loue par mois, mais une maison qu'on achète : il faut qu'on y trouve toutes ses aises, et on ne peut pas passer par-dessus quelques chambre de moins, comme dans un logis de louage, et une vieille tradition russe dit que « les annexes portent malheur. »
Mardi 5 novembre 78.
Il y a quelque chose de vraiment beau, d'antique : — cet anéantissement de la femme devant la supériorité de l’homme aimé doit être la plus grande jouissance d'amour-propre que puisse éprouver une femme supérieure.
Samedi 9 novembre 78.
Une veste honteuse, pas de médaille du tout ! Ce qui fera triompher ces imbéciles de femmes qui sont fortes et qui n'ont pas concouru. Je suis tout de même première. Je crois que je l'aurais été avec la peinture de Breslau. On aurait fait deux premières, mais cette conviction intime n'est rien. Le fait est là. Elles n'ont pas concouru. Il n'y a pas de médaille. Au fond, je m'en moque. Il n'y a que Breslau que je respecte, et encore a-t-elle trois ans d'études chez Julian et deux à Zurich. Total, presque cinq ans, je décompte ses maladies. Et moi, je n'ai eu en tout que onze mois. Et si l'on prend en considération les essais antérieurs, il y en aura pour un mois. Si on compte les copies des gravures et les six têtes peintes à Rome, d'ailleurs à des époques différentes, tout ce gribouillage fait un mois d'étude (huit heures par jour, je le déclare sur mon honneur) six semaines au maximum, donc nous avons un an. Tout cela pour vous annoncer en grande pompe que je dessine les académies aussi bien que Breslau, les maîtres me l'ont dit.
Mercredi 13 novembre 78.
Robert-Fleury est venu le soir. Il serait fallacieux de vous répéter les encouragements qu'il me donna après une longue leçon ; si ce que ces gens-là disent est vrai, vous savez (à l'heure où vous lisez cela) à quoi vous en tenir sur mon compte.
Seulement, cela fait plaisir quand même, de voir qu'on vous prend absolument au sérieux. Je suis bête... J'ai la plus énorme espérance et, quand on me le dit j'ai l'air de l'avoir ignoré moi-même, et me sens transportée de joie ! J'en suis étonnée et radieuse comme un monstre qui se saurait aimé de la plus belle des femmes.
Robert-Fleury est un excellent professeur et vous conduit pas à pas, de sorte que vous sentez à chaque pas le progrès que vous faites. Ce soir il m'a traitée un peu comme une élève qui a fait ses gammes et à laquelle on donne à jouer un morceau. Il a soulevé le coin du rideau et m'a montré un horizon plus vaste. C'est une soirée qui comptera dans mes études.
Samedi 16 novembre 78.
Et aujourd'hui, Robert-Fleury a été très content de Breslau et l'a engagée à faire quelque chose pour le Salon, en ajoutant qu'elle serait reçue ; c'est lui qui en répond. Moi, j'avais cette semaine à côté de moi la vieille G..., le fléau de l'atelier, une bonne femme, mais folle et énervante.
J'ai égalé Breslau en dessin, ce qu'elle a eu de plus, c'est l'habitude. Maintenant il faut que je me donne tant de mois pour peindre comme elle, car, si je ne peux pas faire cela, je n'ai rien d'extraordinaire. Pendant les sept ou dix mois que je me donne, elle ne s'arrêtera pas... Je serai donc forcée de courir de façon à rattraper les dix mois qui sont passés, dans les sept ou dix mois pendant lesquels nous courrons ensemble. Cela me paraît bien improbable, bien extraordinaire. Enfin, à la grâce de Dieu.
Mercredi 20 novembre 78.
Ce soir, après mon bain, je suis devenue subitement si jolie que j'ai passé vingt minutes à me regarder. Je suis sûre que si l'on me voyait aujourd'hui, j'aurais du succès : une couleur absolument éblouissante et si fine, si douce, les joues à peine rosées ; en fait de vigueur, il n'y a que les lèvres et les sourcils avec les yeux.
Je vous prie, ne me croyez pas aveugle quand je suis mal, je le vois bien, allez ; et c'est la première fois que je suis jolie depuis bien du temps déjà. La peinture prend tout.
Ce qui est infâme dans la vie, c'est que tout cela doit se faner, se parcheminer et mourir !
Jeudi 21 novembre 78.
Breslau a peint une joue si nature et si vraie, que moi, femme, artiste rivale, j'ai eu envie d'embrasser cette joue de femme...
Il doit en être souvent ainsi pour les choses de la vie ; il ne faut pas trop s'en approcher, on se salirait les lèvres et l'on abîmerait l'objet.
Robert-Fleury est venu ce soir à l'atelier ; ça va toujours très bien.
Vendredi 22 novembre.
Je suis effrayée de l'avenir de Breslau. J'en suis assombrie, triste.
Elle compose et il n'y a dans ce qu'elle fait rien de féminin, de banal, de difforme. Elle sera remarquée au Salon, car, en outre de l'expression qu'elle y mettra, elle ne choisira pas un sujet ordinaire.
Je suis vraiment folle de l'envier, je suis une enfant dans l'art et elle une femme.
Ma peinture avant tout ; pour le moment je suis dans un mauvais jour, tout me semble noir.
Samedi 23 novembre 78.
Robert-Fleury m'a encore parlé « au point de vue d'un avenir artistique, sérieux, d'un avenir de peintre de talent ! » Je ne me rappelle pas les expressions qu'il a employées, mais il a parlé de mon ensemble du soir, et Breslau, qui a entendu m'a regardée avec considération et de cet air bienveillant qu'on prend quand on veut ne pas paraître jaloux.
Ce n'est pas de la tête de cette semaine qu'il s'agit ; ma peinture est encore si faible qu'il n'y a pas grand chose à en dire, mais c'est de l'ensemble des études. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il m'a ordonné de ne pas me contenter des études de l'atelier, mais de faire des croquis, des compositions par cœur, etc.
J'étais partie comme une machine et maintenant il faudra y mettre du mien, avoir un peu d'indépendance... Par la façon dont il m'a engagée à travailler, dont il m'a encouragée, j'ai vu que je suis dans ses bonnes grâces comme Breslau. Vous comprenez bien, qu'autant je me fiche de l'homme, autant je tiens à mon maître ; car, je vous le répète, sans être un peintre empoignant, notre patron est un parfait professeur.
Avec Breslau et moi, il a une manière de corriger à part.
Ce soir, je vais revoir les Amants de Vérone avec Nadine et Paul. Nous invitons Filippini. Capoul et Heilbronn ont chanté et joué d'une façon adorable. La partition s’ouvre comme une fleur à la seconde audition. Il faudrait y retourner. La fleur s'épanouirait encore et répandrait un parfum tout à fait charmant. Il y a des phrases délicieuses, mais, par exemple, il faut de la patience et de la délicatesse. Cette musique ne s'impose pas, il faut en chercher le charme, qui est fin, effacé presque, mais qui existe.
Dimanche 24 novembre 78.
Nous avons visité le musée des antiques, avec Nadine. Quelle simplicité et quelle beauté !
Ah ! la Grèce ne se répétera plus jamais !
Lundi 16 décembre 78.
Il gèle, il neige.
Je ne me repose qu'en travaillant et les deux heures qui me restent, je les emploie à lire ou à sommeiller.
Jamais, jamais, je n'ai été aussi pendante, abrutie, découragée et sceptique. Rien au monde ne m'attache à rien au monde.
Je travaille, mais comme une machine ; il faut faire une bonne étude et recevoir des compliments. Cela me rattachera à la gloire artistique et me donnera une raison pour exister.
Samedi 21 décembre 78.
Aujourd'hui rien de bon. La peinture ne va pas. Je crois qu'il me faudra plus de six mois pour égaler Breslau. Elle sera sûrement une femme extraordinaire..., un mélange je dirais bizarre, si la bizarrerie n'était si commune par le temps qui court.
La peinture ne va pas.
Allons, ma fille, tu crois que Breslau a peint mieux que toi au bout de deux mois et demi, mais elle peignait des natures mortes ou des plâtres. Il y a 6 mois de cela, Robert-Fleury lui disait les paroles qu'il m'a dites ce matin.
— C'est distingué, le ton est cru et froid. Il faut sortir de là. Faites une ou deux copies.
Elle n'en est pas morte au bout de dix mois de peinture, en mourrai-je au bout de deux et demi ?
Vendredi 27 décembre 78.
Ma semaine est perdue pour l'atelier. Depuis trois jours, j'avais envie d'écrire je ne sais plus au juste quelles réflexions ; mais traquée par le chant de la demoiselle du deuxième je me mis à feuilleter mon passage en Italie, et puis on est venu me déranger et j'ai perdu le fil de mes idées et cette disposition mélancolique qui est asse agréable.
Ce qui me surprend, c'est la facilité avec laquelle, dans ce temps-là, j'employais les plus grands mots pour peindre les aventures simples.
Mais j'avais en vue de grands sentiments, j'étais vexée de n'avoir pas à raconter des sensations étonnantes, foudroyantes, romanesques et j'interprétais mes sentiments ; les peintres me comprennent. Tout cela est très bien ; mais comment une fille qui se prétend intelligente, n'a-t-elle pas mieux compris la valeur des hommes et des événements ? Je dis cela, parce que j'allais dire que mes parents auraient dû m'éclairer et me dire, par exemple, d'A... que ce n'est pas un homme sérieux, ni un homme pour lequel on doive se donner le moindre mal. C'est vrai, on m'en a parlé tout de travers, ma mère étant plus jeune que moi ; mais enfin, tout cela à part et puisque j'ai si haute opinion de mon intelligence, j'aurais dû mieux me rendre compte et le traiter comme tous les autres, au lieu de lui donner un développement si considérable dans ce journal et ailleurs.
Mais, je brûlais d'impatience d'enregistrer des romans et bête que je suis ! ç'aurait peut-être été plus romanesque autrement... Bref, j'étais jeune et inexpérimentée, malgré des fanfaronnades, des roueries ; voilà ce dont il faut enfin convenir, quoi qu'il m'en coûte.
Bon ! Voilà qu'il me semble entendre dire: Une femme forte comme toi, ne devrait pas être sujette à des rétractations.
Dimanche 29 décembre 78.
Là-dessus, je me suis appuyé la tête sur le canapé et me suis endormie de la plus belle façon jusqu'aujourd'hui huit heures du matin. C'est amusant de dormir comme ça, hors de son lit.
Je suis toute détachée de l'art et je ne puis me raccrocher à quoi que ce soit. Mes livres sont emballés, je perds mon latin et mes classiques et je me semble toute bête. La vue d'un temple, d'une colonne, d'un paysage italien me fait prendre en horreur ce Paris si sec, si savant, si expérimenté, si raffiné. Les hommes sont laids, ici. Ce paradis, qui est un paradis pour les organisations supérieures, n'est rien pour moi. Oh ! je me suis détrompée, allez ; je ne suis ni adroite, ni heureuse. J'ai envie d’aller en Italie, de voyager, de voir des montagnes, des lacs, des arbres, des mers... Avec ma famille, avec des paquets, des récriminations, des tribulations, de petites querelles quotidiennes ? Ah ! non, cent fois non. Pour jouir de ces bonheurs de voyage, il faut attendre... et le temps passe. Ma foi, tant pis ! Je pourrai toujours épouser un prince italien quand je voudrai ; attendons donc...
C'est que, voyez-vous, en prenant un prince italien, je pourrai travailler, puisque l'argent sera à moi ; mais il lui en faudrait donner... En attendant, restons ici, travaillons à la peinture.
Samedi, on a trouvé mon dessin pas mal, fait en deux jours. — Vous comprenez, ce n'est qu'avec un Italien que je pourrai vivre à ma guise en France, où je voudrai et, en Italie, quelle belle vie ! Je me partagerai entre Paris et l'Italie.
1879
Jeudi 2 janvier 79.
Ce que j'envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir, de s'asseoir sur les bancs du jardin des Tuileries et surtout du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues ; voilà ce que j envie et voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. Vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit, quand on est accompagnée ou quand, pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille ?
Ah ! cré nom d'un chien, c'est alors que je rage d'être femme ! — Je vais m'arranger des habits bourgeois et une perruque, je me ferai si laide que je serai libre comme un homme. Voilà la liberté qui me manque et sans laquelle on ne peut pas arriver sérieusement à être quelque chose.
La pensée est enchaînée par suite de cette gêne stupide et énervante ; même en me déguisant, en m'enlaidissant, je ne suis qu'à moitié libre et une femme qui rôde est une imprudence. Et en Italie et à Rome ! Allez donc en landau voir des ruines !
— Où vas-tu, Marie ?
— Voir le Colysée.
— Mais tu l'as déjà vu ! Allons au théâtre ou à la promenade, il y aura foule.
Et cela suffit pour que les ailes tombent.
C'est une des grandes raisons pour lesquelles il n’y a pas d'artistes femmes. 0 crasse ignorance ! ô sauvage routine ! Ce n'est pas la peine de parler !
Quand même on dirait des choses sensées, on serait sous le coup de ces moqueries communes et anciennes dont on accable les apôtres des femmes. D'ailleurs, je crois qu'on à raison de rire. Les femmes ne seront jamais que des femmes ! Mais pourtant... Si on les élevait de la même manière que les hommes, l'inégalité que je déplore serait nulle et il ne resterait que celle qui est inhérente à la nature même. Eh bien, quoi que je dise, il faut crier et se rendre ridicule (je laisser ce soin à d'autres) pour obtenir cette égalité dans cent ans.
Moi, je tâcherai de la donner à la société en lui montrant une femme qui sera devenue quelque chose malgré tous les désavantages dont la comble la société.
Vendredi 10 janvier 79.
Robert-Fleury est venu le soir à l'atelier.
Nous dînons et déjeunons au café Anglais où l'on mange bien ; en fait de cabaret, c'est le meilleur.
Les journaux bonapartistes et le Pays, en particulier, sont restés si sots devant les élections, que j'en éprouve comme un sentiment de honte pour eux, comme hier pour Massenet, quand on a bissé son incantation et qu'à la seconde fois cela parut moins beau.
Si la peinture ne me donne pas de gloire assez tôt, je me tuerai et voilà tout. C'est résolu depuis quelques mois déjà... En Russie encore, je voulais me tuer, mais j’ai eu peur de l'enfer. Je me tuerai à l'âge de trente ans, car jusqu'à trente ans, on est encore jeune et on peut espérer la chance, ou le bonheur, ou la gloire, ou n’importe quoi. Ainsi donc, voilà qui est réglé et si je suis raisonnable, je ne me tourmenterai plus, non pas seulement ce soir, mais toujours.
Je parle très sérieusement et je suis vraiment contente de me faire une raison.
Samedi 11 janvier 79.
A l'atelier, on croît que je vais beaucoup dans le monde ; cela joint à ma fortune me sépare des autres et ne me permet pas de leur demander quoi que ce soit, comme elles le font entre elles, pour aller chez un peintre ou visiter un atelier.
J'ai honnêtement travaillé toute la semaine jusqu'à dix heures du soir du samedi, puis, je suis rentrée et me suis mise à pleurer. Jusqu'à présent je me suis toujours adressée à Dieu, mais comme il ne m'entend pas du tout, je n'y crois... presque plus.
Ceux-là seuls qui ont éprouvé ce sentiment, en comprennent toute l'horreur. Ce n'est pas que je veuille prêcher la religion par vertu, mais Dieu est une chose bien commode. Quand on n'a à qui s'adresser, quand on est à bout de moyens, il reste Dieu. Cela n'engage à rien et n'inquiète personne., et l'on a une suprême consolation.
Qu'il existe ou non, il faut y croire absolument ou bien être très heureux, alors on s'en passe. Mais dans le chagrin, dans le malheur, dans toutes les choses désagréables enfin, il vaut mieux mourir que de n'y pas croire.
Dieu est une invention qui nous sauve d'un désespoir définitif.
Songez donc ce que c'est, quand on l'invoque, comme sa dernière, son unique ressource et qu'on n'y croit pas !
Lundi 13 janvier 79 (nouvelle année russe).
Eh bien, je m'amuse à la folie comme d'habitude... Le dimanche tout entier se passe au théâtre. Une matinée à la Gaîté, assez triste, et le soir à l'Opéra-Comique : Le Pré aux clercs. Je passe la nuit à me laver, à écrire, à lire, à me coucher par terre, à prendre du thé.
Il est cinq heures un quart; de cette façon, j'irai de bonne heure à l'atelier et le soir j'aurai sommeil, et le lendemain je me lèverai de bonne heure et puis ça ira tout seul. Ne croyez pas que j'aime ces gentillesses, je m'ai en profond dégoût, en profonde horreur. C'est égal, j'ai rencontré ma nouvelle année d'une manière originale, par terre avec mes chiens... J'ai travaillé toute la journée.
Mardi 14 janvier 79.
Je n'ai pu me réveiller qu'à onze heures et demie après cette veille. Le concours a été jugé ce matin par les trois maîtres au complet : Lefebvre, Robert-Fleury et Boulanger. Je ne suis venu à l'atelier qu'à une heure pour apprendre le beau résultat. Cette fois les grandes ont concouru et le premier mot qu'on me dit en entrant :
— Eh bien, Mlle Marie, venez donc prendre votre médaille !
En effet mon dessin était accroché au mur avec une épingle et portait le mot : Prix. Cette fois je me serai plutôt attendue à recevoir une montagne sur la tête !
Il faut que vous compreniez bien l'importance et la vraie signification des concours.
Comme tous les concours, ceux-ci sont utiles ; mais leurs récompenses ne sont pas toujours le résumé des dispositions, des facultés de l'individu. Car il est incontestable que Breslau, par exemple, dont la peinture a été placée cinquième, est en tout point supérieure à Bang qui est première après la médaille. Bang va piano e sano ; son travail, c'est de bonne et honnête, menuiserie ; mais elle est toujours bien placée, parce que le travail des femmes est en générai une chose qui fait égal par sa mollesse et par sa fantaisie, quand cela n’est pas tout à fait élémentaire.
Le modèle était un garçon de dix-huit ans, qui ressemble à s'y méprendre comme forme et couleur à une tête de chat, qu'on ferait avec une casserole, ou une casserole en forme de tête de chat. Breslau a fait des peintures qui auraient facilement la médaille ; mais cette fois, elle n'a pas réussi. Et puis, ce qui est le plus apprécié en bas, ce n'est ni l'exécution, ni le charme (car le charme n'a rien à faire avec l'étude, étant ou n'étant pas en vous, et l'exécution n'est que le complément d'autres qualités plus sérieuses) ; — mais c'est surtout la correction, l'énergie et le sentiment du vrai.
On ne tient pas compte des difficultés, on a raison ; ainsi une peinture médiocre passe après un bon dessin.
Qu'est-ce, après tout, que nous faisons ici ? Nous étudions , et ce n'est qu'à ce point de vue-là que sont jugées ces têtes. La mienne est on ne peut plus crâne. Ces Messieurs nous méprisent et ce n'est que quand ils trouvent une facture forte et même brutale qu'ils sont contents, car ce vice là est absolument rare chez les femmes.
C'est le travail d'un garçon, a-t-on dit de moi. Celui du nerf ; c'est nature.
— Je te disais bien que nous avions là-haut une gaillarde, a dit Robert-Fleury à Lefebvre.
— Vous avez la médaille, Mademoiselle, me dit Julian, et vous l'avez avec succès, ces Messieurs n'ont pas hésité.
J’ai fait monter un punch, comme c'est l'usage en bas et on a appelé Julian. On m'a félicitée, car beaucoup s'imaginent que je suis arrivée au comble de mon ambition et qu'elles seront débarrassées de moi.
Wick, qui a eu la médaille à l'avant-dernier concours est huitième ; mais je la console en lui répétant cette phrase si juste, et qui est, après tout, la définition la plus scrupuleusement exacte de ces choses-là, d'Alexandre Dumas qui disait : « Qu'une mauvaise pièce n'était pas la preuve qu'on n'eût pas de talent, tandis qu'une bonne était la preuve qu'on en a. »
Un génie peut faire une chose mauvaise, mais un imbécile ne peut pas en faire une bonne.
Jeudi 16 janvier 79.
Sauf quelques-unes, les élèves le soir ne sont pas les mêmes que le jour.
On m'a beaucoup félicitée. Ça a été un bon moment tout de même...
Venez chercher votre médaille !...
L’autre soir, chez Madame de M., d'un ton grave et doux, je dis, en montrant cette médaille : — Cela représente bien du courage, Madame !
En effet, cela représente douze mois de travail. Avec la peur que j'eus après ma rencontre royale de Naples, la sensation la plus violente de ma vie est celle que m'a causée aujourd'hui la lecture de l'Homme-Femme. L’admiration que j'éprouvais pour Dumas me fit croire pendant quelques instants à de l'amour, à de la passion et à du délire, pour cet homme de cinquante-cinq ans et que je n'ai jamais vu. J'ai compris Bettina et Goethe.
Vendredi 17 janvier 79.
Si j'avais seize ans, je serais la femme la plus heureuse de la terre.
— Eh ! bien, dit Robert-Fleury, nous avons le prix.
— Oui, Monsieur.
— C'est bien, cela, et vous savez que vous l'avez bien gagné.
— Oh ! Monsieur, je suis contente que vous le disiez.
— Oui, bien gagné, non seulement pour votre tête du concours, mais encore vous le méritez pour l'ensemble de votre travail. Vous avez fait de très grands progrès et je suis content que cela soit tombé ainsi et que vous ayez la médaille. Vous l'avez bien méritée.
J'étais rouge et maladroite en écoutant, ce qui m 'a même diminué le plaisir de l'entendre, mais ma tante était là et tremblait plus que moi.
— Mlle Breslau a fait une jolie horreur, dit-il à l'Espagnole en s'en allant.
— C'était si difficile, Monsieur !
— Oh ! ta, ta, ta. C'est qu'elle ne travaille plus, elle apparaît de temps en temps et, si on ne lui fait pas des compliments jusque-là, elle s'en va et disparaît pendant des semaines. Elle a pourtant fait des études qui...
— Cette tête était si difficile. Monsieur, interrompit l'Espagnole qui défendrait le diable, à condition d'accuser les concours.
— Elle ne travaille pas.
— Elle fait quelque chose chez elle...
— Elle ferait mieux de faire un bon concours.
Ce pauvre homme est vexé devant Lefebvre et Boulanger.
Samedi 18 janvier 79.
J'ai encore suscité, soutenu et calmé une révolte d'atelier. Après quoi, je suis allée la raconter à Julian « pour qu'on ne dénature pas les faits ».
Grandeur en herbe, science en herbe, talent en herbe ! Toutes ces herbes, je crains bien que cela ne fasse du foin pour quelque âne !
Oh ! si j'étais seulement un homme ! mais non, il vaut mieux mourir.
Mercredi, janvier 79.
Toute la journée, je pense à une mer bleue, des voiles blanches, un ciel tout de lumière...
En rentrant de l'atelier, je trouve P. Ce vieux champignon dit que, dans une semaine, il va à Rome. Et tout en causant, il nomme Katarbinsky et d'autres... et moi, je me sens pâmée devant cette perspective de soleil ; de vieux marbres dans la verdure, ruines, statues, églises. La Campagne ! ce désert, oui, mais je l’adore ce désert. Et il y a, Dieu merci, d'autres qui l'adorent aussi.
Cette atmosphère divine, artistique; cette lumière qui, quand j'y pense, me fait pleurer de rage d'être ici. Je connais des peintres là-bas !
Il y a trois catégories de gens. Les premiers aiment tout cela, sont artistes et ne trouvent pas que la Campagne soit un affreux désert, froid l'hiver et brutal l'été. Les seconds, qui ne comprennent pas les arts et ne sentent pas les beautés, mais qui n'osent pas l'avouer, tâchent de paraître comme les premiers. Ceux-ci ne me déplaisent pas trop, parce qu'ils comprennent qu'ils sont nus et désirent se couvrir. Les troisièmes enfin sont comme les seconds, moins ce bon sentiment. Et ce sont ceux-là que j'exècre parce qu'ils dénigrent et glacent. Ne sentant et ne comprenant rien eux-mêmes, ils affirment que ce sont des bêtises et se vautrent, mauvais, méchants et dégoûtants, en plein soleil.
Lundi 3 février 79.
Hier, je suis allée voir l'Assommoir et je trouve que c'est très beau. Mais avant, de quatre à cinq heures jusqu'à la nuit enfin, j'ai essayé de faire une esquisse. Il faut bien s'habituer... Ceux d'en bas en font tous les dimanches, on leur donne un sujet et ils doivent faire une pochade par cœur.
Moi, je commence par le commencement : Adam et Ève, sur une toile de 4. Et maintenant me voilà partie, j'en ferai toutes les semaines. Si je m'écoutais, je ne tarirais pas sur mon talent. Comme premier essai, mon esquisse est très bien...
Je la montrerai à Julian, avec une autre que je ferai.
Mardi 4 février 79.
Ce soir, le modèle a manqué ; j'ai posé et, pendant que j'étais sur la table, Julian est arrivé et nous avons causé politique. J'aime causer avec ce finaud.
Je me moque de tous et de tout le monde à l’atelier, je déclame, je raille, j'amuse, je fais des programmes politiques quand je suis gaie, et Julian qui me dit : Allez toujours, et la peinture... Avec cette mise en scène, vous pouvez être unique à Paris. Il me croit très spirituelle, intelligente, dominant notre salon, influente.
Mercredi 5 février 79.
Voilà. Nous avons été à Versailles, le premier jour de la présidence Gambetta. Son discours, qu'il a lu, a été accueilli avec enthousiasme ; et fût-il encore plus mauvais, qu'il en serait de même. Gambetta a mal lu et d'une voix détestable. Il n'a aucune mesure comme président et, quand on a vu Grévy, on se demande ce que cet homme vient faire. Pour présider une Chambre il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut un tempérament spécial. Grévy présidait avec une régularité, une précision mécaniques. Le premier mot de sa phrase était semblable au dernier. Gambetta a des crescendo, des ralentissements, des élargissements et des rétrécissements ; des mouvements de tête, des hauts et des bas... Bref, ou il a fait une incohérence, ou il est bien malin.
Dimanche 16 février 79.
Samedi j'ai été grondée.
— Je ne comprends pas qu'avec les dispositions que vous avez, vous ayez tant de difficulté à peindre.
Oui, je ne le comprends pas non plus, mais je suis paralysée. Il n'y a plus à lutter. Il faut mourir. Mon Dieu, mon bon Dieu ! Il n'y a donc plus rien à attendre de personne ? Ce qu'il y a de révoltant, c'est que je viens de remplir de bois la cheminée sans aucune nécessité, car je n'ai pas du tout froid..., tandis que peut-être au mème instant il y a des malheureux qui ont faim, qui ont froid et qui pleurent de misère. Ce sont là des réflexions qui arrêtent immédiatement les larmes que je me complais à répandre. Ce n'est peut-être qu'une idée ; mais je crois que j'aimerais autant la misère complète; car alors on est au fond, on n'a rien à craindre ; et l'on ne meurt pas de faim tant qu'on a des forces pour travailler.
Mardi 18 février 79.
Tout à l'heure, je suis allée tomber à genoux devant mon lit pour demander à Dieu justice, pitié ou pardon ! Si je ne mérite pas mes tortures, qu'il me fasse justice ! Si j'ai commis des abominations, qu'il pardonne ! S'il existe, s'il est tel qu'on nous l'enseigne, il doit faire justice, il doit avoir pitié, il doit pardonner. Je n'ai que lui, il est donc naturel que j’aille le trouver et que je l'adjure de ne pas m'abandonner au désespoir, de ne pas m’induire dans le péché, de ne pas me laisser douter, blasphémer, mourir.
Mon péché est sans doute comme mon tourment, je le commets sans doute à chaque instant de petites infamies qui forment un total effroyable.
Tout à l'heure j'ai durement répondu à ma tante, mais je ne pouvais pas ; elle est entrée au moment où je pleurais la tète dans les mains et sommais Dieu de s’occuper de moi. Ah ! misère des misères !
Il ne faut pas qu'on me voie pleurer, on croirait que je pleure d'amour et j'en... pleurerais de dépit.
Mercredi 19 février 79.
Il faut faire quelque chose pour me distraire. Je le dis par cette stupide raison qu'on a d'imiter ce qu'on écrit dans les livres. A quoi bon se distraire ? Le tourment est encore une jouissance, et puis, je ne suis pas comme les autres et je déteste toutes ces choses que l'on fait pour se soigner au moral et au physique, parce que je n'y crois las.
Nice. Vendredi 21 février 79.
Eh ! bien, je suis à Nice ! J'ai voulu prendre un bain d'air, m'inonder de lumière et entendre le bruit des vagues. Aimez-vous la mer ? Moi, j'en suis folle, il n'y a qu’à Rome où je l'oublie... presque.
J'ai voyagé avec Paul... On nous prenait pour le mari et la femme, ce qui me froissait au suprême degré. Comme notre villa est louée, nous allons à l'hôtel du Parc ; l'ancienne villa d'Acqua-Viva que nous habitions il y a de cela huit ans. Huit ans ! Je fais un voyage plaisir. Nous allons dîner à London-House. Antoine le maître d'hôtel, vient me présenter ses hommages, les dames du comptoir aussi, et puis tous les fiacres sourient et saluent, et celui que nous prenons me fait compliment de ma grande taille ; il me connaît ; et puis un autre, qui offre ses services en criant qu'il a servi Mme Romanoff ; puis mes amis de la rue de France. C'est très gentil, et tous ces braves gens m'ont fait plaisir.
La nuit est belle et je m'échappe toute seule, jusqu’à dix heures du soir ; je vais rôder au bord de la mer chanter avec accompagnement de vagues. Il n'y a pas une âme vivante et il fait bien beau, après Paris surtout. Paris !
Samedi 22 février 79.
Quelle différence avec Paris Ici je m'éveille toute seule, les fenêtres sont ouvert toute la nuit. La chambre que j'occupe est celle où nous prenions nos leçons de dessin avec Benza Je vois le soleil qui éclaire peu à peu les arbres près du petit bassin du milieu du jardin, comme je voyais alors tous les matins ; ma petite salle d'études le même papier, celui que j'avais choisi moi-même. Elle est sans doute occupée par quelque sauvage anglais... Je l'ai reconnue à cause du papier, car on a organisé un corridor qui me trouble ; la chambre où je suis était une vitrine.
Il fait beau !
Nous mangeons au London-House, et c'est ce nous ferons tout le temps que je resterai à Nice. On y voit tout le monde, surtout au carnaval.
Dimanche 23 février 79.
Hier, nous sommes allés à Monaco. Ce que ce nid de cocottes est répugnant, je ne le dirai jamais assez. Je ne suis entrée que pour dix minutes dans les salles, mais cela m'a suffi, ne jouant pas. Mme Abaza, venue pour le théâtre, a exprimé son enthousiasme de me rencontrer. Nous avons écouté un opéra-comique dans la nouvelle salle , qui est fort belle et du goût du jour.
Garnier fecit !
Je me promène à la nuit tombante et j'admire la mer et le ciel. Quelle couleur, quelle transparence, quelle pureté, quel parfum !
Lundi 24 février 79.
Je suis heureuse quand je puis me promener seule. Les vagues sont d’une beauté incomparable ; avant d'aller entendre la Patti, je suis allée les écouter. Il avait plu, il faisait une fraîcheur toute douce et adorable. Cela fait du bien aux yeux, de regarder dans le bleu foncé du ciel et de la mer, la nuit. Je me suis tant promenée que je n'ai pas vu un morceau des promenades emporté par l’eau et suis tombée dans ce précipice d'un ou deux mètres de profondeur.
Paris. Lundi 3 mars 79.
Je suis partie hier à midi, il faisait un temps superbe et j'ai failli verser de vraies larmes en quittant ce délicieux et incomparable pays. De ma fenêtre, je voyais le jardin, la promenade des Anglais, l'élégance parisienne. Du corridor, je voyais la rue de France avec ses vieilles masures italiennes et ses ruelles aux clairs obscurs si pittoresques. Et tous ces gens qui me connaissent : — C’est mademoiselle Marie, disent-ils quand je passe.
Autant les gens de Nice m'ont fait souffrir, autant j'adore les maisons et les rues. C'est mon pays après tout.
Je voudrais à présent quitter Paris, j'ai l'esprit égaré et me sens perdue. Je n'attends plus rien ; je n'espère plus rien. Je suis une désespérée, résignée. Je pense, je pense, je cherche et, ne trouvant rien, je pousse un de ces soupirs qui me font plus oppressée qu'avant. Voyons, qu'auriez-vous fait à ma place ?
Maintenant que je suis dans cet impitoyable Paris, il me semble que je n'ai pas assez regardé la mer, je voudrais la revoir. Vous savez, cette pauvre Bagatelle (chien) écrasée à Spa et guérie si miraculeusement, je l'ai ramenée avec moi. C'était pitié que de la laisser là-bas toute seule. Vous ne vous imaginerez jamais la bonté, la fidélité et l'attachement de cette bête. Elle ne me quitte pas, se met toujours sous ma chaise et se cache avec une figure si humble et si suppliante, quand ma tante vient pour protéger les tapis.
Mardi 4 mars 79.
J'ai été voir Mme G... et nous sommes sorties ensemble ; elle a fait quelques visites, et pendant ce temps-là j'ai lu des journaux dans la voiture.
Il y avait chez elle la comtesse Murat avec sa belle-fille. Ah ! oui, M. G... est validé enfin ! On parle avec enthousiasme du départ du prince, et puis on pleure sur le danger qu'il peut courir, et l'on s'extasie sur son énergie. Il n'a consulté personne !
Et puis si ces bons Zoulous mangent du Napoléon, on ne sera pas trop désespéré. Lui mort, plus de parti, plus d'obligations ; on se tourne vers cette coquine de République, qui est après tout la sœur de l'Empire.
Mercredi 5 mars 79.
Dès demain, je me remets au travail. Je me donne encore un an. Une année pendant laquelle je travaillerai plus ferme encore qu'avant. A quoi sert le désespoir ? Oui, c'est une phrase qu'on dit quand on en est un peu sorti, mais quand ça vous vient...
Enfin, mon ange, le désespoir ne fera rien venir et puisqu'il n'y a rien à faire, travaillons. Je pourrai toujours me décourager après. Puisqu'il faut traîner cette vie dans l'espérance d'un sort meilleur, occupons-la. Je n’ai rien trouvé pour en sortir ; alors, que je lise ou dessine, n'est-ce pas la même chose ? Savez-vous que voilà de singuliers raisonnements pour m'amener à travailler ? Ce n'est même plus un pis aller !... C'est que je crains qu'après, je ne me dise : si, au lieu de rester à l'atelier, tu avais songé à toi, tu aurais peut-être trouvé ?...
Tout ce que vous voudrez ! Il y a peut-être moyen, mais je ne sais que faire.
Voyez-vous, c'est atroce, mais je reviens toujours à la possibilité d'amener mon père ici... Ah bien oui ! Savez-vous ce qu'il fait ? Il remet sa maison à neuf pour nous recevoir. Merci ! J'y ai été et cela suffit. Mes mères sont incapables de rien, et moi, j'ai la bassesse d'avouer que je suis incapable de les pousser, et puis cela n'aboutirait pas.
C'est au moment où l'on renonce à chercher qu'on trouve. De toute façon la peinture ne peut me nuire… C'est que je ne suis pas du tout secondée !... au contraire. Va, mon ange, donne-toi des excuses pour cacher ton manque d'intelligence.
Romans ! Chansons ! Oh ! Voyez-vous ! ! ! j'écris, je pense, j'invente, je songe ! Et puis, je m'arrête et c est toujours le même silence, la même solitude, la même chambre. L'immobilité des meubles me semble comme une provocation, une moquerie ! Je suis là à me débattre dans ce cauchemar pendant que les autre vivent ! ! !
La gloire ? Zut, la gloire !
Je vais me marier. A quoi bon retarder ce dénouement ? Qu'est-ce que j'attends ? Du moment que je supprime la peinture, le champ est vaste. Alors... il faut aller en Italie et se marier là... Pas en Russie, un Russe acheté serait chose affreuse. D'ailleurs, en Russie, je me marierais facilement, surtout en province ; mais pas si bête, moi. A Pétersbourg ? Eh bien, si mon père voulait, il pourrait peut-être nous y faire passer un hiver...
L'hiver prochain à Pétersbourg, alors ! Je ne crois pas que j'aime mon art : c'était un moyen, je l'abandonne... Vraiment ? Oh ! je n'en sais rien... Vais-je me donner un an ? La durée du bail de notre appartement ?
To be or not to be ?
Un an n’est pas assez… ; au bout d'un an on verra s'il faut continuer... Mais en Italie, si je ne peins plus, j'entendrai parler de jeunes filles artistes, cela me fera rager et regretter, et puis chaque fois qu'à Naples ou à Pétersbourg on vantera le talent de quelqu'un, comment l'entendrai-je ? Et puis tout cela serait basé sur ma beauté ? Et si je ne réussis pas ? Car il ne suffit pas de plaire, il faut plaire à un homme voulu.
Du moment que l'art est écarté et que j'admets la possibilité d'aller dans le monde ou même la possibilité de plaire dans la rue ou au théâtre... Je m'y perds, je vais me coucher: Ce Pétersbourg me sourit vraiment. Eh bien, a vingt ans, je ne serai pas trop vieille. A Paris, il ne faut rien espérer en fait de maris riches; quant aux pauvres, l'Italie est plus commode.
Samedi 8 mars 79.
J'ai essayé de modeler, mais je n’ai jamais vu comment cela se fait, et ne sais rien. Les jardinières et les vases sont remplis de violettes. J’en aurai longtemps, elles sont en terre.
Le satin bleu, ces violettes et la lumière qui vient d’en haut, la harpe... Pas un bruit, personne... Je ne sais pas pourquoi j'ai si peur de la campagne ; je n'en ai pas peur, mais je ne la recherche pas... Enfin, tout cela est ravissant pour se reposer, mais je ne suis pas fatiguée, moi ! Je m'ennuie.
Dimanche 9 mars 79.
Savez-vous que c'est une grande consolation que d'écrire ! Il y a des choses qui vous détruiraient .si vous ne les destiniez à être lues et par conséquent « divisées à l'infini ».
Je suis contente de trouver qu'un homme comme Dumas fasse cas de la qualité du papier, de l'encre, des plumes. Parce que chaque fois que quelque accessoire m'empéche de travailler, je me dis que c'est paresse et que les grands peintres n'avaient pas de manies.., Attendez... je comprends que, subitement inspiré, Raphaël dessine sur un fond de tonneau sa Vierge à la chaise, mais je crois bien pourtant que ce même Raphaël, pour peindre et achever ce même tableau, a eu recours à tous ses outils favoris et que, si on le forçait à peindre à une place- contre son gré, il serait énerve comme je le suis, simple mortelle, à l'atelier Julian.
Mercredi 12 mars 79.
Je veux aller me pendre ! Quelque grandiose et impossible et stupide que vous paraisse cette idée de me supprimer, il faudra bien en finir par là.
La peinture ne va pas. Je pourrais, il est vrai, dire que depuis que je peins, je ne travaille que n’importe comment et avec des interruptions, mais c'est égal. Moi qui ai rêvé d'être riche, heureuse, à la mode, entourée... mener, traîner cette existence !
Mlle Elsnitz m'accompagne comme d'habitude, mais la pauvre fille est si ennuyeuse. Figurez-vous un tout petit corps, une grosse tête avec des yeux bleus.... Avez-vous vu des têtes de bois chez les modistes avec des joues roses et des yeux bleus ?... Eh bien, c'est ça, et les traits et l'expression. Joignez à cet extérieur un air langoureux, qui se trouve d'ailleurs dans tous les mannequins dont je viens de vous parler, une démarche lente, mais si lourde qu'en l'entendant on dirait un homme, une voix traînante et faible ; elle avale lest mots avec une lenteur étonnante. Elle est toujours ailleurs, ne comprend jamais tout de suite et puis s'arrête devant vous et vous contemple avec un sérieux qui vous fait éclater de rire ou vous enrage.
Souvent elle arrive au milieu de la chambre et reste là, plantée sur ses jambes sans savoir où elle est. Ce qui est presque le plus énervant, c'est comme elle ouvre les portes ; l'opération dure si longtemps, que chaque fois j'ai envie de me précipiter et de l'aider. Je sais qu'elle est jeune, dix-neuf ans. Je sais qu'elle a toujours été malheureuse, qu'elle est dans une maison étrangère où elle n'a pas un ami, pas un être avec lequel échanger ses pensées…. Souvent elle me fait de la peine, m'attendrit par son air doux et passif ; alors, je prends la résolution de causer avec elle, de... Mais, allez-y donc ! Elle m'est répugnante comme l'étaient le Polonais et B.... Je sais que c'est mal, mais cet air idiot me paralyse.
Je sais que sa position est triste ; pourtant chez les Anitchkoff, elle était la même. Pour me demander la moindre chose, pour me prier de jouer quelque chose au piano, par exemple, elle éprouve les hésitations et les tortures que j'éprouverais, en demandant une invitation de soirée ou de bal.
J'ai l'excuse de ne causer avec personne ici, elle n'est donc pas une exception.
Je travaille à l'atelier et, en mangeant à la maison, lis les journaux ou un livre ; c'est une habitude dont il me sera difficile de me défaire, je lis mème en m'exerçant sur la mandoline. Donc, la petite ne se voit pas plus maltraitée que les autres ; j'ai des remords, mais je ne peux pas !
Je me sens profondément malheureuse dans sa société ; les trajets que je dois faire avec elle en voiture ne seraient une vraie torture si je ne regardais par la portière et, en pensant très fort à autre chose, ne parvenais à l'oublier... On l'oublie facilement, rien de plus imperceptible que ce pauvre être, mais aussi rien de plus énervant ! Je voudrais tant qu'elle trouvât une condition où elle pût être heureuse et qu'elle s'en allât d’ici. J'ai honte de dire qu'elle me gâte mon désert et ma vie de désolation.
Oh ! cette peinture, si je pouvais y arriver !…
Vendredi 14 mars 79.
Paul vient de partir malgré moi ; je me suis fâchée et lui ai déclaré qu'il ne partirait pas ; il m'a donné sa parole d'honneur du contraire. Je tenais la porte ; alors, profilant d'une distraction, il s'est sauvé.
Voyez-vous, c'est pour prouver qu'il ne change pas de résolution ; il avait juré de partir aujourd'hui. Bref, une fermeté de faible qui, ne se sentant rien dans les choses sérieuses, se rattrape sur les bagatelles.
Cela m'a évité de m'attendrir. J'ai immédiatement pris 20 francs à ma tante pour envoyer une dépêche calomnieuse au père, à Poltava ; mais en ce moment Rosalie est venue me dire de ne pas compter sur Champeau (une petite qui me fait des robes quelquefois, qui a la fièvre typhoïde ; ses ouvrières, sont parties) elle est toute seule ; alors, j'ai eu une idée. J'ai déchiré la dépêche et j'ai envoyé les 20 francs à cette femme.
Il n'y a pas de sensation plus agréable que celle de faire du bien qui ne vous rapporte rien. J'irais bien la voir, je ne crains pas le typhus, mais j'aurais l’air de chercher des remerciements, tandis que si je ne lui envoyais pas cette misère à l'instant, je pourrais les dépenser et puis... avouons-le, cela ne me causerait plus un plaisir si vif. Voilà que je me sens d’une charité inépuisable. Aller soulager les misères des autres, quand personne au monde ne soulage les miennes. Cela serait assez chic ; qu'en pensez-vous ?
Samedi 15 mars 79.
Si Robert-Fleury, nommé Tony en son absence, me gronde aujourd'hui, je ne fais plus de peinture. Vous savez ce que mes progrès m'ont valu d'envie et surtout de désagrément. Chaque fois que cela cloche, on a l'air de s'écrier : Je vous le disais bien, ça ne pouvait pas durer ! Mes premières toiles m'ont valu des compliments et puis je suis entrée dan: une passe difficile et je sentais trop de satisfaction autour de moi pour ne pas en souffrir assez fort. Ce matin j'attendais cette leçon comme quelque chose d'épouvantable, et pendant que cet animal de Tony corrigeait les autres et se rapprochait peu à peu de ma place, je récitais des prières avec une ferveur que le ciel a appréciée, car on a été content de moi. Grand Dieu, quel poids m'est tombé du cœur ! Vous n'avez peut-être pas idée de ces émotions-là ? Figurez-vous ce silence où je sentais la joie qu'on aurait de me voir encore aplatie ; cette fois ce serait pour de bon — car amis ou ennemis sont les mêmes dans ces choses-là. — Enfin, c'est passé, la semaine prochaine je pourrai supporter l'éreintement qu'on voudra.
Dimanche 16 mars 79.
Coco est mort, écrasé par une charrette, devant la porte.
Quand je l'ai appelé à dîner, on me l'a dit. Après le chagrin que m'a causé la perte du premier Pincio, remplacé par la Pincia actuelle, celui-ci me parait moins... Mais, si vous avez un chien né à la maison, jeune, bête, joueur, laid, bon, gentil, venant vous sauter au cou et vous regarder avec deux yeux anxieux et inconscients comme ceux des enfants, vous comprendrez que la perte du mien me fait mal.
Où vont les âmes des chiens ? Ce pauvre petit être long, blanc, déplumé, car il n'avait pas plus de poil sur le train de derrière que sur les épaules, une énorme oreille toujours en l'air et l'autre tombante ; en un mot, j'aime dix fois mieux un chien laid comme ça que ces affreuses bêtes qu'on paie cher.
Il ressemblait à un animal de l'Apocalypse ou à un monstre sculpté sur les toits de Notre-Dame.
Pincia n'a pas l'air de s'apercevoir qu'on lui a tué son fils ; il est vrai qu'elle attend une nouvelle famille.
Ils se nommeront tous Coco ou Coquelicot. Je crois que l'on dit que les chiens n'ont pas d'âme, et pourquoi ça ?
Mardi 1er avril 79.
Pourquoi la gaieté doit-elle être plus agréable que l'ennui ? Il n'y a qu'à se dire que l'ennui me plaît et m'amuse.
Réminiscence du Manuel d'Épictète, très commode ; mais je pourrais répondre que les impressions sont involontaires ; ainsi, quelque fort que l'on soit, on aura toujours eu là le premier mouvement après lequel on pourra s'arranger à plaisir, mais il aura toujours et quand même été. Et il est bien plus naturel de continuer dans la voie de la première impression, de l'impression naturelle, en attendant ou en augmentant le sentiment éprouvé, que de le retourner, le tordre, le dévier et d'estropier ses sentiments au point de les assimiler les uns aux autres, ou, pour mieux dire, au point de tout ri confondre, effacer et ne se soucier plus de rien... Ne plus vivre : voilà pourtant où je veux m'amener. Il serait plus court de... Mais non... alors tout serait fini.
Il n'y a d'odieux dans ce monde que de n’en être pas, de vivre caché et de ne voir personne d'intéressant, de ne pouvoir échanger une idée, de ne voire encore ni les hommes célèbres, ni les hommes du jour. Voilà la mort, voilà l'enfer !
Je ne parlerai que de ce qu'on est convenu d'appeler malheurs ; eh bien, on ne devrait pas s'insurger et se plaindre ; les malheurs mêmes sont des jouissances, et on doit les accepter comme les éléments indispensables de la vie. Supposons que je perde un être bien-aimé, croyez-vous que cela ne me fasse rien ? Au contraire, je serais désespérée, je pleurerais, gémirais, crierais, puis cela se fondrait en tristesse pour longtemps, pour toujours peut-être.
Je ne trouve pas cela charmant, je ne le désire pas, je ne le préfère pas ; mais je suis obligée de dire que ce serait vivre, et par conséquent jouir.
On perd son mari ou son enfant, on est trompé par son ami, on pousse des cris de reproche envers la destinée, j'en ferais sans doute autant ; mais ces manifestations sont dans l'ordre des choses et Dieu ne en offense pas, et l'homme- ne s'en offense pas non plus, sentant que ce sont là les conséquences naturelles et inévitables de la douleur qu'on éprouve. On gémit, mais on ne crie pas au fond de l'âme que cela ne doit pas être; sans s'en apercevoir, on accepte.
Il arrive qu'on s'isole, qu'on se cloître après. Vous entendez bien, après ? Il arrive aussi, souvent, qu'on se trouve heureux tout seul, c'est-à-dire avec un homme ou avec les parents auxquels on songe et pour lesquels on vit ; mais moi, je parle pour les personnes toutes seules... D'ailleurs, aujourd'hui j'ai pris ma famille en grippe comme une des causes de mes souffrances. Et puis, je ne parle pas pour les silencieux et inconnus héros décrits dans les romans par des gens qui les inventent ou les copient sur nature, pour ne pas rester comme eux.
Vous vous figurez que je me plains d'une vie calme et désire le bruit ? May be, mais ce n'est pas cela.
J'aime la solitude et je crois même que si je vivais, je m'isolerais de temps en temps pour lire, méditer, me reposer; alors, c'est un charme, un bonheur doux et exquis. Par les grandes chaleurs, vous êtes enchanté de vous fourrer dans une cave ; mais y rester longtemps ou toujours !
Maintenant, si quelqu'un de malin voulait se donner la peine de me confondre, il me demanderait si je consentirais à acheter la vie par la mort de ma mère, par exemple. A cela, je répondrais que je ne le voudrais même pas au prix d'une vie moins chère, puisque, d'après la nature, la mère est ce qu'on aime le plus.
J'aurais des remords affreux, je ne voudrais pas par égoïsme.
Jeudi 3 avril 79.
Après tout, la vie est bonne, je : chante et je danse quand je suis toute seule, car la solitude complète est une grande jouissance. Mais quel supplice, quand elle est troublée par les domestiques ou par la famille !... Pourtant la famille?... Écoutez, ce matin, en revenant de l'atelier, je me suis imaginée heureuse, et vous ne pouvez croire quelle tendresse j'ai trouvée au fond de mon cœur pour tous les miens, pour cette bonne tante, toute dévouement et abnégation ; mais voilà, je ne suis pas heureuse.
La petite Elsnitz me rend la vie amère. Je ne prends plus de thé parce qu'elle le verse, et quand je suis obligée de manger du pain qu'elle a touché de ses mains ! ! ! Je gagnerais un anévrisme en courant comme une folle par les escaliers pour faire une seconde de chemin sans elle, en la devançant. Pour prendre la carafe ou le vinaigrier, je les prends tout au rebours pour ne pas toucher ce qu'elle a touché. Elle a de l'insecte, cette pauvre fille, et son air plaintif et ses ongles noirs me font mal et m'écœurent.
Samedi 5 avril 79.
Robert-Fleury malade a à peine corrigé ; d'ailleurs, ce que j'ai fait n'est pas fameux.
Sarah veut me réconcilier avec Breslau, je fais des difficultés, mais j'en serai heureuse au fond.
La verdure artificielle sur la cheminée a pris feu à des bougies bleues, et la glace a craqué.
Mais les malheurs n'arrivent pas parce que les glaces craquent ; ce sont les glaces qui craquent parce que les malheurs doivent arriver ; il faut savoir gré de l'avertissement.
Dimanche 6 avril 79.
J'ai un petit chapeau du matin si comme il faut, que je ne crains pas d'aller toute seule passer ma matinée au Louvre. Mais comme, tout en étant distingué, ce chapeau me va, j'ai fait la conquête d'un jeune artiste qui me suit tout le temps et risque un salut dans un corridor où il n'y a personne; mais je n'ai rien vu et il en a été assez décontenancé.
Mardi 15 avril 79.
Julian est entré en annonçant la mort de notre Empereur ; j'en fus tellement saisie que je n'y comprends rien. Tout le monde s'est levé pour me voir : je devins blanche, des larmes dans les yeux, des lèvres tremblantes. Me voyant toujours me moquer de tout, l'aimable Julian a voulu rire ; la vérité est qu'un individu a tiré quatre coups à bout portant et que l'Empereur n'a pas été atteint.
Et Julian se tapait les cuisses et s'écriait qu'il ne m'aurait jamais crue capable d'une telle émotion. Mais, ni moi non plus.
Mercredi 16 avril 79.
Une conversation assez drôle avec Breslau ; nous étions dans l'antichambre, elle, Sarah et moi. J'ai donné une orange à Sarah qui en offrit la moitié à Breslau, et lui dit en riant : — Prenez, c'est de moi et pas de Mlle Marie, — et comme elle hésitait, j'ai cessé de laver mes pinceaux et, me tournant vers elle : — Je vous l'offre, dis-je, en souriant ; elle en fut tout interdite, prit l'orange et rougit ; moi aussi.
— Ce que c'est que d'avoir des oranges, dis-je, en en pelant une seconde ; prenez-en encore, Mademoiselle.
— Regardez donc Sarah, nous avons piqué toutes les deux un soleil !
— C'est si bête ! dit Sarah.
— Vous êtes comblée de mes bienfaits, dis-je en riant à Breslau, en lui offrant une nouvelle tranche !
— Vous voyez bien que je me fiche de vous ! me dit-elle en la prenant.
— Pas tant que moi de vous. Mais, si vous vous fichiez de moi tant que cela, vous seriez moins rouge.
— Je me fiche aussi de moi.
— Ah ! fort bien alors.
Et comme cela devenait assez tendre, je me mis à les regarder en riant : — Je vous admire !
— Moi ? demanda Breslau.
— Oui, vous.
— Vous faites bien.
— Parbleu !
Et c'est tout.
— Venez-vous, Sarah ? dit Breslau. Je me remis à ma lessive. — C'est enfant.
Vendredi 18 avril 79.
J'ai cherché une coiffure empire ou directoire, ce qui m'a fait lire la notice sui Mme Récamier, et naturellement je suis aplatie en pensant que je pourrais avoir un salon et que je ne l'ai pas.
Les bêtes vont crier que je me crois aussi belle que la Récamier et aussi spirituelle qu'une déesse.
Laissons crier les bêtes et contentons-nous de dire que je mérite un sort meilleur, et la preuve c'est que tous ceux qui me voient s'imaginent que je trône et que je suis une femme remarquable. On pousse un immense soupir et l'on se dit : Mon jour viendra peut-être... Je suis habituée à Dieu, j'ai essayé de n'y pas croire, mais je ne peux pas... Ce serait un effondrement général, un chaos ; je n'ai que Dieu, un Dieu qui s'occupe de toutes mes petites choses et auquel je parle de tout.
Lundi 21 avril 79.
Dernier jour de concours, assez animé.
Samedi, je suis allée avec Lisen (Suédoise) voir des artistes aux Batignolles, près du cimetière Montmartre, par-là, en haut. Et je découvre que je ne déteste, à Paris que les boulevards et les nouveaux quartiers. Le vieux Paris et les hauteurs, là où j'étais samedi, respirent un parfum de poésie et de tranquillité qui m'a empoignée.
Mardi 6 mai 79.
Je suis très occupée et très contente, je me tourmentais parce que j'avais des loirsirs, je le vois à présent. Depuis vingt jours ou trois semaines, travail de huit heures à midi et de deux à cinq, et rentrée à cinq heures et demie ; je travaille jusqu'à sept heures, et puis quelques esquisses ou une lecture le soir, ou bien un peu de musique, et à dix heures, je ne suis bonne qu'à me coucher.
Voilà une existence qui ne permet pas de penser que vie est courte.
La musique, le soir ; Naples !... Voilà des choses qui troublent... Lisons Plutarque.
Mercredi 7 mai 79.
Si cette rage de travail pouvait durer, je me proclamerais tout à fait heureuse. J'adore le dessin et la peinture, et la composition et le croquis, crayon et la sanguine; je n'ai pas eu une velléité, de repos ou de paresse.
Je suis contente ! Un mois de jours comme cela présente des progrès de six mois ordinaires. C'est si amusant et c'est si adorable, que je crains que cela cesse ! Dans des moments comme ça, j'ai foi en moi.
Jeudi 8 mai 79.
Ma pauvre enfance voyait des preuves d'amour dans l'intérêt que je prenais à lire des histoires de cardinaux, au temps d'A...; aujourd'hui j'ai lu des histoires de peintres avec le même intérêt et j'ai même eu des battements de cœur, au récit d'histoires d'atelier.
Samedi 10 mai 79.
Pas mal ma peinture et le ton pas désagréable. Pour la composition, Julian l’a trouvée très bien, quant à la façon dont c’est exprimé, groupé, composé ; mais c’est mal exécuté ; il a ajouté du reste que, dans les concours de composition, on ne regardait pas à cela, ce qui se comprend très bien.
Lundi 12 mai 79.
Je suis jolie, heureuse et gaie. Nous allons au Salon et puis l'on cause de tout, parce que nous avons rencontré Béraud, le peintre, que nous avons intrigué au bal et qui est passé à côté de moi, sans se douter de rien.
La peinture de Breslau est une grande belle toile occupée par un grand beau fauteuil en cuir doré, dans lequel est assise son amie Maria, en robe vert foncé éteint, quelque chose de bleu gris au cou ; une main tient un portrait et une fleur, l'autre un paquet de lettres qu'elle vient de nouer d'une faveur rouge. Arrangement simple, sujet connu. Dessin admirable et grande harmonie de tons, qui sont d'un effet presque charmant.
Je ne sais si je vais dire une énormité, mais vous savez bien que nous n'avons pas un grand artiste. Il y a Bastien-Lepage ; les autres ?... c'est du savoir, de l'habitude, de la convention, de l'école ; beaucoup de convention, énormément de convention.
Rien de vrai, rien qui vibre, qui chante, qui empoigne, qui donne le frisson, qui fasse pleurer.
Je ne parle pas de la sculpture, je n'en ai jamais assez vu pour en parler. Quand on voit les atroces papillotements des tableaux de genre et les horribles médiocrités prétentieuses, les portraits ordinaires ou bons, on est près d'être écœuré.
Pour aujourd'hui, je n'ai trouvé de bien que le portrait de Victor Hugo, par Bonnat, et puis peut-être la toile de Breslau...
Le fauteuil de Breslau est mal dessiné, la femme a un peu l'air de s'y cramponner parce qu'il semble pencher vers le public, c'est dommage. Je cite Bonnat, parce qu'il a du vrai, et Breslau parce que je trouve que tous ses tons calmes chantent.
Je n'admets pas qu'on fasse comme L..., les mêmes doigts de pieds à toutes ses femmes... Cela m'irrite et m'enrage.
Mercredi 14 mai 79.
Au lieu d'aller au Salon, j'ai travaillé à mon esquisse... La mort d'Orphée.
Je crois que la composition ne m'embarrasse pas plus que le dessin ; j'ai des idées de gloire et de bonheur et de tout ce qu'il y a de meilleur au monde.
Vendredi 16 mai 79.
Le Salon est une mauvaise chose parce qu'en voyant les saletés, les vraies saletés qui s'y trouvent, on commence à se croire quelqu'un, quand on n'est encore rien.
Dimanche 30 mai 79.
Jeanne a posé et nous l’avons retenue à dîner.
Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une femme bien née, parfaitement élevée, très instruite et intelligente. Elle est mal mise et on la prend pour une planche, tandis qu'en réalité, elle a un des plus beaux corps qu'on puisse voir, tout en étant brune et mince.
Elle a des yeux magnifiques, la bouche est de la même dimension que les yeux et que la largeur du nez. Le nez est très grand, mais beau et noble. Un cou de cygne. Elle rappelle la reine d'Italie, tout en étant très brune ; pas de peau, par exemple, la peau est assez blanche.
Comme vous savez, elle a épousé le baron de W…. fils, une affreuse brute.
La pauvre femme était sur le point de mourir, quand sa famille l'a sauvée en plaidant en séparation. Pauvre femme ! Elle le déteste. Vous comprenez que, dans ce cas, il vaut mieux se noyer que de vivre avec son mari. D'ailleurs, je crois que Jeanne ne pourrait aimer personne. C'est une femme de Temple, si vous avez lu l'Homme-Femme.
Jeudi 5 juin 79.
Jeanne a posé et puis nous sommes allées ensemble chez Mme de Souza, qui reçoit le jeudi. Et le soir chez les L..., maman y est venue avec moi, quoiqu'en deuil encore, pour mieux frapper l'imagination des maîtres de la maison.
M. de L... prend une bougie et nous mène visiter les enfants tous couchés et endormis. C'est tout à fait comme un guide qui vous montre les curiosités d'un musée. On emmène les invités par série et on leur montre les neuf miracles, vu l'âge du père.
Samedi 7 juin 79.
Mme de L... nous a envoyé tous ses sept enfants avec trois bonnes.
Mais disons d'abord que le ton de ma peinture n'était pas mal (pour moi. c'est l'important), mais la construction ! R.-F. m'a grondée. Il ne faudrait pourtant ne pas me désoler ; m'appliquant surtout à la couleur, j'oublie la construction que je retrouverai quand la couleur ne me troublera plus ; on ne perd pas ce qu'on a. C'est égal, je suis dans un nuage noir.
Donc ces enfants de L... sont une chose curieuse. ils sont habitués à être donnés en spectacle et exécutent des mouvements ordonnés; au bout de cinq minutes de séjour, ils étaient comme chez eux ; ils ont demandé que je fasse leurs portraits, chacun a posé à son tour ; j'ai mis quatre ou cinq minutes à les croquer tous les sept, et l'aîné a trouvé que c'était très bien fait, et puis il a voulu que je mette les numéros et les noms sous chaque figure.
Je suis abrutie, déferrée, embêtée.
Lundi 9 juin 79.
C'est sans doute le temps chaud et lourd qui me rend bonne à rien. J'ai travaillé toute la journée, du reste... Je suis bien décidée maintenant à ne plus manquer au travail, mais je suis rompue. Ce soir, nous allons au bal des Affaires étrangères. Je serai encore laide ; je suis endormie et je voudrais bien me coucher.
Je n'ai pas soif de succès d'estime, et je sens que je serai laide et bête.
Je ne pense même plus aux « conquêtes ». Je m'habille bien, mais je n'y mets plus d'âme et je ne me souviens jamais de penser à l'effet que je produis. Je ne regarde rien et personne, et je m'ennuie. Il n y a que la peinture. Je n'ai plus d'esprit, je n'ai plus d'à-propos ; quand je veux parler je suis terne ou extravagante, et puis... Il faut que je fasse mon testament, car cela ne durera pas.
Samedi 14 juin 79.
J'ai dessiné cette semaine et on a trouvé que ce n'est pas assez bien pour moi.
Assez du monde !
Dimanche 15 juin 79.
Pour le moment, j'envoie promener tous mes soucis et je suis bien décidée à travailler. Julian est un grand homme, quant à la façon dont il entend les devoirs qui m'incombent, et il dit qu'il faut que j'arrive, justement parce que... Nous nous entendons, aimable postérité, n'est-ce pas ?
Il faut commencer l'année prochaine, dit toujours l'illustre directeur des Folies-Julian.
Oui, c'est convenu et vous verrez bien, grand-père Julian, que j'ai du sang dans les veines !
En somme, vous m'excitez pour l'argent que je rapporte et l'honneur que je rapporterais à l'atelier, qu'importe ! Et puis, que je travaille bien ou mal, vous, êtes payé tout de même.
Vous verrez, si je ne suis pas morte !... Le cœur me bat et j'ai la fièvre en pensant qu'il ne me reste plus que quelques mois.
Je travaillerai beaucoup, autant que possible tout le temps. Demain, j'irai à Versailles, mais si je ne manque que pour aller à Versailles, cela ne sera pas énorme ; tout au plus, tout au plus une après-midi par semaine.
Julian a déjà constaté une reprise de travail respectable, il va voir et je ne manque jamais de faire mes compositions hebdomadaires. J'ai un album où je les projette, numérote et intitule, en marquant la date de chacune.
Samedi 21 juin 79.
Voilà près de trente-six heures que je ne cesse presque de pleurer, je me couchée exténuée hier.
Nous avions deux Russes à dîner, Abigink et Sévastianoff, gentilshommes de la chambre de l'empereur, Tchoumakoff et Bojidar ; mais je n'étais bonne à rien. Mon esprit sceptique et gouailleur était parti. Il m'est arrivé de perdre des parents et d'avoir d'autres chagrins, mais je ne crois pas avoir jamais pleuré quelqu'un comme je pleure celui qui vient de mourir. Et c'est d'autant plus frappant qu'en somme cela ne devrait pas me toucher du tout, je devrais plutôt m'en réjouir. — Hier, à midi, je quittais l'atelier lorsque Julian siffla la bonne qui mit l'oreille au tuyau et qui nous dit aussitôt, passablement émue :
— Mesdames, M. Julian vous fait dire que le prince impérial est mort.
Je vous assure que j'ai poussé un vrai cri. Je m'assis sur le coffre à charbon. Et comme tout le monde parlait à la fois :
— Un peu de silence, s'il vous plaît, Mesdames. C'est officiel, on vient de recevoir la dépêche. Il est tué par les Zoulous. C'est M. Julian qui me le dit.
On avait déjà fait courir ce bruit ; aussi lorsqu'on m'apporta l'Estafette avec ces mots en grosses lettres : Mort du Prince Impérial, je ne puis vous dire à quel point j'en fus saisie.
D'ailleurs, à quelque parti qu'on appartienne, que l'on soit Français ou étranger, il est impossible de ne pas subir l'impression générale, qui est la stupeur.
Cette épouvantable, cette intempestive mort est une chose affreuse.
Mais, je vous dirai ce que ne dit aucun journal, c'est que les Anglais sont des lâches et des assassins. Ce n'est pas naturel, tout cela !... Il y a un ou plusieurs coupables, infâmes, vendus. Est-ce qu'on expose un prince, l'espoir d'un parti ? Un fils ?... Non, je ne crois pas qu'il y ait une seule bête fauve qui ne s'attendrisse en pensant à la mère ! Les plus affreux malheurs, les pertes les plus cruelles, laissent toujours quelque chose, un rayon, un soupçon de consolation, d 'espoir... Ici il n'y a rien. On peut dire sans craindre de se tromper que c'est une douleur comme il n'y en a jamais eu. Il est parti à cause d'elle, elle l'ennuyait, le tourmentait, ne lui donnait pas 500 francs par mois et lui rendait l'existence difficile. L'enfant est parti en mauvaise intelligence avec sa mère.
Voyez-vous toute l'atrocité de la chose ? Voyez-vous cette femme ?
Il y a des mères aussi malheureuses, mais aucunes n'a pu ressentir autant le coup ; car l'impression universelle augmente la douleur d'autant de millions de fois qu'il y a de bruit et de sympathie ou même d'injure autour de cette mort.
Le monstre qui lui a annoncé cette nouvelle aurait mieux fait de la tuer.
Je suis allée à l'atelier et Robert-Fleury m'a fait beaucoup de compliments, mais je suis revenue pour pleurnicher encore et puis j'ai été chez Mme G. où tout le monde est en deuil et les yeux gonflés, à commencer par ceux de la concierge.
M. Rouher est resté une demi-heure sans parler. On a cru que c'était fini, et puis il n'a cessé de pleurer tout le temps. Et Mme Rouher a eu toute la soirée des crises nerveuses, criant que son mari allait mourir et qu'elle voulait mourir.
Alors Mme G. interrompt son récit, et avec conviction :
— Vraiment, dit-elle, dans des moments pareils, on devrait s'arranger pour ne pas avoir des attaques de nerfs... C'est très incommode ! ajoute-t-elle très sérieusement.
Je retenais mes larmes, car on n'aurait pas compris ce que j'avais, mais je n'ai pu m'empêcher de sourire en entendant Mme G... faire son récit à quelques femmes en deuil, et dire que Mme Rouher, en apprenant la nouvelle, est tombée les quatre fers en l'air. On prend le deuil pour six mois : « on s'en dégoûtera sans doute avant, mais les premiers jours, vous comprenez !.... »
Ces Anglais ont toujours été hideux pour les Bonaparte, qui ont toujours eu la stupidité d'aller vers cette noble Angleterre, contre laquelle je me sens une haine et une fureur accomplies.
On se passionne bien, on pleure bien, sur un roman. Comment ne pas être remuée jusqu'au fond de l'âme sur cette catastrophe épouvantable, par cette fin horrible, odieuse, navrante ! J'ai tout de suite pensé que C... se tournerait vers la famille de Jérôme, et c'est ce qui est arrivé en effet.
En somme, voilà tout un parti sur le pavé. Il leur faut un prince pour la contenance au moins, et je crois qu'ils ne se désuniront pas ; quelques-uns, les moins compromis, iront à la République, mais les autres continueront à soutenir une ombre quelconque. Qui sait d’ailleurs ? Le roi de Rome mort, n'a-t-on pas cru que tout était fini ?
Mourir ? dans un pareil moment ! Mourir à vingt-trois ans, tué par des sauvages et combattant pour des anglais ! !
Je crois qu'au fond de leurs cœurs, ses plus cruels ennemis sentent comme une espèce de remords.
J'ai lu tous les journaux, même ceux qui insultent ; Je les ai arrosés de mes larmes.
Je serais Française, homme, bonapartiste, que je ne serais pas plus révoltée, plus outrée, plus désolée. Mais pensez donc à cet enfant, que les quolibets des sales journaux radicaux ont fait partir, à l'enfant qui est attaqué, assassiné par des sauvages !
Les cris qu'il a poussés, les appels désespérés, souffrance, l'horreur de l'impuissance. Se voir mourir dans un coin inconnu, affreux, abandonné, livré presque. Aussi partir comme ça, tout seul avec des Anglais.
Et la mère !
Et les feuilles anglaises ont l'infamie d'insinuer qu'il n'y avait aucun danger dans l'endroit où se faisait la reconnaissance. Est-ce qu'il peut y avoir sécurité dans un tel pays, au milieu de sauvages ennemis pour une troupe de quelques hommes ?
Il faut être fou ou idiot pour le croire. Mais lisez les détails. On l'a laissé là trois jours, et ce Carrey ne s'est aperçu que trop tard que le prince manquait.
En voyant les Zoulous, il s'est sauvé avec les autres sans s'occuper du prince.
Non, voyez-vous, le voir imprimé dans leurs journaux et se dire que cette nation n'est pas exterminée, qu'on ne peut pas anéantir leur île maudite et ce peuple froid, barbare, perfide, infâme ! Oh ! si c'était en Russie ; mais nos soldats se seraient fait tuer jusqu'au dernier !
Et ces infâmes l'ont abandonné, livré !
Mais lisez donc les détails, et si vous n'êtes pas saisis de tant d'infamie, de lâcheté !
Est-ce qu'on s'enfuit sans défendre ses camarades ?
Et l'on ne pendra pas le lieutenant Carrey !
Et la mère, l'Impératrice, pauvre Impératrice ! Tout est fini, perdu, anéanti ! Plus rien ! qu'une pauvre mère vêtue de noir.
Lundi 23 juin 79.
Je suis toujours sous l'impression douloureuse de cet atroce événement.. Le public, un peu revenu de sa stupeur, se demande par quelle criminelle imprudence le malheureux enfant a été livré aux sauvages.
La presse anglaise s'émeut de la lâcheté des compagnons du prince. Et moi, qui n'y suis pour rien, en lisant ces lamentables détails, je sens le souffle me manquer et les larmes qui me montent dans les yeux. Je n'ai jamais été plus dérangée, et les efforts que je fais toute la journée pour ne pas pleurer m'oppressent. On dit que l'Impératrice est morte cette nuit, mais aucun journal ne confirme cette nouvelle affreuse et consolante. Ce que j'ai de rage dans le cœur, quand je pense qu'il eût été si facile de prévenir ce crime, ce malheur, cette infamie !
On voit encore des figures consternées dans la rue et il y a des marchandes de journaux qui pleurent. Et moi, je fais comme les marchandes de journaux, tout en avouant que ce n'est ni explicable, ni naturel. Je voudrais tant prendre le vrai deuil avec du crêpe. Cela répondrait bien à la disposition de mon esprit.
Qu'est-ce que ça vous fait ? me dira-on. Je ne sais pas ce que ça me fait, ça me fait très mal.
Il n'y a personne, je suis enfermée chez moi, je n 'ai pas à poser et je fonds en larmes, ce qui est bête parce que cela m'affaiblit les yeux ; déjà ce matin, je l'ai senti en travaillant. Mais je ne puis me calmer à la pensée des circonstances fatales, horribles, épouvantables qui entourent cette mort, à la scélératesse de ses compagnons.
Il eût été si facile d'éviter cela !
Mercredi 2 juillet.
Ayant lu d'autres dépositions de soldats anglais, je suis arrivée à l'atelier si dérangée, qu'il m'a fallu gratter ma peinture et m'en aller.
Jusqu'à samedi j'aurai le temps de faire un profil de Dina, qui est embellie autant que je suis devenue laide.
Mercredi 16 juillet 79.
Je suis extraordinairement lasse ; on dit que la fièvre typhoïde commence comme cela.
J'ai fait de mauvais rêves. Si j'allais mourir ? Et je suis tout étonnée de n'être pas effrayée de mourir. S'il y a une autre vie, elle sera certainement meilleure que celle que j'use ici-bas. Et s'il n'y a rien après la mort ? Il y a d'autant plus lieu de ne rien craindre et de désirer voir finir des ennuis sans éclat et des tourments sans gloire. Il faut que je fasse mon testament.
Je commence à travailler à huit heures du matin, et vers cinq heures je suis si fatiguée que ma soirée est perdue ; pourtant il faut que j'écrive mon testament.
Lundi 21 juillet 79.
Nous n'avons décidément pas d'été, il fait de plus en plus froid.
Le modèle de cette semaine, pour toute la journée est une femme rousse d'une beauté étonnante.
Des formes sculpturales et une couleur comme je n'en ai jamais vu. Elle ne restera pas longtemps modèle aussi nous en profitons avec rage.
Dimanche 3 août 79.
Mon chien Coco II a disparu ? C'est arrivé pendant que nous étions au théâtre Je fus surprise de ne pas le voir se précipiter à mon arrivée et j'allai voir chez les autres ; alors on me dit qu'il était perdu. Ça vous est égal, mais moi qui aimais cette pauvre créature énormément, qui l'avais baptisée avant sa naissance et qui m'y étais attachée autant qu'elle m'était attachée à moi !...
Mais vous ne pouvez pas comprendre quel chagrin c’est pour moi. Je restais toujours à travailler avec ce chien qui ne me quittait jamais... Les miens, qui savent que je suis peinée, gardent un silence morne. Maman a couru toute la soirée.
En rentrant, je suis descendue dans la rue et j'ai prié les sergents de ville de le rapporter s'ils le trouvent.
On a déclaré à tous les domestiques qu'ils doivent rapporter ce chien ou s'en aller. C'est le quatrième chien en un an. D'abord Pincio, puis Coco Ier, il y a huit jours Niniche, et hier mon chien.
Lundi 4 août 79.
Je ne pouvais pas m'endormir, j’avais toujours devant les yeux ce pauvre petit chien encore bête, qui s'est sauvé effrayé par le concierge et qui ne sait où aller.
J'ai même daigné verser quelques larmes, après quoi j'ai prié Dieu de me le faire retrouver. J'ai une prière spéciale que je me dis tout bas quand je demande quelque chose. Je ne me souviens pas de l'avoir dite sans en ressentir du soulagement.
Ce matin, on m'a réveillée en me rapportant le chien, et ce misérable avait si faim qu'il ne m'a pas trop témoigné sa joie.
Je le considérais comme perdu et ma famille répétait toujours qu'on l'avait tué, pour me mettre l'esprit en repos.
Maman crie que c'est un vrai miracle, car jamais nous n'avons retrouvé de chien. Elle le crierait bien plus si je lui disais ma prière ; mais je ne le dis qu’ici, et encore en suis-je mécontente : il y a des pensées et des prières si intimes que lorsqu'on les dit ou écrit, on paraît bête et maladroit.
Samedi 9 août 79.
Partir ou rester ? Les malles sont faites. Mon docteur ne paraît pas croire à l'efficacité des eaux du Mont-Dore. Qu'importe, j'y vais me reposer. Et en revenant il me faudra mener une existence incroyable.
Je peindrai tant qu'il fera jour et je sculpterai le soir.
Mercredi 13 août 79.
Depuis hier, à une heure de la nuit, nous sommes à Dieppe.
Est-ce que toutes ces villes de mer sont les mêmes J'ai été à Ostende, à Calais, à Douvres, et je suis Dieppe. Cela sent le goudron, le bateau, les cordages, la toile cirée. Il fait du vent, on est exposé de tous côtés et l'on se croit en détresse. Cela sent le mal de mer. Quelle différence avec la Méditerranée ! Là on respire, là il y a de quoi admirer, là on est bien. Et ça ne sent pas toutes ces vilaines choses d'ici. J'aime déjà mieux un bon petit nid de verdure comme Soden, Schlangenbad et comma doit être le Mont-Dore.
Je viens ici pour respirer. Ah ! bien oui. Sans doute hors la ville et le port, l'air est meilleur. Toutes ces mers du Nord ne me plaisent pas. Et de tous ces hôtels d'ici on ne voit la mer que du troisième étage. 0 Nice, ô san Remo, ô Naples ! ! 0 Sorrente l ! ! Vous n'êtes pas de vains mots, vous n'êtes ni exagérés, profanés par les guides des voyageurs, vous êtes vraiment belles et divines ! ! !
Samedi 16 août 79.
Nous rions beaucoup et je m'ennuie bien, mais le rire est dans ma nature et est indépendant de mon humeur.
Avant, je m’intéressais aux passants dans une ville d’eaux, cela m'amusait.
Je suis devenue d'une indifférence complète. Qu'il y ait des hommes ou des chiens autour de moi, cela m'est égal. Je m'amuse encore le mieux toute seule à faire de la musique ou à peindre. Je m'attendais à faire dans ce monde tout autre chose que ce que j'y fais, et du moment que ce n'est pas ce que je croyais, peu m'importe ce que cela peut être.
On ne peut pas nier, du reste, que j'aie eu du malheur tout le temps.
Mardi 19 août 79.
J'ai pris mon premier bain de mer et tout cela ensemble fait que je voudrais bien avoir une excuse pour pleurer. J'aimerais mieux être habillée en ramasseuse de moules que d'avoir une robe bourgeoise. Du reste, c'est une nature malheureuse que la mienne : je voudrais une harmonie exquise dans tous les détails de la vie ; souvent des choses qui passent pour élégantes et jolies me choquent par je ne sais quel manque d'art, de grâce particulière et de je ne sais quoi. Je voudrais voir ma mère élégante, spirituelle ou, tout au moins, digne, fière... Fichue existence, va ! Vraiment, on ne tourmente pas ainsi les gens...
Des futilités ?... Tout est relatif et si une épingle vous fait autant de mal qu'un couteau, qu'est-ce que les sages ont à dire ?
Mercredi 20 août 79.
Je ne pense pas que je puisse jamais éprouver un sentiment où l'ambition ne soit pas mêlée. Je méprise les gens qui ne sont rien.
Jeudi 21 août 79.
Ce matin, je suis allée faire une pochade de la mère Justin, qui a soixante-treize ans, qui a eu dix-neuf enfants et qui fait le commerce de sable.
Il est venu du monde, mais j'ai fait semblant de ne voir personne, et puis il est venu une troupe de soldats faire je ne sais quel exercice sur la plage, et presque aussitôt une pluie battante ; mais je reviendrai demain. Cela m'amuse tant de faire des études en plein air, ces toiles vont donner du chic à mon atelier.
Il est bien entendu, n'est-ce pas ? que je n'affecte aucun dehors artistique et toutes ces vilaines poses de gens qui barbouillent sans talent et s'habillent comme des artistes.
Dieppe. Vendredi 22 août 79.
0 sublime Balzac ! tu es le plus grand génie du monde ; de quelque côté qu'on aille, on se retrouve toujours dans ta sublime comédie Il semble qu'il ait toujours vécu et copié sur nature. Je viens de voir deux femmes qui, par leur provenance, leur figure, leur vie, me font penser à Balzac, ce grand, cet inépuisable, cet incroyable génie.
Les miens sont revenus du théâtre. On trouve Mme S. laide ; c'est, du reste, ce que dit tout le monde.
Comment se fait-il donc que je la voie si charmante ?
Je veux bien qu'elle ne soit pas jolie ; mais avec mon œil d'artiste, je suis séduite par certaine qualités du dessin des lèvres et du nez, aux arêtes si vives. Elle n'a ni flétrissures de joue, ni poches sous les yeux, et puis des manières exquises.
Vendredi 29 août.
Le fatalisme est la religion des paresseux et des désespérés. Je suis désespérée je vous jure que je ne tiens pas à la vie. Je ne dirais pas cette banalité si je ne la pensais que sur le moment, mais je la pense toujours, même dans les moments joyeux. Je méprise la mort; s'il n'y a rien là-bas... c'est tout simple, et s'il y a quelque chose, je me recommande à Dieu. Mais je ne crois pas aller au paradis, car là-bas encore se continueront les tourments d’ici ; on y est voué.
Lundi 1er septembre 79.
J'espère que vous vous êtes aperçu du grand changement qui se fait en moi, petit à petit. Je suis devenue sérieuse et raisonnable, et puis je pénètre plus avant dans certaines idées, je comprends plusieurs choses que je ne comprenais pas et dont je parlais selon les circonstances, sans conviction. J'ai saisi aujourd'hui, par exemple, que l'on peut avoir un grand sentiment pour une idée et qu'on l'aime, comme on s'aime soi-même.
Le dévouement aux princes, aux dynasties me touche, m'enflamme, me fait pleurer et me ferait peut-être agir sous l'impulsion directe de quelque chose d'émouvant ; mais il y a au fond de moi un sentiment qui m'empêche absolument de m'approuver dans toutes ces fluctuations cardialgiques: Chaque fois que je pense aux grands hommes qui ont servi d'autres hommes, mon admiration pour eux boite et se dissipe. C'est une espèce de sotte vanité peut-être, mais je trouve presque méprisables tous ces... serviteurs, et je ne suis réellement royaliste qu'en me mettant à la place du roi. Et, voyez-vous, Gambetta n'est pas un vulgaire ambitieux ; il faut que l'intuition qui me le fait penser soit forte et motivée, pour que je le dise sincèrement, après avoir été pendant trois ans bercée par la presse réactionnaire.
Pour moi, je veux bien encore me voir inclinée devant des rois, mais je ne puis pas adorer ou estimer complètement un homme qui s'inclinerait.
Ce n'est pas que je refuse les rayons... non ; il bien entendu, n'est-ce pas, que je serais ravie d'être la femme d'un attaché à une ambassade ou à une cour (Seulement, ils sont sans dot ces gens-là : ils en veulent une.)
Mais ici, je parle de mes sentiments intimes. J'ai toujours pensé cela, mais on ne sait pas toujours dire ce qu'on pense Je veux bien d'une royauté constitutionnelle, comme en Italie ou en Angleterre, et encore. Je me révolte de voir ces saluts à la famille royale, c'est une humiliation inutile. Quand le roi est sympathique, comme l'était Victor-Emmanuel, qui représentait et servait une grande idée,.ou comme l'est la reine Marguerite, qui est adorable et bonne, passe ! Mais ils sont des accidents heureux, et il est bien plus naturel d’avoir un chef éligible, et par conséquent éternellement sympathique, entouré d'une aristocratie intelligente.
L’aristocratie ne se détruit pas et ne se crée pas en un jour; elle doit se maintenir, mais ne pas se renfermer pour cela comme dans une citadelle stupide.
Les anciens régimes sont la négation du progrès et de l'intelligence ! ! !
On crie contre les hommes, qu'est-ce donc que cela ?
Les hommes passent et l'on s'en débarrasse quand on n'en veut plus. On prétend que le parti républicain est plein d'hommes tarés. Je vous ai déjà dit, il y a de mois, mon idée là-dessus. On me parle de haine absurde contre la personnels rois. Ce n'est pas là Ia question. Ce n’est pas l'homme qui est mauvais, c'est la fonction qui est inutile.
Je respecte les familles illustres ; il y en a eu, il y en a, il y en aura ; le pays doit les honorer, mais de là a se mettre sur le dos un homme et sa postérité, irrévocablement, stupidement ! Non, pas cela ! Je ne dis rien contre la puissance de la race, au contraire !
Le césarisme copie les Romains. Pourquoi copier ? Si les intrigues et les manœuvres déloyales trompent le peuple, ce sera sa faute ! Mais avec les rois, il est dispensé de tout effort d'intelligence et n'a même pas la chance de bien choisir, quatre fois sur dix. C'est le vague, l'inconnu, la routine, l'imbécillité et la lâcheté. Si le peuple est bête et choisit mal, c'est qu'il ne mérite rien de mieux. Ces réflexions sont des réponses aux choses qu'on a l'habitude de dire contre la république.
Mais entendons-nous... Ma république est une république éclairée, polie, aristocratique ; que vous dirai-je ?... Athénienne, il l'a dit (1).
(1) Aristocratique, cela demande des réflexions et des explications. Aristocratie de race, absolument confirmée par les manières et l'éducation à défaut d'intelligence. Oui, car dans les relations de la société, ce sont des choses dont l'influence ne se peut nier. Du reste, il n'y a qu'une égalité possible, c'est l'égalité devant la loi ; toutes les autres égalités sont de mauvaises farces inventées par les ennemis de la liberté et réclamées par les ignorants.
Mercredi 3 septembre 79.
L'arrivée des déportés affichant des bonnets et des ceintures rouges est une vilaine chose. On ne devait jamais faire revenir ces gens-là. Ils s'étaient habitués là-bas et seront des étrangers ici. Dieu sait quelles complications peuvent surgir de ce retour de maris et de femmes après dix ans d'absence !
Je n'ai pas le temps de vous dire comment j’agirais avec l'opinion qui réclamait ce retour.
Paris. Mercredi 17 septembre 79.
C'est aujourd'hui un mercredi, jour favorable, un 17, date plutôt bonne, que je commence à me préparer à sculpter. Je suis allée m'informer des ateliers. Robert-Fleury est venu hier à l'atelier ; il n'y avait pas grand'chose à corriger il m'a donc donné de bons conseils en m'engageant à travailler le côté peintre, qui me manque jusqu'à présent, malgré les qualités de construction, dessin, caractère, ressemblance, etc.
Eh oui ! aussi vais-je faire de la sculpture au gaz, au lieu de dessiner. Vous comprenez, je ne perds pas la couleur, puisque je peins tant qu'il fait jour et aussitôt le jour parti, je sculpte. Est-ce convenu ? Oui, bien. Je me suis promenée avec Amanda (la Suédoise forte) et elle m'a raconté sa visite à Tony (qui a été très gentil pour moi, hier), avec lequel elle a parlé de toutes les élèves. Il lui a dit que A... pécherait toujours par le dessin et la construction, etc. En effet, elle produit des toiles insensées, des têtes à fluxion, des yeux de travers, etc. Quant à Breslau, il dit qu'elle n'a pas fait assez de progrès, et Julian ajoute que son talent n'est que de l'application. Emma est très bien douée, mais pas de travail et des idées folles. Et moi, extrêmement bien douée et en même temps travailleuse, appliquée, sévère ; progrès étonnants et rapides, dessins très bons ; en un mot « un concert de louanges ». C'est donc vrai, puisqu ils le disent à des étrangers ? Enfin, cela me donne du courage, je travaillerai mieux et encore plus.
J'ai envie d’aller à la campagne, une vraie campagne avec des arbres, des gazons, un parc. De la verdure comme Schlangenbad, ou même Soden, au lieu de ce sot et aride Dieppe ! Et on dit que je n'aime pas la campagne !
Je n'aime pas la campagne russe, les voisins, la maison, etc., mais j'adore les arbres et l'air pur, au point que je désire passer quinze jours dans quelque coin bien vert et bien parfumé, comme je désirais aller à Rome. Mais de Rome, je n'en parle presque jamais, même ici ; le sujet m'exalte et je veux rester tranquille.
C'est en traversant le jardin des Tuileries que j'ai été prise de toutes ces idées de villégiature. Que voulez-vous ? j'aime cela autant que je déteste les plages arides et venteuses... Mais aller quinze jours Suisse avec ma famille, ce serait joliment ennuyeux. Tracas, récriminations et tous les accessoires du bonheur domestique.
Mercredi 1er octobre 79.
Voici des journaux et je viens de lire les deux cents pages dont se compose la première livraison de la revue de Mme Adam. Tout cela m’a dérangée et j'ai quitté l'atelier à quatre heures pour me promener au Bois avec un nouveau chapeau qui fait sensation ; mais à présent, cela m'est égal. Je trouve bien heureuse, Mme Adam !
Je crois que vous me connaissez assez pour comprendre l'influence qu'exercent sur ma pauvre tête toutes ces questions si vivantes. Il n'y a rien à faire en fait de fidélité ancienne... J'aime toujours les violettes, mais uniquement comme fleur.
Je passe à la république et aux idées nouvelles. Aujourd'hui, me voilà empoignée par la Revue nouvelle ; qui sait si, à un moment donné, je n'irai pas m'enthousiasmer pour le prince Napoléon, que, du reste, je préfère à Napoléon III et qui est vraiment quelqu'un. Non, vous comprenez bien que je ne plaisante pas et que je suis aussi avancée qu'il est possible de l'être. Il faut marcher avec son temps, surtout lorsqu'on en sent réellement le désir et le besoin irrésistible.
Samedi 11 octobre 79.
J'ai lâché ma tête au milieu de la semaine ; par conséquent, comme Robert-Fleury passait du grand atelier dans le petit, je me suis dissimulée derrière les manteaux ; mais il m'a vue et m’a adressé un reproche amical, et, comme je répondais, poursuivait son chemin en hochant la tête et en me regardant ; ce qui fit qu'il ne regarda pas devant lui et alla s'aplatir le nez contre une porte, et moi de rire. Aussi a-t-il été très froid en corrigeant mon torse et ne m'a-t-il rien dit de bon. Une autre fois, avec la même toile, j'aurais eu un peu plus de succès ; aussi me voilà malheureuse, détraquée, offensée, perdue, et si Julian ne m'avait un peu réconfortée avec la composition j'aurais été me coucher par terre de désespoir. Chaque samedi me coûte cher d'émotion !... Si les professeurs, pouvaient soupçonner ce que je subis de tourments ils n'auraient le courage de rien dire.
Samedi 29 octobre 79.
Ma peinture est « beaucoup, beaucoup mieux ». Nous avons fait l'autre jour l'esquisse d'une heure pour les places. Et ce matin, on les étale dans le petit salon où l'on enferme Tony, qui refuse absolument à les numéroter, en disant que c’est impossible, que le travail d'une heure n'est rien, qu'enfin il veut bien y mettre des numéros au hasard et en tournant le dos. Si ce n'est pas très sérieux, c'est assez amusant, parce que nous écoutions à la porte.
— Mademoiselle Marie, dit-il, vous êtes jeune, j'aurais aussi bien pu vous mettre première, cela ne signifie rien ; une autre fois, vous me donnerez vos études de la semaine, d'après lesquelles je vous placerai, ceci n'a pas le sens commun.
Avec le n° 3, j'aurai une très bonne place pour le concours.
Gambetta est revenu à Paris.
Jeudi 30 octobre 79.
La France est un pays charmant et amusant : les émeutes, les révolutions, les modes, l'esprit, la grâce, l'élégance ; tout ce qui donne enfin à la vie du charme, de l'imprévu. Mais n'y cherchez ni gouvernement sérieux, ni homme vertueux (au sens antique du mot), ni mariage d'amour... ni même véritable art. Ils sont très forts, les peintres français ; mais, à part Géricault et actuellement Bastien-Lepage, le souffle divin manque. Et jamais, jamais, jamais la France ne produira ce qu'ont produit l'Italie et la Hollande dans un genre spécial.
Beau pays pour la galanterie et le plaisir, mais le reste ?... Enfin, c'est toujours cela, et les autres pays, avec leurs qualités solides et respectables, sont ennuyeux quelquefois. Du reste, si je me plains de la France, c'est que je ne suis pas mariée... La France, pour les jeunes filles, est un pays infâme, et le mot n'est pas trop gros. On ne peut mettre plus de froid cynisme dans l'accouplement de deux êtres, qu'on en met ici en mariant un homme et une femme.
Commerce, trafic, spéculation sont des mots honorables, appliqués proprement, mais ils sont infâmes appliqués au mariage, et pourtant il n'y en a pas de plus justes pour raconter les mariages français.
Samedi 8 novembre 79.
J'ai fini le portrait de la concierge : elle est très ressemblante. C'est une joie immense dans la loge ; fille, beau-fils, petites filles, sœurs, tout cela est dans le ravissement.
Malheureusement, Tony n'a pas partagé cet enthousiasme. Il a commencé par dire que ce n'est pas mal et puis... cela ne va pas aussi bien que cela devra aller. Il est incontestable que je ne suis pas douée au même point pour la peinture que pour le dessin. Le dessin, la construction, la forme, tout cela va tout seul. Le côté pictural ne se développe pas assez vite. Il ne veut pas que je perde mon temps ainsi. Il faut en sortir, il faut faire quelque chose pour cela.
— Vous pataugez, c'est évident, et comme vous êtes extrêmement bien douée, comme vous avez de très grandes dispositions, cela m'ennuie.
— Cela ne m'amuse pas non plus, Monsieur, mais je ne sais qu'y faire.
— Il y a longtemps que je veux causer de cela avec vous. Il faut essayer de tous les moyens, il ne s'agit peut-être que d'ouvrir une porte.
— Dites-moi ce qu'il faut faire, une copie, un plâtre, une nature morte ? Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez.
— Vous ferez tout ce que je vous dirai de faire ; eh bien ! alors, nous sommes certains d'en sortir. Venez me voir samedi prochain, et nous en causerons.
Il y a longtemps que j'aurais dû y aller un samedi. Toutes ses élèves le font. Enfin, c'est un bon garçon.
Lundi 10 novembre 79.
Je suis allée à l'église hier, j'y vais de temps en temps pour qu'on ne dise pas que je suis nihiliste.
Je dis bien souvent pour rire que la vie n'est qu'un passage. Je voudrais le croire sérieusement pour me consoler de toutes ces misères, de tous ces chagrins brutaux, de ces froissements ignobles.
Et le monde entier est si potinier ! C'est en éprouvant ce dégoût et cet étonnement en fait de potins de tous les jours que je me découvre pure de toutes ces mesquineries nauséabondes.
Vendredi 14 novembre 79.
Si pendant plusieurs jours je ne dis souvent rien, c'est que je ne trouve rien intéressant.
Jusqu'à présent, j'ai été charitable pour mes semblables ; je n'ai jamais dit ni répété le mal que l'on dit ; j’ai toujours pris la défense de n'importe qui attaqué en ma présence, avec la pensée intéressée que l'on en ferait peut-être autant pour moi ; j'ai toujours défendu même ceux que je ne connaissais pas, en priant Dieu de me le faire rendre ; je n'ai jamais eu sérieusement l’idée de faire du mal à qui que ce soit, et si je désirais la fortune ou la puissance, c'était avec des idées de générosité, de bonté, de charité dont la grandeur m'étonne ; mais cela ne me réussit pas. Je continuerai bien à donner vingt sous à un pauvre dans la rue, parce que ces gens-là me font venir les larmes aux yeux, mais je crois bien que je vais devenir mauvaise.
Ce serait beau pourtant de rester bonne, toute aigrie et malheureuse. Mais ce serait amusant de devenir méchante, mauvaise, calomniatrice, nuisible..., puisque cela est égal à Dieu et qu'il ne tient compte de rien. Du reste, il faut croire que Dieu n'est pas ce que nous imaginons. Dieu, c'est la nature même peut-être, et tous les événements de la vie sont présidés par le hasard, qui amène quelquefois des coïncidences étranges et des événements qui font croire à une Providence Quant à nos prières, à nos religions, à nos conversations avec Dieu..., je suis payée pour les croire inutiles.
Se sentir une intelligence, des forces à remuer le ciel et la terre, et n'être rien ! Je ne crie pas, mais tous ces tourments s'écrivent sur mon visage. On croit que cela ne fait rien lorsqu'on se tait, mais ces chose là reviennent toujours a la surface.
Samedi 15 novembre 79.
J'admire Zola, mais il y des choses que tout le monde dit et que je ne puis me décider à dire, ni même à écrire. Pourtant, pour que vous ne pensiez pas que ce sont des horreurs, je vous dirai que la plus forte est le mot purgé ; je suis fâchée de placer un tel mot ici ; je n'hésite pas à dire ni canaille, ni d'autres choses de ce genre; mais quant à ces petites saletés innocentes, elles me dégoûtent.
Mercredi 19 novembre 79.
Robert-Fleury vient ce soir et, outre qu'il me donne des conseils, nous passons une bonne soirée ensemble autour du samovar et dans mon atelier, d'autant plus qu'il m'explique très bien ce qu'il faut faire pour les lampes. Tony n'est ni payé ni intéressé ; en plus, c'est un homme sérieux, il a répété ce soir ce qu'il avait dit à Mme Breslau : que de tout l'atelier, il n'y a que sa fille et moi qui avons des dispositions exceptionnelles. Toutes les autres, rien. Il les passe en revue, et cela m'amuse de voir ainsi traiter tous ces orgueils.
De moi, il ne dit du bien que lorsque je sors de là chambre. Seulement il insiste beaucoup pour que je continue, ajoutant qu'il est certain que j'arriverai à un résultat ; que, pour un amateur, j'ai déjà du talent, mais que j'ai raison de voir plus haut ; qu'avec une direction plus suivie, je ferais plus de progrès ; qu'il s'occupera spécialement de moi ; qu'il viendra me donner des conseils chez moi ; qu'il me conseille de ne pas toujours travailler à l'atelier, de prendre de temps en temps un modèle chez moi, et le soir je sculpterai. Il viendra me donner les premiers conseils et puis, un soir, il m'amènera Chapu.
En un mot, je suis absolument sous son aile. Aussi, pour le payer un peu, je lui commande mon portrait, un petit ; et voilà que cela me gâte mon bonheur. Je crains que cela ne soit trop cher.
Cet homme a été toute la soirée tout ce qu'il y a de meilleur, en causant et en donnant des conseils. Ce qui m'ennuie, c'est de faire mes copies.
Samedi 21 novembre 79. (le 21 est un vendredi. ds)
Je suis allée lui porter ma copie : « Ce n'est pas encore assez large, pas encore assez de tenue. » J'en ferai encore la semaine prochaine : deux têtes de Rubens copiées par Robert-Fleury père ; — un grand artiste celui-là, — et puis, un petit bout de toile du même, mais original.
Comme j'admire beaucoup l'esquisse qu'il a faite pour son plafond du Luxembourg (lui Tony), il me l'offre de la façon la plus gracieuse, disant que cela lui fait grand plaisir de la donner à quelqu'un qui s'y connaît bien, qui apprécie...
—- Mais, Monsieur, il ne doit. pas manquer de gens qui apprécient votre peinture...
— Mais non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose...
Je m'enhardis déjà et n'en ai presque plus peur. Après l'avoir vu une ou-deux fois par semaine-pendant deux ans à l'atelier, il me semble tout drôle de causer avec lui et qu'il m'aide à mettre ma pelisse. Encore un peu et nous serons une paire d'amis. Sans ce portrait. je serais bien contente, car mon maître est tout ce qu'il y a de meilleur pour moi.
Lundi 23 novembre 79. (le 23 est un dimanche. ds)
Nous sommes allées inviter Julian à dîner et il a fait vingt mille façons, disant que cela lui ôterait toute autorité sur moi et qu'alors il n'y aurait plus moyen de marcher ; d'autant plus que le moindre semblant de complaisance de lui à moi semblerait du népotisme éhonté. On dira que nous lui donnons à dîner et que je fais ce que je veux chez lui, parce que je suis riche, etc. Le brave homme a raison. C'est, du reste, un système excellent de perfidie. L'Espagnole en a usé avec Breslau, qui a fini par être malhonnête envers moi, à force de s'entendre dire qu'elle était ma femme de chambre.
Mardi 24 novembre 79. (le 24 est un lundi. ds)
L'atelier du n° 37 est loué et presque aménagé.
J’y ai passé la journée : c'est très grand, avec des murailles grises. J'y ai apporté deux mauvais Gobelins qui masquent le mur du fond, un tapis persan, des nattes de Chine, un grand pouf algérien carré, une table à modèle, un tas de morceaux d'étoffe, des grandes draperies de satinette d'une nuance indécise et chaude.
Beaucoup de plâtres : les Vénus de Milo, de Médicis, de Nîmes ; l'Apollon, le Faune de Naples ; un écorché, des bas-reliefs, etc. ; un porte-manteau, une fontaine, une glace de 4 fr. 25, une pendule de 32 francs, une chaise, un poêle, un meuble en chêne à tiroir avec le dessus en boîte à couleur, un plateau complet pour aire du thé ; un encrier et une plume, un seau, un broc, des toiles en quantité, des caricatures, des études, les esquisses.
Demain, j'étalerai quelques dessins, mais je crains qu'ils ne fassent paraître mes peintures plus mauvaises. Un bras d'écorché et une jambe grandeur nature. Un squelette, une boîte de menuiserie. Il me faudrait encore l'Antinoüs.
Mercredi 25 décembre 79. (10 décembre. ds)
Nous sommes allées voir le Père Didon au couvent des Dominicains. Ai-je besoin de vous dire que le Père Didon est le prédicateur dont la gloire grandit à vue d’œil depuis deux ans et dont, en ce moment, tout Paris s'occupe. Il était prévenu; aussitôt que nous arrivons, on va l'appeler et nous l'altendons dans une cellule de réception, toute vitrée avec me table, trois chaises et un bon petit poêle ; j'avais déjà vu son portrait hier et je savais qu'il avait des yeux splendides.
Il arrive très aimable, très homme du monde, très beau avec sa belle robe de laine blanche qui me rappelle les robes que je portais autrefois. Sans la tonsure, ce serait une tête dans le genre de celle de Cassagnac, mais plus éclairée, les yeux plus francs, l'attitude plus naturelle, quoique très haute ; un visage qui commence à devenir épais et qui a le même quelque chose de désagréablement de travers dans la bouche que Cassagnac ; mais une grande distinction, pas de charme outré de créole, un teint mat, un beau front, la tête haute, des mains adorablement blanches et belles, un air gai et même, autant que possible, bon garçon. On voudrait lui voir une moustache.
Beaucoup d'esprit, malgré un grand aplomb. On voit tellement qu'il mesure toute l'étendue de sa vogue, qu'il est habitué aux adorations et qu'il est sincèrement heureux du bruit qui se fait autour de lui ; la mère M... l'a naturellement prévenu par lettre de la merveille qu'il allait voir et nous lui parlons de faire son portrait.
Il n'a pas refusé, tout en disant que ce serait difficile, presque impossible, une jeune fille faisant le portrait du Père Didon. Il est si en vue, on s'occupe tant de lui.
Mais c'est justement pour cela, idiot !...
On m'a présentée comme son admiratrice fervente. Je ne l'avais jamais ni vu, ni entendu, mais je le pressentais tel qu'il est, avec ses inflexions de voix passant des notes caressantes à des éclats presque terribles, même dans la simple conversation.
C'est un portrait que je sens tout à fait et, si cela pouvait s'arranger, je serais une bien heureuse personne.
Il a promis de venir nous voir, et, pendant un instant, j'ai désiré qu'il en restât à sa promesse ; mais c'est bête et faux ; ce que je désire à présent est qu'il consente à poser. Rien au monde ne ferait mieux mon affaire de peintre ambitieux.
Jeudi 26 décembre 79. (11 décembre. ds)
Nous allons nous promener en traîneau avec Mme G.
La soirée finit en farce ; ces dames, la princesse, Alexis et Blanc s'en vont aux Variétés, et nous, Dina, le comte de Toulouse et moi, tirons un souper au champagne de l 'armoire, et, après avoir soupé, nous arrangeons quatre couverts pour qu'on pense qu'il y a du monde, et je verse de l'eau au vin blanc dans la bouteille de Champagne vidée, que je bouche soigneusement ; même truc pour le foie gras que je recolle. Ils reviendront tous souper.
Bon appétit !
Dimanche 14 décembre 79.
Berthe est venue me prendre et, accompagnées de Bojidar, nous nous en allons à pied battre le quartier latin, place Saint-Sulpice, rue Mouffetard, rue de Nevers, la Morgue, rue des Anglais, etc.
Nous sommes montés en tramway pour un quart d'heure, et puis nous avons recommencé la marche ; cela a duré de trois à sept heures. Il n'y a rien d'adorable comme le vieux Paris ; il me rappelle Rome et les romans de Dumas, et Notre-Dame de Paris avec Quasimodo, et un tas de choses ravissantes et anciennes.
Nous avons acheté des marrons à un coin de rue et puis nous avons passé vingt minutes chez une marchande de chaussons où nous dépensâmes près de neuf francs, et chez une autre qui nous a presque dit des sottises parce que je marchandais : — Comment, Madame, vous marchandez pour sept francs et vous n'hésitez pas à mettre deux cents francs à un manteau de fourrure ! — J'en avais un sur moi de deux mille francs.
Au détour d'une rue, comme nos chaussons ne font aucun bruit, nous laissons filer Bojidar et nous nous cachons sous une porte ; mais il nous retrouve vite et nous allons dans deux compagnies de déménagement commander deux voitures à quatre chevaux pour transporter les meubles de M. A... Berthe donnait tranquillement les détails : deux pianos à queue, un bain, des armoires à glaces doubles, de la vaisselle, un billard, etc. Après, nous avions envie d'entrer partout et de dire des bêtises à tout le monde mais il était sept heures; il fallut prendre un fiacre qui, au bout de dix pas, flanque son cheval par terre et nous descendons; on ramasse la bête et nous nous remettons en chemin.
Sans compter qu'en tramway il y avait un couple très innocent à côté de nous, que nous avons fait poser en nous racontant entre nous des histoires, comme celle de cette jeune fille qui, dans un déraillement de chemin de fer, a reçu un choc si violent que ses deux genoux lui étant entrés dans la poitrine, lui sont sortis dans le dos.
Dimanche 28 décembre 79.
Paul se marie, moi je consens. Je vais vous dire pourquoi. Elle l'adore et tient beaucoup à l'épouser. Elle est d'assez bonne famille, connue, du même pays, voisine, assez riche, jeune, jolie et, d'après ses lettres, bonne nature. Et puis, elle y tient. On croit qu'elle a un petit peu la tête montée, parce que Paul est fils d'un maréchal de noblesse et qu 'il a une famille chic à Paris. Raison de plus pour; que je consente. Grâce à la négligence de Rosalie, ma lettre à Paul ne lui est jamais parvenue. Maman a consenti ; la jeune fille lui a envoyé le télégramme suivant : « Contente, heureuse, remercie maman à genoux, revenez vite. — Alexandrine. »
On dit que la pauvre petite a peur de la famille de Paris, de moi, si fière, si hautaine, si dure. Non, ce n 'est pas moi qui dirai « non » ; bien que n'ayant jamais aimé comme elle aime, je ne veux pas prendre sur ma conscience de causer du chagrin à qui que ce soit. C'est facile à dire qu'on est ça et ça et qu'on va devenir mauvais, mais quand l'occasion se présente de faire de la peine à un concitoyen de la, terre, on n'y regarde même pas à deux fois. Si j'ai des ennuis, est-ce que je me les guérirai en tourmentant les autres ? Ce n'est pas du tout par bonté que je suis bonne, mais parce que j'aurais cela sur la conscience et que cela me tourmenterait. Les gens vraiment égoïstes ne doivent faire que du bien ; en faisant le mal, on est trop malheureux. Il paraît cependant qu'il y a du monde qui se plaît à faire du mal... Chacun ses goûts. D'autant plus que Paul ne sera jamais rien qu'un gentleman-farmer.
Mercredi 31 décembre 79.
Je dois couver une maladie. Je suis si énervée que je pleurerais pour rien. Nous sommes allées au magasin du Louvre en sortant de l’atelier. Il faudrait Zola pour décrire cette foule agaçante, affairée, dégoûtante, courant, se poussant, ces nez en avant, ces yeux chercheurs ; je me sentais défaillir de chaleur et d'énervement. Maman envoie à la belle Alexandrine Pachtenko (Dieu me pardonne !) une lettre simple et convenable, et voici celle que j'écris moi, sur un papier blanc, uni, avec une petite M, surmontée d'une couronne en or.
« Chère demoiselle,
Mon frère vous apportera le consentement de maman ; moi, je fais des vœux pour votre bonheur et espère que vous rendrez notre cher Paul aussi heureux qu'il mérite de l'être. En attendant de vous voir parmi nous, je vous embrasse cordialement. »
« Marie Bashkirtseff. »
Que puis-je dire d'autre ? Paul, taillé en hercule et beau garçon, pourrait faire un meilleur mariage ; il fait celui-là, je l'accepte à cause de la jeune fille.
Quelle triste fin d'année !... je crois que je me coucherai à onze heures pour dormir à minuit, au lieu de m'ennuyer... à faire la bonne aventure.
1880
Jeudi 1er janvier 80.
J'ai été à l'atelier le matin, pour qu'ayant travaillé le 1er de l'an, je travaille toute l’année. Après, nous sommes sorties faire des visites et nous avons été au Bois.
Paul est parti ce soir, à sept heures ; maman seule l'a conduit jusqu'au wagon ; le chemin de fer attendrit ; je l'ai laissé partir sans plus d'émotion que s'il allait en ville ; et si j'étais allée jusqu'à la gare, j'aurais certainement pleuré.
Samedi 3 janvier 80.
Je tousse autant que possible ; mais par miracle, loin de m'enlaidir, cela me donne un air de langueur qui va bien.
Lundi 5 janvier 80.
Eh bien ! cela va mal.
Je me remets au travail ; mais comme cela n'a pas été franchement interrompu, je sens une mollesse, un découragement inouis. Et le Salon qui approche ! Je vais causer de tout cela avec le grand Julian et nous sommes d'accord, surtout lui, que je ne suis pas prête.
Voyons, il y a deux ans et quatre mois que je travaille, sans décompter ni temps perdu, ni voyage c'est peu, mais c'est énorme. Je n'ai pas assez travaillé, j'ai perdu du temps, je me suis relâchée, je..., en un mot je ne suis pas prête. « Les coups d'épingle vous rendent folle, a dit Edmond, mais vous supportez les coup de massue bien appliqué. » C'est vrai. L'éternelle comparaison... Breslau. Elle a commencé en juin 1875, cela lui fait quatre ans et demi et deux années à Zurich ou à Munich : total six ans et demi, en ne décomptant ni voyage, ni temps perdu comme pour moi. Il y avait un peu plus de deux ans qu'elle peignait quand elle a exposé. Il y a un an et quatre mois que je peins, et je ne pourrais pas exposer aussi honorablement qu'elle.
Oh ! pour moi, cela ne ferait rien, j'attendrais, je suis courageuse et si on me dit d'attendre un an, je réponds sincèrement : C'est bien. Mais mon public, mais ma famille ; on ne croira plus en moi ! Je pourrais exposer mais ce que Julian voulait, c'est que je fisse un portrait à tapage et je ne pourrai m'en tirer que médiocrement. Voilà ce que c'est que de monter sur de grands chevaux ; il y en a dans l'atelier de cinq fois moins fortes que moi qui ont exposé et l'on n'a rien dit c'est vrai. Mais moi... pourquoi faire ? — Vous n'avez besoin ni de leçons, ni de commande à 50 ou 100 francs, il nous faut un éclat. Exposer quelque chose comme les autres, mais c'est indigne de vous !
C’est mon opinion aussi ; mais mon public et la famille et en Russie !...
Vous comprenez, Julian dit que je dessine dix fois mieux que Manet, et il ajoute ensuite que je ne sais pas dessiner. Vous devez faire plus !
Moi, moi je suis bien ennuyée et je cherche à me tirer d'affaire.
Mme G... vient prendre de mes nouvelles, car, vous savez, je suis enrhumée comme un chien.
Samedi 17 janvier 80.
Le docteur prétend que ma toux est purement nerveuse, c'est possible, car je ne suis pas enrhumée ; je n'ai ni mal de gorge, ni mal de poitrine. J'étouffe tout simplement et j'ai un point au côté droit. Enfin, je rentre à onze heures et, tout en souhaitant tomber gravement malade pour ne pas aller au bal, je m'habille. Je suis belle…
Mardi 20 janvier 80.
Je rentre de l'atelier et j'apprends que Mme G... est venue, croyant me trouver gardant la chambre et qu'elle est furieuse de ce que je ne me soigne pas à la manière des vieux. Et puis, les billets promis pour demain ont été donnés à Mme de Rothschild.
Je donnerais bien dix mille francs pour une carte permanente. N'avoir plus à demander de billets, être indépendante !
O stérile aspiration, stérile et misérable intrigue, stériles discussions avec ma famille, stériles soirées passées à parler de ce que je voudrais, sans faire un pas pour que cela arrive ! Stériles et misérables efforts !
Samedi 31 janvier 80.
Ce soir samedi, concert et bal pour les inondés de Murcie, à l'Hôtel Continental, sous le patronage de la Reine Isabelle, qui, après avoir assisté au concert, est descendue dans les salons de bal où elle est restée une heure.
Je n'aime pas trop danser, et me trouver comme cela entre les bras des hommes ne m'amuse pas trop. En somme, cela m'est indifférent, car je n'ai jamais rien compris aux troubles occasionnés par la valse dans les romans.
En dansant, je ne pense qu'à ceux qui me regardent.
Jeudi 5 février 80.
Je voudrais faire toujours comme aujourd'hui : travailler de huit heures à midi et de deux à cinq. A cinq heures, on apporte la lampe et on dessine jusqu'à sept et demie.
De sept et demie à huit, taire sa toilette; à huit heures dîner, lire et s'endormir à onze heures.
Pourtant, de deux à sept heures et demie sans s'arrêter, c'est un peu fatigant.
Mardi 10 février 80.
J'ai eu une longue conférence avec le père Julian au sujet de mon Salon ; j’ai soumis deux projets qu'il trouve bien. Je les dessinerai tous deux, cela prendra trois jours, et alors nous choisirons. Je ne suis pas assez forte pour me tirer brillamment d'un portrait d'homme, sujet ingrat ; mais je suis de force à exécuter une figure (gr. nat. bien entendu) et du nu, ce qui, comme dit Julian, m'attire comme tous ceux qui sentent une force. Il m'amuse cet homme, il bâtit sur ma tête un avenir ; il me fera faire ceci, cela, si je suis sage et, depuis notre dernier entretien, je suis sage. L'année prochaine, ce sera portrait d'homme célèbre et un tableau. « Je veux que d'un coup vous sortiez des rangs. »
Pour cette année, moi « la trouveuse » j'ai trouvé ceci : une femme devant une table, le menton appuyé sur la main et le coude sur la table, qui lit un livre, éclat de lumière sur de très beaux cheveux blonds. Titre : La question du divorce, par Dumas, Ce livre vient de paraître et la question passionne tout le monde. L’autre chose, c'est simplement Dina en jupe de crêpe de Chine blanc, assise dans un grand fauteuil ancien, bras abandonnés et les doigts entrelacés. Pose très simple mais si gracieuse que je me suis empressée de croquer, un soir qu'elle était ainsi par hasard et que cherchais à la poser. Cela a un petit air Récamier et, pour que la chemiser ne soit pas trop indécente, je mettrai une ceinture de couleur. Dans ce deuxième projet ce qui me tente c'est cette simplicité complète et de beaux morceaux à peindre. Oh l c'est une vraie volupté.
Aujourd'hui, je suis en haut. Je me sens supérieure, grande, heureuse, capable. Je crois à un avenir. Enfin, il n'y a rien à dire.
Lundi 16 février 80.
Nous allons chez la Reine, qui est très gracieuse.
Je cherche toujours un tas de choses pour mon tableau.
Le soir, au Théâtre-Français, la première de Daniel Rochat, de Sardou. Véritable événement. Nous avons une excellente loge de six places. Une salle superbe, du monde et le gouvernement.
Quant à la pièce, il faut que je la revoie ; il me semble qu’il y a des longueurs ennuyeuses, des conversations genevoises, ça a l'air suisse. Mais on a tant crié, applaudi, sifflé, approuvé et protesté, qu'on n'entendait que la moitié. Le héros est un grand orateur, espèce de Gambetta athée ; l'héroïne une jeune fille, anglo-américaine, protestante, très libérale, républicaine, mais croyante.
Vous voyez ce que ce sujet peut donner à l’heure actuelle.
Mercredi 25 février 80.
Tout en courant après les modèles, chez Léonie, je fais connaissance de presque toute l'honorable famille Baudouin. C'est du Zola pur, du Zola de Nana ; du reste, c'est ce nom-là que je donne à Léonie. Un mélange de naïveté... et de perversion étonnant.
Pour le moment, elle ne pose pas. — Je posais quand je ne savais pas ce que je faisais, ce n'est pas honnête de poser, je suis dans un magasin de robes, cela ne m'amuse pas, allez, mais IL le veut. — Qui ça ? — Mon ami, car je suis avec un Monsieur.
Et sa sœur me raconte qu'elle en est toquée, surtout depuis qu'il la bat.
Dimanche 29 février 80.
Julian est venu voir mon tableau, il en est très content et en a parlé à Tony, qui est très... très occupé, mais qui viendra avec plaisir quand je le ferai appeler.
Mercredi 3 mars 80.
Maintenant, il faudra que je ne sorte plus le soir, pour pouvoir être levée sans fatigue et travailler dès huit heures.
Il ne me reste que seize jours.
Vendredi 12 mars 80.
Julian est venu voir mon tableau ; il trouve la table en peluche, le livre et les fleurs très bien. Le reste viendra, le tout a de l'allure, c’est crâne, presque brutal en un mot ; moi, qui pleurais ce matin, je rentre à six heures du soir consolée et confiante... et je trouve maman tout en larme avec deux dépêches, la première de mon père.
Si maman part demain, Dina partira avec maman il ne me reste que sept jours, je ne trouverai jamais de modèle ; maintenant, en trouverais-je un demain, je n’aurais que six jours et ce n'est pas possible ! Alors je suis perdue et je ne vous cacherai pas que je pleure de dépit et aussi parce que rien ne me réussit. Je tiens une idée, un sujet à sensation qui ferait de l'effet, malgré l'imperfection de l'exécution ; qui me donnerait cette année ce que je pourrais à peine avoir dans un an... et tout est fini. Tout s'effondre. Le travail à moitié fait, l'actualité, tout est perdu sans retour. Voilà ce qui s'appelle du malheur. Jugez-moi comme vous voudrez, les drames de Paul m'ont laissée calme et ceci me désespère et m'exaspère. C'est que je ne sais comment expliquer cela, il y a à cela un autre motif que l'égoïsme. Et quand cela serait de l'égoïsme, je suis assez malheureuse, assez abandonnée pour être égoïste.
Alors tous les rêves pour cette année s'évanouissent. Attendre encore ?... toute une année. Croyez-vous que c’était peu ? Je souffre de tant de choses tous ces jours ; je croyais trouver des consolations dans ma peinture et vous voyez comment tout s'arrange.
Et ma pauvre peinture sacrifiée, mes ambitions déçues, les satisfactions que je pourrais avoir, perdues ou ajournées, est-ce que ça les consolera ou les sauvera, là-bas, Paul et sa fiancée ?
Les sacrifices, les malheurs inutiles sont triplement douloureux.
Maintenant, tout est saccagé, gâché. Mais, pour eux, tout s'arrangera, ils se marieront ; un mois plus tôt, un mois plus tard ne signifie rien, et si le mariage ne se fait pas, ce sera peut-être heureux pour tous les deux. Tandis que pour moi, ici, il s'agit d'aller vite ; huit jours de retard, et je suis en arrière d’une année. Enfin, que voulez-vous ? c'est absurde, peut-être, mais moi j'en suis désespérée à en pleurer, là, comme pour le prince impérial. Ils vont croire que j'ai les yeux rouges pour Paul, les idiots !
Chacun a ses intérêts ici-bas : lui, c'est sa fiancée, l'amour, une petite terre et Poltava ; moi, c'est autre chose, autre CHOSE qui semble contenir tout ce que je désire et tout ce qui me manque, toutes les jouissances humaines, tout le bonheur, toutes les revanches. Encore un an, alors, quand pour moi, plus que pour quiconque au monde, la vie est une course !
Lundi 15 mars 80.
Drames inutiles. Tout est arrangé samedi on a reçu des dépêches rassurantes. Il n'y rien de grave.
J'ai écrit à Tony pour qu'il vienne, et j'ai très peur.
J'ai si peur de ce que dira Tony, il me semble que c’est si présomptueux à moi d'exposer, bien que Julian ait dit que s'il n'y avait que des exposants de ma force ce serait bien heureux. Il me semble que je serai anéantie de honte quand il viendra voir le tableau ; ne sais pas si j 'oserai, et pourtant je ne pourrai pas m'en aller s'il vient. C'est incroyable que ce soit moi qui dise cela, et voyez pourtant ! Si je disais cela tout haut, on croirait que je blague.
Vendredi 19 mars 80.
A midi moins le quart, Tony Pourquoi n'ai-je pas commencé plus tôt ? c'est très joli, c'est ravissant, quel dommage, etc., etc. ; en somme, il me rassure, mais il faut demander un sursis.
— On peut l'envoyer tel quel, mais ce n'est pas la peine, « voilà, mon opinion sincère, intime. » Demandez un sursis et vous ferez quelque chose de bien. — Alors il retrousse ses manches, prend la palette et promène des balayages un peu partout pour me faire comprendre que mon affaire manque de lumière. Mais je le retravaillerai... si j'ai le sursis. Il est resté plus de deux heures. C'est un charmant garçon, je m'amuse beaucoup et suis de si bonne humeur que peu m'importe ce qui adviendra du tableau. En somme, ses balayages sont une excellente leçon. A deux heures, je me mets en quête de mon côté et maman du sien. Je prends Dina avec moi, nous allons à la Chambre, je demande M. Andrieux (pour qu'il apostille ma demande à M. Turquet, le sous-secrétaire aux Beaux-Arts). On me fait attendre une heure en vain ; nous allons à la préfecture de police, il n'y est pas. Alors je vais porter une lettre au docteur K. dans laquelle je lui explique ce qu'il me faut. En rentrant, j'apprends que M. le préfet de police est venu chez nous se mettre à notre disposition et que Julian est au 37 avec maman. Julian est ravi du tableau. « Vous êtes un garçon, rien ne m'étonne de vous. » Il dit toutes ces belles choses devant Mme Simonidès, qui était venue voir mon tableau, devant Rosalie, en mon absence.
Je suis tout en l'air et tout à la joie, avant même de savoir le résultat des démarches de maman auprès de Gavini, qui a écrit à Turquet. — En somme, j'ai mon sursis, un sursis de six jours. Je ne sais qui au juste remercier, mais ce soir je vais à l’Opéra avec les Gavini ; je remercie le père Gavini, je crois que c’est à lui que je le dois. Je suis radieuse, triomphante, heureuse.
Non, mais ma peinture ! Julian en est toqué, Tony aussi a trouvé que c'est bien de ton, harmonieux, joli, énergique, et Julian ajoute que c’est séduisant et que les coloristes suédoises de l’atelier sont des bêtes de penser que la jolie couleur consiste en un procédé.
« Voilà une brutale qui a fait une chose agréable mais pas agréable dans le sens mou du mot, une chose séduisante. »
Je le finirai donc !
Une journée immense.
Samedi 20 mars 80.
Je sors pour accomplir les formalités de bulletins., etc. Au Salon, il y a une foule et des tableaux, et des camions, et des artistes ! Je vais chez le sous-secrétaire d'État pour qu'il signe mon bulletin, le sursis étant accordé à Mlle Bashkirtseff et mon tableau est signé Russ. Il est très bien, Turquet ; il me dit qu'on lui a parlé de mon tableau. Puis... Bref, je ne sais plus au juste toutes les courses que j'ai faites.

par Paul Mathey
Dimanche 21 mars 80.
Saint-Marceaux vient me donner des conseils. Il me plaît assez, mais il me laisse un sentiment de malaise. Il a l'air absent, il marche vite, parle vite. Un paquet de nerfs. Je suis comme cela, moi ; mais il me laisse tout de même un sentiment de malaise, bien qu'il m'ait dit du bien de ma peinture. Seulement voilà, quand on ne dit rien, je suis mécontente, et quand on dit du bien, il me semble qu'on me traite en petite fille et que l'on se moque de moi. Enfin, ce soir, je ne suis pas si en train qu'hier, c'est parce que le bras droit est trop long... il a deux centimètres de trop, et moi, le dessinateur sévère, je suis humiliée devant un sculpteur comme M. de Saint-Marceaux.
Lundi 22 mars 80.
Tony est étonné que j'aie pu faire ce que j’ai fait en si peu de temps.
— Car, en somme, c'est la première fois que vous faites l'application de vos études ?
— Mais oui.
— Eh ! bien, ce n'est pas mal du tout, savez-vous.
Il ôte son paletot, saisit une palette et me peint une main, celle d'en bas, de ce ton blanchâtre qui lui est propre.
(Il a touché aux cheveux et je les ai entièrement refaits ; de même pour la main.) Donc, il me travaille la main, et je m'amuse, et nous causons.
C'est égal, sauf le fond, les cheveux et les peluches, c’est de la sale peinture. C'est du ratatinage. Je puis faire mieux. C'est l'avis de Tony ; mais néanmoins il est content et dit que s'il y avait chance d'être refusée au Salon, il serait le premier à me dire de ne pas envoyer. Il dit qu'il s'étonne de voir ce que j'ai fait : c’est bien conçu, bien arrangé, bien établi, c'est harmonieux, élégant, gracieux.
Oh ! oui, oui, mais je suis mécontente des chairs ! Et penser que l'on dira que c'est ma manière ! ! C'est du ratatinage ! Je suis obligée d'avoir recours aux glacis ! ! Moi qui adore la peinture franche, simple, du premier coup. Je vous assure qu'il m'en coûte d'exposer quelque chose qui me déplaît tant comme exécution ; quelle chose qui est si différent de ce que j'ai l'habitude de faire... Il est vrai que je n'ai jamais fait quelque chose qui m'ait plu… ; mais enfin, c'est sale, c'est rafistolé. Tony dit que Breslau a subi cette fois l'influence de Bastien-Lepage. Elle subit mon influence comme je subis la sienne. Tony est aussi bon que possible. Et dire que j'aurais pu faire mieux ! Maudite modestie ! Sacré manque de confiance ! Si je n'avais pas été à trembler à me demander : To be or not to be !... Ne commettons pas l'ineptie de déplorer un fait accompli.
Je ne sais pourquoi je pense à l'Italie, ce soir. Ce sont là des pensées brûlantes que je tâche d'éviter toujours. J'ai cessé mes lectures romaines, parce qu'elles m'exaltaient trop et je me rabats sur la Révolution française ou la Grèce. Mais Rome, mais l’Italie, quand je pense à ce soleil, à cet air, à tout, je deviens folle.
Même Naples... Oh ! Naples, le soir !... Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas d'homme dans l'affaire. Quand je pense que je pourrais aller là, je devient folle. C'est tellement vrai que les décors de la Muette me causent une sorte d'émotion.
Mercredi 24 mars 80.
Tony est venu, mais n'a rien tracassé à ma peinture. A six heures, nous sommes encore là à causer.
— Il y aura certainement au Salon, dit Tony, des choses vingt fois inférieures à cela, mais il n'y a tuti de même pas de certitude absolue, car ce pauvre jury en voit passer près de six cents par jour, et on refuse parfois par dégoût ce qu'on a vu par mauvais humeur ; mais vous avez cela pour vous, que cela a de l'aspect, que c'est d'une tonalité agréable. Et puis, j'ai Lefebvre, Laurens, Bonnat qui sont absolument de mes amis.
Quel brave garçon que ce Tony ! et je l'aime d'autant plus que je ne le crois pas heureux. L'autorité du nom du père et son talent naissant lui donnent la médaille d'honneur en 1870. Puis, peu à peu, tout s'oublie, tout s'efface et il lui surgit un ennemi qu ayant de l'influence sur Wolf du Figaro, lui rend ce terrible journaliste hostile. Avec ça il ne sait pas battre la grosse caisse et, tandis que des gens comme Cot font de grands portraits bien payés, il en fait des betits qui rapportent de l'argent, mais ne donnent aucune satisfaction.
Ce brave Tony m'a prodigué des encouragements sobres, mais bien sentis.
Je puis, si je veux, avoir « beaucoup de talent », et par là vous comprenez, il n'entend pas comme maman ce que j'ai à présent. « Beaucoup de talent, » c'est lui, c'est Bonnat, c'est Carolus, c'est Bastien, etc. Il faut faire des études sérieuses, peindre des torses chez moi pour me préparer à faire des tableaux. Ne pas songer à autre chose qu'à ma peinture, m'y adonner. Je suis admirablement organisée. En fait de femme, il n'y a que moi et Breslau qui comprenions si bien le nu. Peu d'artistes dessinent une académie comme elle ou moi. En somme, c'est très étonnant ce que j'ai fait là en dix-huit jours, après deux ans d'étude ; mais il ne faut pas m'arrêter à ces succès-là, « pas de ces satisfactions-là ! ! »
— Monsieur, je ne l'ai pas fait pour moi.
Il sait bien, mais il faut éviter de subir ces influences, il faut voir plus loin, plus sérieux. Je puis arriver où je veux. Le génie ne s'acquiert pas ; mais pour avoir du talent il faut travailler, surtout ne pas croire aux compliments qu'on me fait ; lui, il ne dit que la vérité.
—Mais, Monsieur, si vous disiez autre chose, je serais désolée.
Allons, que je travaille, que je m'applique et j'arriverai où je veux !
Jeudi 25 mars 80.
Je donne les dernières touches au tableau, mais je ne peux plus travailler, car il n'y a plus rien à faire, ou il y a tout à refaire. C'est fini pour une chose faite à la diable. Mon tableau est de 1m70 de haut avec le cadre.
La jeune femme est assise devant une table de peluche vieux vert d'un ton très riche et, appuyée sur sa main droite, le coude posé sur la table, lit dans un livre à côté duquel est posé un bouquet de violettes. Le blanc du livre, le ton de la peluche et les fleurs à côté du bras nu font bien. La femme est en déshabillé de damas bleu très clair, un fichu de mousseline avec de la vieille dentelle. La main gauche tombe naturellement sur les genoux et semble à peine retenir un coupe-papier.
La chaise est en peluche bleu foncé et le fond est une draperie loutre. Le fond et la table sont très bien. La tête est de trois quarts. Les cheveux adorables, blond doré de Dina, sont défaits ; le crâne se dessine et les cheveux tombent dans le dos à moitié nattés.

A trois heures et demie, M. et Mme Gavini arrivent. — Nous avons pensé qu'il était impossible de laisser partir le tableau de Marie sans le voir. C’est le départ du premier enfant. — Ce sont de braves gens. Lui, Gavini, m'accompagne au palais de l'Industrie en voiture, pendant que deux hommes portent la toile. Tout cela me donne chaud, froid et peur comme un enterrement.
Et puis, ces grandes salles, le hall de la sculpture, sablé, les escaliers, cela fait battre le cœur. Pendant qu'on va chercher mon reçu et mon numéro, on apporte le portrait de M. Grévy, par Bonnat, mais on le place près d'un mur et le jour empêche de voir. Il n'y a dans toute la salle que le Bonnat, le moi et un fond jaune affreux. Le Bonnat me paraît bien et je suis tout étonnée de voir le moi là.
C'est mon premier début, un acte indépendant, public. On se sent seule sur une éminence entourée d'eau... Enfin, c'est fait ; mon numéro est 9091.
« Mademoiselle Marie — Constantin Russ. » J'espère que ce sera reçu. J'envoie le numéro à Tony.
Vendredi 26 mars 80.
Nous nous sommes confessées pour communier demain.
Notre pope confesse comme un ange, c'est-à-dire en homme d'esprit : quelques mots et c'est fini. Du reste, vous savez mes idées là-dessus. Je serais déjà morte de désespoir si je ne croyais pas en Dieu ; mais en revanche, les formules et les légendes me laissent froide.
Mercredi 31 mars 80.
Je suis détraquée ! Il fallait écouter Tony et se reposer. Je vais tracasser Julian auquel je donne le billet suivant :
« Je soussignée m'engage à faire toutes les semaines une tête et une académie, ou bien une étude grandeur nature. En plus, je ferai trois compositions par semaine ou bien une, mais alors peinte convenablement. Si je manque aux conditions susdites, j'autorise M. Rodolphe Julian, artiste peintre, à proclamer partout que je suis absolument indigne de toute espèce d'intérêt.
« Marie Russ. »
Puis je vais chez Tony ; mais il a modèle, je ne reste que quelques minutes.
— Vous êtes très douée, me dit Tony, il faut faire quelque chose vraiment.
— Si vous vous laissez aller, je ne réponds plus de rien ! Me dit Julian ; vous êtes déjà en retard ; pour arriver, vous arriverez, mais il fallait arriver à l’état de phénomène. Il faut, il faut absolument qu'au Salon prochain vous frappiez un grand coup ; vous devez faire un tableau, quelque chose; il le faut absolument.
Mercredi 7 avril 80.
N'oublions pas que Julian m'a annoncé ce matin que mon tableau est reçu ; chose curieuse, je n'en éprouve aucune satisfaction. La joie de maman m'ennuie. Ce succès-là n'est pas digne de moi.
Samedi 10 avril 80.
Je ne suis pas heureuse de mon exposition. Il y a quatre numéros d'admission. Breslau a eu le 3 ; moi, j'ai été admise simplement, sans numéro. Si Breslau n'a eu que le 3, c'est juste que je n'aie rien ; mais c'est égal. Il faut sortir de là. Je n'ai été ni complimentée, ni grondée pour ma tête. Ce n'est pas digne de moi, il faut sortir de là, il faut, il faut, il faut ! Je suis humiliée d'avoir exposé ce que j'ai exposé; c'est joli, mais pas digne de moi.

Samedi 17 avril 80.
L'après-midi, j'ai passé une grande heure chez Tony ; j'y ai fait la connaissance de Robert-Fleury père, qui a été fort aimable et qui m'a dit qu'il est resté quatre ans à dessiner avant de peindre. Le père parti, nous avons causé et j'ai fumé, une cigarette. Quant à la peinture par moi apportée, il l'a trouvée bien, et me dit de continuer. Julian a dit aussi qu'avec mon Salon, c'est le plus grand effort que j'aie fait.
Jeudi 22 avril 80.
En somme, mon tableau sera mal placé et inaperçu, ou bien en vue, et alors il m'attirera du désagrément. On dira qu'il n'y a que prétention à tapage, faiblesse insigne, que sais-je ?
Lundi 26 avril 80.
Je n'ai pas de place à l'atelier. Une ravissante Américaine va poser pour moi, à condition que je lui donne l’œuvre.
Mais sa petite figure m'empoigne et ce sera presque un tableau ; je rêve un arrangement exquis et la petite est assez gentille pour me dire qu'elle posera et se contentera d'un petit portrait que je ferai après celui-là.
Si je n'avais un tableau au Salon, jamais des élèves n'auraient assez confiance pour poser.
Julian pense que Tony a travaillé à mon tableau et Tony, vous savez bien ce qu'il a fait : c'était dans une gamme trop sombre, il a remis des blafardises partout et j'ai consciencieusement tout repeint ; quant à la main, il l'avait dessinée en peignant ; mais l'avant-dernier jour j'ai raccourci les doigts, ce qui m'a amené à refaire tout ; donc il n'y a même pas de dessin de lui, il m'a seulement montré comment il fallait faire. — En somme, je l'ai fait honnêtement et, du reste, ce n'est )as fameux.
Ce soir, chez Mme P., d'anciens magistrats, je crois ; ils ont loué l'hôtel d'Alcantara qui a cette galerie longue et étroite donnant par une fenêtre unique sur les Champs-Élysées. L'hôtel est curieusement disposé, grâce à cette langue de terrain qui va aux Champs-Elysées et se prête aux fêtes, bien que la galerie soit étroite. De braves gens aimables, mais une société bizarre, des toilettes de l'autre monde, personne de connu. Je suis endormie et en colère. Et cette chère maman qui se lève pour aller me présenter le Chilien ou le Mexicain « qui rit ». Il a une affreuse grimace qui le fait sinistrement ricaner toujours ; c'est un tic et avec cela une grosse figure épanouie. Il a 27 millions, et maman croit que…. Épouser cet homme, c'est presque comme un. homme sans nez ; fi l'horreur ! Je prendrais bien un laid, un vieux, ils sont tous les mêmes pour moi, mais un monstre, jamais ! ! A quoi serviraient les millions avec ce boulet du ridicule ? Plusieurs connaissances, mais c'est endormant. Des amateurs qui vous font grincer des dents avec leur musique ; un violoniste qu'on n'entend pas et un bel homme qui chante la sérénade de Schubert après avoir, une main appuyée sur le piano, lancé à l'assistance des regards de vainqueur, et une attitude... ridicule ! Je ne comprends pas, du reste, qu'un Monsieur vienne cabotiner dans une grande soirée.
Les femmes, avec leurs coiffures et cette poudre blonde qui est si sale à voir dans les cheveux avaient l'air d'être coiffées avec des choses à matelas et de s'être roulées dans de la paille. Est-ce laid ! Est-ce bête ! !
Mardi 27 avril 80.
Je me sauve, impatiente d'avoir ma première séance avec l'Américaine. Elle ressemble à Mme Récamier ; je lui retrousse les cheveux à la Psyché, et lui mets une chemise de batiste à manches courtes et bouffantes, un ruban rose autour de taille, sous les seins, et une écharpe paille dans laquelle elle s'enveloppe les bras.
Elle est d'une maigreur exquise qui est même étonnante à dix-huit ans, une maigreur de quinze ans, un teint d'une fraîcheur radieuse et des pattes très blanches.
Jeudi 29 avril 80.
Ce soir, dîner chez le ménage Simonidès. Tout est étrange chez eux. (Je connais la dame de chez Julian) ; le mari est beau et jeune, la femme est belle et a passé trente-cinq ans ; ils sont très unis, vivent cachés, ne voient que quelques artistes et font des dessins et des peintures extraordinaires, des espèce d’imitation de la renaissance, des sujets étonnants de naïveté : la mort de Béatrice, la mort de Laure, la femme qui enferme la tête de son amant dans un pot et où il a poussé des fleurs, et tout cela d'un dessin qui a l'air d’être fait il y a des siècles. Madame s'habille comme du temps de Boccace. Ce soir, elle portait une robe de crêpe japonais blanc d'une souplesse adorable, des manches longues et étroites comme celles de la Vierge et d’autres manches nouées derrière ; la robe droite et simple ; une ceinture de galon ancien lui faisait une taille assez courte ; un bouquet de muguets au corsage, des perles au cou et des boucles d'oreilles et des bracelets en vieille orfèvrerie ; avec son teint pâle, ses cheveux noirs et crépus et ses yeux de gazelle, elle avait l’air d'une apparition fantastique. Si elle avait seulement l’esprit de se coiffer simplement, au lieu de s'ébouriffer les neveux et de faire de sa tête une épouvante, elle serait très remarquable.
Nous étions depuis un quart d'heure rentrés dans l'atelier, au sortir de la salle à manger où nous avions eu un très bon dîner, des fleurs, des fruits et un arrangement très artistique et j'accompagnais Madame qui chantait des romances antiques italiennes classiques, lorsque maman est venue nous prendre pour aller à église... C'est la Passion, mais nous arrivons trop tard. Je fais mes prières chez moi.
C'est demain le vernissage, j'y mènerai la petite américaine pour qu'elle pose bien.
Vendredi 30 avril 80.
Ma petite Américaine, qui s’appelle Alice B..., vient à dix heures et nous partons ensemble. Je tiens à aller presque seule pour voir d'abord où est placé mon tableau. Donc, je vais au Salon très peureuse et me figurant les plus mauvaises choses pour qu'elles n'arrivent pas. En effet, rien de prévu ; mon tableau n'est pas encore accroché, je le trouve à peine vers midi avec un millier d'autres toiles non encore accrochées, mais je le trouve dans la galerie extérieure où j'avais été déjà choquée de trouver placée Breslau En effet, vous pouvez voir comment Wolff traite la galerie, mais pourtant il y a là des œuvres de Renoir et d'autres, connus. A... expose un grand et beau portrait de Léon Say. Pas mal du tout, très crâne, mais les mains ont l'air d'être faites par Robert-Fleury père, Dieu me pardonne cette supposition, si ce n'est pas vrai. Le fait est que Léon Say n'ayant posé que pour la tête il a été facile de se faire aider. Le portrait est très bien placé. Quant à Breslau, placée comme moi dans la galerie et sur la cimaise comme moi, elle a fait un bien mauvais morceau de peinture, ou tout au moins une chose aussi désagréable à voir que possible. C'est le portrait de Mgr Viard. Je crois que ce qui l'a perdue c'est une trop grande recherche de finesse de tons. Tout est gris, le fond qui ressemble à des panneaux de bois grisâtre, des décorations de chapelle, d'oratoires, le fauteuil, tout est sale ; la tête est aussi très sale.
Mais il y a des têtes comme cela ; on aurait pu avec un autre arrangement en tirer parti. Maintenant, il y a un bon dessin et une certaine largeur de faire dans les mains. Les autres élèves ne valent pas la peine qu'on en parle.
Quant à Bastien-Lepage, cela frappe d'abord comme quelque chose de vide, l'effet du plein air. — Jeanne d'Arc, la vraie, la paysanne appuyée à un pommier tenant une branche de l'arbre de la main gauche, qui est une perfection ainsi que le bras ; le bras droit pend le long du corps ; c'est un morceau admirable. La tête renversée, le cou tendu et les yeux qui ne regardent rien, des yeux clairs, prodigieux ; la tète est d'un effet étourdissant ; c'est la paysanne, la fille des champs, stupéfaite, souffrant de sa vision. Le jardin fruitier qui entoure la maison tout au fond est nature, mais il y a... en somme, pas tout à fait assez de perspective ; cela semble venir en avant et nuit à la figure.
La figure est sublime et m'a donné une émotion si forte, qu'en écrivant je me retiens de pleurer.

Le plafond de Tony est très gracieux, très bien et me plaît.
Voilà le principal pour moi, maintenant voilà : après le déjeuner nous devions, je le pensais du moins, visiter le Salon en famille. Mais non, ma tante est allée à l’église et maman a voulu y aller aussi, et ce n’est qu'en me voyant étonnée et offensée qu’elles se décident à venir de fort mauvaise grâce. Je ne sais si c’est ma modeste place qui les met en fureur, mais ce n est pas une raison et il est vraiment dur d’avoir une famille pareille ! Enfin, honteuse de son indifférence ou de je ne sais comment nommer cela, maman y va, et nous trois, moi, elle et Dina, rencontrons d'abord tout l’atelier et puis des connaissances, puis Julian.
Samedi 1er mai 80.
Je viens de subir un de ces fours formidables et bêtes et inutiles ! Demain, c’est Pâques ; ce soir, ou cette nuit, nous allons à la grand'messe où se trouve réunie toute la colonie russe, à commencer par l'ambassade au grand complet. Toutes les élégances, toutes les beautés, toutes les vanités en avant. La grande revue des femmes et des robes russes, le grand sujet de commérages.
Bien ; on m'apporte au dernier moment ma robe neuve qui a tout à fait l'air d'un paquet maladroit de vieille gaze sale. J'y vais malgré cela, mais ce que cela m'a coûté de rage, personne ne le saura ! Taille perdue dans un corsage mal fait et de travers, bras estropiés par des manches trop larges et bêtes. En un mot un ensemble prétentieux, et par-dessus le marché, cette gaze que je n'ai vue qu'au jour, le soir paraît tout à fait sale !
Ce qu'il m'a fallu d'efforts pour ne pas tout déchirer en morceaux et m'enfuir de l'église ! Être mal, faute de mieux, passe ; mais pouvoir être bien et se montrer en monstre comme moi ce soir ! Et naturellement les cheveux se ressentent de l'humeur : ils se dérangent et la figure brûle. C'est ignoble.
Ce matin, je suis allée au Salon voir le jeune homme de Julian, et il m'a promis de faire l'impossible. J'étais en laine noire, très simple, mais la figure fraîche, et l'on me regardait beaucoup.
Et ce soir ! Ah ! nom de tout ce qu'on voudra !
Jeudi 6 mai 80.
Des grands compliments de Julian pour ma peinture.
Vendredi 7 mai 80.
Mme Gavini est venue encore aujourd'hui pour dire à maman que je me fatigue trop, c'est vrai, mais ce n'est pas la peinture ; pour ne pas être fatiguée, il n'y aurait qu'à se coucher à dix ou onze heures, et moi je veille jusqu'à une heure et me réveille à sept heures.
Hier, c'est cet idiot de S... qui en a été cause. J'écrivais, et il est venu s'expliquer ; puis il est allé jouer avec ma tante, alors ça été moi qui ai voulu l'attendre pour entendre quelques sottes paroles frisant l'amour. Et il m'a dit bonsoir vingt fois, et vingt fois je lui ai dit : « Allez vous-en, » et vingt fois il a demandé la permission de me baiser la main, et je riais et enfin : « Eh bien, faites, ça m'est égal, » ai-je dit. Donc il m'a baisé la main, et j'ai la douleur d'avouer que cela m'a fait plaisir, non à cause de l'objet, mais il y avait un... tas de choses, et l'on est femme tout de même.
Ce matin, je sentais encore ce baiser sur la main, car ce n'était pas le vulgaire baiser de politesse.
O les jeunes filles !
Croyez-vous que je sois amoureuse de ce garçon aux larges narines ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien, l'affaire... n'a pas été autre chose. Je me suis battu les flancs pour devenir amoureuse et, les cardinaux et le pape aidant..., je me suis exaltée, mais d'amour ? Ah ! fi. Eh bien, comme j'ai plus de quinze ans et que je suis moins bête, je n'invente rien et la chose reste normale.
Ce baiser sur la main m'a déplu, surtout lorsqu'il m'a fait plaisir ; il ne faut pas être femme à ce point. Aussi je me promets de faire froide mine à S... ; mais il est si bon garçon, si simple que je serais bête de jouer quelque comédie ; ça ne vaut pas la peine, il vaut mieux le traiter en Alexis B... C'est ce que je fais. Dina, lui et moi sommes restés jusqu'à onze heures. Dina écoutant et S... et moi lisant des vers et faisant des traductions latines. Je suis tout étonnée de voir que ce garçon est très fort, du moins notablement plus fort que moi ; j’ai beaucoup oublié et il se souvient très bien de son baccalauréat ès sciences et ès lettres et de sa licence. Je n'avais jamais pensé qu'il fût si instruit. Voyez-vous cela : Je voudrais en faire un ami... Non, il ne me plait pas assez pour cela, mais un indifférent familier.
Samedi 8 mai 80.
Quand on parle bas, je n'entends pas ! ! Ce matin, Tony m'a demandé si j'avais vu du Pérugin et j'ai dit « non », sans comprendre.
Et comme on est venu me le dire après, je m'en suis tirée, mal tirée en disant qu'en effet, je n'en avais jamais vu et qu'en somme il valait mieux avouer son ignorance.
Du reste, Tony a été très content de ma tête. Breslau m'a fait demander la permission de faire mon modèle, j'ai généreusement consenti et nous offrons à l'atelier aux aguets le touchant spectacle de nos deux amitiés côte à côte. Elles sont vraiment enfants ; moi je me moque de tout cela.
Tony a dit que c'est très bien commencé, qu'il n'y qu'à aller. Nous avons l'air de faire un concours avec Breslau et je l'ai battue, jusqu’à présent du moins. (Nous reprendrons la semaine d'après, quand ce sera sec.)
Cela amuse toute la boutique et tout le monde veut poser pour moi. Je fais enrager cette bonne Breslau en disant que mon tableau trouve acheteur à 1,500 franc et que je suis accrochée dans la galerie du pourtour. — C'est triste, dis-je, mais juste, ma peinture n'est pas fameuse, je l'avoue d’autant plus volontiers que c’est très naturel : deux ans de travail, ma première exposition, et quinze jours pour exécuter... Du reste, l'administration a été relativement juste. On n'a accroché dans la fameuse galerie que les plus mauvaises chose, il n'y a pas une toile propre, etc..
Lundi 10 mai 80.
Ce qui est bon, c'est quand je veux contrarier mes penchants. Je n'y suis encore jamais parvenue ; je n'ai même jamais essayé de lutter ; tout se borne à une résolution prise d'avance et à une ligne de conduite jamais suivie. Tout se fait sous l’inspiration du moment, comme cela me plaît et comme cela vient. 0 diplomatie !... ou plutôt c'est que tout bonnement il m'est désagréable de ne pas suivre ma nature et que je la suis.
Jeudi 13 mai 80.
J'ai des bourdonnements tels dans les oreilles qu'il me faut faire les plus grands efforts pour qu'on ne s'aperçoive de rien.
Ah ! c'est horrible. Avec S... ça va, parce que je suis assise près, et puis quand je le veux, je peux lui dire qu’il m'ennuie ; les G... parlent haut. — A l'atelier, on rit et on me dit que je suis devenue sourde ; je parais préoccupée et je me plaisante : mais c'est horrible.

Dimanche 16 mai 80.
Je suis allée seule au Salon de bonne heure ; il n'y avait que les gens qui ont des cartes. J'ai bien regardé la Jeanne d'Arc et surtout le Bon Samaritain de Morot. Je me suis assise en face du Morot avec une lorgnette et je l'ai étudié. C'est le tableau qui m'a fait le plus complètement plaisir depuis que j'existe. Rien n'accroche, tout est simple, vrai, bien ; il est fait d'après nature et ne rappelle en rien les affreuses beautés académiques et convenues. C'est adorable à regarder ; la tête de l'âne même est bien, le paysage, le manteau, les ongles des pieds. C'est heureux, c’est juste, c'est bien.

La Jeanne d'Arc a une tête sublime. Ces deux toiles sont dans deux salles voisines ; j'allais de l'une à l'autre. Je lorgnais le Morot et pensais à ce bon S... lorsqu'il est passé devant moi sans me voir, et en m'en allant, je l’ai vu qui, du jardin, montrait mon tableau à une autre personne qui avait la tournure d'un journaliste.
Et l'Arlequin de Saint-Marceaux ! Le Salon de l'année dernière fermé, j'ai pensé que la médaille d'honneur m'avait monté la tête, l'œuvre n'étant plus là pour me rassurer ; au bout de six mois, j'étais persuadée que j’avais exagéré Saint-Marceaux, mais cet Arlequin me rouvre les yeux. Le premier jour, je suis restée là plantée sur mes deux pieds, ne m'imaginant pas de qui cela pouvait être. Une chose si ingrate, mais que de talent. C'est plus que du talent. C'est un vrai artiste, aussi n'en parle-t-on pas autant que d'autres.... fabricants de sculpture : ils sont tous des fabricants à côté de Saint-Marceaux.
Mardi 25 mai 80.
Madame Goup... est venu pour son portrait ; puis j'ai fait une composition.
Un sujet qui m'empoigne : Marie Madeleine et l'autre Marie au tombeau du Christ. Seulement pas de convention, ni de sainteté, mais faire comme on croit que c'était et sentir ce qu'on fait.
Jeudi 27 mai 80.
Que c'est beau le matin ! Attention je commence...
J'ai d'abord salué le jour devant la fenêtre ouverte par les sons harmonieux de la harpe, comme les prêtre d'Apollon et puis mes deux femmes devant le sépulcre.
J'ai envie d'aller à Jérusalem et d'y faire ce tableau avec des têtes de là-bas en plein air.
Mardi 1er juin 80.
Voyez-vous, les athées doivent être bien malheureux quand ils ont peur ; moi, quand j'ai peur, j'appelle aussitôt Dieu et tous mes doutes s'évanouissent par égoïsme. C'est un vilain sentiment mais je ne tiens pas à me parer des vertus que je n'ai pas. Je trouve que c'est déjà assez fat d'étaler toutes ses petitesses et toutes ses vilenies. En 1873, je suis allée à l'exposition universelle de Vienne, au plus fort du choléra, sous l'égide de ces vers du Psaume XCI. Je les copie exactement :
« II te couvrira de ses ailes ; sous leur abri, tu seras ; en sûreté ; la vérité te servira de bouclier, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni les fléaux errants dans les ténèbres, ni le trépas qui exerce ses ravages à midi ; mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite ; mais la mort n'approchera point de toi. »
Hier j'ai pensé à ces lignes divines, je les ai relues avec enthousiasme ; avec le mème enthousiasme qu'en mon enfance ; je ne prévoyais pas qu'elles me serviraient aujourd'hui.
Je viens de faire mon testament, il est contenu dans l’enveloppe ainsi adressée : — A M. Paul Bashkirtseff,. Poltava. En main propre, Russie.
« Je viendrai te tirer par les pieds quand je serai morte, s'ils n'exécutent pas mes volontés ! »
S... est resté, d'abord c'était une simple causerie. Ma tante ne me quitta pas, elle m'ennuyait et je me suis mise au piano et il me dit une chose qui m'a fait froid : ses sœurs le marient, mais il n'aime pas la femme qu'on veut lui donner.
— Alors, ne l'épousez pas, croyez-moi, c'est insensé.
Après, nous jouons aux cartes, aux bêtes, jeu favori des domestiques russes.
— C'est Mme de B. que vous épouserez, lui écris-je sur un cahier.
— Non, elle est encore plus vieille, me répond-il par la même voie.
Alors nous emplissons six pages de ces phrases qu'il serait amusant de conserver.
En fin de compte, il m'aime, il m'adore et les phrases tournent, autour du sujet brûlant.
Je lui défends de plaisanter et il répond que c'est loi qui me moque de lui. Ma tante dit de temps en temps que je suis folle, qu'il faut me coucher, et je lui réponds que j'ai la maladie et que je vais mourir.
Après cette correspondance singulière je suis presque convaincue qu'il m'aime ; ce soir, il y a eu de sa part des regards fort significatifs et des serrements main, sous prétexte de voir si j'ai la fièvre.
Enfin cela ne mène à rien, mais je voudrais tout de même garder ce garçon, ne sachant pas encore ce que j'en ferai. Je lui dirai de demander à maman, cela fera gagner du temps : maman refusera, encore un délai... et puis, je n'en sais rien. C'est déjà quelque chose de n'en rien savoir.
Lundi 14 juin 80.
Je relis le passé pour lequel je me passionne.
Je me rappelle, lorsque C. entrait, c'était comme un éblouissement ; je ne saurais définir, ni sa manière d'être, ni mes impressions... Tout mon être allait à lui quand je lui tendais la main. Et puis, je me sentais envolée, partie, dépouillée de mon enveloppe charnelle. Je me sentais des ailes et puis une terreur affreuse de voir les heures passer si vite ! Et je ne comprenais pas !.. C'est dommage que la nature de ces écritures ne me permette pas d'isoler les faits remarquables, tout se confond. Et puis, j'ai un peu affecté, à dire vrai, à m'occuper de tout pour montrer que j'existais en dehors de C. Seulement, quand je veux revivre ces événements, je suis choquée de les trouver entourés de tout le reste. Mais n'est-ce pas ainsi dans la vie ?
Pourtant, il y a des choses, des événements, des hommes qu'on voudrait isoler et renfermer dans un précieux coffret avec une clef d'or.
— Quand vous vous sentirez supérieure à lui, il ne vous dominera plus, dit Julian.
Est-ce que ce n'est pas l'idée d'avoir son portrait à faire qui m'a poussée à travailler ?
Mercredi 16 juin 80.
Nous allons au Salon à huit heures, où je rencontre Saint-Marceaux. Échange de banalités, et je lui dis bêtement : — Vous ne venez jamais nous voir. — Je suis si occupé ! — Voyez-vous, faire de ces reproches, c'est stupide. Maintenant, il va me sembler que Saint-Marceaux sera ennuyé de me rencontrer. Non, voyez-vous, il faut que j'arrive à quelque chose. Il faut que des hommes comme Saint-Marceaux voient quelqu'un en moi. — Attention ! il ne me reste que quelques mois avant de faire mon Salon. Et moi, qui pouvais aller à Pétersbourg pour me marier ! Non, je reste ici, je travaille et ce n'est que l'hiver 81-82 que j'irai. Que diable, cela pourra encore aller.
Oui, je reste et je travaille. Oh ! oui, oh ! oui. Vous allez voir cela. — Me voilà bien, presque tout à fait bien, demain je reviens tout à fait à l'atelier.
Vendredi 18 juin 80.
J'ai travaillé toute la journée. Mon modèle est si gracieux et si joli que je remettais de jour en jour à commencer à peindre ; la préparation était bonne, je craignais de gâter. Une vraie émotion pour commencer, mais il parait que cela va très bien.
Et le soir, S... J'attribuais à l'amour sa mauvaise mine, mais il y a encore autre chose : il va partir pour Bucharest ou pour Lille, comme administrateur de la banque de son. beau-frère. Mais aussi et surtout le mariage. Ah ! il y tient. Moi, je souris, le traite de présomptueux, de téméraire et lui explique que je suis sans dot, puisque ma dot passera en menus besoins de femme et qu'il faudra me loger, me nourrir, me promener.
Pauvre diable, il m'a fait un peu de peine tout de même.
Je crois qu'il n'est pas enchanté de partir... Le Mont-Dore, Biarritz, tout s'envole...
Il m'a baisé cent fois les mains en me suppliant de penser à lui. — Vous penserez quelquefois à moi dites, oh ! je vous en prie, vous penserez à moi ?
— Quand j'aurai le temps !
Mais il a tant demandé qu'il m'a fallu dire un ou très léger. Ah ! les adieux sont tragiques, de son côté du moins. Nous étions près de la porte du salon tous deux et, pour lui laisser de moi un souvenir noble je lui tendis gravement ma main à baiser, puis nous nous sommes serré la main gravement.
Je suis restée un bon moment rêveuse. Il va me manquer, cet enfant. Il m'écrira.
Vous savez que depuis quelques jours Paris est fou de petits cochons. Ça s'appelle des porte-veine et c'est fait en or, en émail, en pierreries, en tout au monde. J'en porte un en cuivre depuis deux jours. A l'atelier, on prétend que c'est grâce au cochon que j'ai fait un bon morceau de peinture. Eh bien ! ce pauvre Casimir emporte, en souvenir de moi, un petit cochon..
J'ai envie de lui donner l'Évangile de saint Matthieu avec cette dédicace : « — Le plus beau livre qui soit au monde et qui réponde à toutes les dispositions de l'âme. Il n'est pas besoin d'être sentimental ou bigot pour y trouver du calme et des consolations. Gardez-le comme un talisman et lisez-en une page tous les soirs en souvenir de moi, qui vous ai peut-être fait de la peine, et vous comprendrez pourquoi c'est le plus beau livre qui soit au monde. » — Mais, le mérite-t-il ? Et ne vaut-il pas mieux se borner au petit cochon. D'abord, il ne comprendra pas saint Matthieu.
Dimanche 20 juin 80.
J'ai passé la matinée au salon qui ferme ce soir. Le bon Samaritain a eu la médaille d'honneur. Mais la peinture de M. Morot a beau être épatante, la médaille d'honneur devrait se donner avec plus de difficulté. Du reste, on ne la donne pas au mérite, mais à la meilleure œuvre du Salon.
Le paysage de Bastien-Lepage n'est pas parfait, il nuit à la figure, mais quelle admirable figure ! Cette tête est une œuvre absolument hors ligne. Le tableau de Morot m'a presque ennuyée aujourd'hui, tandis que Séastien-Lepage ! J'allais de l'un à l'autre et puis à une tête endormie de Henner et à une petite nymphe du même. Henner, c'est le charme lui-même. Ce n'est pas tout à fait la nature, mais... mais non cela doit être la nature, c'est adorable. Ses nymphes dans le crépuscule sont incomparables et inimitables. Il ne varie pas, mais c'est toujours charmant. Ses nudités qui sont au Luxembourg ne valent pas ce qu'il fait maintenant. Son tableau de l'année passée est ce que j'ai vu de mieux de lui. J'ai désiré passionnément l'acheter, je le regarderais tous les jours. Ah ! si j'étais riche ! !... S... n'aura pas son saint Matthieu. C'est singulier l'effet que m'a fait le Morot, c'est ennuyeux à côté de Bastien-Lepage et de Henner. Henner !... c'est inexprimable de charme.
Dimanche 27 juin 80.
J'ai fait du modelage le matin. Je suis aussi bas que possible, mais il faut avoir l'air gai, et cette misère rentrée me rend bête. Je ne sais rien dire, ris par force, écoute dire des banalités et voudrais pleurer.
Misère de misère !
En dehors de mon art, que j'ai commencé par fantaisie et ambition, que j'ai continué par vanité et que j'adore maintenant ; en dehors de cette passion, car c'est une passion, je n'ai rien ou la plus atroce des existences ! Ah ! misère de misère. Il y a pourtant des gens heureux sur la terre. Heureux, c’est trop ; une existence supportable me suffirait ; avec ce que j'ai, ce serait le bonheur.
Mercredi 30 juin 80.
Au lieu de peindre, je prends miss Graham et nous allons rue de Sèvres et passons là près d'une heure en face des maisons des jésuite Mais il était neuf heures et nous n'avons vu que les restes de l'agitation.
Je trouve cette dispersion bête et ne me l’explique que comme une mesquine revanche de M. Jules Ferry pour son article 7. L'influence des jésuites vient d’être considérablement augmentée ; si on déteste leurs doctrines, ce n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre... et c’est tellement difficile de s'y prendre, qu'il vaut encore mieux ne pas y toucher.
Il n'y aurait qu'une fantaisie qui serait applicable. Donner toutes sortes de garanties, faire toutes les avances à tous les jésuites qui existent, leur faire don d'un terrain, leur bâtir des maisons, leur créer une cité et quand ils seront tous là, faire sauter le tout. — Je ne déteste pas tant les jésuites que je les crains, dans l'ignorance où je suis de ce qu'ils sont au juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait cela au juste ?
Non ! Mais il est difficile de faire quelque chose de plus bête et de moins utile que cette dispersion. Pourquoi Gambetta laisse-t-il faire ? J'ai cru un instant qu’il laissait faire pour intervenir victorieusement.
Mercredi 14 juillet 80.
Anniversaire de la prise de la Bastille. Revue, distribution de drapeaux, illuminations, bals dans tous les carrefours.
Paris a un cachet de nouveauté charmante.
A six heures, nous prenons le train de ceinture à la Porte Maillot. Je me suis habillée d'une robe rose coûtant 25 francs au magasin du Printemps.
Remarquez que nous allons voir les illuminations et les émeutes à Belleville. On cause et on rit tant, que l'on manque la station et que nous changeons par trois fois de train. Ce qu'il y avait d'inquiétant, c'est que les quartiers semblaient abandonnés. Enfin nous débarquons en plein désert, il est huit heures et on commence à avoir faim. Gaillard parle de dîner au lac Saint-Fargeau : ombrages délicieux, lac, bonne cuisine, etc., etc. Adopté. On se met à sa recherche, et on entre dans un parc, les bulles Chaumont. On a une faim atroce; mais on se console en trouvant le paysage superbe, surtout certain pavillon à l'air de temple. Julian aborde presque tous les passants et se renseigne quant au restaurant, qu'on nous indique de tous côtés. Enfin, après avoir marché et admiré le pavé pour nous consoler, nous apercevons un lac et un restaurant illuminés. C'est superbe ; on s'élance ; mais au bout de dix minutes de marche, on trouve une barrière. Il faut retourner et prendre par un autre côté. C'était désolant ; la future Mme Gaillard mourait de faim. Et chaque fois que nous prédisions, pour rire, quelque mésaventure, elle arrivait. Le lac n'était pas Saint-Fargeau, et le restaurant un simple café où on ne trouve rien à manger.
— Descendez à la Villette, disait l'un.
— Si vous voulez manger quelque chose debout, dit un citoyen pochard, entrez là, et il indiquait un mastroquet.
0 bonheur ! Un fiacre passe, mais refuse de nous prendre, et ce n'est qu'après de vives instances et des supplications qu'il consent. On s'empile à cinq et on part pour le lac Saint-Fargeau. Je ne vous peindrai pas cette course d'une heure entière par des tas de petite rues assez vides. Nous arrivons ; le lac Saint-Fargeau n'est pas un lac, mais une mare d'eau affreuse. Il est neuf heures et demie; mais à peine sommes-nous à table, qu'il pleut. Déménagement dans une salle de conférence immense. Je monte sur une chaise : « Messieurs, je suis une opportuniste avant tout ; or, comme à l'heure qu'il est il est opportun de manger, je propose de nous remettre à table. » Vers dix heures, nous songeons au feu d'artifice que nous devions voir du haut des buttes Chaumont. A la porte du restaurant se retrouve notre angélique cocher. Il est gris, mais fait preuve d'un talent d'ambassadeur dans les passages difficiles. En effet, des cris de : « A bas les voitures ! » font entendre ; mais nous répondons par : « Vive la République ! »
Vendredi 16 juillet 80.
Julian trouve très bien, très bien ma peinture et A... est obligée de dire que ce n'est pas mal, car Julian est plus sévère que Tony.
Je suis folle des éloges de Julian.
Nous partons demain et je subis les ennuis de la veille des départs, paquets, etc., etc.
Il est heureux que je parte, sans cela l'atelier n'irait plus si bien. J'en suis, à l'heure qu'il est, le chef incontesté. Je donne des conseils, j'amuse, on s'extasie devant mon œuvre ; je mets de la coquetterie à être bonne, gentille, obligeante, à me faire aimer, à aimer les camarades et à les consoler par des fruits ou des glaces.
L'autre jour, je suis sortie et on se mit aussitôt à dire du bien de moi. Mlle Marie D... n'en revenait pas encore en le racontant, et Madeleine, qui dessine comme vous savez, veut se mettre à peindre et se met sous mon aile pour les conseils. Il est vrai que j'enseigne parfaitement ; si je peignais comme j'enseigne, je serais fort contente. — En somme, que voulez-vous, c'est toujours ça que d'être un professeur épatant. — Julian regrette que je ne puisse pousser plus loin cette tête qui « serait une chose d'exposition ». — « Ça, c'est du tempérament,, c'est nature, c'est franc, c'est vivant. »
La petite est une tête originale : de très grands yeux, des paupières énormes, l'arcade sourcilière énorme, des sourcils un peu étonnés, un nez retroussé, une jolie bouche, un teint charmant ; elle est jeune, mais il y a je ne sais quoi de flétri, qui ne déplaît pas pourtant. Des cheveux d'or que je crois teints, mais qui sont admirables, arrangés en crinière de lion sur un fond gros vert.
Samedi 17 juillet 80.
Je voulais aller à la campagne, une vraie campagne où il n'y eût personne ; mais ce n'est pas assez. Le bonheur, ce serait de pouvoir se retirer de temps en temps dans des pays inhabités, aux îles, parmi de grands arbres étrangers, chez Paul et Virginie. Voir le lever du soleil et savourer la nuit toute seule, dans le calme le plus absolu. Un pays sauvage, de grands arbres, un ciel pur, des montagnes dorées par le soleil... un air comme on n'en a pas d'idée, un air qui à lui tout seul est une félicité, au lieu des horreurs que l'on respire ici... Mais pour une existence pareille, il faut de l'argent. Et je ne voudrais même pas un homme aimé dans cette solitude.
Mont-Dore. Mardi 20 juillet 80.
Chez Julian, avec Villevieille pour chercher mes clefs oubliées hier. Cet homme m'encourage beaucoup, je pars avec une bonne impression. Ce qui est un soulagement, c’est que Breslau ne me fait plus peur. — Ce qu’il y a chez elle (chez moi), dit Julian, c’est que ce n’est pas de la peinture, c'est l'objet même ; et lorsqu'elle n'y arrive pas, on voit tout de même que l'effort tendait à cela.
Après, nous allons revoir le prix de Rome. A quatre heures, Villevieille revient me dire encore adieu et nous partons. Arrivées lundi à six heures du matin à Clermont ; à trois heures, nous arrivons au Mont-Dore. Il y a six heures de voiture de Clermont à cet affreux Mont-Dore, mais j'aime mieux cela que le chemin de fer.
Nous sommes mal logées, tout est plein, cuisine atroce. Ce n'est qu'aujourd'hui que je m'y fais un peu. Surtout parce que j'ai découvert des choses intéressantes pour la peinture.
Mercredi 21 juillet 80.
J'ai commencé mon traitement. On vient vous chercher dans une chaise à porteur calfeutrée. Un costume de flanelle blanche, pantalon à pied, et capuchon et manteau.
Alors se suivent : bain, douche, boisson, aspiration. Je me prête à tout ; c'est la dernière fois que je me soigne et je ne me soignerais pas si je ne craignais de devenir sourde. Ma surdité va beaucoup mieux, presque bien.
Jeudi 22 juillet 80.
J'admets l'élévation au pouvoir suprême d'un homme, quand cet homme est un héros comme Napoléon I er ; j'admets qu'on confère une sorte de dictature à un être supérieur et capable mais ses enfants ne sont rien. Je ne veux même pas de pouvoir à vie, cela montrerait qu'on a peur de faillir à ses engagements, de part et d'autre. Si l'élu se conduit bien, il n'est pas besoin de serment pour qu il reste le chef.
Je me suis coiffée d'un chapeau de paysanne d'ici, cela me va très bien, me faisant ressembler à un Greuze. J'ai télégraphié et on m'envoie des robes de linon pour les chaleurs d'ici, et voilà qu'il fait froid. Je commence à voir le paysage ; jusqu'à ce soir j'étais énervée par la saleté de la nourriture, énervée parce que le manger est une préoccupation ignoble et à laquelle on ne peut se soustraire.
Vendredi 23 juillet 80.
Qui me rendra ma jeunesse gaspillée, saccagée, perdue ? Je n'ai pas encore vingt ans et, l'autre jour, je me suis trouvé trois cheveux blancs ; je m'en vante, c'est une preuve épouvantable que je n'exagère rien. N'était ma figure d'enfant, je paraîtrais vieille. Est-ce que c'est naturel à mon âge ?
Non ! voyez-vous, il se soulève au fond du cœur un tel orage, qu'il vaut mieux couper court à tout, en me disant que j'aurai toujours la ressource de me casser la tête avant qu'on me plaigne.
J'avais une voix extraordinaire : c'était un don de Dieu, et je l'ai perdue. Le chant, pour la femme, est ce que l'éloquence est à l'homme, une puissance sans limite.
A la promenade, dans le parc sur lequel donne ma fenêtre, j'ai vu Mme, de Rothschild, venue ici avec palefreniers, chevaux, etc., etc. La vue de cette heureuse m'a fait mal, mais il faut être brave. Du reste, quand une douleur devient aiguë, c'est la délivrance. Quand on en arrive à un certain point, on sait que cela ne peut plus que diminuer. C'est en attendant cette crise du cœur et de l'âme qu'on souffre ; mais une fois arrivé là, on est soulagé. Et puis on appelle à son aide Epictète ou on prie ; mais la prière attendrit...
Maintenant, je suis mieux pour quelques jours, pendant lesquels les amertumes vont monter, monte, monter ; puis de nouveau un éclat, puis l'abattement et toujours comme cela !
Mardi 27 juillet 80.
J'essaie de peindre du paysage, mais cela finit par un coup de pied dans la toile, et puis une petite fille de quatre ans était là à côté qui me regardait faire et, au lieu de regarder mon paysage, je regardais l'enfant qui va me poser dès demain. Comment peut-on préférer quoi que ce soit à la figure ?
J'ai tellement mal entre le cou et l'oreille gauche tout à l'intérieur, que c'est à en devenir fou. Je ne le dis pas, cela me ferait ennuyer par ma tante, et je sais que cela tient à mon mal de gorge.
Voilà plus de vingt-quatre heures que je souffre à crier, impossible de dormir, ni de faire quoi que ce soit. Ma lecture même en est interrompue à chaque instant. C'est cette douleur qui me fait voir la vie en noir, je crois. Misère de misère !
Jeudi 29 juillet 80.
Je trouve des modèles en masse ; tous ces Auvergnats sont d'une complaisance rare et les femmes sont extrêmement flatteuses.
Je commence une petite de dix ans, couchée, endormie dans l'herbe. Mais demain, je la laisse pour faire un petit bonhomme avec sa chèvre (grand. nat.) que j'achèverai et après lequel je reprendrai ma petite. Le bonhomme à la chèvre est le fils d'un sculpteur en bois et menuisier qui a dessiné dans des ateliers à Paris. La femme est couturière et les trois enfants sont jolis.
Au surplus, leur boutique prend jour sur le nord et, les jours de pluie, je ferai une étude de la boutique très sombre où je placerai la petite fille, qui n'a pas plus de sept ans et qui est charmante.
Samedi 31 juillet 80.
Hier, j'ai commencé mon tableau sur une toile de 25. C'est fort simple d'arrangement. Les deux enfants sont assis sous de beaux arbres au tronc couvert de mousse ; il y a une éclaircie dans le haut de la toile par laquelle on voit la campagne d'un vert clair. Le garçon, qui a une dizaine d'années, est assis de face, un livre d'école sous le bras gauche, les yeux dans le vague. La petite fille, qui a six ans, le tire par l'épaule d'une main et, de l'autre, tient une poire. La tête est de profil, elle a l'air de l'appeler. On voit les deux enfants jusqu'aux genoux seulement, . Car c'est grandeur nature.
Avant de quitter Paris, j'ai lu Indiana, de Georges Sand. Et je vous assure que cela n'est pas amusant !
N'ayant lu que la Petite Fadette deux ou trois autres nouvelles et Indiana, je ne devrais peut-être pas me prononcer... Mais jusqu'à présent je ne goûte pas du tout ce talent.
Pourtant, pour que tout le monde l'ait proclamé si haut... Enfin, je n'aime pas cela, moi.
C'est comme les Vierges de Raphaël ; ce que je vois au Louvre me déplaît. J'ai vu l'Italie avant de pouvoir juger, et alors ce que j'ai vu m'a déplu également. Ce n'est ni divin, ni terrestre, à ce qu'il m'a semble, c'est conventionnel et cartonneux.
J'ai voulu monter à cheval..., mais je n'ai envie de rien et, quand je passe une journée sans travailler, j'ai d’affreux remords, et il y a des jours où je ne peux rien faire ; alors je me dis que, si je voulais, je pourrais, et alors des querelles avec moi-même, et cela finit par un lâchez tout ! Ça n'est pas la peine de vivre ! pendant lequel je fume et lis des romans.
Mardi 17 août 80.
Mon tableau en plein air est abandonné, vu le mauvais temps.
J'en ai fait un autre (toile de 15).
La scène se passe chez le menuisier : à gauche la femme essaie au petit, qui a dix ans, le costume d'enfant de chœur ; la petite fille, assise sur une vieille caisse, regarde son frère, ébahie ; la grand mère est près du poêle, au fond, les mains jointes, et sourit en regardant l'enfant. Le père, près de l'établi, lit la Lanterne et regarde de travers la soutane rouge et le surplis blanc. Le fond est très compliqué, poêle, vieilles bouteilles, outils, un tas de détails un peu bâclés naturellement.
Je n'ai pas le temps de finir, mais j'ai fait ce tableau pour me familiariser avec ces choses. Des êtres en pied, les planchers, les autres détails m'épouvantaient et je ne me risquerais qu'en désespérée si je devais faire un tableau d'intérieur. Maintenant cela me connaît, non pas que je le fasse bien, mais je n'en ai plus peur, voilà.
Les têtes de mon premier plan ont trois doigts de hauteur à peu près.

Et il y a eu les robes et tout à faire, je n'ai jamais fait que du nu, sauf dans mon méprisable tableau du Salon. — Et des mains ! il y a six mains et demie.
Je n 'ai jamais eu la persistance de mener à bonne fin un écrit. L'événement arrive, j'ai l'idée, je fais le brouillon et, le lendemain, je vois dans les journaux un article qui ressemble au mien et rend le mien inutile, que je n'ai du reste jamais fini, ni mis en état convenable. La persistance en art me montre qu'il faut un certain effort pour vaincre la première difficulté ; il n'y a que le premier pas qui coûte. Ce proverbe ne m'a jamais tant frappée.
Et puis, il y a aussi et surtout la question de milieu. Le mien peut se qualifier, malgré la meilleure volonté du monde, d'abrutissant. Les gens de ma famille sont, pour la plupart, ignorants et ordinaires. Puis, il y a Mme G..., qui est une mondaine par excellence. Et puis, le monde qui vient en visite ; on cause rarement, et vous connaissez les habitués : la M..., etc., quelques jeunes gens incolores. Aussi, je vous assure que si je ne me renfermais si souvent avec moi et mes lectures, je serais encore moins vive d'intelligence que je ne le suis. J'ai l'air de briser les vitres, et parfois personne n'a plus de difficulté à se produire. Souvent je deviens imbécile, les mots se pressent dans la bouche et je ne puis parler. J'écoute, je souris vaguement, et c’est tout.
Mercredi 18 août 80.
Nous avons fait une trop grande promenade ; cinq heures à cheval avec ce traitement affaiblissant. Et je suis éreintée, dans le sens exact du mot.
Je crains que le traitement ne donne raison à cet animal de docteur des eaux, qui a prétendu que j’étais faible... Il est vrai que, quand j'eus fini, il m'assura que, pour avoir si bien supporté vingt et un bains, il fallait être très forte. La médecine est une triste science.
Nous avons monté jusqu'au sommet du Sancy ; les montagnes qui encaissent l'horrible Mont-Dore paraissent plates de cette hauteur. Le spectacle du haut du Sancy est vraiment grandiose ; j'aimerais voir un lever de soleil de là-haut. Les lointains sont d’une teinte bleuâtre qui m'a fait penser à la Méditerranée, et il n'y a que cela de beau. L'ascension à pied est très pénible ; mais quand on est arrivé, on semble dominer le monde.
Il y avait une foule de gens, venus comme nous, qui gâtaient la nature.
Jeudi 19 août 80.
Je ne vaux rien ce matin, les yeux, la tête fatigués. Et dire que je ne pars que samedi ! Aujourd'hui, je n'ai pas le temps ; demain, c'est vendredi, et si je partais un vendredi, je penserais que les embêtements qui m'arrivent toujours sont arrivés à cause de cela.
Paris. Dimanche 22 août 80.
8 heures. Ce que mon cabinet d'études me paraît joli et confortable !
J'ai lu les journaux hebdomadaires illustrés et autres brochures... Tout est au pair maintenant, c'est comme si je n'étais pas partie.
2 heures après-midi. Je me console (!) en pensant que mes ennuis sont l'équivalent de ceux de toute nature que les artistes ont à vaincre ; puisque je n'ai pas à subir la pauvreté et la tyrannie des parents..., car c'est de cela, n'est-ce pas, qu'ils se plaignent, es artistes ?
Ce n'est pas en ayant du talent que je m'en tirerai, à moins que cela soit... un coup de génie ; mais ces coups là, les plus grands génies ne les ont jamais eus après trois ans d'études seulement, surtout maintenant où il y a tant de talents.
J'ai de bonnes intentions, et puis, tout à coup, je fais des folies comme dans un rêve... Je me méprise et me déteste, comme je méprise et déteste tous les autres et les miens... Oh ! la famille... Tenez, ma tante a fait trente petites ruses pour me mettre du côté où la fenêtre n'ouvrait pas (en wagon) : j'ai consenti de guerre lasse, à condition que l'autre fût ouverte, et à peine ai-je été endormie qu'elle l'avait fermée. Je me suis réveillée en disant que j'allais casser les vitres avec mes talons, mais nous étions arrivées. Et ici, à déjeuner, des regards d'angoisses et des sourcils contractés dramatiquement, parce que je ne mangeais pas. Évidemment ces gens-là m'aiment..., mais il me semble pourtant que l'on devrait comprendre plus que ça quand on aime !...
L'indignation sincère fait l'éloquence.
Un homme indigné ou se croyant indigné contre un gouvernement monte à la tribune et se fait une renommée. La femme, elle, n'a aucune tribune à sa disposition ; au surplus, elle est obsédée par des père, beaux-pères, mère, belles-mères, tous, etc., etc., qui l'embêtent toute la journée : elle s'indigne, elle est éloquente devant sa table de nuit ; résultat : — zéro.
Et puis...maman parle toujours de Dieu : si Dieu veut, avec l'aide de Dieu. On n’invoque si souvent Dieu que pour se soustraire à toutes sortes de petits devoirs.
Ça n'est ni la foi, ni même la dévotion : une manie, une faiblesse, une lâcheté de paresseux, d'incapable, d'indolent ! Quoi de plus indélicat que de couvrir toutes ses défaillances par ce mot de Dieu ? C'est indélicat ; c'est plus, c'est criminel si l'on croit en Dieu. S'il est écrit que telle chose arrivera, elle arrivera, se dit-elle, pour s'éviter la peine de se remuer... et les remords.
Si tout était écrit d'avance, Dieu ne serait qu'un président constitutionnel, et nos volontés, vices, vertus, des sinécures.
Jeudi 2 septembre 80.
« Il lisait d'ailleurs beaucoup, il se donnait, cette profonde et sérieuse instruction qu'on ne tient que de soi-même et à laquelle tous les gens de talent se sont livrés entre vingt et trente ans. » Cette phrase cueillie dans Balzac, me flatte.
Mais voici : j'ai loué un jardin à Passy, rue du Ranelagh, 45, pour faire des études en plein air. Je commence par Irma, nue, sous un arbre, nu-corps, grandeur naturelle.
Il fait assez chaud encore, et il faut se dépêcher. Voilà comment se passe la vie. Enfin, j'aime autant cela, je ne sais ce qui fait que j'ai comme des appréhensions de je ne sais quoi ; il me semble qu'il va m'arriver des ennuis, des... Enfin, enfermée seule, travaillant, je me croirai à l'abri...; mais les hommes sont si bêtes, si méchants qu'ils vont vous chercher dans votre coin pour vous faire de la peine.
Mais que peut-il arriver ? Je ne sais : quelque chose qu'on inventera ou dénaturera ; on me le redira et j'en aurai la peine...
Ou bien il arrivera quelque vilenie... pas grave, mais triste, humiliante, dans mon genre enfin. — Tout cela m'éloigne de Biarritz.
— Allez-y donc, me disait Mme G..., il faut que vous y alliez, je veux le dire à votre mère ou à votre tante... Enfin vous irez à Biarritz, c'est très élégant, vous y verrez du monde.
Flûte ! comme on dit dans le grand monde. Enfin, pourvu qu'on me laisse tranquille, je veux bien rester dans mon jardin à Passy.
Mardi 7 septembre 80.
Il pleut... tous les pires incidents de mon existence me défilent par la tête, et il y a des choses, lointaines déjà, qui me font sauter et me crispent les mains, comme une douleur physique qui serait arrivée à l'instant.
Il faudrait, pour que je fusse mieux, que tout changeât autour de moi... Les miens me sont désagréables ; je prévois d'avance ce que dira ma tante ou maman, ou ce qu'elles feront dans chaque circonstance, comment elles sont au salon, à la promenade, aux eaux, et tout cela m'énerve horriblement... comme si on coupait du verre.
Il faudrait changer tout ce qui m'entoure, et après, calmée, je les aimerais sans doute comme on doit les aimer. Pourtant elles me laissent périr d'ennui, et quand je refuse un plat ce sont des airs épouvantés... ou bien mille tricheries pour ne pas servir de glace à table, parce que cela peut me faire mal. Ou bien l'on vient, comme des voleurs, fermer les fenêtres que j'ouvre. Mille petites niaiseries qui m'irritent ; mais tout ce qui est la maison m'obsède. Ce qui m'inquiète, c’est que je me rouille dans cette solitude ; tous ces tons noirs obscurcissent l'intelligence et me font rentrer dans moi-même. Je crains que ces nuages sombres ne laissent pour toujours un voile sur mon caractère et ne me rendent amère, aigrie, sombre ; je n'ai pas envie d’être ainsi, et je crains de le devenir, à force de rager et de me taire.
On dit que j'ai une tenue parfaite, les vieux bonapartistes l'ont dit à Adeline... Non, voyez-vous, il me semble qu'il pèsera toujours sur moi une sorte de malaise.
J'ai toujours peur d'être calomniée, humiliée, mise à l'index... et il doit en rester quelque chose, quoi qu'on dise... Non, voyez-vous, ma famille ne sait pas ce qu'elle a fait de moi. Ma tristesse ne m’effraie que parce que je crains de perdre à jamais toutes les qualités brillantes, indispensables à la femme...
Pourquoi vivre ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que j'ai ? Ni gloire, ni bonheur, ni même paix !...
Vendredi 10 septembre 80.
Grand émoi pour ma tante. Le Dr Fauvel, qui m'a auscultée il y a huit jour et qui n'a rien trouvé, m'a auscultée aujourd'hui et a trouvé les bronches attaquées ; il a pris un air... grave, affecté, un peu confus de ne pas avoir prévu la gravité du mal ; puis des prescriptions de poitrinaires, huile de foie de morue, badigeonnage à l'iode, lait chaude, flanelle, etc., etc., et enfin il conseille d'aller trouver le Dr Sée ou le Dr Potain, ou bien de les réunir chez lui en consultation. Vous pensez bien quelle figure avait ma tante ! Moi, cela m'amuse. Il y a longtemps que je me soupçonne quelque chose, j'ai toussé tout l'hiver et je tousse et étouffe à présent. Du reste, l'étonnant serait que je n'eusse rien ; je serais contente d'avoir quelque chose de sérieux et d'en finir. Ma tante est consternée ; moi, je triomphe. La mort ne m'effraie pas ; je n'oserais pas me tuer, mais je voudrais en finir.... Si vous saviez... je ne mettrai pas de flanelle et ne me salirai pas avec de l'iode. Je ne tiens pas à guérir. Il y aura sans cela assez de santé et assez de vie pour ce que j'ai à en faire.
Vendredi 17 septembre 80.
Hier, je suis retournée chez le docteur où je suis allée pour mes oreilles. Et il m'a avoué qu'il ne s'attendait pas à voir la chose si grave, que je n'entendrais jamais aussi bien qu'avant. J'en suis restée comme assommée. C'est horrible. Je ne suis certes pas sourde, mais j'entends comme on voit à travers un léger voile. Ainsi je n'entends plus le tic tac de mon réveil et peut-être je ne l'entendrai plus jamais qu'en m'approchant. Voilà, en vérité, un malheur. Dans la conversation, quelquefois, bien des choses m'échappent... enfin, remercions le ciel de n être pas encore devenue aveugle ou muette.
J'écris toute courbée et, si je veux me redresser, j'ai atrocement mal ; c'est chez moi l'effet des larmes ; à la mort du prince impérial, j'ai eu mal comme cela. J'en ai pleuré depuis ce matin.
Mardi 28 septembre 80.
Une bonne journée commencée dès la nuit. J'ai rêvé de lui. Il était laid et malade, mais ça ne fait rien. — Je comprends maintenant qu'on n'aime pas pour la beauté. — Nous causions comme deux amis, comme avant ; comme nous causerions encore si nous nous retrouvions ! Je ne demandais qu'une chose : que notre amitié restât dans les limites permises pour durer.
C'était aussi mon rêve dans la réalité. Enfin je n'ai jamais été si heureuse que cette nuit.
Saint-Amand arrive à déjeuner. Avalanche de compliments ; je suis ceci et cela, et l'on formera cet hiver un cercle d'élite autour de moi ; il m'amènera les célérités, tous les quelqu'un, etc., etc. Je n'avais pas même besoin de cela, je me suis éveillée en riant.
Dumas fils dit que les jeunes filles n'aiment pas, mais préfèrent, car elles ne savent pas ce que c'est que l’amour. Aussi où diable place-t-il l'amour, M. Dumas ?
Et d'abord on sait toujours à peu près assez pour savoir... Et puis, ce que M. Dumas appelle l'amour n’est que la conséquence et le complément naturel de l’amour et pas du tout une chose à part, isolée et complète, du moins pour les gens un peu propres. « Conséquence inévitable souvent et sans laquelle il n'y a as d'amour possible, » dit le même Dumas, et il appelle cela aussi « la dernière expression de l'amour ». Ça, veux bien, mais dire qu'une fille ne peut pas aimer, est fou. Moi, je n'en sais rien, et pourtant je sens qu'il a là quelque chose de repoussant, avec un être désagréable, et qu'il y a là « la dernière expression de l’amour » quand on aime.
Maintenant, il y a aussi les idées folles qui vous passent quelquefois, mais on sait bien ce que c 'est... quand l'homme n'est pas repoussant, mais ça n'a rien à faire avec l'amour. Moi, ce qui m’horripilerait le plus , ce serait d'embrasser sur les lèvres un indifférent ; je crois que je ne le pourrais jamais.
Mais quand on aime. Ah ! c'est... tellement différent. Ainsi cette nuit, dans mon rêve, j'aimais, cela m’est arrivé aussi étant éveillée. Eh bien, c‘est si pur, si tendre, si beau. L'amour est un sentiment grandiose et pur, tout y est chaste.
L'amour de M. Dumas n'est pas l'objectif, mais n’est qu'une conséquence de ce qu'on éprouve, qu'un moyen de mieux, de plus aimer ce qu'on aime.
Mercredi 29 septembre 80.
Je suis depuis hier blanche et fraîche et jolie à m'en étonner. Et des yeux animés et brillants ; le contour même du visage apparaît plus joli et plus fin. Seulement, c'est dommage que ça vienne dans un moment où je ne vois personne C'est bête à dire, mais je suis restée une demi-heure à me regarder dans la glace avec plaisir ; il y a quelque temps que cela ne m’est arrivé…
Vendredi 1er octobre 80.
La famille russe qui est venue nous voir me raconte ce qui se passe en Russie. — Leur fille aînée est sous la haute surveillance de la police, pour avoir dit, un jour d'examen où l'on attendait le grand-duc, qu'elle estimait bien plus passer son examen que de recevoir la visite du grand-duc. Ensuite, étant très myope, elle portait un pince-nez grâce à quoi elle a été dénoncée à la police ; les lunettes et le pince-nez étant, chez les femmes, les signes des idées avancées. On déporte, on empoisonne, on exile sur un mot. On fait des visites domiciliaires de nuit, et si vous n'êtes pas très dangereux, on vous exile à Viatka ou à Perm ; si vous l'êtes beaucoup, en Sibérie, à la potence. On dit qu'il n'y a pas de famille où il n'y ai un exilé, un pendu ou un surveillé au moins. L'espionnage est tellement organisé qu'il est impossible de causer chez soi, en famille, sans que tout soit rapporté à qui de droit.
Pauvre pays, et je m'accusais, l'autre jour, de lâcheté parce que je ne voulais pas y aller ! Mais est-ce possible ? Les socialistes y sont d'atroces gredins qui assassinent et pillent ; le gouvernement y est arbitraire et stupide, ces deux éléments épouvantables se font la guerre, les sages sont écrasés entre les deux. La jeune fille me dit, au bout de deux heures de causerie, que sur le dixième de ce que je dis je serais envoyée aux travaux forcés ou pendue, et que si je vais en Russie mon affaire est faite.
J'irai en Russie, quand il y aura dans ce beau pays quelque respect du droit des gens, quand on pourra y être utile et qu'on ne risquera pas d'être exilée pour voir dit que « la censure est bien sévère ».
Tout cela fait bondir. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de fonder un parti libéral honnête, car je hais autant les crimes du socialisme que ceux du gouvernement ?
Ah! si je n'avais ma peinture, comme je...
Oh ! Français, qui dites que vous n'êtes ni heureux, ni libres !... Il se passe en Russie ce qui s'est passé en France sous la Terreur : un geste, un mot et on est perdu. Ah ! qu'il reste encore à faire pour que les hommes soient à peu près heureux !
« Nous sommes en train de délivrer la femme, dit Dumas fils ; quand ce sera fait, nous tâcherons de délivrer Dieu ; et comme alors il y aura entente parfaite entre les trois corps d'états éternels : Dieu, l’homme et la femme, nous verrons plus clair et nous marcherons plus vite. »
La question de la femme est une des plus odieuses et quand on pense que tout a progressé, sauf cela, on est vraiment stupéfait. Lisez la brochure de Dumas, Les femmes qui votent et les femmes qui tuent, le talent cassant de Dumas ne me choque plus dans ces pages, bien que l'homme y soit encore un peu trop hautain envers la femme. Mais, somme toute, cela a du bon.
Samedi 2 octobre 80.
Une dame dont je fais le portrait me le paie en posant pour une étude de mains. Tony a été adorable ; il allait corriger la Juive quand il aperçut mes mains : — Qui est-ce qui a fait cela ? — C'est moi, Monsieur.
— C'est très vrai, très vrai, très vrai ; puis, après avoir encore regardé l'étude, il se remit à dire : — C'est très vrai, très vrai, très vrai ; et, après une nouvelle pose : — C'est très vrai. — Il avait l'air agréablement surpris, et pensez à ma joie !
Enfin il s'assit à ma place et me fit la leçon. — C’est une bonne étude, il faut en faire d'autres comme cela ; il y a là des tons charmants ; je souligne à cause des camarades qui, ne sachant que dire, me refusaient la couleur.
— Malheureusement, ce n'est pas tout à fait bien dessiné, mais, à la seconde étude, cela n'arrivera plus, j'en suis sûr, ce doit être trop long, c'est une façon qu'on ne fait pas deux fois ; en somme, c'est bien, il y a du bon. — Non ! j'en étais rouge et pâle. Du reste, il faut voir l'importance qu'on me donne à l'atelier, je suis la plus forte ; et on fait tant et tant que je parle presque avec onction, comme Cassagnac. Mais ne craignez pas que ce triomphe-là me tourne la tête.
Je suis heureuse pour ma peinture, et en général je vais mieux.
Ces mains sont peintes sur une toile de six ; la gauche appuyée, aplatie sur la table ; la droite tient une plume comme si elle venait de s'arrêter pour relire. Je m'explique mal, mais vous comprenez.
Dimanche 3 octobre 80.
Je suis triste.
Non, voyez-vous, il n'y a rien à faire. Voilà quatre ans que je soigne chez les plus célèbres docteurs une laryngite, et cela va de mal en pis.
Depuis quatre jours, mes oreilles allaient bien, j'entendais bien ; maintenant, ça recommence.
Eh bien, voyez, je vais être prophète :
Je vais mourir, mais pas tout de suite ; tout de suite, cela mettrait fin à tout, ce serait trop bien. Je vais traîner mes rhumes, ma toux, des fièvres, toutes sortes de choses…
Lundi 4 octobre 80.
J'avais demandé de la musique pour mandoline à mon professeur de Naples ; voici sa réponse.
Je garde sa lettre à cause de sa tournure italienne charmante, quoique venant d'un homme simple. J’avoue que, malgré mes tendances naturalistes (un mot peu compris) et mes sentiments républicains, je suis fort sensible à ces fleurs de langage.
Pourquoi tout cela n'irait-il pas ensemble, du reste !
Mais il faut laisser ce style aux Italiens ; chez les autres, il est ridicule. Mon Dieu ! quand est-ce que je pourrais aller en Italie ?
Que tout le reste est terne après l'Italie ! Personne et rien ne m'a jamais transportée comme le souvenir de ce pays.
Pourquoi n'irais-je pas là à présent ? Et la peinture ? Suis-je assez forte pour ne pas m'égarer sans direction. Je ne sais pas.
Non. Je resterai cet hiver à Paris ; j'irai passer le carnaval en Italie, je passerai l’hiver de 1881 à 1882 à Pétersbourg. Si je ne trouve pas un riche mariage à Pétersbourg, je reviens à Paris ou en Italie, de 1882 à 1883. Et alors je me marierai avec un Monsieur titré qui aura 15 ou 20,000 francs par an et qui me prendra avec plaisir, avec mes rentes à moi. N'est-ce pas absolument sage de me donner trois ans pour chercher, avant de capituler ?
Mardi 5 octobre 80.
Se résigner, ou plutôt se ramasser, pénétrer jusqu'au fond de son être, et alord se demander si cela n'est pas indifférent. Avoir vécu d'une manière ou d'une autre, qu'importe ? Vaincre ses sensations et se dire, avec Épictète, qu'on est maître de prendre le mal pour le bien, ou plutôt de rester indifférent à ce qui arrive. Il faut avoir horriblement souffert pour accepter de sortir de la vie par cette espèce de mort, et ce n'est qu'après des souffrance inouïes et un désespoir complet qu'on commence à comprendre la possibilité de cette vie morte. Mais, en somme, si on s'y mettait bien, on serait tranquille au moins... Ce n'est pas un vain rêve, c'est une chose possible. Mais pourquoi vivre alors ? direz-vous. Et parce qu'on est venu au monde, il est évident qu’il devient ainsi inutile de vivre. Aussi ce n'est qu'après avoir bien reconnu que la véritable vie vous est un sujet de maux sans fin, qu'on accepte l'autre ou qu'on se cache de la première dans la seconde.
Arrivé à un certain point de douleur physique, on perd connaissance ou on tombe en extase ; de même pour les souffrances morales arrivées à un certain point ; on plane, on s'étonne d'avoir souffert, on méprise tout et on marche la tète haute comme les martyrs.
Qu'importe, après tout, que les cinquante ans que j'ai à vivre se passent au fond d'un cachot ou dans un palais, parmi du monde ou dans la solitude ! La fin est la même. Les sensations enfermées entre le commencement et la fin et qui ne laissent aucune trace, voilà donc ce qui préoccupe. Qu'importe une chose qui ne dure pas et qui ne laisse pas de trace ! Je puis utiliser ma vie en travaillant, j'aurai du talent ; peut-être cela laisse-t-il des traces... après la mort.
Samedi 9 octobre. 80
Je n'ai pas travaillé cette semaine, et l'inaction me rend stupide. J'ai relu mon voyage en Russie et cela m'a beaucoup intéressée. En Russie, j'avais lu en partie Mademoiselle de Maupin, et comme cela ne m'avait pas plu, je viens de la relire. Car enfin Théophile Gautier est reconnu pour un norme talent et Mademoiselle de Maupin pour un chef-d'œuvre, surtout la préface. Je l'ai donc relue aujourd'hui. La préface est très bien, c’est vrai ; mais le livre ?... Malgré toutes...ses nudités, le livre n’est pas amusant, certaines pages en sont simplement ennuyeuses. J'entends des gens qui crient... et la langue et le style ? etc. Eh ! Pardieu ! oui, c'est en bon français, c'est d'un homme fort dans son métier, mais ce n’est pas un talent sympathique... Plus tard peut-être je comprendrai pourquoi c'est un chef-d œuvre, je veux bien même comprendre à présent que c'est très bien, mais c'est antipathique, et cela m'ennuie.
C'est comme Georges Sand... Encore un écrivain avec lequel je ne sympathise pas, et Georges Sand a en moins de Gautier cette vigueur, cette crânerie qui vous donnent du respect, sinon de l'amitié pour lui. Georges Sand... Enfin, c'est très bien. J'aime mieux Daudet dans les modernes ; il écrit des romans, mais semés d'observations justes, de choses vraies, senties. On vit là dedans.
Quant à Zola, nous sommes en froid ; il s'est mis à attaquer, dans le Figaro, Ranc et d'autres individualités républicaines, avec un acharnement de mauvais goût, qui ne sied ni à son grand talent, ni à sa grande situation littéraire.
Mais que voit-on dans Georges Sand ? Un roman joliment écrit ? Oui, après ? Eh bien, ses romans m'ennuient. Tandis que Balzac, les deux Dumas, Zola, Daudet, Musset ne m'ennuient jamais. Victor Hugo, dans sa prose la plus romantiquement folle, dans Han d'Islande, n'est jamais fatigant. On sent le génie-, mais Georges Sand ! Comment peut-on lire trois cents pages remplies des faits et gestes de Valentine et de Bénédict, accompagnés d'un oncle, d'un jardinier, que sais-je ?
Toujours le nivellement social par l'amour ; ce qui est ignoble.
Qu'on établisse l'égalité, c'est admirable, mais qu'elle ne soit pas due à des caprices de sexe... La comtesse amoureuse de son valet, et des dissertations là-dessus ! Voilà le talent de Georges Sand. Évidemment ce sont de très jolis romans, de jolies descriptions de campagne... Mais je voudrais quelque chose de plus... Je ne sais trop m'expliquer... Voilà des choses qu'il ne faudrait pas croire ; je crois toujours m'adresser à des êtres qui me sont supérieurs et devant qui je crains de dire avec prétention, tandis qu'en général, il n'y a que des médiocres, des inférieurs, et ceux-là ne savent jamais gré d'une modestie ou d'un aveu de faiblesse.
Eh bien, Valentine, je la lis en ce moment et cela m'agace, parce que le livre m'intéresse assez pour que je le finisse, et en même temps je sens qu'il ne m'en reste rien, que peut-être une vague impression désagréable ; il me semble que cette lecture me rabaisse, je me révolte et je continue, car il faut que ce soit aussi assommant que le Dernier Amour, du même auteur, pour que je n'aille pas jusqu'au bout. Pourtant Valentine est ce que j'ai lu de mieux de Georges Sand. Le Marquis de Villemer est bien aussi ; je crois qu'il n'y a pas de palefrenier amant de la comtesse.
Dimanche 10 octobre 80.
Quelques personnes et Saint-Amand. Nous faisons de la musique et il pleure sur Paul et Virginie. Moi je comprends cet attendrissement irrésistible. J'ai pleuré en lisant ce livre, et la musique de l'Opéra me fait pleurer aux mêmes endroits. Les romans les plus déchirants ne vous causent pas autant de tristesse profonde.
— Ah ! vraiment, je sens quelque chose se déchirer en moi et je fonds en larmes.
Si on lisait ces lignes, on croirait que je blague ou que je suis devenue folle, tellement j'ai une apparence philosophe et frondeuse.
J'ai passé la matinée au Louvre et je suis éblouie ; jusqu'à présent, je n'avais pas compris, comme ce matin. Je regardais et je ne voyais pas. C'est comme une révélation. Avant, je voyais, j'admirais poliment, comme la très énorme majorité de l'univers. Ah ! quand on voit ; et sent les arts comme moi, on n'est pas une âme ordinaire. Sentir que c'est beau et comprendre pourquoi c'est beau, voilà un grand bonheur.
Lundi 11 octobre 80.
Je me mets à la peinture avec la tête montée d'hier ; il est impossible de ne pas arriver à avoir du talent, quand on a des révélations comme celle d'hier.
Mardi 12 octobre 80.
Hier, j'ai reçu la dépêche suivante de Poltava : — « Toute la noblesse vous présente en nos personnes ses félicitations à l'occasion élection unanime de votre père — Buvons votre santé — Abaza. — Manderstern. »
Abaza est celui que j'ai connu, en Russie, le plus gros bonnet de Poltava, après l'avoir été à Pétersbourg et à Odessa.
Manderstern est le maréchal de la noblesse du gouvernement, comme mon père l'est du district de Poltava.
Voici ma réponse télégraphique. Il faut me montrer polie, car les affaires de famille ne regardent personne et puis, c'est une sorte de... comment dire, c'est presque officiel, c'est pompeux :
« Flattée de la gracieuse attention, je remercie cordialement les dignes interprètes de la noblesse de Poltava, à laquelle je souhaite mille prospérités.
« Marie Bashkirtseff. »
C'est digne, c'est noble, c'est une dépêche de grand homme, et puis ce n'est pas un style télégraphique avec tous les adverbes, etc., supprimés. Bref, ma fille, tu me fais pitié.
Je relis très attentivement Paul et Virginie, et j'excuse volontiers les naïvetés un peu guindées du style dans les descriptions des vertus de ces braves gens. Mais je viens de me payer une séance de bonnes larmes !
Vous savez, quand Paul revient de chez le voisin et demande de loin à la négresse Marie : — Où est Virginie ? Marie tourne la tête vers lui et se met à pleurer. Et moi aussi. Non, c'est atroce aussi pour cet enfant de revenir et de ne plus la trouver. Alors, il court sur le rocher et aperçoit le vaisseau qui n'est plus qu'un point noir... là, on est pris de rage pour lui.
Et je pleure et je pleure ! Et quand Paul dit au chien qui courait devant lui : — Va, tu ne la trouveras plus jamais ! C'est plus fort que moi. Et la lettre de Virginie où elle envoie des graines de violettes à Paul. — Non, mais le moment atroce, c'est lorsqu'elle est partie et qu'il regarde le point noir sur l'horizon, du haut du. rocher. Bernardin de Saint-Pierre n'a pas compris lui-même ce qu'il a fait ; c'est un passage sublime dans sa simplicité, et incomparable comme émotion.
Vendredi 15 octobre 80.
J'ai repris le portrait que j'ai fait, avant cet été, d'une élève de chez Julian, pas les cheveux jaunes, non, une autre: une créature ravissante. Des cheveux bruns avec des reflets rouges. Une fraîcheur et une vie ! Un teint ravissant (mais disposé à se couperoser), des yeux bruns adorables, une bouche divine. Mais quelque chose d'un peu ordinaire dans la figure vue de face ; je la fais de profil. Et un cou, des bras splendides de couleur et de forme.
Elle a vingt-cinq ans et est veuve avec un petit garçon de cinq ans et demi. Si cette femme-là était modèle, je la prendrais à l'année.
Et elle a des mains admirables avec cela, et une peau admirable aussi. Non, il est impossible de rendre l'éclat extraordinaire de sa figure. J'ai déjà mon idée pour le Salon avec elle ; je lui donne son portrait et elle l'a bien gagné, car elle pose comme un ange. Je l'ai habillée en Greuze, corselet de damas crème et fichu de mousseline de l'Inde.
Je n'oserai jamais lui demander de poser pour le Salon, ce serait l'affaire d'un mois. Si je pouvais découvrir le moyen de la payer, mais c'est impossible... Je lui ai déjà demandé de poser en riant, mais pour de bon... Ah ! quel modèle !... on pourrait en faire quelque chose de splendide.
De même que j'ai mis le blanc à la mode, il y a trois ans, on copie maintenant mes draperies croisées et ma ceinture en pointe. C'est très agaçant.
Samedi 16 octobre 80.
Avec toutes sortes de bonnes choses, Tony a dit : « Somme toute, je suis très content, cela va bien. » — Suit la leçon. Je suis très contente, chaque samedi, j'ai des peurs ! Et puis des joies!...
C'est que c'est la seule chose que je regarde sérieusement.
Mon éclatant modèle qui se nomme Mme G. veut bien poser pour un tableau, pourvu que cela ne soit pas trop nu. Je ne sais pas quelle est sa situation, mais je suppose qu'elle ne travaille pas pour vivre, puisqu'elle vient à l'atelier et pose tant que je veux pour ce portrait. C'est égal, elle est vraiment bien gentille.
Elle m'avait promis ses mains et son bras en échange de la tête de son fils, mais tout un tableau ! Savez-vous, c'est une affaire de six semaines peut-être. Elle est fraîche, jeune, éclatante, avec je ne sais quoi de touchant et de maternel dans la physionomie. Je lui ferai un beau cadeau.
Mardi 19 octobre 80.
Hélas ! tout cela va se réduire à mourir dans quelques années, misérablement, en traînant.
Je soupçonnais bien un peu que cela finirait ainsi. On ne peut pas vivre avec une tête comme la mienne, je suis comme les enfants qui ont trop d'esprit.
Il me fallait trop de choses pour être heureuse, et les circonstances se sont groupées de telle façon que je suis privée de tout, sauf du bien-être physique.
Lorsqu'il y a deux ou trois ans, et même il y a six mois, j'allais chez un nouveau médecin pour retrouver ma voix, il me demandait si je n'éprouvais pas tel ou tel symptôme, et comme je répondais « non », il disait à peu près ceci : — Il n'y a rien aux bronches, ni aux poumons ; c'est seulement le larynx. — A présent, je commence à ressentir toutes ces choses que commençait par supposer le médecin. Donc, les bronches et les poumons sont atteints. Oh ! ce n'est encore rien, ou presque rien. Fauvel a ordonné de l’iode et un vésicatoire ; naturellement j'ai poussé des cris d'horreur, j'aime mieux me casser un bras que de subir un sinapisme. Il y a trois ans, en Allemagne, un médecin des eaux m'a trouvé je ne sais quoi au poumon droit, sous l'omoplate. J'en ai bien ri ; encore à Nice, il y a cinq ans, je sentais parfois comme une douleur à cet endroit ; seulement j’étais convaincue qu'il allait me pousser une bosse, ayant deux tantes bossues, les sœurs de mon père, et voilà, qu'il y a quelques mois encore, on me demandait si je ne sentais rien là, et je répondais « non », sans y songer. A présent, quand je tousse ou seulement respire profondément, je le sens là, à droite, dans le dos. Toutes ces choses ensemble me font croire qu'il y a peut-être quelque chose vraiment... Je mets une sorte d'amour-propre à démontrer que je suis malade, mais cela ne me plaît guère. C'est une vilaine mort, très lente, quatre, cinq, dix ans peut-être. Et l'on devient si maigre, si laid.
Je n'ai pas beaucoup maigri, je suis tout à fait comme on doit être ; seulement j'ai l'air fatigué et je tousse beaucoup, et la respiration est difficile. Voilà pourtant ! Depuis quatre ans, soignée par les plus grandes célébrités, promenée aux eaux, et non seulement je n'ai pas retrouvé ma belle voix, si belle que je pleure en y pensant, mais encore je suis de plus en plus malade et, disons le mot, horrible, un peu sourde,
Allez, pourvu que la mort vienne vite, je ne me plaindrai pas.
Vous est-il arrivé parfois de prendre la. parole ou la plume pour dire que vous ne croyez plus à quelque chose à quoi vous avez cru, et pendant même que vous dites : — Et dire que j'étais persuadé de cela ! — d'être repris par l'ancienne idée et d'y croire de nouveau ou tout au moins de fortement douter de la nouvelle ? C'est dans ces dispositions-là que je fais l'esquisse d'un tableau... En attendant l'artiste, le modèle, une petit femme blonde, est assis à califourchon sur une chais et fume une cigarette en regardant le squelette entre les dents duquel il a fourré une pipe. Les habits son éparpillés par terre, à gauche; à droite, les bottines, un porte-cigare ouvert par terre et un petit bouquet de violettes. Une des jambes est passée par-dessus la traverse du dossier de la chaise, la femme est accoudée et a une main sous le menton. Un bas par terre et l'autre pend encore au pied. Cela s'arrange très bien comme couleur. A propos, je deviens coloriste. Ah ! je dis cela pour rire; mais, blague à part, je sens la couleur et il n'y a pas de comparaison entre mes peintures d'il y a deux mois, avant le Mont-Dore, et d'à présent.
Vous verrez qu'il se trouvera trente-six choses pour m’attacher à la vie, quand je ne serai plus bonne à rien, quand je serai malade, dégoûtante.
Jeudi 21 octobre 80.
J'ai montré à Julian le tableau que j'ai fait au Mont-Dore. Il m'a naturellement brutalisée, tout en disant que certains artistes modernes trouveraient cela très bien, que c'est un mélange de Bastien-Lepage et de Bouvin ; que « ça » de travail en plus et cela ferait un tableau presque bon ; qu'il y a des choses amusantes ; que, malgré tout, c'est « tableau amusant, mais que je peins « comme un bourreau ». Sur l'esquisse de la jeune femme nourrissant son enfant, il a dit seulement qu'une mère n'allaite pas avec le torse tout nu. J'avais composé ça dans une note calme, la femme est assise sur un fauteuil bas en peluche jaune, les jambes allongées, les pieds nus, un pied sur un tabouret ; la tête est en profil, le buste de trois quarts. L'enfant tète en tripotant le sein avec sa peite main. Le fond se fait par le rideau du lit, et plus loin, dans l'ombre, on voit un palmier dans un vase bleu de Chine. C'est très calme, mais il faudrait couvrir une épaule au moins..
Quant à l'esquisse du modèle en face du squelette, ça, ça l'a touché au cœur. Il a dit que c'est « absolument ça », que c'est canaille, que « c'est dégoûtant » j'ajoutais : — Oui, dégoûtant, et c'est justement pour cela que c'est ça, c'est nature. — Seulement, vous ne pouvez pas signer cela. Cela ferait scandale. Mais, sapristi, comme c'est ça ! Je ne dis pas que vous deviendrez à l'instant un peintre célèbre, mais certainement vous serez célèbre par cette... drôlerie d'invention... c’est un tableau qui fera crier, surtout si on sait que c'est une femme, une jeune fille ; mais moi aussi, quand je fais un tableau, on se voile la face.
Vendredi 22 octobre 80.
Il pleut, il fait froid, un froid aigu, atroce ; il fait noir. Aussi, je suis comme le temps et je tousse sans cesse. Ah ! quelle misère et quelle atroce existence ! A trois heures et demie, il ne fait plus assez clair pour peindre et, si je lis le soir, j'ai les yeux fatigués le lendemain pour peindre. Le peu de gens que je pourrais voir, je les fuis de peur de ne pas entendre ce qu'ils disent. Il y a des jours où j'entends très bien et d'autres non, et alors c'est un supplice sans nom... Aussi Dieu va me faire finir. Du reste je suis préparée à toutes sortes de misères, à condition de ne voir personne. Chaque coup de sonnette me fait frémir... Ce nouveau et horrible malheur me fait craindre tout ce que je désirais. Jugez ! Je suis toujours très gaie et très drôle pour les autres, je ris autant que Mlle Samary du Théâtre-Français, mais c'est plus une habitude qu'un masque, je rirai toujours. C'est fini ; non seulement je crois que c'est fini, mais je désire que cela soit fini. Il n'y a pas de mot pou peindre mon abattement.
Dimanche 24 octobre 80.
Je suis allée au Louvre J'y vais toujours seule, sachant bien n'y rencontrer personne de connu, le dimanche avant midi On ne voit bien que seul. Je suis enchantée des tableaux du siècle passé ; c'est d'une grâce inimitable et exquise. Voilà une charmante époque. Me croyez-vous née pour la vie laborieuse, studieuse ou héroïque ? Je voudrais m'adonner à la plus molle paresse, enfouie dans les gazes de Watteau et de Greuze et dans les brocards de Rigaud. Voilà un siècle exquis, tous les vestiges anciens, avec les cabinets de toilette à l'anglaise déjà. Tandis qu'avant on ne se lavait guère ou si peu ; aussi cela me gâte-t-il toutes les belles aventures des vieux temps.
Lundi 25 octobre.
Je lis Les Châtiments. C'est vrai, Hugo est un génie. Et je ne sais même pas si je vais dire que certains de ses emportements lyriques m'ont étonnée, pour ne pas dire fatiguée. Non, je ne le pense pas, c'est beau, c'est sublime, et malgré les grands bras et les sueurs et les effrois, etc., c’est humain, c'est naturel, c'est beau. Mais je l'aime surtout dans la simplicité touchante : le dernier acte d’Hernani, lorsque Dona Sol supplie le vieillard... et le langage de l'aïeule dont l'enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Vendredi 29 octobre 80.
Un passage lu dans l'Évangile se trouvant extraordinairement d'accord avec la pensée qui me guidait, j'ai un retour vers la ferveur et vers les miracles, Jésus-Christ et mes prières exaltées des anciens jours. Depuis quelque temps je me contentais d'un Dieu, et ma croyance était très pure, très sévère, très simple ; mais voilà que je reviens à une religion plus familière plus... consolante, plus en apport avec les craintes, les misères et les bassesses de ma nature.
L'Homme Dieu et la Vierge Marie semblent vous entendre plus que le vrai Dieu…
Lundi 1er novembre 80.
Notre atelier devient comme celui des hommes, c'est-à-dire que nous avons l'académie toute la journée, le même modèle, dans la même pose ; par conséquent, on pourra peindre de grands morceaux. Il y a déjà deux ou trois mois que j'ai besoin de cela ; avant, cela n'aurait servi à rien mais je suis à point pour ce travail. Nous ne sommes que huit, les autres élèves, au nombre de vingt-deux ont passé dans le nouvel atelier que Julian a arrangé 51, rue Vivienne, et où l'organisation est comme dans notre ancien.
Mardi 2 novembre 80.
Depuis une huitaine de jours je me fais apporter mon déjeuner de la maison à l'atelier. On a organisé cela dans un machin en paille ou en jonc comme les troupiers. C'est bien plus raisonnable que de courir de la rue Vivienne aux Champs-Elysées et de perdre les heures où le jour est le plus beau. De cette façon, je travaille de huit à midi et de une à quatre heures.
Mercredi 10 novembre 80.
C'est horrible d'avoir travaillé sans cesse pendant trois ans pour arriver à découvrir qu'on ne sait rien !
Jeudi 11 novembre 80.
Tony est venu et, comme je lui expliquais mon découragement, il me dit que cela prouve que je ne suis pas aveugle, et il m'engage à reprendre mon étude, à continuer d'étudier.
Enfin, cela prouve toujours que j'en sais plus qu'avant, puisque j'y vois clair. Mais quelle tristesse ! Comme j'aurais besoin d'encouragement ! Je me suis refait un manteau brun à capuchon de moine pour l'atelier, quand il m'arrive de prendre une place près de la fenêtre, de laquelle il vient un vent d'enfer. Donc j'ai un capuchon de moine, ce qui m'a toujours porté malheur. J'ai pleuré sous ce capuchon de malheur et tant, que cette bonne Zilhardt, qui était venue voir si ce n'était pas pour rire, en fut tout ébahie. Je veux faire un tableau représentant une expulsion de moines. Je suis donc allée chez les capucins de la rue de la Santé, et les trois Pères qui restent m'ont raconté et montré les lieux du sinistre. Je venais offrir hospitalité à deux pères à Nice. J'espère qu'ils ne profiteront pas de l'offre.
Dimanche 14 novembre 80.
Je devais aller à Versailles pour voir si le couvent des capucins de là me convient, car c'est là qu'on a le plus résisté.
Dans la cour du couvent, des prie-Dieu sont disposés où, malgré la pluie, les fidèles viennent s'agenouiller devant la porte scellée de la chapelle. Des femmes exaltées qui s'écrient qu'il n'y a plus ni propriété, ni loi... Dieu ! que tout cela a été maladroit et que ces moines en ont tiré parti !
Est-ce que Gambetta ne serait pas l’homme fort ?... Enfin, il faut qu'un homme surgisse... Le système bonapartiste, alors ? Et le principe, et la République ? Oh ! soyez tranquille, je ne change pas ; c’est même, avec l'égalité de la femme et de l'homme, la seule chose au monde à laquelle je sois sincèrement attachée. Il y a des choses qui s'imposent à mon bon sens, elles sont rares, mais enfin, lorsque je suis convaincue moi-même dans mon fond, rien au monde ne me fait transiger et il m'est même très difficile de ne pas crier mes convictions sur les toits, tellement je suis contente et fière d 'avoir trouvé cela toute seule et d'y croire sincèrement. Car pour tant de choses, pour presque tout, hélas ! je n'y tiens que... très à la surface... pour ce que l'on dira, ou pour ne pas être tout à fait en dehors de tout, ou pour ce que cela peut me rapporter.
Donc, il faut un homme ou plutôt des hommes, ceux qui nous dirigent ici sont ridicules et bêtes ; c'est humiliant pour la République. N'allez pas me croire impressionnée par les prie-Dieu sous la pluie... Quand même ce serait sincère, je ne serais pas trop touchée. L'Église a amoindri Dieu, dénaturé la religion ou plutôt a créé, au lieu du culte qu'on doit à Dieu, une religion compliquée et pleine de charlatanisme qu'il faut détruire. Le Père capucin nous a fort mal reçues à travers son guichet, en nous disant que nous n'avions, pour tous renseignements, qu'à nous adresser aux fidèles. J'ai fait un léger croquis de la cour, mais cela ne me convient pas plus que la rue de la Santé et j'arrangerai un peu. Mais... mon Dieu, c'est tout.
Mardi 16 novembre 80.
Je crains d'avoir exagéré l'autre jour par rapport à l'Église. J'ai eu de saints remords et il n’a tenu qu'à un fil que je me levasse de mon lit pour venir faire amende honorable ici ; car l'Église sert à faire connaître Dieu, l'Église a fait énormément pour les mœurs, l'Église a porté chez les sauvages le nom de Dieu et la civilisation. Sans offenser Dieu, je crois qu'on aurait pu civiliser sans catholicisme, mais enfin... l’Église a été utile comme la féodalité et, comme elle, elle a fait ou presque fait son temps. Il y a trop de choses inadmissibles et révoltantes, sans être odieuses pourtant, dans le catholicisme. On a mêlé le divin à des légendes plates ; il y a trop de gens éclairés maintenant pour que les saints mensonges soient respectés. Mais c'est une époque de transition que nous traversons, et malheureusement les masses ne sont pas encore assez instruites pour ne pas passer des vaines superstitions au mépris et à la négation de Dieu.
Il y a des hommes sincèrement religieux, mais y en a-t-il de sincèrement monarchistes ?... à moins...que... car il y a des gens qui croient que la monarchie est nécessaire à la prospérité de certain pays. Tiens, je n'y pensais pas, l'autre jour, en disant qu'il fallait une âme de valet pour aimer la monarchie.
Supposons un pays où la monarchie, constitutionnelle bien entendue, fasse le bonheur du peuple, eh bien, l’homme le plus fier et le plus noble peut y adhérer sincèrement, et même avoir un certain attachement sincère pour la famille qui représente depuis des siècles son pays. Mais de là à cet attachement servile à une race, il y a loin !
Je ne dis pas que je trouve bien d'être monarchiste comme je viens de dire plus haut, mais enfin on peut admettre qu'on y soit attaché sincèrement et qu'on y croie au fond du cœur, dans les conditions susdites.
Ce n'est toujours pas en France que c'est possible, ni qu'il y ait une monarchie qu'on puisse, la main sur la conscience, préférer à la République. — Et y a-t-il seulement un candidat qui ne soit avili ou déshonoré ? — M. de Chambord ? Les d'Orléans qui le suivent inévitablement ? — Mais, après tout, les d'Orléans, patiemment supportés pendant des siècles, pourraient devenir cette famille qui représente le pays dont je parlais tout à l'heure, et les platitudes auxquelles oblige une cour, ce serait le sacrifice de sa fierté personnelle qu'on ferait au pays... Sans doute ; mais à quoi bon tout cela,quand il y a la République qui a tout ce que la monarchie bourgeoise a de bon et qui n'a rien de ce qu'elle a de mauvais, qui est le plus beau et le plus noble des gouvernements ?
Il y a en somme quelque chose de révoltant dans les honneurs souverains rendus à un monarque mannequin par un ministre ou par un homme d'État de génie, qui, quoi qu'il fasse, sera toujours le domestique du monarque, nul, sot et peut-être imbécile.
Vendredi 19 novembre 80.
J'ai fait venir ma négresse à l'atelier, où elle a chanté pendant une heure, au lieu de me donner la leçon chez moi.
On allume le gaz et quinze femmes, présidées par Julian, se rangent au fond de l'atelier, pendant que Mme Ponce et sa guitare montent sur la table à modèle, au milieu d'une salve d'applaudissements. — Si vous croyez que je suis gaie ! Ah ! flûte alors !... Julian a éreinté ma peinture au dernier point. — C'est mal dessiné, froid de mouvement, pas vrai de ton et mal compris d'effet... Si avec ça je ne suis pas contente ! Mais je me console un peu en pensant que je savais que ce n'est pas bon, et alors ça fait moins de peine. Ah ! si je le trouvais bon, et s'il m'avait dit ça...; mais bast ! je vois ce que c'est que la peinture, ce que c'est que du nu, grandeur nature.
Ah ! j'ai compté sur la peinture pour m'en sortir ! Attends un peu, ma vieille !
J'ai tout le temps peur de fondre en larmes.
Samedi 27 novembre 80.
Fini le concours. Je voulais pouvoir me prononcer d'avance ici, mais je ne puis vraiment. Je n'aime pas ce que j'ai fait, j'ai du sable aux yeux et il a fait noir les jours où j'ai peint mes plus grands morceaux ; je n'ai été en train qu'aujourd'hui, aussi ai-je repeint toute la tête qui s'en trouve mieux ; c'est égal, je n'aime pas ça ;... mais je dois avouer que c'est ce qu'il y a de mieux.
Je ne suis pas sûre du tout d'avoir dessiné aussi bien que je peux ; et puis, bien que je me juge toujours à peu près justement, on a des surprises quelquefois ; quand j’ai eu la médaille, je pensais avoir fait une horreur... mais il ne faut pas se fier à cela... En somme, je voudrais bien l'avoir, ça me remonterait le moral. Et puis, cela prouverait que j'ai peint une tête trouvée bonne par Tony, Bouguereau, Lefebvre et Boulanger. Vous savez, on ne donne la médaille que quand on la mérite ; s'il n'y a rien qui la mérite, on classe les dessins, et puis voilà tout.
Mercredi 1er décembre 80.
En sortant de l'atelier je vais prendre Mme de D. et nous allons, 12, rue Cail, chez Mlle Hubertine Auclerc. C'est un mercredi. Nous avions sonné vainement trois fois et, étant redescendues, parlementions avec le concierge, lorsqu'une jeune femme vint à la loge ; nous nous étions arrêtées indécises, je l'ai reconnue à l'instant.
Le concierge nous rappelle et Mlle Auclerc nous invite à monter. Droits des femmes, siège social. Ces mots, écrits sur la porte m'avaient déjà donné, avant l'arrivée de la demoiselle, un accès d'enthousiasme d'autrefois, et je fis semblant de sauter au cou de Mme de D.
Très pauvre et simple et nu, le bureau. Elle allume du feu, s'assied devant la cheminée, Mme de D. à sa droite et moi à sa gauche ; c'est ma compagne qui commence. Alors j'ai dit que je ne puis me défendre d’une grande émotion en présence de la femme qui a si courageusement pris en main la défense de nos droits. — Mme de D. est Française, veuve d'un Anglais, Norskott ; moi, d'origine étrangère, mais élevée en France et je m'appelle Pauline Orelle. Mon but secret, c'est de faire le portrait d'Hubertine pour le Salon. J'adopte le pseudonyme de Daria pour la peinture. Très joli, très simple, c'est un nom de baptême russe. En somme, elle sera bien pour la peinture, — brune, le teint un peu couperosé peut-être, mais il fait froid et puis il y a des jours. De petites mains, un peu rouges, de petits pieds. Une mise et un langage très convenables. Elle est sympathique et gentille, l'accent pas trop distingué. Elle nous donne un programme, une petite brochure, nous nous serrons les mains. Nous adhérons, nous reviendrons, nous déposerons notre cotisation de 25 francs par mois, nous viendrons aux conférences.
— Par Dieu ! A mercredi prochain, à huit heures.
J'ai été aimable et j'ai dit que le principal argument des réactionnaires : la laideur, la vieillesse et le grotesque des conférencières, ne peut être de mise, car : « Vous ètes jeune et jolie. »
Je suis contente, non pas encore, car cela peut mal tourner. Tout ne tourne-t-il pas mal ? Nous verrons.
Dimanche 5 décembre 80.
Le docteur Potain est venu ce matin et veut que j'aille dans le Midi jusqu'au mois de mars, sans cela je ne pourrai respirer bientôt, ni bouger de mon lit. Voilà qui va bien. Depuis quatre ans, je fais tout ce que m'ordonnent les célébrités ; je vais de mal en pis. Je suis allée même jusqu'à porter la main sur ma beauté. Je me suis badigeonnée d'iode la clavicule droite. Et ça ne va pas mieux. Est-ce que mes ennuis ordinaires auraient de l'influence sur ma santé, par hasard ? Pourtant le larynx, les bronches ne sont généralement pas sujets aux affections morales. Je n'en sais rien. Je fais ce qu'on me dit de faire, me garde d'imprudence, ne me lave plus qu'à l'eau chaude et suis tout de même malade.
Villevieille m'a dit hier que Tony, étant venu corriger samedi, a demandé à voir nos peintures de concours et qu'il a trouvé que mes yeux était singulièrement dessinés, mais qu'il y avait du bon et des choses très jolies et des tons charmants. Il n'est pas content du concours en général. Si je n'ai pas la médaille, j’aurai tout de même fait une assez bonne étude.
Mercredi 8 décembre 80.
Ce soir, les citoyennes Alexandrine Norskott et Pauline Orelle ont assisté aux travaux hebdomadaires de la société « Le droit des femmes ». Cela se passe dans le petit salon d'Hubertine.
Une lampe sur le bureau, à gauche ; à droite, la cheminée surmontée d'un buste de la République, et au milieu, tournant le dos à la fenêtre, qui fait elle-même face à la porte, une table chargée de dossiers, ornée d’une bougie, d'une sonnette et d'un président qui a l’air très sale et très bête. A la gauche du président, Hubertine, qui, chaque fois qu'elle parle, baisse les yeux et se frotte tout le temps les mains. A droite, une vieille sèche socialiste et furieuse qui s'écrie « Que s'il y en à frapper, elle frappera la première ». Une vingtaine de vieilles typesses, des espèces de concierges en rupture de loges et quelques hommes, le rebut de ce que on s'imagine ; de ces garçons à longs cheveux et à coiffures impossibles et qu'on ne veut pas écouter dans les cafés. — J'ai une perruque très noire et des sourcils très noirs. Les hommes ont clabaudé sur le socialisme, le collectivisme et les trahisons des députés les plus avancés. La rouge du coin a déclaré la guerre à la religion ; là-dessus, Mme de D. (Norskott) a protesté et a prononcé plusieurs morceaux de discours qui ont détonné en bien. Du reste, Hubertine est très sage et comprend qu'il ne s'agit pas de prolétaires ni de millionnaires, mais de la femme en général, qui revendique ses droits. C'est sur ce terrain qu'il faudrait maintenir tout le monde. Au lieu de cela; on discute les nuances politiques.
Nous sommes inscrites, nous avons voté, payé, etc. Voilà.
Lundi 13 décembre 80.
Je méprise les médisances... parce que je n'y puis rien et que, par ce semblant de mépris, je me mets l'esprit en repos... et aussi parce que trop de gens médisent ; j'ai fini par m'y habituer. Vous savez ma vie, jugez-moi. Je ne le dis pas pour que vous exaltiez mes vertus, car mes imprudence et mes folies suffisent pour me noircir pas mal. Enfin c'est fait, passons. J'en accepte tout de même la responsabilité, mais accordez-moi les circonstances atténuantes.
Mardi 21 décembre 80.
Je n'ai plus de bourdonnements dans les oreilles et j'entends très bien.
Mercredi 22 décembre 80.
C'est un dessin de la rue Vivienne qui a la médaille, une Américaine nouvelle, — et je suis première.
Jeudi 23 décembre 80.
Comme il se faisait tard, j’ai quitté le portrait et me suis mise à faire une esquisse cherchant toujours pour le Salon. Julian arrive et trouve cela très joli, alors je vais avec lui dans l'antichambre et demande si cela pourrait faire l'affaire. Mais oui très bien, seulement c'est un sujet calme et de jeune fille, et il croyait que je trouverais quelque chose plus. Et puis, il me reproche, pour la dixième fois au moins, de ne pas avoir fait le portrait de Mme N... sur une toile plus grande et avec plus de robe, enfin pour l'exposition. Il faut vous dire que cette scie revient chaque fois que je parle du Salon. Mais pour que vous compreniez l'effet que cela me fait, il faut vous dire que ce portrait ne me plaît et ne m'amuse pas, que je le fais par complaisance, que le modèle n'a rien d'empoignant, que je le fais parce que, dans un moment d'expansion, j'ai promis ;— cette expansion idiote qui fait que je donnerais tout et me creuse la cervelle pour savoir ce que je pourrais bien offrir et comment je ferais mieux plaisir à n'importe qui, à tout le monde. — Et si vous croyez que cela m'arrive rarement ! C'est presque toujours comme ça, sauf quand je suis trop ennuyée... et encore...
Ce n'est même pas une qualité, c'est dans ma nature de vouloir faire le bonheur de tout le monde et de m'emballer avec des attendrissements bêtes ! Vous ne saviez pas cela et je passe pour égoïste ; arrangez le tout ensemble. Donc, ce portrait que j'ai hâte d'avoir fini, on me le met sous le nez à toute minute pour cette exposition qui me préoccupe depuis un an, à laquelle je rêve et sur laquelle je fonde de si belles espérances. Alors, il semble que c'est pour que je n'expose rien ; je dis il semble, parce qu'il serait trop cruel pour moi si vous pensiez que c'est vrai. — Et puis, toujours cette scie du portrait que je ferais bien, dit-il, de faire à l’atelier, je le ferai mieux ainsi.
Enfin, voilà mon exposition. Ceci dit, vous ne serez pas étonné que je sois revenue à la maison les mâchoires contractées et craignant de faire un mouvement, de peur de fondre en larmes et de pleurer comme à présent. Aussi fallait-il être folle de croire à quelque chose de possible pour moi !
0 néant !
Maintenant, c'est envenimé, et la question du Salon me ferait pousser des cris. Voilà donc où je suis après trois ans de travail ! « Il faut arriver phénomène,» disait Julian, mais je n'ai pas pu. Voilà trois ans, et qu'ai-j fait ? Que suis-je ? Rien. C'est-à-dire que me voila bonne élève et voilà tout ; mais le phénomène, le cou de foudre, l'éclat ?...
Cela me frappe comme un grand désastre inattendu... et la vérité est si cruelle que j'essaie déjà de croire que j'exagère. C'est la peinture qui m'arrêtait tant qu'il s'agissait de dessin « j'épatais » les professeurs ; mais voilà deux ans que je peins : je suis au dessus de la moyenne, je sais, je montre même des dispositions extraordinaires, comme dit Tony, mais il me fallait autre chose. Enfin, ça n'y est pas. Mais j'en suis assommée comme d'un grand coup sur la tête, et je ne peux y toucher du bout de la pensée sans que cela me fasse horriblement mal. Et les larmes donc !
Voilà qui arrange bien les yeux ! — Je suis perdue, je suis finie, morte, et quelle rage affreuse ! Je suis navrée de moi. Ah ! mon Dieu !…
Je deviens folle en pensant que je pourrai mourir dans l'oubli ! Je suis trop au désespoir pour que ça n'arrive pas.
Vendredi 24 décembre 80.
Ayant fait de mauvais rêves, je vais à l'atelier où Julian me fait l'offre suivante : « Promettez-moi que le tableau sera à moi et je vous indiquerai un sujet qui vous donnera la célébrité ou au moins la notoriété de six jours, après l'ouverture du Salon. » Naturellement je promets. Il tient le même langage à A., et après nous avoir fait écrire et signer l'engagement, avec Magnan et Madeleine pour témoins, moitié riant, moitié sérieux, il nous emmène dans son cabinet et nous offre, à moi de faire un coin de notre atelier avec trois personnes sur le premier plan grandeur nature et d’autres comme accessoires, à A... tout l'atelier de la rue Vivienne, 53, en petit.
Il s'en va nous démontrant les avantages du sujet pendant une bonne demi-heure ; après quoi, je retourne à mon portrait, agitée et ayant mal à la tête, et ne peux rien faire de la journée. Les suites d'hier.
Quant au sujet, il ne me dit pas beaucoup ; mais ça peut être très amusant, et puis Julian est si empoigné, si convaincu : il m'a cité tant d'exemples qui ont réussi — jamais un atelier de femmes n'a été fait. Du reste, comme ce serait une réclame pour lui, il ferait tout au monde pour me donner cette fameuse notoriété dont il parle. Ce n'est pas facile, un grand machin comme ça.. Enfin nous verrons.
*
* *
A trois heures et demie nous descendons avec Villevieille dans l'intention de voir les baraques des boulevards ; mais, ayant eu l'idée de jeter un coup d'œil au nouvel atelier du patron, nous y entrons. Villevieille, qui joue en artiste, se met au piano et moi je fais des vers de mirliton pour le patron. Il rentre, en ce moment et nous passons chez lui deux heures, en compagnie de ma tante qui venait me chercher. L’atelier est très gentil, tout à côté de celui des hommes, à l'entresol ; un tuyau acoustique communique avec le troisième étage des dames.
Ca été pas mal drôle, on a beaucoup parlé du tableau. Julian le désire pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il n'a pas le temps de le faire lui-même, ensuite pour m'être agréable et puis pour faire enrager Breslau et prouver à celles qui ne veulent pas croire en moi ma force. Tout ça est bien. Mais voilà que je soupçonne qu'il m'offre ce machin pour que je m’embourbe et ne fasse rien : il est stipulé que le tableau lui appartiendra, à quelque degré d'exécution que je laisse. Je lui fais part gracieusement de mes soupçon : il me répond que je ne crois pas un mot de ce que dis. Enfin, vous comprenez, l'atelier est petit, nous ne sommes que douze, mais c’est assez pour me gêner vu ma grande toile ; car enfin on ne peut pas demander aux élèves de s'immobiliser et de poser pendant deux mois pour moi. Je ne comprends pas comment je ferai ; je voudrais bien faire autre chose, mais quoi ?
Dimanche 26 décembre 80.
Potain veut que je parte, je refuse net, et alors, moitié pour rire, moitié sérieusement, des plaintes contre ma famille. Je lui demande de rager et de pleurer tous les jours peut faire mal la gorge. Sans doute... Je ne veux pas partir. Voyager c'est charmant, mais pas avec les miens, avec leurs petites tracasseries fatigantes. Je sais que je commanderais, mais ils m'énervent, et puis, non,.non, non !
Je ne tousse presque plus, du reste. Seulement tout cela me rend malheureuse ; je ne m'imagine plus pouvoir en sortir ; sortir de quoi ? Je ne sais pas du tout et les larmes m'étouffent. N'allez pas croire que ce sont des larmes de fille pas mariée ; non, les autres ne ressemblent point à celles-là. En somme... c'est peut-être ça. Je pense pas.
Et puis, des choses si tristes autour de moi, et pas moyen de crier. Ma pauvre tante mène une vie si isolée, nous nous voyons si peu ; je passe les soirées à lire ou à jouer.
Je ne peux plus ni parler, ni écrire de moi sans fondre en larmes. Il faut croire que je suis malade... Ah l les folles plaintes ! Tout ne mène-t-il pas à la mort ?
Et qu'est-ce qu'il y a donc en nous pour que, malgré de beaux raisonnements, malgré la conscience que tout mène à rien, nous criions, tout de même !
Je sais que, comme tous les autres, je vais à la mort, au néant ; je pèse les circonstances de la vie qui, quelles qu'elles soient, me paraissent misérablement vaines, et pourtant je ne puis me résigner ! C'est donc une force, c’est donc quelque chose, ce n'est donc pas « un passage », une durée de temps qu'il importe peu de passer dans un palais ou dans une cave ; il y a donc quelque chose de plus fort, de plus vrai que nos folles phrases sur tout cela ! C'est donc la vie enfin, non pas un passage, une misère ; mais la vie, tout ce que nous avons de plus cher, tout ce que nous avons même du tout ?
On dit que ce n'est rien, parce qu'on n'a pas l'éternité. Ah ! les fous !...
La vie est nous ; elle est à nous, elle est tout ce que tous ayons ; comment est-il donc possible de dire que ce n'est rien ? Pour que cela ne soit rien, montrez-moi à côté quelque chose !
Jeudi 30 décembre 80.
Je suis allée chez Tony et j'en reviens réconfortée un peu. Il m'engage beaucoup à faire ce tableau (l'atelier). Je suis parfaitement capable de le faire grandeur nature, dit-il, ce serait très amusant. Bonne étude et tableau en même temps. Il ne faut pas être reçue par grâce, mais par mérite ; si cela vient mal, il me le dira ; mais il croit que je m'en tirerai assez bien et me décide à le faire. Puis nous avons causé de moi en général ; nous sommes d’accord sur ce point que les qualités de peinture tardent à se révéler, mais il dit que très souvent cela fait cet effet et puis cela vient, et que, du reste, on n'a jamais rien exigé après trois ans d'études ; que je veux aller trop vite, qu'il est convaincu que j'arriverai ; que sais-je ? En somme, je lui ai tant dit de ne pas me ménager, j'ai tellement insisté pour amener le plus de franchise possible, que je crois qu'il a été sincère. Du reste, il n'a pas intérêt à mentir, et puis ça n'est déjà pas énorme ce qu'il m'a dit. Donc, me voici remontée un peu et prête à faire le tableau.
Quel brave et gentil garçon que ce Tony ; il dit que les mieux doués ne sont arrivés à un petit commencement de quelque chose qu'après une dizaine d'année de travail ; que Bonnat, après sept ans d'études, n'était rien ; que lui-même n'a exposé qu'à la huitième année. En somme, je sais cela, mais comme je comptais là dessus pour arriver à vingt ans, vous comprenez mes réflexions.
A minuit, il me vient des soupçons. Tony parait trop confiant en mes forces; je cherche quelque affreux piège.
1881
Samedi 1er janvier 81.
J'ai donné un bouquet de corsage à A... qui m'a embrassée deux fois et, comme nous étions seules, je l'ai questionnée sur la marche de son amour, sur le commencement, et elle m'a raconté ça : — Voilà six ans que cela dure sans aucune espèce de variation. Elle reconnaît son pas dans l'escalier et la manière dont il ouvre la porte, et chaque fois cela la saisit comme les premiers jours. — Je comprends cela ; si c'était autrement, ce ne serait plus ça. On dit qu'on s'habitue, que les sensations s'effacent ; vous voyez bien que c'est une erreur, et l'amour qui change ou qui s'apprivoise n'est pas le véritable.
J'aurais horreur de changer. Bien peu de personnes sont assez heureuses pour éprouver l'amour véritable, qui est éternel, même lorsqu'il n'est pas partagé. En général, on est incapable d'éprouver un sentiment aussi entier, ou bien l'on en est distrait ou empêché et il se contente de lambeaux qui changent, eux ; c'est ce qui fait hausser les épaules à beaucoup de gens quand on parle d'amour éternel ou unique, ce qui est très rare.
L'amour vrai peut ne pas être éternel, mais il est toujours unique.
Dimanche 2 janvier 81.
J'ouvre Flamarande, de G. Sand, et c'est un laquais qui raconte tout le roman, c'est dégoûtant. Les vingt premières lignes me suffisent. Je suis républicaine, et voilà justement la raison pour laquelle je ne puis considérer des valets comme des égaux. Un domestique perd certains droits en consentant à servir... C'est odieux de toujours tripoter avec des domestiques comme cette G. Sand. Malgré mon indignation, je lis Flamarande, qui est ce que l'auteur a fait de mieux. Les domestiques sont à leur, place et le livre est exquis.
Lisant très vite, j'ai fini ce livre, qui est charmant, je vais lire Les Deux Frères, qui terminent le volume.
Lundi 3 janvier 81.
J'ai fini hier Les Deux Frères à minuit et demi. C'est gentil, mais il ne m'en reste rien. 0 Balzac !
Julian ne veut pas qu'on ouvre la cloison avant dimanche ; dans la semaine, cela dérangerait les élèves. Avec ça, je perds une semaine ; il ne me reste en tout que dix semaines, ce qui n'est guère. Et de nouveau je pense que Tony et Julian me font commencer le tableau sachant que je n'en sortirai pas. Mais dans quel but ? Nescio.
Mercredi 5 janvier 81.
Tony arrive en même temps que moi à l'atelier ce matin. Je lui montre une petite esquisse et nous causons du tableau. Le salon où je travaillerai est tout petit et, même la cloison abattue, ce ne sera pas drôle, vu la dimension de la toile. Enfin !...
Et puis cette idée de le faire faire par deux personnes, ce qui crée une sorte de concours, ce qui est très énervant. Avec mes airs braves, je suis très timide et quand A...est là, je suis à moitié paralysée pour tout et ne puis plus ni poser un personnage, ni... ; c'est très gênant, et puis ça m'agace d'être deux au même sujet.
Ah ! ce tableau m'ennuie ! Ah ! je voudrais faire autre chose ! Ah ! ces hauts et ces bas sont impossibles ! D'un mot on me relève ou on me flanque par terre et, pour ne pas être désespérée, il faut que Julian et Tony passent leur vie à m'exalter. Quand ils ne font que donner des conseils sans dire ni bien ni mal, je suis par terre.
Vendredi 7 janvier 81.
Je raconte les canailleries dont je suis victime à toutes ces dames et, comme tout le monde est pour moi, c'est encore une preuve que j’ai raison. Plusieurs me disent qu'elles me croyaient plus forte et que je me suis laissé rouler. J'en consens, mais il est si beau de laisser aux autres la spécialité des duplicités et des intrigues. J'ai dit « laisser », ce n'est pas exact, je la leur laisse parce que je me reconnais définitivement incapable d'intrigues et de potins. C'est si fatigant, si ennuyeux, enfin je ne sais pas comment faire. Et puis, c'est aussi une satisfaction de se savoir mieux que les autres. Être roulée et qu'on le sache, mais c'est un sentiment délicieux, c'est presque un brevet d'honnêteté, de candeur... Et la conscience ? Avoir la conscience nette et voir la bassesse des autres, se voir propre et les autres sales, même au préjudice de ses intérêts ; mais le préjudice disparaît presque dans ces conditions-là; et plus on est victime, plus c'est une jouissance !
Evidemment, au premier tiraillement, je devrais dire : Si c'est ainsi, je ne le fais pas, votre tableau !.. Mais ce serait combler de joie A..., qui verrait ses efforts couronnés de succès. Si je ne me retire pas c'est uniquement pour cette raison.
Je dis tout cela tout haut et ajoute que je vais laisser aller les choses, convaincue qu'A... n'acceptera pas de me gêner si horriblement. Je fais semblant de croire que c'est impossible et fais bon visage.
Samedi 8 janvier 81.
C'est une vraie passion que j'ai pour les livres, je les range, les compte, les regarde et rien que cette masse de bouquins me réjouit le cœur, je m'éloigne pour les regarder comme un tableau. J'ai sept cents volumes à peu près, mais comme ils sont presque tous de grand format, cela ferait beaucoup plus en grandeur ordinaire.
Dimanche 9 janvier 81.
Potain refuse de me soigner, vu que je ne suis pas ses ordonnances. Ah ! je voudrais bien partir, m'en aller en Italie, à Palerme. Ah ! le ciel pur ! Ah ! la mer bleue ! Ah ! les belles nuits calmes ! L'idée seule de l'Italie me rend folle. C'est comme quelque chose de très beau pour lequel on n'est pas préparé. Non, ce n'est pas cela... je ne sais pas m 'expliquer... Cela me semble comme un grand bonheur définitif vers lequel on ne voudrait aller que délivré de toute préoccupation, de tout ennui. Quand je me dis : Allons ! je pense aussitôt : Non, pas encore ; il faut encore lutter, travailler et puis après, je ne sais quand, le repos définitif, l'Italie... Je me demande ce qu 'il y a là, mais sur moi l'effet est prestigieux, magique, inconcevable.
Oh ! oui, partir ! Pour que Charcot, Potain et tous les autres me disent de partir, il faut que je sois bien malade ! Je sens que l'air chaud de là-bas me guérirait tout de suite, mais c'est leur faute.
Pourquoi maman ne revient-elle pas aussi ? Ils disent que c'est un caprice de ma part, soit, mais c'est comme ça. Enfin !... Tout est fini. Encore un an peut-être. 1882 est la grande date dans mes rêves d'enfant; c'est 1882 que je plaçais comme un point culminant, sans avoir quoi. Ce sera peut-être la mort. Ce soir, à l'atelier, le squelette était déguisé en Louise Michel, avec une écharpe rouge, une cigarette, un couteau à palette pour poignard. Un squelette est dans moi aussi, nous finissons tous par là ! Horrible néant !
Ce matin, j'avais déjà fait une esquisse : le marché aux fleurs de la Madeleine. Une jolie Parisienne avec un petit garçon achetant à une vieille marchande émergeant de sa boutique pleine de fleurs. Il n'y a qu'à faire comme on voit, c'est très nature, très parisien, très amusant à faire et à voir, et parfaitement faisable dans mon atelier. Et puis toutes ces fleurs, c’est ravissant. Et c'est plus facile que l'officiel, et plus vite fait, et fait tranquillement chez moi. Enfin... il faudra savoir ce que dira Tony, car Julian tient à sa boutique, lui.
Mercredi 12 janvier 81.
Tout est arrangé, je commence à faire mes plans, esquisse, etc. Et comme je pense qu'A... lâchera son tableau, je ferai cela demi-nature et avec beaucoup de monde dedans.
Jeudi 13 janvier 81 (1er janvier, le jour de l’an russe).
Je tousse toujours un peu et respire péniblement. Mais aucun changement notable, ni amaigrissement, ni pâleur. Potain ne vient plus, ma maladie n'a, parait-il, besoin que d'air et de soleil ; il est honnête, le Potain et ne veut pas me bourrer de médecines inutiles. Mais je prends du lait d'ânesse et de l'élastine. Je sais qu'un hiver au soleil m'aurait guérie, mais... je sais mieux que personne ce que j'ai. J'ai toujours eu le larynx sujet à être malade, et les agitations continuelles y ont aidé beaucoup. En somme, je n'ai rien que cette toux et les oreilles. Ce n'est rien, comme vous voyez.
Samedi 15 janvier 81.
Entrée en fonctions de M. Cot, qui va alterner avec Tony. Je ne lui ai rien montré, bien que Julian m'eût désignée comme la personne dont il lui avait parlé. — C'est Mademoiselle, dit-il, qui va faire ceci, en désignant la grande toile qui a eu tant de mal à entrer hier.
— Oui, Monsieur, c'est moi qui suis l'auteur de cette toile, avec cadenas, de sûreté.
Julian est venu me dire ensuite qu'il avait parlé de moi à Cot, comme d'une élève très intéressante, etc., etc., et que si je ne lui ai rien montré, c'est par timidité. Tout ça, et autre chose avec, pour vaincre ma répugnance à accepter des conseils.
Tony, lui, est un homme fort, un artiste sérieux, un académicien, un classique, et les leçons de ces gens-là sont toujours excellentes. En peinture comme en littérature, apprenez d'abord la grammaire, puis votre nature vous dira s'il faut composer des drames ou des chansonnettes. Ainsi si Tony venait à être assassiné, je prendrais Lefebvre, Bonnat ou même Cabanel..., ce qui me serait pénible. Les peintres à tempérament comme Carolus, Bastien-Lepage, Henner, vous forcent involontairement à les imiter ; à ce jeu-là on ne prend que les défauts de ceux qu'on copie..., à ce qu'on dit. Et puis, comme maître, je ne voudrais pas d'un peintre de figures isolées ; il me faut voir autour du peintre un tas de tableaux d’histoire ; cela l'entoure, le peuple, et me fait écouter ses avis, bien que je préfère souvent une seule peinture à cinq ou six tableaux de trente personnes chacun.
En somme, ce Cot a l'air bon enfant, son début me touche. Il a bien quarante-sept ans, il n'a ni ventre, ni cheveux et il a causé assez gentiment dans l’atelier du 51. Nous l'avions eu tout neuf et là-bas il s’est dégourdi.
La figure la moins intéressante du monde peut le devenir avec certains arrangements. J'ai vu des têtes de modèles les plus banales devenir superbes, grâce à un chapeau, à un béret ou à une draperie ; tout cela pour vous dire modestement que, tous les soirs, en rentrant de l'atelier, sale et fatiguée, je me lave, passe un vêtement blanc et me drape sur la tête un fichu de mousseline de l'Inde à dentelles, comme les vieilles de Chardin et les petites filles de Greuze ; cela me fait une tête ravissante dont on ne me croirait pas capable... Ce soir, le fichu un peu grand s'est drapé à l'Egyptienne, et je ne sais comment, ma figure est devenue superbe. En général, ce mot semble jurer avec mon visage,mais la draperie a fait le miracle. Cela me rend gaie.
C'est une habitude à présent ; rester le soir, tête découverte me gêne et « mes tristes pensées » se plaisent à être abritées ; je me crois plus chez moi, plus tranquille.
Jeudi 20 janvier 81.
Parlons de choses agréables. J'ai été chez Tony lui montrer mon esquisse qu’il trouve très bien arrangée ; il me donne de bons conseils, une foule d'encouragements, et sa bénédiction pour commencer dès demain.
— Vous n'avez jamais fait de tableau ? dit-il.
— Jamais.
— Et vous ne savez pas un mot de perspective ?
— M. Ingres ne la savait pas non plus.
— Il mentait.
— C'était donc un farceur ?
— Absolument. Vous allez vous trouver aux prises avec des difficultés énormes ; observez bien, et bon courage, bon courage !
Bon courage ! J'en suis cousue de courage, parole d'honneur.
J'en suis toute gaie et contente.
Mardi, janvier 81.
Sans me presser, le matin, je vais déjeuner à onze heures chez les G..., que j'ai fort négligés ; après quoi, à une heure et demie, j'arrive à l'atelier et commence mon tableau avec le plus grand plaisir. Dès le premier trait, on sent si cela vient facilement ou s'il va y avoir du tirage.
Grâce à Dieu, je crois que cela vient tout seul. Mlle de Villevieille a posé et puis la petite Turque. Je vais dessiner comme ça au fusain toutes mes figures ; puis, en regardant l'ensemble, on verra les modifications à y apporter. Cela m'amuse ! Je suis bien portante et gaie ! Les tètes du premier plan sont de douze à quatorze centimètres.
Je n'ai pas encore compris qu'on donne sa vie pour un être aimé, être périssable, pour lequel vous vous sacrifiez parce que vous l'aimez...
Mais je comprends, en revanche, qu'on subisse toutes les tortures et qu'on meure pour un principe, pour la liberté, pour quelque chose qui peut améliorer la condition des hommes en général.
Moi, je défendrais toutes ces belles choses aussi bien en France qu'en Russie ; la patrie ne vient qu'après l'humanité ; la distinction entre les nations, ce n'est, en somme, que des nuances et je suis toujours pour simplifier et élargir les questions.
Si je ne vais pas me faire déporter, c'est parce que c’est inutile et que j'ai horreur de l'inutile. — On n’est pas lâche pour choisir son rôle et il est tout naturel de préférer d'être martyrisé comme saint Paul que de faire partie des onze mille vierges. J'avoue en toute franchise que je serais désolée d'être une héroïne inconnue, mais, je vous jure...
Là je m'arrête subitement, j'allais jurer devant Dieu et je ne suis pas bien sûre qu'il existe. Je le pense, sans crainte. Dieu, s'il existe, ne saurait s'offenser de mes doutes, qui ne sont qu'un aveu de mon ignorance. Je me garderais bien de nier l'existence de Dieu et je ne puis sincèrement l'affirmer de sang-froid. Oh ! dans les moments terribles, je ne suis pas si raisonneuse, je me jette à deux genoux par terre et invoque ce Dieu, dont je suis sûre, alors !
Il me semble pourtant bien qu'il doit exister une suprême intelligence..., mais pas le Dieu auquel je suis habituée... Mais alors, à quoi sert cette suprême intelligence ?...
Mais j'allais... oui, jurer devant Dieu que je donnerais jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour aider à sauver quelque grand principe qui m'est cher.
Je suis calme ; pas Louise Michel, pas nihiliste, du tout; mais si je croyais à quelque sérieuse menace contre la liberté, je serais la plus furieuse de toutes.
Samedi 22 janvier 81.
Il fait froid, de la neige partout ; je sors avant huit heures tous les matins.
Le tableau m'amuse. Cot l'a vu, mais ne me dit que des choses insignifiantes comme « cela se présente bien, pas mal », et puis des encouragements. Il est vrai que c'est la première fois qu'on me corrige. Cot parti, Tony est arrivé, je l'en avais prié par lettre ; .c'est bien gentil à lui. Tony trouve qu'il n'y a rien à changer, que rien ne cloche, que cela ne va pas mal du tout, que ça peut être très amusant et qu'il n'y a qu'à continuer. Julian, qui vient après, est aussi gentil, et je vois que mon travail l'amuse, car il vient le regarder souvent et m'encourage en me donnant de bons conseils. Tout cela va si bien que je n'y crois pas. Voilà pour deux mois d'oubli, d'amusement, de bonheur.
Après quoi, j'irai faire un tour en Italie, jusqu’à l'ouverture du Salon : trois mois et demi de bonne vie, cela me paraît impossible ; tout serait bon.
Mercredi 26 janvier 81.
Mardi, en revenant de l'atelier, je suis prise de la fièvre et reste jusqu'à sept heures sans lumière à grelotter dans un fauteuil moitié endormie et toujours le tableau devant les yeux comme chaque nuit depuis huit jours. Vous savez qu'A... s'est installée à l'autre extrémité de l'atelier et fait mon tableau à rebours et, comme chaque fois qu'elle veut me surpasser, elle croit qu'elle. y arrivera en prenant tout le temps des mesures ; et ce bras tendu, cette main avec ce bout de fusain, me donne devant les yeux avec des lignes très noires, tirées sur mon tableau pour la perspective.
N'ayant pris qu'un peu de lait, la nuit a été encore plus extraordinaire; je ne dormais pas, puisque j'ai fais plusieurs fois sonner le réveil, mais le tableau était toujours là et j'y travaillais ; seulement je faisais tout contraire de ce qu'il fallait, entraînée par une volonté surnaturelle à effacer ce qui était bien. Oh ! c'était énervant ! Et pas moyen de rester calme, je m'agitais comme un diable, m'efforçais de croire que je rêvais mais non. Mais c'est donc du délire ?... me disais-je. Je crois que ça en était, maintenant je sais ce que c'est et n’en serais pas fâchée, si ce n'était la fatigue partout dans les jambes.
Mais ce qu'il y a de bon, c'est que, toute faible, j’attendais Julian pour avoir son avis sur une figure que j'ai changée.
Hier, il vient et trouve que j'ai eu grandement tort. J’ai effacé ce qui était bien avant le rêve.
Et le soir, hier, par un phénomène curieux, j'entendas très bien, très bien.
Je suis brisée.
Lundi 31 janvier 81.
Julian et Tony, Julian surtout, puisqu'il l'a vu plus souvent, sont contents du tableau et me l'ont dit plusieurs fois et j'en étais contente moi-même et très montée. A présent, ça tombe ; je ne suis plus satisfaite de ma composition et j'ai beau me répéter que Tony l'a vue deux fois et m'a dit « que c’est très bien arrangé, amusant et qu'il ne faut rien changer », je n'ai plus confiance. Julian aussi me dit ne rien déranger. Enfin tout le monde trouve cela bien, un groupe du second plan surtout très joli, mais je ne suis pas contente. Je vois ça autrement, il ne faut plus songer à des modifications ; il est trop tard... du reste.
C'est tout de même curieux que tant de choses me choquent dans ce tableau et ne choquent ni Julian, ni Tony... C'est qu'ils pensent que je ne puis pas faire mieux et ne veulent pas me laisser enfoncer en cherchant midi à quatorze heures.
Jeudi 3 février 81.
J'ai là devant les yeux les portraits de ma mère et de mon père, quand ils étaient fiancés. Je les ai accrochés au mur comme document. Selon Zola et d'autres philosophes plus renommés il faut voir les causes pour comprendre l'effet. Je suis née d’une mère excessivement belle, jeune et bien portante, avec des cheveux bruns, les yeux aussi, une peau éclatante ; — et d'un père blond, pâle, d'une santé délicate, fils lui-même d'un père très vigoureux et d'une mère maladive, morte jeune, et frère de quatre sœurs plus ou moins bossues de naissance... Grand papa et grand-maman étaient bien constitués et ont eu neuf enfants tous bien portants, grands, dont quelques uns beaux, par exemple maman et Étienne.
Le père maladif de l'illustre produit qui nous occupe est devenu fort et bien portant, et la mère, éblouissante de santé et de jeunesse, est devenue faible et nerveuse grâce à l'horrible existence qu'on lui a faite.
J'ai fini l'Assommoir avant-hier ; j'en ai été presque malade, tellement saisie par la vérité du livre qu'il me semblait vivre et converser avec ces gens-là.
J'étais indignée de vivre et de manger, pendant que ces horreurs se passent autour de moi, plus bas... Tout le monde devrait lire ce livre, on serait meilleurs. Mais je suis calmée, surtout parce que mon action isolée serait impossible. Qui donc a nié la question sociale ?
Oh ! oui, il faut que tout le monde s'y mette, ah ! oui il le faut !... mais on traite les socialistes de canailles et de fous, et les socialistes souvent tournent à l'utopie. 0 abîme Et je ne suis seulement pas capable de faire un article de journal ?
Lundi 9 février 81.
Mon tableau, un instant dévoyé à cause d'une figure qui ne s'arrangeait pas, remarche : je suis légère comme une plume.
A une heure, Villevieille et Brisbane, mes principaux modèles et complaisants à l'infini, viennent avec moi aux Mirlitons. Je ne sais si j'ai mal regardé ou si mes yeux se sont ouverts, ou si Carolus est en progrès, mais je suis éblouie de son portrait : la femme avec la petite fille en rouge ; moi qui n'aimais pas Carolus (son enfant rouge du dernier Salon et sa femme bleue m'ont dégoutée). Mais les deux portraits d'aujourd'hui sont les plus beaux qu'on puisse voir. Je préfère encore la femme et l'enfant, à la femme seule qui est vieille et fardée.
C'est un éblouissement. La femme n'est pas belle, mais belle femme, sympathique, maternelle, en robe prune Louis XIII, la poitrine découverte et lumineuse; la lumière se continue par la tête blonde de l'enfant et se perd dans la main droite de la femme, qui est sur l’épaule de l'enfant. La main gauche tient un éventail et tombe négligemment. Des perles dans les cheveux et aux bras ; les mains sont peu faites et vers le bas du portrait c'est très lâché pour faire valoir les figures et poitrine : c'est une plaque de lumière superbe sur fond vert-mousse. Et c'est traité ! C'est large ! Et ça a un aspect de nature !
J'aime mieux ça que les machines enfumées et mortes des musées. — Mon favori, Bastien-Lepage, pose la face du prince de Galles en costume Henri IV, avec la Tamise et la flotte anglaise pour fond ; le fond rappelle celui de la Joconde comme ton. Une tête d’abruti ; ça a tout à fait l'air d'un Holbein, on s'y tromperait, je n'adore pas ça. Pourquoi imiter ?
Si c'est une copie, mais ce n'est pas une copie ; enfin, c’est extrêmement réussi comme imitation... Je n’aime pas ça,
Oh l si je pouvais peindre comme Carolus Durant !... Voici la première fois que je trouve quelque chose digne d'être désiré, quelque chose que je voudrais pour moi en peinture. Après avoir regardé ça, tout parait mesquin, sec et sale.
Samedi 12 février 81.
J'avais fait mettre mon tableau en perspective et voilà que cela me changeait tout, je ne devais plus voir ce que je voyais, mais il fallait me supposer à six mètres de là ; de sorte que mes yeux voyaient l'échelle derrière la tête de Mlle de Villevieille et la perspective m'ordonnait de la voir beaucoup plus à gauche. Je ne comprends pas comment on peut faire ce qu'on ne voit pas. Du reste, quand on dessine juste, on ne doit pas faire de faute de perspective ; il faut des perspecteurs quand il s'agit de faire un temple, une colonnade, des machines de ce genre ; mais un simple atelier avec des femmes !
J'ai perdu quatre ou cinq jours avec tout cela ; enfin vient Tony et il me donne raison.
Usez de la perspective, si cela rentre dans vos arrangements ; mais si ça dérange la composition, flûte ! Il est avec elle des accommodements. Du reste, comment peut-on faire une chose fausse, en faisant exactement ce que l'on voit ?
Tony persiste à être très content et me dit de peindre.
Je suis ravie.
A midi, la bonne arrive en courant, le visage congestionné. M. Julian est décoré, joie générale, cela pose la maison ; nous triomphons et courons, A..., Neuvéglise et moi, commander une splendide corbeille de fleurs avec un gros nœud rouge, chez Vaillant-Roseau. Vaillant-Roseau n'est pas un fleuriste ordinaire, c'est un artiste raffiné ; 150 francs, ce n’est pas trop.
Nous y mettons une carte ainsi conçue :
« A M. Julian, l'atelier des dames du passage Panorama. »
Villevieille revient exprès à trois heures pour féliciter le maître ; il monte avec son ruban et j'ai le plaisir de voir pour la première fois de ma vie un homme absolument heureux. Il l'avoue lui-même : « Il y a peut-être des gens qui ont envie de quelque chose ; moi, à l'heure qu’il est, je ne désire plus rien au monde ! »
Puis nous descendons, Villevieille et moi, dans l'atelier du directeur décoré, voir la corbeille ; joie, félicitations et même un peu d'attendrissement. Il nous parle de sa vieille mère, à laquelle il craint de donner coup en lui annonçant brusquement la nouvelle. Puis un vieil oncle qui en pleurerait comme un enfant. — Songez donc, c'est un village là-bas ! Vous voyez l’effet !... Un pauvre petit paysan, parti de là-bas sans rien,... chevalier de la Légion d'honneur !
Il a été très gentil en parlant de sa famille, le père Julian ; ici aussi c'est une fête de famille. Sous le coup de l'émotion, les élèves les moins sympathiques parlent d'offrir un bronze, un souvenir, que sais-je ?
Puis arrivaient d'autres élèves, ma tante, Neuvéglise, etc. — Il est ravi de nos fleurs et du nœud. — Enfin, cela dure jusqu'à cinq heures et demie.
Blague à part, cela donne un tout autre cachet à la boutique. Et puisqu'il est si heureux que ça, le père Rodolphe, ça va le rendre bon.
Dimanche 13 février 81.
Voici une lettre de maman, très tendre :
27 janvier. Karkoff, Grand-Hôtel.
« Mon ange adoré, l'enfant chérie Moussia, si tu savais comme je suis malheureuse sans toi ; « surtout m'inquiétant de ta santé, et comme je voudrai partir le plus tôt possible !
« Toi, ma fierté, ma gloire, mon bonheur, ma joie ! Si tu pouvais imaginer les souffrances que « je suis sans toi ! Ta lettre écrite à Mme Anitskoff est entre mes mains; comme un amoureux, je la « relis continuellement et je l'arrose par mes larmes. Je te baise tes petites mains et tes petits « pieds et je supplie le bon Dieu que je puisse le faire en réalité le plus tôt possible.
« J’embrasse tendrement notre chère tante.
« M. B. »
Lundi 14 février 81.
La tête de Brisbane (Alice) est, peinte en deux heures de temps et Julian me dit de la laisser. Et d'autres fois, on reste huit jours à faire une saleté. Une partie du corsage et du tablier sont aussi peints.
Le perspecteur vient et me prêche pendant vingt-cinq minutes la nécessité de me soumettre à ses règles infaillibles. Tony alors ?... Et moi !
Cet homme ne peut se tromper, puisque ce sont des règles fixes ; mais Tony, mais moi ? Je n'en sais rien , n'approfondissons pas, afin de ne pas nous fatiguer, au moment où il nous faut beaucoup de liberté d'esprit pour tranquillement faire le chef-d'œuvre.
Mais j'opte pour le mathématicien.
Vendredi 18 février 81.
Des embêtements ! On avait mélangé les dessins et la moitié du concours n'a pas été jugée. Grand émoi, Julian monte et se met à expliquer je ne sais quoi ; moi, qui pensais à autre chose, appuyée contre la porte, je pousse un formidable bâillement qui signifiait clairement : Ah ! que tout ça m'embête !... Julian, déjà exaspéré, se retourne et me dit que je n'ai qu'à aller chez moi, si cela ne m'amuse pas. Je n'ai rien trouvé à répondre, ne l'ayant pas fait exprès et n'ayant pas eu la moindre envie d'être impolie.
Voilà deux jours que l'illustre artiste passe sans me corriger, et cela fait à l'atelier une situation tendue... qui m'ennuie !
Samedi 19 février 81.
Tony dit que ça va très bien ; après m'avoir donné une bonne leçon, il s'en va corriger A... à laquelle il ne dit presque rien, très embarrassé ; il la prie de changer des figures qui ne s'arrangent pas, je crois.
Elle en devient toute rouge et, au lieu de causer avec lui, comme d'habitude, reste à sa place et travaille fébrilement, pendant que cet ange de Tony revient à mon tableau, l'examine, donne des conseils, m'entourage et répète plusieurs fois que cela va bien.
J'en suis si ravie que j'oublie les froideurs de Julian, qui me tracassent pourtant.
Depuis une dizaine de jours , je rêve toujours de grand-papa, de maman, des miens...
Et puis presque toujours je rêve ou des gens que je dois voir le lendemain, ou bien le rêve continue la journée terminée et je ne dors jamais sans rêves.
Mardi 22 février 81.
Nous avons fait la paix avec Julian ; je lui ai dit : — Monsieur Julian, eh ! quoi, me gardez-vous toujours rancune d'une chose que je n'ai pas faite exprès ? venez donc me corriger ! Et il est venu d'un air très digne, en disant que, puisque je reconnaissais avoir tort, c'était bien ! Je n'ai rien répondu, parce que je n'ai pas tort; mais je déteste les brouilles et ça me détraquait le tableau.
Jeudi 3 mars 81.
Je suis très malade, je tousse très fort, je respire avec peine et il se fait dans mon gosier un clapotement sinistre... Je crois que cela s'appelle une phtisie laryngée.
J'ai ouvert le Nouveau Testament oublié depuis quelque temps, et à deux reprises, dans l'espace de quelques jours, j'ai été saisie de l'à-propos avec lequel la ligne indiquée au hasard répondait à ma pensée. Je suis revenue à prier le Christ, et je suis revenue à la Vierge, aux miracles, après avoir été déiste, avec des jours d'athéisme absolu. Mais la religion du Christ, d'après ses paroles, ressemble peu à votre catholicisme ou à notre orthodoxie que je m'abstiens de suivre, me bornant à suivre les préceptes du Christ et ne m'embarrassant pas des allégories prises pour tout de bon, des superstitions, des diverses absurdités introduites dans la religion plus tard par de simples hommes, pour des motifs politiques ou autres.
Mercredi 16 mars 81.
Tony est venu, il trouve plusieurs choses très bien, d'autres bien ; en somme, ce n'est pas mal. Finalement, je ne suis pas très contente.
C'est Bojidar qui, revenu de Nice, escortera le tableau et les commissionnaires.
Vendredi 18 mars 81.
J'ai fini le tableau, sauf quelques retouches.
Julian trouve qu'il a énormément gagné depuis huit jours, que c'est bien maintenant.
Tony n'a pas vu le changement du centre ; les trois principales figures, quoique au second plan, sont repeintes, changées, et puis d'autres, et des mains.
Je sens moi-même que c'est mieux à présent, nous verrons ce que dira demain Tony.
Il y a en tout seize personnes et le squelette, cela fait dix-sept.
Samedi 19 mars 81.
Eh bien, je ne suis pas contente. Tony trouve, comme les autres fois, plusieurs morceaux bien, mais le tout ne me vaut pas de compliments ; il m'explique longuement ce qu'il faut y faire et donne quelques coups de brosse que j'enlève ensuite.
A quatre heures et demie vient Julian ; il se produit une détente, on cause. J'avais commencé à huit heures moins le quart, j'étais fatiguée, et fatiguée surtout de n'avoir pas obtenu des « très bien » de Tony.
Mon Dieu, je le sais bien, c'est gai et mouvementé, mais il y a un manque de savoir énorme !
Julian s'écrie qu'il est furieux de m'avoir donné cet épatant sujet pour mon premier tableau. — Ah ! « si c'était seulement votre second ! » — Ah ! oui. Eh bien, Monsieur, laissons-le pour l'année prochaine.
Là-dessus il m'a regardée avec des yeux luisants d'espoir de me trouver digne et capable de renoncer à la vaine satisfaction d'exposer une chose incomplète et médiocre. Il serait charmé si j'y renonçais ; moi aussi, mais les autres ! Les amis ? On dirait que ce que j'ai fait a été trouvé trop mauvais par les professeurs, que je n'ai pas été capable d'un tableau, enfin que je suis refusée au Salon.
Question : Ai-je fait tout ce que je pouvais, sauf quelques petites choses ? Oui, certainement ; mais je me suis trouvée en face de choses absolument inconnues et que je ne soupçonnais pas ; dans tous les cas j'ai beaucoup appris.
Julian trouve que j'ai fait un grand effort, que ce n'est pas mal, que c'est amusant ; mais que c'est à s'arracher les cheveux quand on pense à ce que ça aurait pu être. Ah ! je voudrais qu'il fût crevé, ce tableau, pour ne pas être forcée de l'exposer. Car j'y suis forcée par une sotte vanité punie d'avance, parce que je crains l'indifférence du public et la blague des hommes d'en bas. Ce n'est pas précisément de la blague, mais ils diront : — Eh bien, elle n'est pas forte la plus forte de vos femmes.
Ah ! Seigneur ! c'était à prévoir. Julian aurait dû le savoir ! Mais il dit que c'est parce que j'ai fatigué ma toile, que si j'avais peint comme j'ai commencé, ça aurait été bien ! Et il y a là l'académie du modèle, un petit bonhomme de dix ans. Non, si j'avais fait ça comme étude de la semaine, j'aurais gratté tout ; c'est mal et surtout d'un dessin commun, sans caractère et absolument indigne de moi : c'est le plus mauvais des tableaux.
Ah ! c'est ennuyeux ; mais que faire ? ?
Dimanche 20 mars 81.
Au palais de l'Industrie. C'était très amusant, la foule poussait des cris et faisait des remarques sur les malheureuses toiles qui arrivaient. Bojidar était entré, moi j'eus quelque peine à me faire reconnaître pour l'auteur ; enfin je cours, élégante et regardée par les chers confrères ; nous nous retrouvons avec l'éternel Bojidar et je puis voir quelques tableaux.
Le mien paraît assez petit, quoiqu'il ait 1 m. 50 de haut sur près de 2 m. de large. Un groupe d'hommes était arrêté devant ; je me suis enfuie, pour ne pas entendre leurs remarques, et puis il me semblait qu'on savait que c'était de moi.
J'ai sérieusement parlé à Julian, je lui ai expliqué mon sentiment. Je ne veux pas qu'il me croie capable de sotte vanité ; non, je ne dis pas ça par bravade et je n’aurai pas de crève-cœur ; ne pas me confondre avec les femmes nerveuses, non !
Enfin, il comprend très bien et moi aussi. Il dit que je serai honorablement reçue et que j'aurai même du succès ; mais pas celui que nous avions rêvé. Les hommes d'en bas ne viendront pas se planter devant la toile : comment, c'est une femme qui a fait cela ? — Enfin, j'ai proposé de faire un accident pour sauver l'amour-propre, mais il ne veut pas. Il avait préparé un succès ; il avoue que son amour-propre n'est pas complètement satisfait, mais que cela peut aller. Et, dans ces conditions là, j'expose ! ! ! !
Hélas oui ! C'est égal, les encouragements qu'il me donne, c'est parce qu'il ne croit pas à mes résolutions raisonnables ; malgré mes déclarations il me croit femme, et il se dit qu'il me blesserait en me disant la vérité pure.
Pourtant j'ai tout dit !.. C'est que je suis une élève sérieuse et n'ai pas besoin d'exposer pour avoir des leçons ; j'expose par vanité ; donc si c'est mauvais, ce l'est pas la peine. Enfin ! c'est fini, je suis délivrée du tableau, mais les inquiétudes jusqu'au 1er mai inclusivement ?... Pourvu que j'aie un bon numéro !
Oh ! je vais peindre des torses et faire des esquisses ! Vous verrez.
Jeudi 24 mars 81.
Je découvre sous mon lit un pot de goudron. C'est une tendresse de Rosalie pour ma santé. D'après les conseils d'une tireuse de cartes !
Ma famille trouve cette marque de dévouement admirable de la part d'une servante ; maman s'est attendrie. Je verse un seau d'eau sur le tapis, sous le lit, casse une vitre et couche dans mon cabinet de travail, en colère.
C'est comme cette scie de vêtements chauds !
Ma famille s'imagine que l'on a un intérêt particulier à se faire geler, et ça m'embête à un tel point que souvent je ne me couvre pas pour leur prouver l'inutilité de leurs obsessions. Oh ! ces gens-là me font crever de rage…
Mardi 29 mars 81.
J'apprends à l'atelier que Breslau est déjà reçue et je n'ai pas de nouvelles de mon tableau. J'ai travaillé jusqu'à midi, et puis nous avons fait des courses qui m'ont paru atrocement longues.
J'ai épuisé tous les raisonnements tacites du monde et je n'ai gagné que la fièvre et un mal de tête, sous des dehors calmes, il est vrai.
Mais cette bête de Rosalie étant allée demander de l'argent à ces dames pour expédier la dépêche où je peins mes inquiétudes à Tony, ces dames ont lu la dépêche ; c'est affreux maintenant, je ne puis ni paraître à l'atelier ni rester ici. Oh ! ma famille !...
Je ne vous souhaite pas mes angoisses, quand même vous seriez n'importe qui.
Mercredi 30 mars 81.
J'ai fait semblant de dormir jusqu'à dix heures, pour ne pas aller à l'atelier, et suis très misérable.
Voici la réponse de Julian. Cela me calme un peu.. Songez donc. Non, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que serait pour moi le refus du tableau ! Ce ne serait plus... Enfin, je n'aurais à crier que contre moi ! Et je ne sais pas ce qui est plus affreux : être soi-même coupable de son infortune ou souffrir à cause des autres… Ah ! ce serait un de ces coups en pleine poitrine, je ne m’imagine pas ce que je ferais... Enfin, il faut espérer…
Vendredi 1er avril 81.
Poisson d'avril à part, je suis reine. Julian est venu le dire lui-même hier après minuit, en sortant de chez Lefebvre. Nous avons pris du punch à l'atelier. Bojidar, sans que je le lui demande, s’est informé chez Tidière (un jeune homme d'en bas) et assure que j'ai le numéro 2. Cela me parait excessif.
Dimanche 3 avril 81.
Jamais Patti n'a chanté avec plus d'entrain qu'hier ; sa voix avait une largeur, une fraicheur, un éclat ! Le boléro des Vêpres siciliennes a été bissé. Mon Dieu ! comme j'avais une belle voix ! Elle était puissante, dramatique, empoignante ; ça faisait froid dans le dos. Et maintenant, plus rien, pas même de quoi parler !
— Est-ce que je ne guérirai pas ? Je suis jeune, je pourrai peut-être...
La Patti n'émeut pas, mais elle peut faire pleurer d'étonnement, c'est un véritable feu d'artifice ; hier, j'ai été positivement saisie à un moment où elle a lancé un jet de notes, mais pures, mais hautes, mais d’une délicatesse !..
Mardi 5 avril 81.
Surprise ! mon père est arrivé. On est venu me chercher à l'atelier et je le trouve dans la ville à manger avec maman qui lui fait mille tendresses, Dina et Saint-Amand, ravis du spectacle de ce bonheur conjugal.
Nous sortons ensemble : Monsieur, Madame et bébé ; visitons les magasins pour Monsieur, puis au Bois et un instant chez les Karageorgevitch.
Il vient sans doute chercher maman, mais je ne sais encore rien, nous sommes trop en l'air.
Mercredi 6 avril 81.
— Je suis retenue jusqu'à neuf heures par le père, qui insiste pour que je n'aille pas travailler ; mais mon torse m'intéresse trop et je ne revois l'auguste famille qu'à dîner ; après quoi, ils s'en vont au théâtre et je reste seule.Mon père ne comprend pas du tout qu'on puisse être artiste et que cela puisse rapporter de la gloire. Je crois par moment qu'il fait exprès d'avoir de pareilles idées.
Samedi 23 avril 81.
J'ai porté le portrait de B. à Tony ; il trouve d'abord que c'est très bien arrangé ; puis, après divers conseils, il dit que c'est étonnamment bien pour quelqu'un qui n'a pas plus travaillé que moi.
— Oui, c'est étonnamment bien, et si vous continuez à travailler comme...
Mais je l'interromps en m'écriant que je vais travailler encore plus, autant que je pourrai et plus.
Je suis enchantée, c'est étonnamment bien ! À la bonne heure ! Je ne fais donc pas des progrès estimables seulement. Ah ! je respire ! Je m'étais déjà classée dans les élèves honorables... Ah ! nom d'un chien, quelle chance !
Le portrait est joli. B. est habillée d'une robe de batiste blanche ouverte et froncée, des manches courtes, bouffantes, un ruban rose autour de la taille, sous les seins, un châle jaune-paille autour d'elle et couvrant les bras, la main gauche tient une rose avec abandon... La tête est de face, toute droite, moitié ombre très claire et moitié lumière. Fond neutre, gris vert, chaud et transparent. N'allez pas croire que je me vois du talent ; pas encore, mais c'est joli d'arrangement, la femme est jolie et c'est étonnamment bien pour quelqu'un qui ne travaille pas depuis longtemps.
Dimanche 1er mai 81.
Alexis vient de bonne heure, il a un billet pour deux ; cela fait qu'avec le mien, nous pouvons aller quatre. Monsieur, Madame, moi et Alexis. Je ne suis pas trop contente de mon accoutrement : un costume de laine gris, très foncé, chapeau noir, élégant, nais assez banal. Nous trouvons de suite mon œuvre qui est dans le premier salon, à gauche du salon d'honneur, au deuxième rang. Je suis ravie de la place et très étonnée que le tableau paraisse si bien que ça. Ce l'est pas bien, mais je m'attendais à une véritable horreur, et c'est gentil.
Seulement par erreur on a omis mon nom dans le catalogue (j'ai réclamé et ce sera rectifié). On ne peut pas bien voir dans ce premier jour ; on a hâte de tout voir à la fois. Alexis et moi lâchons un tant soit peu la famille pour pousser une pointe à droite et à gauche ; finalement, nous l'avons tout à fait perdue et j'ai pris son bras pour quelque temps; du reste, je m'émancipe, je vais, je viens, je n'ai pas peur. Une foule de connaissances, de grands compliments qui n'avaient pas l’air d'être tirés par les cheveux. C'est naturel ; ces gens-là, qui ne s'y entendent pas, voient un assez grand tableau avec beaucoup de monde dedans, d'un aspect convenable !
Moi, j'ai donné, il y a huit jours, mille francs aux pauvres. Personne ne le sait, j'ai été dans le grand bureau et me suis sauvée très vite sans écouter les remerciements ; l'administrateur a dû croire que j'avais volé pour donner. — Le ciel m'en rend pour mon argent.
Abbema, qui se promène avec Bojidar, m'envoie dire que mon tableau lui plaît, que c'est viril, amusant, etc. Quelques minutes après, nous nous rencontrons et faisons connaissance avec la célèbre amie de Sarah Bernhardt.
C'est une très bonne fille et j'apprécie ses éloges, d'autant plus que Bojidar m'annonce qu'elle vient de se brouiller avec B... à qui elle a dit qu'il baisse et qu'elle n'aime pas ses envois de cette année.
Nous avons déjeuné là ; en tout, un séjour de six heures au milieu des arts. Je ne vous dirai rien des tableaux. Je veux seulement dire ici que je pense beaucoup de bien du tableau de Breslau ; de grandes qualités, mais peu de dessin et des empâtements stupides. Des doigts en griffes d'oiseau, des nez avec des fentes, et des ongles, et des duretés. — Et puis des encroûtements extravagants ; en somme, cela sent l'impressionnisme et c'est Bastien-Lepage qu'elle imite.
Où avez-vous jamais vu de ces barbouillages et de ces reliefs dans la nature ?
Mais c'est égal, il y a du bon, et on regarde ces trois têtes placées entre le portrait de Wolff et le Mendiant de Bastien-Lepage.

(Le cadre au fond semble abriter une reproduction du dernier jour de Corinthe de Tony R.-F.,
Madeleine Delsarte, robe bleu ciel, est au centre, la blonde, Marie de dos à droite,)
Vendredi 6 mai 81.
Ce matin au Salon, où j'ai rencontré Julian qui m'a fait faire la connaissance de Lefebvre, lequel m'a dit qu'il y a de grandes qualités dans mon tableau. — Je suis très petite fille.
A la maison, toujours des conversations sur les changements à opérer. Ils m'agacent tous ! Mon père a des idées parfois absurdes ; il n'y croit pas, mais il s'y obstine, comme de dire que tout dépend de mon consentement à passer l'été en Russie. — On verra, dit-il, que tu n'es pas en dehors de ta famille.
Est-ce que je l'ai jamais été ! Ce truc de me mettre directement en cause est répugnant. Du reste, j'en ai assez tout plein, je ne peux en dire un mot sans fondre en larmes. Ils ne veulent ou ne peuvent rien ! Eh bien, j'attendrai tout du hasard. Mais au moins je ne voyagerai pas, je resterai tranquille (! ! !) chez moi et je pourrai me désoler dans mon fauteuil, où je suis physiquement bien.
0 lassitude, ô atrocité ! Est-ce que je devrais connaître ça à mon âge ? Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi estropier un caractère ?
Et c'est ce qui me désole : si jamais j'ai quelque joie ou si j'ai une existence heureuse, pourrai-je en jouir ? Pourrai-je tirer parti de ce qui se présentera ? Je crois que je ne vois plus comme les autres et que… ; mais c'est assez comme ça.
Et le soir, toute fatiguée, à moitié endormie, des harmonies divines me passent par la tête. — Ça vient, ça passe, on le suit comme un orchestre dont la mélodie se développe en vous et malgré vous.
Samedi 7 mai 81.
Mon père veut partir demain et maman doit partir. Ça détraque tout.
Et moi, vais-je partir ? Pourquoi rester ? Je ferais là des études de plein air et nous reviendrions pour Biarritz.
D'un autre côté, on dit qu'Ems me ferait du bien... Ah ! tout m'est indifférent. Il n'y a rien pour moi.
Dimanche 8 mai 81.
A présent, je suis presque heureuse de voir que ma santé se détraque par suite des bonheurs que le ciel ne m'envoie pas.
Et quand je serai totalement finie, tout changera peut-être, et alors il sera trop tard.
Chacun pour soi, il est vrai ; mais pourtant ma famille affecte de tant m'aimer et elle ne fait rien... Je ne suis plus rien moi-même, il y a un voile entre moi et le reste de la terre. Si on savait ce qu'il y a là-bas, mais on ne sait pas ; du reste, c'est cette curiosité qui me rendra la mort moins affreuse.
Je m'écrie dix fois par jour que je veux mourir, mais c'est une forme de désespoir. On pense : je veux mourir, et ce n'est pas vrai ; c'est une façon de dire que la vie est horrible ; mais on veut vivre toujours et quand même, surtout à mon âge. Du reste, ne vous attendrissez pas, j'en ai encore pour quelque temps. On ne peut accuser personne. C'est Dieu qui veut ça.
Dimanche 15 mai 81.
Pourtant... En un mot, je vais partir pour la Russie, si on veut m'attendre huit jours. Il me serait affreux d'assister à la distribution des récompenses. Ça, c'est un très gros chagrin que personne ne sait, sauf Julian. Donc, je pars. Je suis allée incognito consulter un grand docteur, C... Mes oreilles guériront, l'enveloppe du poumon droit est malade et depuis longtemps, pleurésie, tout dans le gosier est abîmé. Je lui ai demandé tout cela en des termes tels qu'il a dû me dire la vérité après avoir bien vu la maladie.
Il faut aller à Allevard et suivre un traitement. Bien. J'irai en revenant de Russie, et de là à Biarritz. Je travaillerai à la campagne. Je ferai des études de plein air, ça fait du bien. J'écris tout ça d'un air rageur.
Mais ici à la maison, la situation est larmoyante.
D'un côté, maman désolée de partir et moi assommée de rester avec ma tante, une superstition bête.
Et, d'un autre côté, ma tante qui n'a que nous, que moi au monde et qui ne dit rien, mais qui est blessée au cœur de voir que je souffrirais de rester avec elle.
Je suis à bout de forces, je reste là tout le jour sans desserrer les dents pour ne pas pleurer, la gorge étranglée, des bourdonnements dans les oreilles et une drôle de sensation comme si les os allaient percer la chair qui s'en va. Et cette pauvre tante qui voudrait que je sois contente et que je parle, et que je reste avec elle. Je vous dis que je suis à bout de forces, que je ne crois à rien et crois tout possible. Ni rester ni partir ne me valent rien, mais il me semble qu'on restera moins longtemps avec moi. Du reste, je ne sais rien. C'est la mention ou la médaille de Breslau qui me fait partir. Ah ! je n'ai de chance en rien ! Il faudra donc mourir misérable. Moi qui croyais et priais tant... Donc, après les tiraillements les plus émouvants du monde, voilà le départ fixé à samedi.
Lundi 16 mai 81.
J'ai été voir Julian et nous avons causé longtemps et sérieusement. Il dit que je fais une sottise en allant en Russie : — Les médecins vous envoient dans le Midi et vous partez dans le Nord. — Il m'a dit des choses si sages, si sensées que je suis plus qu'ébranlée. Et pour que je ne pense pas que c'est une question de boutique, il m'envoie hors de Paris travailler à la campagne, où il fera chaud et où je serai enveloppée d'air et de soleil toute la journée. Il faut donc que je fasse un grand paysage, l'été, avec des figures, et l'hiver je ferai un tableau d'atelier ; cela me fera deux envois très différents.
Et que je ne marche à la queue de personne, ni de Bastien, ni d'un autre (attrape Breslau) ; je suis de celles qui doivent rester elles-mêmes. Bref, il pense du bien de moi et trouve toujours des conseils excellents, de bonnes et encourageantes paroles. Et très sévère avec ça; aussi, je suis obéissante. Je lui parle presque à cœur ouvert et je crois qu'il en est flatté.
Mais, par exemple, pour faire de la bonne peinture il faut se soigner ! Je sais bien. Cet homme qui me conseille carrément de ne pas aller en Russie, bien que cela soit agréable à ma famille : « Votre famille le regrettera après. » — Il l'a dit à maman, au risque de la fâcher, lorsqu'elle est venue me chercher. En effet si cela me faisait du mal ! Ah ! je ne suis pas heureuse... mais je me soignerai ; je vais partir... pour Allevard, y rester cinq semaines ; cela me mènera en juillet. Alors, passer un mois dans la forêt de Fontainebleau... Non, rester juin à Paris jusqu'au 15 ; le 15 partir à Allevard jusqu'au 20 juillet, puis un mois à Fontainebleau en venant souvent à Paris montrer mes études ; vers le 20 août, rentrer, préparer ses hardes et arriver à Biarritz le 1er septembre ; après un mois de Biarritz, revenir ici et travailler en prenant des précautions.
Et la Russie au diable !
Vendredi 20 mai 81.
En deux mots, mes hésitations recommencent ! Oh ! là là ! Potain vient et je comptais sur lui pour ne pas aller en Russie et ne pas trop vexer mon père. Bon, je puis ne pas partir.
Mais c'est Bojidar qui apporte le mot mortel : « Le jury a fait sa promenade au Salon aujourd'hui, et beaucoup regardé le tableau de Breslau ! » Oh ! là là ! les larmes, qui avaient déjà coulé, se répandent en torrents. Mon père et ma mère pensent que c'est ce qu'a dit Potain qui me chagrine, et moi je ne puis avouer la vérité, mais je pleure bien ; pas de grimaces ni de sanglots, de belles grosses larmes silencieuses à profusion, qui tombent comme une pluie d'été sans trop détraquer le visage.
En somme, Potain n'a pas dit grand'chose de neuf et il m'a donné moyen de rester ici ; mais c'est le tableau de Breslau ! C'est affreux, ça. Enfin, que vous dire ? une journée !... J'ai prié Potain d'exagérer mon état et de dire tout bonnement à ma famille que le poumon droit est malade, pour que le père ne soit pas vexé de ce que je reste.
Et les voilà tous deux dans la désolation, marchant sur la pointe des pieds... Ah ! misère ! leurs égards me blessent, leurs concessions m'exaspèrent... et pas un point d'appui ! A quoi me raccrocher ? Ah ! la peinture est une bonne farce ! Vous savez, dans les moments d'ennui, on n'est jamais trop malheureux quand on a un point lumineux quelconque dans son horizon. Je me repliais en disant : Attendons un peu, la peinture nous sauvera. A présent, je doute de tout, je ne crois ni à Tony ni à Julian.
Si c'est en pleurant que j'espère bien peindre ! ! !
Lundi 23 mai 81.
Enfin tout est emballé et nous voilà à la gare. Alors, au moment de partir, mon hésitation gagne les autres ; je me mets à pleurer, et maman avec moi, et Dina, et ma tante ; et mon père qui vient demander quoi faire ? Je réponds par des larmes ; La cloche sonne, nous courons au wagon où on ne m'avait pas pris de billet et on monte dans un compartiment ordinaire (ce que je ne ferais pas). Je veux , monter aussi, mais on ferme ; je n'ai pas de billet et on part sans se dire même adieu. — Voyez-vous, on se maudit, on se déteste, mais quand il s'agit de se séparer, on ne sait plus rien. D'un côté maman, d'un autre ma tante et mon père au milieu. Il doit être furieux, car en somme il a été très gentil; mais ce voyage inutile, cette perte de temps, et puis, je n'en sais plus rien. Je pleurais de partir, je pleure de rester. Breslau ne me fait presque plus rien, mais en somme..., je n'en sais plus rien, je crois vraiment qu'ici je me soignerais mieux et que je ne perdrais pas de temps.
Mardi 24 mai 81.
Je suis désespérée de n'être pas partie.
J'ai fait une offense gratuite à mon père et je reste ici ; mon été sera tout de même en morceaux, puisqu'il faut aller aux eaux fin juin. Au lieu donc de passer trois semaines ici, d'assister à la médaille de Breslau de rester enfermée, triste, languissante, dans ce Paris où l'on étouffe, j'aurais été à la campagne et j'ai vraiment besoin de sortir de cet état impossible. Aussi je suis idiote. 0.... pleure et me prie de rester croyant que c'est mon tombeau, ce voyage, et que le terrible M. Bashkirtseff me retiendra là-bas. En voilà des bêtises ! ! ! Et moi je suis assez ramollie, assez tout ce que vous voudrez pour me laisser influencer ! ! ! Je vais télégraphier à Berlin pour qu'on m'attende et je pars.
Berlin. Mercredi 25 mai 81.
Je suis donc partie hier ma tante, qui m'avait vue triste de rester à Paris, ne pleure pas, craignant que je lui reproche de m'influencer en m'attendrissant, mais elle a la mort dans l'âme et croit qu'elle ne me reverra jamais. La pauvre femme, qui adore maman, m'adore doublement à cause de cela, et je suis aussi désagréable que possible. Je me demande même comment il est possible de récompenser si mal ce sublime dévouement. Elle est habituée par grand'maman, depuis ma naissance, à voir en moi l'idéal du monde entier ; maintenant, quoi que je fasse, elle n'a pour moi que soins et prévenances ; n'ai même pas à parler, elle guette mes fantaisies et cela d'autant plus que, me sachant très malheureuse et malade, elle n'y peut rien... que de ne pas me rendre la vie matérielle désagréable.
Je suis atteinte et ma pauvre famille, exagérant tout, me croit presque perdue.
Du reste, j'ai toujours eu la consolation de voir les plus beaux fruits, les primeurs sur la table avec mes plats favoris, chaque fois que j'ai eu un ennui ostensible. Ces soins-là peuvent paraître niais, mais il y a là quelque chose de touchant. Et je ne puis paraître douce ; pauvre tante a remarqué sans que je souffle un mot que j'évite autant que possible tout visage humain ; aussi, ayant veillé à ce que le souper soit préparé, elle s’esquive et me laisse seule avec un livre. Quand il y trois, quatre personnes de la famille, je les supporte et parle avec; mais une seule, c'est une intimité qui me gène et je reste à bouder, tout en me reprochant d'être si peu tendre avec une femme aussi dévouée, aussi vertueuse ! Car on est très vertueux chez nous ; ma pauvre tante, sous ce rapport, est un ange.
Donc, me voilà partie.
Je suis allée chez Tony, qui est très malade et auquel j'ai laissé une lettre de remerciements, et chez Julian qui était sorti. Il m'aurait peut-être fait changer d’avis et rester, et j'avais besoin de changer... Depuis huit jours, personne n'osait plus se regarder dans la famille, de crainte de fondre en larmes, et, restée seule, je pleurais tout le temps, tout en sentant que c'était cruel pour ma tante... Mais elle a dû pourtant voir que j'ai aussi pleuré quand il s’agissait de la quitter. Elle croit que je ne l'aime pas du tout, et quand je pense à la vie toute de sacrifice de cette héroïque créature, je fonds en larmes : elle n'a même pas la consolation d'être aimée comme une bonne tante !... pourtant je n'aime personne davantage... Enfin, je suis à Berlin, ma famille et Gabriel à la gare ; nous dînons ensemble.
Ce qui est le comble de l'horrible, ce sont mes oreilles. Je suis frappée là d'une façon épouvantable.., avec ma nature, c'est ce qui pouvait arriver de plus cruel... Ainsi je crains tout ce que je désirais et c'est une situation affreuse. Maintenant que j'ai plus d'expérience, que je vais commencer peut-être à avoir du talent, que je sais mieux comment me tirer d'affaires.. il me semble que le monde serait à moi, si je pouvais entendre comme avant. Et dans ma maladie cela arrive une fois sur mille à peine, à ce que me disent tous le médecins que j'ai consultés. « Rassurez-vous, vous ne deviendrez pas sourde à cause de votre larynx, ça arrive très rarement ! ! » Et justement c'est mon cas... Vous ne vous figurez pas tout ce qu'il faut de dissimulation, de tension continuelle pour tâcher de cacher cette infirmité odieuse ; j'y parviens avec ceux qui m'ont connue avant et qui me voient peu ; mais à l'atelier, par exemple, on sait !
Et ce que ça enlève d'intelligence ! Comment être vive ou spirituelle ?
Ah ! tout est fini.
Faskorr (après Kieff). Jeudi 26 mai 81.
J'avais besoin de ce grand voyage ; la plaine, la plaine, la plaine partout. C'est très beau, je suis folle des steppes... comme nouveauté... C'est presque l'infini... ; quand il y a des forêts ou des villages, ce n'est plus ça. Ce qui charme c'est l'air avenant, aimable de tous les employés, jusqu'aux faquins, sitôt qu'on entre en Russie ; les gens le la douane causent comme s'ils vous connaissaient. Mais j'ai déjà quatre-vingt-six heures de wagon et il m'en reste trente à faire. C'est vertigineux ces distances !
Gavronzy. Dimanche 29 mai 81.
Hier, à la nuit, nous sommes arrivés à Poltava. Je comptais beaucoup sur les joies de l'accueil qu'on nous ferait, un bon souper chaud, etc.
Paul et Alexandre sont venus seuls à notre rencontre et on n'avait même pas retenu de chambre à l'hôtel, croyant que nous irions droit à la campagne. Horrible !
Paul est devenu affreusement gros.
Ce matin sont venus Kapitanenko, Wolkovisky, etc. Un nouveau aussi, Lihopoy, assez bien et comme il faut. Mon père est très heureux, mais un peu confus de voir le triste effet que me fait ce pays après cinq ans d'absence. Je ne cherche pas à dissimuler, et, familiarisée avec mon père, je ne le flatte pas.
Il fait froid, une boue abominable, des juifs... Et tout ça en état de siège, et il court des bruits sinistres : Pauvre pays !
Arrivée à la campagne...
Les champs inondés encore par la rivière, des flaques d'eau partout, de la boue, de la verdure toute fraîche, des lilas en fleurs; mais c’est une vallée, j'ai l'idée qu'elle sera humide. Jolie façon de se soigner ! C'est d'une tristesse mortelle. J'ouvre le piano et improvise quelque chose de funèbre. Coco pousse des hurlements plaintifs. Je me sens triste à pleurer et forme le projet de repartir demain...
On sert un potage qui sent l'oignon ; je quitte la salle à manger. Ça ahurit un peu la princesse et la femme de Paul. La femme de Paul est assez jolie, des cheveux noirs superbes, un beau teint, pas mal faite ; très bonne petite femme.
Je tâche d'être comme tout le monde, mais ça ne va pas ; en déballant les malles ça s'anime un peu. Mais je ne suis pas à ce qu'on dit, et pour cause. Il faut me soigner ! Le moyen par cette humidité ! Ah ! que Julian avait raison !
Maman a apporté tous les journaux qui parlent de moi ; avec mes... désespoirs de là-bas on me fait ici une auréole.
Mercredi 1er juin 81.
Mme Gorpintchenko est arrivée, Michel est reparti.
Il fait beau, les lilas sont en fleurs, le printemps est adorable, mais trop frais pour ma satanée carcasse.
Je n'ai pas emporté de toiles, il n'y en a pas comme je veux.
Samedi 4 juin 81.
Julian écrit que Tony R.-F. a pris une fluxion en sortant de chez sa mère en voiture découverte, et tout de suite il se voit entre la vie et la mort. Il pleure se sachant perdu. Est-ce assez atroce, sans parler du père qui a quatre-vingt-cinq ans et de la mère que le pauvre Tony craignait tant de perdre ?
Dimanche 5 juin 81.
J'ai télégraphié hier à Julian pour avoir des nouvelles de Tony, et suis anxieuse.
Je suis toute la journée dehors et fais des études, le temps est très beau. Je ne peux pas me figurer que cet homme si jeune encore puisse mourir..., et pourtant il était très changé depuis six mois.
Lundi 6 juin 81 (25 mai).
Tony est sauvé. J'en suis ravie ; Rosalie fond en larmes en disant que s'il avait été mort, ça m aurait rendue malade ; c'est un peu exagéré, mais enfin c'est une brave fille. En même temps que la dépêche, arrive une lettre de Julian donnant la bonne nouvelle.
Voici ce que Zola dit de Jules Vallès : ... « Une sensibilité cachée comme un ridicule, une brutalité souvent voulue, et, par-dessus tout, la passion de la vie, du grouillement humain, vous avez toute sa nature... ; avec cela très gai, « blaguant » tout de suite, peut-être de peur d’être blagué, cachant ses larmes sous une ironie féroce. » — Je crois que ça me ressemble. Mais on a l'air si bête quand on s'apprécie comme ça soi-même.
Lundi 13 juin 81 (1er).
J'ai commencé une paysanne grandeur nature, debout, appuyée à une haie tressée avec des branches sèches comme un panier...
On a mis de la paille et des planches par terre pour me préserver de l'humidité, et on a placé là un petit pavillon ambulant composé de deux pièces, de sorte que je suis admirablement. Maman, Paul, Nini, Papa, Michel, Dina et Spérandio restent là une partie de la journée.
Lundi 27 juin 81 (15).
Je travaille depuis... ; c'est aujourd'hui le treizième jour, car les pluies m’ont fait perdre beaucoup de jours. — C'est presque fini, j'ai l’intention de recommencer pour la troisième fois la tête, si j'ai le temps.
Paul et sa femme sont allés visiter un bien de maman, et Monsieur et Madame sont à Poltava. Nous restons quatre : la princesse, Dina, Spérandio et moi. La pluie nous a fait dix fois nous cacher dans le pavillon (une vraie voiture de saltimbanque), et maintenant que nous sommes rentrés à la maison, il fait beau ; je perds une heure. Avant-hier, je voulais crever ma toile ; depuis hier, c'est une rage de travail.
J'ai fait le croquis d'un de mes tableaux pour le Salon. Le sujet m'enchante, ça s'arrange et je brûle d'impatience de le faire.
Mercredi 6 juillet 81 (24 juin).
J'ai fini mon tableau qui est mieux que ce que j'ai fait jusqu'ici, la tête surtout que j'ai refaite entièrement trois fois. Mais n'ayant pas dessiné avec assez de soin, il se trouve que le bras est un peu court et qu'il y a de la gaucherie dans la pose. Or, ces défauts-là ne me sont pas pardonnables, attendu que j'ai ce qu'il faut pour les éviter. J'aurais laissé ça là plusieurs fois, car enfin autant aurait valu faire plusieurs études que d'achever ce bras trop court ; j'avais toujours l'espoir que mon père me l'achèterait, ne m'ayant fait aucun cadeau et moi étant venue ici... ; mais ça n'a pas l'air de prendre.
Il y a foire au village, nous y allons et l'on s'amuse à jeter tous les bonbons qu'on peut trouver à la foule, c'est comme les confetti du carnaval. Ça fait un beau mouvement d'ensemble, toutes les mains se tendent la fois, tout le monde se précipite par terre, c'est comme une vague humaine.
C'est beau, la foule !
Lundi 7 juillet 81.
Nini, sa sœur et Dina sont venus me reconduire jusqu'à ma chambre et nous avons causé de choses sinistres à propos de miroirs cassés. Et les trois bougies, j'en ai eu deux ou trois fois ici. Enfin, est-ce que je vais mourir ? Il y a des moments ou cette idée me donne froid. Mais quand je crois en Dieu j'ai moins peur, quoique... je veuille bien vivre. Ou bien je deviendrai aveugle ; ce serait la même chose, car je me tuerais... Mais qu'est-ce qu'on trouve là-bas ? Qu'importe ? on s'évite quand même des douleurs connues. Ou peut-être deviendrai-je sourde tout à fait ? Je m'acharne à écrire ce mot qui m’écorchait la plume... Mon Dieu, mais je ne puis même pas prier comme les autres fois. — Si c'est la mort d'un proche… de mon père !... Mais si c'est maman ?... je ne me consolerais jamais de lui avoir dit une parole de travers.
Ce qui me nuit sans doute près de Dieu, c’est que je tiens compte des moindres mouvements de mon âme et ne puis m'empêcher de penser que telle pensée peut m'être imputée à mal, et telle autre a bien , or, dès que je reconnais que c'est bien, il n'y a plus là aucun mérite et tout est perdu. Si j'ai quelque élan généreux, ou bon, ou chrétien, je m'en aperçois aussitôt ; par conséquent, j'éprouve malgré moi de la satisfaction en vue de ce que cela doit, selon moi, me rapporter... Et dans ces considérations-là, le mérite s'évanouit. Ainsi, tout à l'heure, j'ai eu l’idée de descendre, de me jeter dans les bras de maman, de m'humilier ; et naturellement la pensée qui suivit celle-ci fut à mon avantage et tout a été perdu. Puis j'ai senti que je n'aurais pas trop de peine d'agir ainsi et que, malgré moi, je le ferais un peu cavalièrement ou à l'enfant ; car une expansion véritable, sérieuse, dramatique entre nous est impossible ; on ne m 'a jamais vue que blagueuse, et ce ne serait pas vraisemblable. On croirait que je joue la comédie.
Samedi 9 juillet 81.
Nous voilà tous partis pour le pèlerinage, et de là à Krementchoug où on se promènera sur le Dnieper ; je joue l'impie ou à peu près et les pousse à cette excursion.
Après mille et mille tiraillements, on se décide. Vous ne vous imaginez pas, c'est tout une affaire ! — Et pourquoi faire ? Et peut-être vaudrait-il mieux ne pas y aller ! Car enfin comment cela se passera-t-il. ? Trouvera-t-on à dormir ou à manger ? Enfin, c'est un village, on emmènera Vassil qui fera la cuisine. — C'est terrible, il y a une montagne près de Gavronzy qu'on ne peut se dispenser de franchir, par conséquent on devrait y être habitué ; eh bien, non, chaque fois, c'est comme si un obstacle nouveau et effrayant venait de surgir. Enfin, après que chacun eut dit à son tour qu'il reste ou que tel ou tel lui a dit qu'il reste, on part en trois voitures : Monsieur et Madame, Dina, la Suissesse Catherine, sœur de Nini, et Spérandio ; Nini, moi, Paul et Micha. Vers le milieu du chemin, Paul et Micha chantent de très bon cœur, ce qui ébahit les paysans sur la route. Nous trouvons les trois frères Babanine réunis à l'hôtel, Alexandre, Étienne, Wladimir, buvant du Champagne.
Alexandre parle de cœur, de parenté, de souvenirs de jeunesse ; bref, il est ouvert comme une porte cochère, quand elle est ouverte... Enfin, je devine, immédiatement qu'il y a quelque chose. En effet, il vient d’acheter à Étienne sa part d'héritage ; Étienne y a donc passé comme les autres. Il ne reste plus que Nicolas, mais il y passera. malgré tous ses cris, et alors Alexandre aura toutes les terres de son père. C'est une force que cet homme, il marche à son but et y arrivera ; c'est une force. Je m'incline et je le respecte presque. Il est brouillé avec Paul et il le mangera ; aussi vais-je les raccommoder.
N'ayant aucune affaire, nos relations sont toutes courtoises et je lui ai donné le bras ce soir au jardin de la ville. Mais il paraît que nous avons fait la journée la plus chic et la plus tapageuse qu'un puisse rêver à Poltava et qu'on en parlera. Je vais donc vous la raconter.
On dîne au susdit jardin : une table de quinze couverts occupant tout le côté droit de la terrasse et où on ne nous laisse pas ennuyer par le public, qui se presse à une distance aussi peu respectueuse qu'il peut, pour nous voir manger et pour écouter l'orchestre qui joue pour nous, et le chœur de femmes que nous avons fait venir. — Des chansons bohémiennes mal chantées par des Russes et des Suédoises. J'aurais voulu sonner le tocsin, car le monde n'arrivait pas assez vite. Ça c’est rempli vers huit heures.
Lundi 11 juillet 81.
C'est la Saint-Paul. On a fait venir à Gavronzy la musique militaire qui joue pendant le dîner, et le soir sur le balcon. En transportant soldats et instruments, un des postillons a eu la jambe cassée et on lui a immédiatement donné la différence du jeu de la journée : cela s'élevait à cinquante roubles. L'idée est de moi. Peu de monde : Lihopay, Etienne et le propriétaire de l'hôtel où nous descendions à Poltava. Les messieurs jouent aux cartes avec lui et l'admettent dans leur société. Il a épousé une demoiselle noble. Mais la société de cet aubergiste !... Enfin. — Puis la famille, nous sommes quatorze. Je m'habille à ravir. Dina est aussi très charmante ; pendant un temps je cause et ris avec Lihopay et Micha, comme si cela m'amusait. D'autres écoutaient ce que nous disions d'amusant. On danse ; papa avec maman, ayant pour vis-à-vis Paul et sa femme, moi et Micha en face de la Suissesse avec Étienne, Spérandio et Catherine. La salle est vaste et, la musique aidant, Ies pieds prennent de la gaieté. Dina danse toute seule comme une folle toute espèce de pas de fantaisie, vraiment avec beaucoup de grâce. Moi aussi, avec mon chagrin atroce (les oreilles) qui me fait des cheveu blancs, j'ai dansé un instant, sans gaieté, seulement c'était sans prétention.
Mercredi 13 juillet 81.
Toujours triste, peut-être de partir ; nous arrivons à Poltava vers sept heures Je fais le trajet avec Dina et nous causons un peu de tout ce séjour en bloc... Quelque incroyable que cela puisse paraître, il n'y a ici ni délicatesse, ni morale, ni pudeur dans leur sens véritable.
Dans les petites villes de France on craint un confesseur, on a une grand'mère, une vieille tante qu'on respecte fort... Ici, rien.
On se marie souvent par amour, et très facilement on s'enlève et tout cela à froid.
Je crois que nous partons demain.
Je m'arrêterai à Kief pour faire dire des messes ; les plus noirs pressentiments me tourmentent et j'ai tellement peur de tous ces présages ! A la fête de Paul, j'ai trouvé un cierge sur mon couvert, oublié là, parait-il par l'homme qui allumait les lustres. Et toutes ces glaces cassées ? Aussi, je me demande s'il ne va pas arriver quelque vilenie.
Vendredi 15 juillet 81.
Nous sommes à Karkoff, sur la plate-forme nous trouvons Micha et Lihopay ; ils sont partis avant nous de Poltava.
Je tousse et étouffe. Je reviens de me mirer, croyant trouver les apparences du mal; mais non, rien encore. Je suis mince, mais très loin de la maigreur, et puis les épaules nues ont un air d'épanouissement qui ne va pas avec la toux et les bruits que j'entends dans mon gosier, ni avec ceux que je n'entends plus si bien par les oreilles... C'est que je suis enrhumée, voila ce qui fait que je tousse plus fort... Enfin !... Nous sommes entrées avec maman dans un couvent et maman s'est agenouillée avec ferveur devant l'image peinte de la vierge. Comment prier devant une image ? J'en avais la ferme intention et je n'ai pas pu. Mais quand je suis chez moi, quand ça vient, eh bien, après, je me sens mieux, je vous jure, et je crois que Dieu peut me guérir ; mais lui seul. Seulement il faudrait pour cela me pardonner tant de petites choses !
Samedi 16 juillet 81.
Ce matin est arrivé le gros Pacha, mon ancien amoureux ; les uns veulent que nous restions un jour, les autres que tout le monde aille jusqu'à Soumy, où nous sommer à l'heure qu'il est. Pacha a engraissé ; mais c’est toujours le même être farouche et pas effrayant du tout. Un rêveur prosaïque, des dehors abrutis, et tout cela à froid et très bourgeoisement. On se voit à la gare seulement, où nous trouvons Alexandre arrivant de Poltava, qui a promis d'aller à Soumy pour les affaires. Enfin nous y sommes : papa, maman, Dina, Alexandre et moi. Les autres sont restés là-bas ; on s'est quitté, cela va sans dire, avec des regrets, des souhaits, des baisers.
Jeudi 21 Juillet 81.
Nous voici à Kieff, la ville sainte, « la mère de toutes les villes russes, » d’après saint-Wladimir qui, s'étant fait baptiser, a ensuite baptisé de gré ou de force son peuple, en le faisant entrer dans le Dnieper ; on a dû en noyer, je pense. Mais les imbéciles pleuraient leurs idoles qu'on noyait en même temps qu'on baptisait les hommes. On est encore si ignorant de la Russie, où tant de beautés et tant richesses demeurent inconnues, que je vous apprendrai peut-être une nouvelle en disant que le Dnieper est une des belles rivières du monde, et que ses bords sont adorablement pittoresques. Kieff est bâti en désordre, pêle-mêle, n'importe comment ; il y a la ville basse et la ville haute, des rues escarpées. Ce n'est pas confortable, car les distances sont énormes, mais c'est intéressant. Il ne reste rien de l'ancienne ville ; du reste notre civilisation d'alors se contentait de temples chétifs bâtis sans art et sans solidité, ce qui fait que nous ne possédons pas ou peu de monuments. Si j'étais portée à l'exagération, je dirais qu'il y a autant d'églises que de maisons. Les cathédrales et les couvents sont en nombre considérable ; en effet, il y en a jusqu’à trois, quatre à la file. Tout cela avec beaucoup de coupoles dorées ; les murs et les colonnes blanchis à la chaux ou peints en blanc, avec des corniches et de toits verts. Souvent aussi toute la façade est peinte des scènes de la vie des saints, des images, mais d'une naïveté complète.
Nous allons d'abord à la Lavra, couvent où les pèlerins viennent par milliers tous les jours, de toutes les parties de la Russie.
L'iconostase, ou cloison qui sépare l'autel de l'église, est couvert d'images peintes et recouvertes d'argent. Les châsses et les portes, entièrement plaquées d'argent doivent représenter des sommes assez rondes, avec les cercueils des saints aussi recouverts d'argent travaillé, et les chandeliers et les lustres, et tout le reste, tout en argent. On assure que ces moines ont des sacs pleins de pierreries.
Du reste, il est connu qu'ils sont riches comme les Rothschild.
Pierre le Grand et Nicolas leur ont emprunté dix millions de roubles qu'ils n'ont jamais rendus ; et c’est bien fait. Encore vos moines à vous donnent aux pauvres ; ceux d'ici, jamais rien à personne. Et on ne s’imagine pas ce que les pèlerins apportent d'argent, en supposant que chaque pèlerin ne donne qu'un sou par jour. Et les messes que l'on fait dire et les cierges ! Il s'en consomme des quantités prodigieuses. Et les images et les médailles bénites qu'on vend ! La grande curiosité ce sont les catacombes, des souterrains très droits et très bas, humides, noirs naturellement. Chacun s'y rend muni d'un cierge allumé. On est conduit par un moine qui vous fait rapidement voir les cercueils ouverts contenant les corps des saints, les corps sont corrompus, desséchés, et c'est là le miracle, dit-on. Maman a prié avec une ferveur sans égale; je suis bien sûre que Dina et papa ont tous prié pour moi. Mais le miracle ne s'est pas fait. Vous riez ? Eh bien, j’y comptais presque, moi. Je n'attache pas d'importance aux églises, aux reliques, aux messes ; non, mais je comptais sur les prières, sur ma prière. Mais j'y compte encore aujourd'hui ; je ne suis pas entendue, je le serai peut-être un jour. Je ne crois qu'en Dieu, mais Dieu est-il le Dieu qui écoute et s'occupe de ces choses-là ? Dieu ne me guérira pas du coup, dans une église ; non, je n'ai rien mérité de pareil, mais il me prendra en pitié et inspirera un docteur qui me fera du bien... et enfin avec le temps... Seulement, je ne cesserai de le prier.
Maman, elle, croit aux images bénites, aux reliques... afin elle a une religion païenne..., comme la plupart des gens pieux et... pas très supérieurs...
Peut-être que le miracle se serait fait si je croyais au pouvoir des images et des reliques ? Mais là, vraiment, tout en m'agenouillant et priant, ça n'allait pas. Je comprends bien mieux qu'on s'agenouille n'importe où et qu'on prie Dieu tout simplement. Dieu est partout... Mais comment croire ?... Il me semble même que ce fétichisme diminue Dieu et lui fait tort. Et pour bien des personnes, pour la majorité des pèlerins, Dieu s'efface tout à fait ; il n'y a qu'un morceau de chair desséchée qui a le pouvoir de faire un miracle, ou une image de bois qu'on peut invoquer et qui vous entend. Ai-je tort ? Ont-ils raison ? C'est le plus éclairé qui doit être dans le vrai... Au moins, mon Dieu à moi doit être ennemi de... toutes ces messes qu'on dit nécessaires à la vraie foi…
Paris. Mardi 26 juillet 81.
J'y suis enfin ! C'est vie la ici. Entre autres courses, j'ai passé à l'atelier. On me reçoit avec des acclamations et des baisers. Comme je tiens beaucoup à la boîte, et surtout à l'amitié et à l'aide de Julian, j'avais peur qu'il ne me fît mauvais visage, ayant cassé une glace, etc. Eh bien ! Non ce n'est pas encore de ce côté que vient l'ennui. Tout se porte bien.
Mercredi 27 juillet 81.
J'ai porté à Julian un projet de tableau dont il n'est, pas fou ; du reste, il ne fait que me parler de ma santé, pendant deux heures, sans ménagement aucun. Il paraît que c'est grave ; il faut bien croire, puisque deux mois de traitement n'ont amené aucune amélioration. Je le sais moi-même que c'est grave, que je vais mal, que je m'étiole ! tout en ne croyant pas de si horribles choses. Breslau a eu sa mention. Elle a des commandes. Mme..., qui la protège beaucoup et chez laquelle elle a connu les principaux artistes, lui a commandé son portrait pour le Salon prochain. Elle a déjà vendu trois ou quatre choses ; enfin, la voilà lancée. Et moi ? Et moi je suis poitrinaire. Julian tâche de m'épouvanter pour me forcer à me soigner. Je me soignerais si j'avais confiance. C'est lugubre, à mon âge ! Il a bien raison, Julian ; d'ici un an, je verrai comme je suis changée, c'est-à-dire qu'il n'en restera plus rien. J'ai été voir Collignon aujourd'hui. Elle va mourir bientôt ; en voilà une qui est changée ! Rosalie m'avait prévenue, mais j'en suis restée saisie : la mort elle-même.
Et puis, dans la chambre, une odeur de bouillon très fort que l'on donne aux malades. C'est horrible !
J'ai cette odeur encore dans les narines. La pauvre Collignon, je lui ai porté de la soie blanche et molle pour une robe et un fichu, qui me plaisait tant, que j’ai hésité cinq mois et me suis décidée à cet immense sacrifice par la mauvaise pensée que cela sera remboursé par le ciel. Ces calculs enlèvent tout mérite. Me voyez-vous faible, décharnée, pâle, mourante, morte ?
N’est-ce pas une chose atroce que... cela se passe ainsi ? Mais, au moins, en mourant jeune comme cela, j’inspire de la pitié à tout le monde. Je suis moi-même attendrie en pensant à ma fin. Non, cela ne paraît pas possible. Nice, quinze ans, les trois Grâces, Rome, les folies de Naples, la peinture, l'ambition, des espérances inouïes et pour finir dans un cercueil, sans avoir rien eu pas même l'amour !
Je l'avais bien dit; on ne peut pas vivre quand on est comme moi et que les circonstances sont comme... celles qui ont formé ma vie. Vivre ce serait trop avoir.
Pourtant on voit des fortunes plus folles et plus fabuleuses que celle que j'ai rêvée.
Ah ! quelque chagrin que l'on éprouve, il renferme une jouissance. J'avais bien raison ; il n'y a d'atroce que les douleurs d'amour-propre, celles-là ne renferment rien et sont pires que la mort. Mais tout le reste ? Ah ! Dieu, mort, désespoir d’amour, absences ! C'est la vie quand même. Me voilà sur le point de pleurer, je crois même que je vais mourir, je suis presque sûre que je suis affaiblie. Ah ! je ne me plains pas de cela, mais de mes oreilles ! Et puis, Breslau à présent ; mais Breslau, c'est un accablement de plus. Partout repoussée avec perte, battue.
Eh bien, la mort alors !
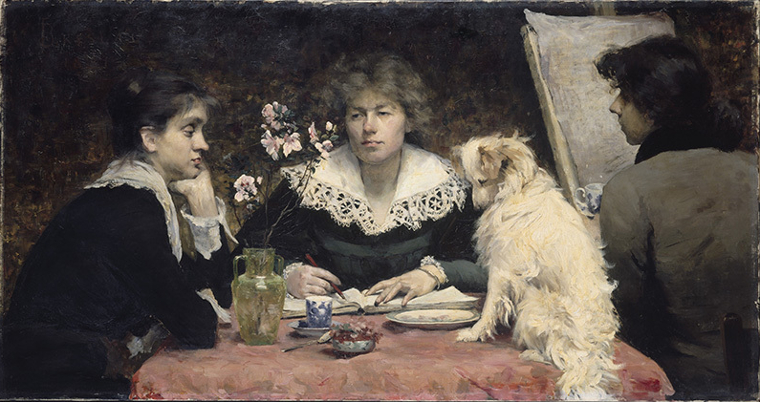
Maria Feller à gauche, Sophie Shäppi au centre et Louise à droite.
Musée d'Art et d'Histoire de Genève.
Mardi 9 août 81.
J'ai été chez le docteur ce matin, voilà la troisième fois depuis quinze jours. Il me fait revenir pour avoir un louis chaque fois, car le traitement est toujours le même à suivre.
Vraiment, c'est à en devenir folle. Sur mille cas, m'a t-on dit, la surdité arrive une fois, et c'est justement moi ! Tous les jours on voit des malades de la gorge, des poitrinaires qui souffrent, qui meurent, mais qui ne deviennent pas sourds. Ah ! c'est un malheur si inattendu, si horrible ! Quoi ! ce n'était pas assez de tout ! que je perde la voix, que je sois malade, il fallait encore ce supplice sans nom ! Ça doit être pour me punir d'avoir crié pour des niaiseries. C'est Dieu qui punit ? Le Dieu du pardon, de la bonté, de la miséricorde ? Mais le plus méchant des hommes ne serait pas plus inexorable !
Et je suis torturée à tous les instants. Rougir devant les miens, sentir leur complaisance à parler plus fort ! Dans les magasins, trembler à chaque minute ; là, ça se passe encore ; mais avec les amis, toutes les ruses que j’emploie pour cacher mon infirmité, non, non, non, c’est trop cruel, c'est trop affreux, c'est trop épouvantable ! La peinture et les modèles ! Je n'entends pas toujours ce qu'ils me disent et je tremble qu'ils parlent ; est-ce que vous croyez que le travail ne s'en ressent pas ? Quand Rosalie est là, elle m'aide ; seule, je suis saisie de vertige et ma langue se refuse à dire : « Parlez un plus fort, je n'entends pas très bien ! » Mon Dieu, ayez pitié de moi ! Et si je ne crois pas en Dieu, c'est mourir à l'instant de désespoir. Le poumon est venu à la suite de la gorge, et la gorge a causé ce qui arrive aux oreilles. Maintenant, soignez ça ! Mais je me suis toujours soignée. C'est le docteur Krishaber qui a fait le mal, c'est à la suite de son traitement que j'ai...
Mon Dieu, faut-il donc être si atrocement séparée du reste de la terre ? Et c'est moi, moi, moi ! Ah ! il y en a à qui ça ne serait pas si douloureux, mais...
0 quelle horrible chose !
Mercredi 10 août 81. — Jeudi 11 août.
Tous les jours je vais à Passy, mais sitôt que je suis installée je prends en horreur ce que je commence. D'abord Fortunata que j'ai renvoyée en lui payant six séances pour rien ; mais c'est le tableau duquel j'étais folle. Julian avait dit qu'il fallait modifier, améliorer la composition et cela m’a suffi pour que je ne sache plus quoi faire. D'abord, malgré tout, je l'ai commencé, mais après avoir commencé, j'en ai eu dégoût et peur. La vérité est qu'il ne me reste que vingt jours, et s'il pleut ?
Mon tableau, c'est une affiche électorale devant laquelle il y a un garçon épicier avec son panier, un ouvrier qui rit à un monsieur avec serviette sous le bras ; un gommeux à l'air très bête et un vaste chapeau bonapartiste dont on ne voit que... le chapeau. Dans le fond, une petite femme. C'est grand comme nature à mi-corps. Bref, ça et le reste me rend folle ; j'ai la main qui tremble pour écrire. A peine ai-je une idée que je l'ai en dégoût. Il n'y avait que ce tableau et j'ai perdu tant de jours, et me voilà encore indécise. Diable de caractère ! quand je suis libre de faire ce que je veux je ne sais plus que faire. C'est ma maladie qui me rend idiote, et la mention honorable de Breslau me coupe les bras. Le ciel est juste. Je me demande... C'est que ce tableau, Julian et les autres disent que ce n'est ni neuf, ni original ; d'accord, du reste, je n'en sais rien.
C'est actuel toujours, et puis, si c'est bien exécuté, ce sera toujours bien. Et il faut encore que je sache si Alexis sera ici dans le courant d'août ; il pose le gommeux et sans lui pas de tableau, et je n'ai pas encore trouvé le vieux monsieur à la serviette. Tout ça ne serait rien, si j'étais décidée et en train. Et je perds mon temps et j'use mes yeux à lire pour me calmer.
Enfin, plus moyen de porter mes hésitations à qui que ce soit, Tony en Suisse, Julian à Marseille. Et moi au diable ! Sitôt que je décide quoi que ce soit, une voix me dit..... Enfin, quoi que je fasse, je ferai toujours à mon désavantage. Si je renonce au tableau, quelqu’autre le fera et j'en aurai un dépit mortel ; si je fais, je le ferai en m'y prenant mal, il pleuvra et j'ai déjà vingt jours. Tout ce que je pourrai faire sera certainement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire donc, il faudrait n'avoir plus souci de rien. Aussi, vous me voyez. Ah ! qu'il est affreux d'en être là !
J'ai des cheveux blancs ; un jour j'en ai trouvé près de deux sur le devant, c'est depuis qu'il me semble que je deviens sourde... Est-ce assez horrible !
Oh maintenant... au moins ça coupe court à mes récriminations ; je n'ai rien, d'accord ; mais aussi je ne suis plus bonne à rien. Vie de salon, politique, plaisirs de l'esprit, tout cela à travers un brouillard, et si je m'y risque, je risque aussi de me couvrir de ridicule ou de passer pour sotte ou médiocre. Tout ce que je dois affecter de brusqueries, de singularités, d'absences, pour cacher à l'unique Saint-Amand que je n'entends pas bien ! C'est à décourager quarante chevaux. Comme il est possible d'avouer qu'on est sourde, quand on est jeune, élégante et qu'on prétend à tout ! Comme il est possible de solliciter l'indulgence, la pitié, dans ces conditions-là ! Du reste, à quoi bon tout ? La tête se fend, on ne sait plus où l'on en est ! Oh ! non, il n'y a pas de Dieu tel que je l'avais imaginé. Il y a un Être suprême, il y a la Nature, il y a, il y a..., mais il n'y a pas le Dieu que j'ai l'habitude de prier tous les jours.- Qu'il ne m'accorde rien, passe, mais m'assassiner de la sorte ! Mais me rendre plus malheureuse, plus dépendante de tous, que le premier mendiant venu ! Et qu'ai je fait ? Je ne suis pas une sainte, je ne passe pas ma vie à l'église, ne fais pas maigre ; mais vous savez ma vie, sauf-des irrévérences constantes envers ma famille qui ne le mérite pas, je n'ai rien à me reprocher. A quoi sert prier tous les soirs et demander pardon d’être forcée par les circonstances à dire des.duretés aux miens ? Car si j'ai tort vis-à-vis de maman, vous savez bien que c'est pour la forcer à agir.
Enfin, me voilà horriblement frappée, et frappée avec la cruauté la plus raffinée.
Enfin Dieu, non, le Dieu que je croyais connaître n'existe pas, ça n'est pas possible ! Mais alors ? Oh ! non, il nous faut un Dieu, pour reporter ,à quelqu un le bien et le mal.
Vendredi 12 août 81.
Vous croyez peut être que j'ai décidé quelque chose ! Je ne puis rien faire ! J'ai la certitude affreuse de mon incapacité ! Voilà plus d'un mois, en comptant le temps perdu en voyage, que je ne fais rien ! Je ne puis même m'imaginer que je travaille ; je suis horrifiée d'avance des choses sans talent, sèches et froides que je vais produire. C'est odieux; je ne puis rien faire !
Et tout s'en mêle. Je renonce au tableau et me décide à peindre Olstnitz, mais elle part dans deux jours. Alors je vais chercher un modèle que je ne trouve pas. Puis je cours chez Julia ; elle ne peut poser qu'à partir de lundi. Je me retourne vers la petite du concierge, mais elle a encore trois jours de classe. Enfin !…
Alors je m'en vais voir Amanda, qui travaille dans la cour de sa maison, à Issy ! Ça me fait du bien, encore qu'elle ne soit pas assez artiste pour que je sois vraiment remontée, c est égal, ça vivifie... Je rentre résolue à faire ce sacré tableau.
Samedi 13 août 81.
Eh bien, j'y travaille deux heures, pas même, et puis va te promener ! Qui sait ? Ça aurait peut-être été très bien. Alors je me décide et aussitôt de me dire : C'est prétentieux et ça ne dit rien. En effet, je n'aime pas mes modèles. Et puis je vois la toile exposée sur le boulevard, juste après les élections. Et puis c'est un sujet si peu féminin. Enfin, qui sait ? en m'appliquant peut-être ? Voilà le peut-être qui me rend folle. L'opinion de Julian, mais Julian s'est trompé pour Zilhardt cette année ; il avait prédit du bien et il en est résulté une horreur.
Je vais m'en remettre au sort, mais si le sort ne dit pas comme moi... et comment dis-je ?
C'est une maladie, ma parole. J'ai absolument besoin d’Alexis pour le tableau et je ne sais pas quand il reviendra, et je n'ai plus que dix-huit jours !
Alors tu es folle. — Mais non, j'ai le temps !
Oui, le sort... eh bien ! j'ouvre ce cahier au hasard, je pose le doigt au hasard et si sur la ligne où se posera mon doigt le nombre des lettres est pair, je renonce au tableau...
Bon, c'est pair. — Mais... vous n'ignorez pas que j'ai le poumon droit malade, eh bien ! vous aurez, je n'en doute pas, du plaisir à apprendre que le gauche est également attaqué. Aucun de ces idiots de docteurs ne me l'a encore dit, du reste ; je l'ai senti pour la première fois dans les catacombes à reliques de Kiew, mais j'ai pensé que c'était une -douleur momentanée, causée par l'humidité ; depuis, cela revient tous les soirs, et ce soir, si fort, que j'ai mal à respirer et que ça fait une vraie douleur entre la clavicule et le sein, là où les docteurs frappent leurs petits coups.
Et le tableau ?
Dimanche 14 août 81.
J'ai eu de la peine à m'endormir et ce matin ça me fait toujours mal, mais encore dans dos ; et chaque fois que je respire, c'est le diable, et chaque fois que je tousse, c'est deux diables. Ah ! me voilà bien ; oui, me voilà très bien !
A présent, je renonce au tableau, c'est dit. Mais que de temps perdu !
Plus d'un mois.
Quant à Breslau, encouragée par sa mention, tout doit aller bien ; moi, j'ai les bras coupés et n'ai plus confiance.
Jeudi 18 août 81.
Aujourd'hui... ne lisez pas si vous aimez les choses gaies, j'ai passé la journée à travailler et, tout en travaillant, à m'adresser in petto les plus cruelles vérités.
J'ai visité mes cartons où l'on peut suivre pas à pas mes progrès. De temps en temps, je me disais bien que Breslau peignait avant que je ne dessine... mais vous me direz que cette fille est donc le monde entier pour moi ? Je ne sais, mais ce n'est pas un petit sentiment qui me fait craindre cette rivalité.
Dès les premiers jours, et quoique les hommes et les camarades eussent dit, j'ai deviné son talent ; vous voyez que j'ai raison. La seule pensée de cette fille me trouble ; un trait d'elle sur un de mes dessins m'a donné un coup au cœur ; c'est que je sens une force devant laquelle je me brise. Elle se comparait toujours à moi. Figurez-vous que les nullités de l'atelier ont toujours dit qu'elle ne peindrait jamais ; — « elle n'a pas la couleur, sa peinture ne se tient pas, elle n'a que le dessin. » — Justement ce qu'on dit de moi... Ce devrait être une consolation, c'est la seule que j'aie, en effet !
En 1876 (février) elle avait déjà la médaille pour le dessin. Elle avait commencé au mois de juin 1875 ayant déjà travaillé pendant deux ans en Suisse. Pendant deux ans, je l'ai vue se débattre contre les plus éclatants insuccès en peinture ; puis c'est venu peu à peu et en 1879 elle a exposé, d'après le conseil de Tony. Il y avait six mois que je peignais à cette époque. Il y aura trois ans que je peins, dans un mois.
Maintenant, la question est de savoir si je suis capable de faire quelque chose comme son exposition de 1879 ? Julian dit que celle de 1879 valait mieux que celle de 1881 ; seulement, comme ils étaient en guerre il n'a pas poussé au succès, tout en demeurant neutre. Son envoi de l'année passée a été placé, comme le mien dans la morgue, id est galerie extérieure.
Maintenant, cette année, elle se raccommode avec Julian et, patronnée en outre par la nouvelle école, est placée sur la cimaise. Suit la récompense.
*
* *
En sortant de l'atelier, ma tante et moi allons nous promener en fiacre sur les rives de la Seine, du côté du Trocadéro, les avenues de Tourville... Quel ravissant quartier qu'on ne connaît pas assez ! Je me sens fatiguée comme Breslau, avant ; je me crois presque ratatinée, comme elle, et j'admire le ciel et les finesses des tons du lointain, ce qu'elle faisait. Mais je hurle, pas par singerie, cela vient tout seul et je me flatte que cela m'apportera un peu de bonne peinture. Breslau est ma préoccupation constante, et je ne donne pas une touche sans me demander comment elle ferait et comment elle s'y prendrait. C'est que le sujet n est rien, rien ! Rien ! La qualité de la peinture est tout..., à moins qu'il ne s'agisse de compositions historiques. Mais à heure actuelle ! Et ils ont bien raison : une tête, une main et c'est assez si la peinture est bonne ; ce que je fais est sec ! est froid ! est dur !... Je ferai de la sculpture, ai-je dit un jour. — D'un modelé un peu sec, a ajouté Julian. — Cela donne froid.
Mais en sculpture, c'est impossible ; on modèle comme ce que l'on voit, il n'y a pas de tricherie, pas de couleur, pas d'optique...
Et mais, pourquoi ces gens-là, Tony par exemple, pourquoi insistent-ils pour que je continue ? Tony n'a aucun profit, Julian non plus, du reste, car le moment est venu où je travaillerai plus chez moi que chez lui.
Avec ma peinture, je n'ai rien dit du départ d'Oelstnitz ; voilà déjà longtemps qu'elle veut s'en aller, on l'a toujours retenue. Mais la pauvre enfant est à bout de forces, elle s'ennuie à mourir. — Pensez-donc, moi je dis bonjour et bonsoir, et tous les soirs je me reproche de ne pas causer davantage, et tous les jours cela recommence.
J'ai eu cent cinquante élans généreux pour me rapprocher d'elle, mais ça en est resté là et je trouve mon excuse dans les tristesses qui m'accablent.
Enfin elle est partie, la pauvre petite ; une nature vraiment angélique, et ce départ m'a serré le cœur bien fort, mais elle sera plus heureuse là-bas ; ce qui surtout me chagrine, c'est que je ne puis plus réparer ma froideur, mon indifférence ; je la traitais comme maman, ma tante, Dina ; mais les miens, ça leur est moins pénible, tandis que cette enfant étrangère, seule, si douce, si calme ! Elle est partie hier, à neuf heures. Je ne pouvais pas parler pour ne pas pleurer, et j'ai affecté un air détaché; mais j'espère qu'elle aura vu.

Samedi 20 août 81.
Je me suis présentée seule chez Falguière le sculpteur ; je lui ai dit que je suis Américaine et lui ai montré des dessins, en lui faisant connaître mon désir de travailler. Il y en a un qu'il a trouvé très bien, très bien ; tous les autres bons. Il m'a envoyée à un atelier où il donne des conseils, et du reste, si je ne m'en arrangeais pas, il s'est mis à ma disposition, soit pour que j'aille lui porter ce que j’aurais fait ou qu'il vienne chez moi. Ça, c'est gentil, mais pour ça j'ai Saint-Marceaux que j'adore, et je me contenterai de l'atelier.
Biarritz. Vendredi 16 septembre 81.
Ayant fait nos adieux, nous sommes parties jeudi matin. Il fallait passer la nuit à Bayonne ; nous avons préféré Bordeaux où Sarah donnait une représentation. Nous avons donc eu deux stalles de balcon pour cinquante francs et j’ai vu la Dame aux Camélias. Malheureusement, j'étais très fatiguée ; on a tant parlé de cette femme que je ne me rends pas bien compte de mes impressions. Il semblait d'avance qu'elle n'allait rien faire comme personne et alors on est un peu surpris de la voir marcher, parler, s'asseoir. Je ne l'ai vue que quatre fois : une fois quand j'étais petite dans le Sphinx ; puis, ces derniers temps, dans le Sphinx encore et l'Étrangère. Je prête une attention extraordinaire à ses moindres mouvements. Enfin, je ne sais, je crois qu'elle est ravissante.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que Biarritz est joli, joli…
La mer a été d'un ton enchanteur toute la journée.
Des gris si fins !…
Samedi 17 septembre 81.
Jusqu'à présent, point de ces élégances suprêmes que je rêvais de voir à Biarritz. Quant à la plage, au point de vue artistique, c’est désagréable et laid.
0 baie de Nice ! 0 golfe de Naples ! mais même les petites plages autour de Nice, Eses, Beaulieu, etc. Ici, on est tracassé par un tas de petits rochers jetés là pêle-mêle, ça a l'air de décors de carton posés là exprès. La plage est petite : à droite, le phare ; à gauche, un rocher ; et, au delà de deux remparts, d'énormes plages désertes.
Le site est tourmenté sans être pittoresque ; il n'y a pas une maison vraiment au bord de la mer ; on doit grimper et regrimper et descendre tout le temps. Et puis j'ai exploré les environs pendant deux heures, en voiture, et je n'ai pas trouvé l'ombre d'un motif, pas un pêcheur, pas une barque, des sapins, des villas, des grands chemins. Il vaut mieux s'en aller en Espagne ; je verrai les musées, ferai quelques copies, et peut être trouverai-je un tableau à faire, dans tous les cas des études. Oui, passer un mois ou six semaines presque sans bagages, inconnue, tranquille.
Dimanche 18 septembre 81.
J'ai de petites robes de batiste ou de laine blanche sans garniture, mais faites à ravir, très fraîches et très pimpantes. Des souliers de toile achetés ici, mais jolis, et des chapeaux blancs, jeunes, des chapeaux de femme heureuse. Cela forme un ensemble très remarqué.
Et dans l'état d'esprit où je me trouve, c'est tout bonnement désespérant. Maman et ma tante ne sont ni en train, ni gaies. Enfin, c'est tout le contraire d'un voyage d'agrément sur une plage élégante.
Je ne puis pourtant pas me résigner à rester enfermée à Paris, car je n'irai jamais que dans le vrai grand monde. Et le silence et la solitude de l'atelier, c'est encore ce qu'il y a de plus heureux.
Mardi 27 septembre 81.
Hier à Bayonne, en famille et aujourd'hui à Fontarabie et la famille aussi ; je ne sorts jamais sans. Je voulais y aller à cheval, mais le corsage de l'amazone va si mal, et puis ce serait agaçant de faire route avec un Russe que je ne connais pas beaucoup et qui est ennuyeux.
Fontarabie, c'est charmant. Du reste, Biarritz est si commun, si maladroit dans sa beauté très banale, que l'on est heureux d'en sortir. Et tout de suite là, sur le petit port, des enfants mendiants dont on ferait facilement un tableau ; seulement, je veux voir l'Espagne d'abord, et si là je ne rencontre pas mieux, je reviendrai par Fontarabie.
J'ai joué, il y a une roulette ; mais ayant perdu quarante francs, je fis des croquis. C'est un petit coin perdu ; j’espère que personne ne m'a vue jouant. Oh ! ces heures de voiture à écouter Mme R. ! Cette dame racontait des inepties qui n'avaient même pas le charme des bavardages du monde. Ah ! qu'ai-je fait au ciel pour être comme ça ?
Pourquoi ne puis-je manger la mauvaise cuisine de l’hotel, que mangent des princesses du sang pourtant ? Pourquoi ne puis-je supporter la misère intellectuelle qui m'entoure ? car je n'ai sans doute que ce que je méite, et puis, en somme, si j'étais vraiment si supérieure je saurais bien... Ah ! funèbre banalité !
O rêves de mon enfance ! ô espérance divine ! Ah ! s'il y a un Dieu, il m'abandonne. Je ne suis tranquille qu'à Paris ; en voyage, on se voit tout le temps, et ma famille m’agace. Ce n'est pas que mes mères soient communes ou qu'elles se tiennent mal ; quand il n'y a pas d'étrangers, elles sont mème très bien, et puis elles sont mes mères. Mais, dès qu'il y a des étrangers, maman pose, devient affectée dans sa prononciation, d'une façon qui a le don de m'exaspérer.
C'est un peu ma faute. Je leur reprochais toujours de ne pas avoir su se créer de relations dans le grand monde et je leur dis quelquefois des choses désagréables pour les pousser à faire quelque chose. Mais ça ne peut que leur donner cette attitude piteuse. Je me plains toujours des miens, mais je les aime ; je suis juste.
Madrid. Dimanche 2 octobre 81.
On croit avoir rêvé sortant de cette infamie sanglante. Combat de taureaux ! Abominable tuerie de rosses et de vaches, où les hommes n'ont l'air de courir aucun danger et où ils jouent un rôle ignoble. Du- reste, les seuls instants intéressants, pour moi, c'était de voir les hommes rouler par terre ; un d'eux a été foulé par le taureau ; un vrai miracle qu'il ait échappé. Aussi lui fit-on une ovation.
On lance des cigares, — des chapeaux qu'on renvoie très adroitement. Et les mouchoirs s'agitent et l’on pousse des hurlements sauvages.
C'est un jeu cruel, mais est-il amusant ? Voilà ! Eh bien, non ! ce n'est ni passionnant, ni intéressant, c'est horrible et ignoble. Cette bête soi-disant furieuse, qu'on agace avec des manteaux multicolores et à laquelle on plante des espèces d'épées dans le corps. Le sang coule ; plus l'animal se secoue, plus il bondit, plus il se blesse. On lui présente de pauvres chevaux aux yeux bandés, qu'il éventre. Les intestins sortent, le cheval se relève néanmoins et obéit jusqu'à la dernière extrémité à l'homme qui tombe souvent avec lui, mais n'a presque jamais rien.
Ce sang noir sur le sable et ce sang écarlate sur dos des taureaux. Il y en avait surtout un noir, lorsque nous sommes arrivées, sur lequel c'était comme des bandelettes écarlates ; je le crus d'abord orné de rubans, car ces piques plantées dans la peau ruisselaient. Et quand les chevaux sont morts, le combat continue ; une douzaine de crétins espagnols agacent et criblent de piqûres le taureau,-qui bondit et les poursuit ; mais c'est toujours le manteau qu’il rencontre. Et quand, blessé, sanglant, poussant des gémissements de détresse, il s'arrête et détourne tête, on lui présente encore ce manteau rouge et lui donne des coups de pied. Alors le public trépigne, la pauvre bête tombe à genoux et se couche pour mourir dans la pose inoffensive de la vache qui se repose dans un pré. On la tue d'un coup sur la nuque. La musique joue et trois chevaux enrubannés, attelés à une sorte de crochet auquel on attache le cadavre, viennent enlever au galop le taureau mort. Et puis ça recommence encore. Trois hommes à cheval, encore des chevaux éventrés, et puis les ridicules et sanglantes agaceries des toréadors.
Et quand on a tué une quinzaine de chevaux et cinq ou six taureaux, le public élégant s'en va faire un tour au Buen Retiro qui est une des plus belles promenades du monde, que je préfère au Bois, sans parler de Londres, de Vienne et de Rome. Mais non, Rome à un charme tel que rien ne saurait lui être comparé.
Le roi, la reine, les infantes assistaient au combat. Plus de 14,000 spectateurs. Et c'est comme ça tous les dimanches. Et il faut voir la tête de tous ces sinistres nigauds, pour croire qu'on peut se passionner pour de telles horreurs. Si encore c'étaient de véritables horreurs ! mais ces rosses inoffensives, et ces taureaux qui sont furieux qu'excités, blessés, martyrisés…
Ah que cette tirade est bien venue, et tant pis pour les aficionados.
La reine, qui est Autrichienne, ne doit pas s'amuser. Le roi a l'air d'un Anglais de Paris. La plus jeune des infantes est la seule gentille. La reine Isabelle m'a dit que je lui ressemblais. Je suis flattée, car elle est vraiment gentille.
Nous sommes parties de Biarritz jeudi matin et sommes arrivées le soir à Burgos. Les Pyrénées me frappent par leur beauté majestueuse ; à la bonne heure, en sort des rochers de carton de Biarritz.
Nous avons voyagé avec un gros monsieur qui ne parlait pas français, personne de nous ne parle espagnol ; néanmoins, il m'a expliqué un journal illustré et offert des fleurs à une station. Il y avait en plus un jeune homme qui allait à Lisbonne et qui ne demandait qu'à être utile, une sorte d'Anglais de Gibraltar.
Si vous croyez que le voyage avec mes mères est un plaisir, vous vous trompez joliment. Du reste, c'est tout naturel, elles n'ont ni ma jeunesse, ni mes curiosités. Enfin, puisque c'est passé, je ne parlerai plus de leurs innocentes taquineries, d'autant plus qu'elles sont si tatillonnes que j'aurai mille occasions d'en i reparler. — Des airs malheureux et puis des questions saugrenues, affectant de se croire dans un pays où on ne va jamais ! — Et le guide disait qu'il fait froid à Burgos ; c'est une vraie désolation, et on aurait dû emporter les pelisses. — Quel pays ! Et y voir quoi ? La cathédrale ? mais il n'y a que les Anglais qui vont là. — Et le pire, c'est que tout ça s'adressait à moi à la troisième personne, ou bien on ne disait rien, mais, tout en parlant d'autre chose, des airs ! Et si je proteste, on dit que je cherche des prétextes à querelles. Et pourtant je n'ai pas insisté. Ce sont elles qui ont proposé de venir en Espagne.
Donc, Burgos... Ah ! elles sont insupportables quand ce n'est pas la résignation douloureuse et le plaintes à la troisième personne, c'est une indifférence si complète, qu'on en est tout surpris.
J'ai tout de même fait une pochade dans la cathédrale... La décrire, est-ce possible ? Cet amas d'ornementations, de sculptures peinturlurées, de dorures, de fioritures, de fanfreluches, qui font un tout grandiose. Ah ! les chapelles demi obscures, les grande grilles, non, c'est une merveille vraiment. Et surtout ce cachet de romantisme religieux ; ces églises appellent les rendez-vous ; on prend de l'eau bénite et l'on cherche à qui faire de l'œil. Il en est de même de ce couvent comparativement modeste de la Cartuja. Nous y allons vers le soir, ce qui accentue encore la poésie des églises espagnoles ; à la cathédrale, on montre cette fameuse Madeleine de Léonard de Vinci (?) Horreur ! j'ose avouer que je trouve ça laid, et que ça ne me dit rien, ainsi que les Raphaël, du reste.
Enfin, depuis hier matin, nous sommes à Madrid. Ce matin, au musée. Ah ! le Louvre est bien pâle à côté ; Rubens, Philippe de Champagne... Que sais-je, et même Van Dyck et les Italiens. Rien n'est comparable à Velazquez, mais je suis trop éblouie encore pour juger. Et Ribera ? Seigneur Dieu l Mais les voilà, les vrais naturalistes ! Est-ce qu'on peut voir quelle chose de plus vrai, de plus admirablement vrai ! de plus divinement, de plus véritablement vrai ! Ah ! qu’on est remué et qu'on est malheureux de voir de telles choses ! Ah ! qu'on voudrait avoir du génie ! Et on ose parler des pâleurs de Raphaël et des peintures maigres de l'école française !
La couleur ! Sentir la couleur et ne pas en faire, ce 'est pas possible ! Soria est venu avant dîner avec son ami, M. Pollack (administrateur des chemins de fer), et son fils qui est peintre ; il a travaillé chez Julian.
J'irai au musée demain, seule. On ne saurait croire ce qu'une réflexion niaise peut avoir de blessant en face des chefs-d'œuvre. C'est douloureux comme un coup de couteau, et si l'on se fâche, on a l’air trop bête. Et enfin, j'ai des pudeurs qu'on ne s'expliquera peut-être pas : je ne vaudrais pas qu'on me vît admirant quelque chose ; enfin, j'ai honte d'être surprise manifestant une impression sincère ; je ne sais m’expliquer ici.
Il me semble qu'on ne peut sérieusement parler de quelque chose qui vous a remué qu'avec quelqu'un avec qui on est en parfaite communion d'idées. On cause bien avec.... Tenez, je cause bien avec Julian qui n'est pas une bête, mais il y a toujours une pointe d'exagération, pour que l'enthousiasme, par exemple, ait un côté moqueur qui vous mette à l’abri de la raillerie, quelque légère qu'elle soit. Mais recevoir une impression profonde et la dire simplement, sérieusement comme on l'a sentie... Je ne me figure pas que je le pourrais, à d'autres qu'à quelqu'un que j'aimerais complètement... Et si je le pouvais à un indifférent, cela créerait immédiatement un lien invisible et qui gênerait fort après ; on semble avoir commis une mauvaise action ensemble.
Ou bien alors il faut l'échange d'idées à la parisienne, affectant un peu de regarder ça au point de vue du métier, pour ne pas paraître trop poétique en parlant du côté artistique, avec des mots qui en font quelque chose d'exquis, mais de boulevardier : « saveurs, finesses... » et puis c'est « très fort, c'est tout bonnement ce qu'on peut voir de plus étonnant... »
Mardi 4 octobre 81.
Mais attendez, terminons hier. Donc, du Buen Retiro, nous allons à un café entendre chanter et voir danser des espèces de gitanes.
C'est tout à fait étrange ; une guitare raclée par un homme et une douzaine de femmes tapant des mains en mesure ; puis, tout à coup, une d'elles se met à pousser des notes, des chants chromatiques en désordre : impossible de raconter ça. C'est tout à fait arabe, au reste ; au bout d'une heure, on en a bien assez. Ces femmes sont en peignoir avec fichu sur les épaules et fleurs dans les cheveux, et ces robes de mousseline ou même de toile empêchent de voir les mouvements si caractéristiques des hanches. Les femmes espagnoles sont toutes amusantes à peindre, sinon jolies. Des teints, des yeux. Ah ! on comprend la peinture espagnole en les voyant, c'est... superbe ! en pleine pâte, c'est gras, c'est large, c'est d'une couleur ! !...
Ce matin, dès neuf heures, je suis au musée avec Velazquez, devant lequel tout est sec et pâle, sauf Ribera qui ne le vaut pourtant pas. Dans le portrait d'un sculpteur inconnu, il y aune main !... C'est la clef de toute l'exécution de Carolus Duran qui, comme on le sait, veut rééditer Velazquez.
Nous avons acheté une guitare et une mandoline espagnoles... On ne se figure pas l'Espagne !... Et on dit que Madrid a moins de caractère que ce que je vais voir, Tolède, Grenade, Séville... Du reste, je suis ravie d'être ici, j'ai la fièvre de me faire la main avec quelle étude au musée, puis de faire un tableau et de rester ici deux mois s'il le faut.
Jeudi 6 octobre 81.
J'ai copié la main de Velazquez, vêtue modestement, en noir et en mantille, comme toutes les femmes ici ; mais on est venu beaucoup me regarder, un homme surtout. Il paraît qu'à Madrid, ils sont pires qu'en Italie ; promenades sous les fenêtres, guitares ; on vous suit en parlant, partout, et ça dure. Il y a des billets échangés dans les églises, et les jeunes filles ont comme cela cinq ou six soupirants ; on est extraordinairement galant pour les femmes, sans qu'il y ait là rien de blessant, car le demi-monde comme en France n'existe pas ; ces femmes-là sont très méprisées ; mais dans la rue, on vous dit très bien que vous êtes jolie, qu'on vous adore ; on vous demande de vous accompagner, sachant que vous êtes une dame, en tout bien tout honneur !
Et vous voyez des hommes vous jeter leurs manteaux pour que vous passiez dessus. Pour mon compte, je trouve ça ravissant ; quand je sors extrêmement simple, mais chic, on me regarde, on s'arrête et je renais, et c'est une existence nouvelle, romanesque teintée de chevalerie moyen âge…
Dimanche 9 octobre 81.
Eh bien ! il n'y a rien de neuf, Pollack et Escobar sont venus tous les jours. Maman partait pour la Russie; leur présence nous a évité bien des larmes. J'étais très triste depuis le matin et pourtant il fallait bien, il faut bien qu'elle parte, puisque mon père l'appelle pour les affaires ; donc, elle est partie.
La soirée se passe à parler art avec Pollack, et maintenant que je suis seule, je me figure des choses noires : si maman allait mourir sans nous revoir.
Oh ! si cette chose affreuse arrivait, ces serait une punition pour mes imbéciles révoltes filiales...
Je passerais ma vie à pleurer de ne pouvoir racheter mes duretés. Ah ! je deviendrais folle... Songez donc, se sentir coupable et ne pouvoir plus jamais, jamais racheter ses folies.
Et elle mourrait croyant que je ne l'aime pas, que cela m'est égal, que je me console, que je suis même peut-être contente !
Je m'attends à tous les malheurs, mais je ne puis me figurer ce que me ferait celui-là... J'aime mieux tout au monde que cela, devenir aveugle, paralysée... Je serais à plaindre ; mais perdre maman dans ces conditions-là, il me semble que je l'aurais tuée.
Lundi 10 octobre 81.
Comme je travaillais au musée, arrivent deux hommes assez âgés et pas très beaux ; ils demandent si je ne suis pas Mlle Bashkirtseff. — Certainement ; alors ils se précipitent. M. Soldatenkoff est un millionnaire de Moscou qui voyage beaucoup et adore les arts et les artistes. Puis Pollack nous dit que Madrazo, fils du directeur du musée et peintre lui-même, a beaucoup aimé ma copie et a demandé à faire ma connaissance. Le vieux Soldatenkoff m'a demandé si je vendais, et j'ai eu la bêtise de dire que non.
Quant à la peinture, je suis en train d'apprendre beaucoup ; je vois ce que je ne voyais pas ; mes yeux s'ouvrent, je me hisse sur les pointes des pieds et ne respire pour ainsi dire pas, de crainte que l'enchantement cesse, car c'est un véritable enchantement. On espère enfin toucher à ses rêves, on croit comprendre ce qu'il faut faire, toutes les facultés sont tendues vers ce but effrayant : un bon morceau de peinture ; — non pas de la peinture de menuisier... mais de la chair, tout ce qui chante... et quand on fait ça et qu'on est artiste, on peut faire des choses admirables. Car tout, tout est dans l'exécution ! Qu'est-ce que la Forge de Vulcain, de Velazquez, ou ses Filandières ? Otez à ces tableaux cette peinture prodigieuse et ce sera un monsieur quelconque, n'importe qui. Je sais que je fais crier bien des gens ; les imbéciles d'abord qui posent pour adorer le sentiment... Et tenez, le sentiment, mais c est la pâte, c'est la poésie de l'exécution, c'est l’enchantement de la brosse. On ne se rend pas compte à quel point c’est vrai ! Aimez-vous les primitifs, les formes maigres et naïves et la peinture lisse ? C'est curieux et intéressant, mais on ne peut pas aimer ça. Aimez-vous les sublimes vierges en carton de Raphaël ? Je vais passer pour grossière, mais je vous dis que ça ne me touche pas... Il y a là un sentiment et une noblesse que je respecte, mais que je ne puis aimer. L'École d'Athènes, du même Raphaël, voilà-qui est admirable et incomparable, comme d'autres de ses compositions, et surtout en gravure ou en photographie. Et là il y a, un sentiment, une pensée, un souffle vraiment de génie. Notez que je suis aussi ennemie des chairs ignobles de Rubens et des chairs magnifiques mais bêtes de Titien. Il faut l'esprit et le corps. Il faut, comme Velazquez, exécuter en poète et penser en homme d'esprit.
Mardi 12 octobre 81.
J'ai rêvé qu'on m'expliquait ce que j'avais dans le poumon droit ; dans certaines parties l'air ne pénètre pas... ce qui fait remonter...; mais c'est trop dégoûtant à raconter, il suffit que je sois atteinte. Ah ! je le sais, car depuis quelque temps je sens une espèce de malaise, de légère faiblesse indéfinissable ; mais je ne suis plus comme avant, je ne me sens pas comme les autres ; une sorte de vapeur affaiblissante m'enveloppe, je parle au figuré bien entendu. Il semble que j'ai quelque chose d'étrange dans la poitrine et j'ai... ; mais à quoi bon ces absurdités? On verra bien.
Mercredi 13 octobre 81.
Ce Paris, je l'ai toujours détesté, au physique, toujours, toujours. Combien Madrid est plus sympathique, malgré ses rues irrégulières et son apparence pauvre, en comparaison de Paris. Voyez Paris : son élégance fatigue, ses magasins, ses cocottes, ses maisons neuves, c'est terriblement anti-artistique. Oh ! Rome (et Madrid lui ressemble un peu). Oh ! le Midi. Je suis du Midi, moi, née en Ukraine et grandie à Nice ; j'adore le Midi.
e finis ma copie du Vulcain, de Velazquez, et, à en croire le public, elle doit être bonne. Les pauvres diables d'artistes qui font des réductions des tableaux célèbres, pour la vente, viennent plusieurs fois par jour me voir travailler, et les gamins de l'École des Beaux-Arts, et les étrangers, dont plusieurs, en anglais, français ou espagnol, et parlant entre eux, ont dit de moi les choses les plus flatteuses.
t quand je m'éloigne, on monte sur l'échelle pour voir mes grandes brosses et voir comment c'est peint ; en un mot, mes pauvres enfants, il y aurait de quoi être bouffie d'orgueil si on était moins ambitieuse.
Vendredi 14 octobre 81.
Hier, à sept heures du matin, départ pour Tolède. On m'en a tellement parlé que je m'étais imaginé je ne sais quelle merveille ; malgré le bon sens, je m'obstinais à me figurer quelque chose de Renaissance et de moyen âge ; de merveilleuses pièces d'architecture, des portes à sculptures noircies par le temps, des balcons divinement travaillés, etc. Je savais bien que c'était autre chose, mais c'était gravé là et cela m'a gâté Tolède, lorsque j'ai aperçu cette ville mauresque avec ses inévitables maigreurs de murailles et de portes ébréchées ou paraissant telles. Tolède est tout en haut, comme une citadelle, et lorsqu'on regarde du sommet la campagne et le Tage, cela ressemble à certains fonds invraisemblables de Léonard de Vinci ou même de Velazquez : — Ces montagnes presque à vol d'oiseau, d'un vert bleuâtre qu'on voit par la fenêtre auprès de laquelle est la dame ou le cavalier en velours prune avec de belles mains fines. — Quant à Tolède même, c'est un dédale de petites rues irrégulières, étroites, où le soleil ne pénètre pas, où les habitants ont l'air de camper, tellement toutes les maisons ne ressemblent à rien ; une momie, une Pompéi conservée entière, mais ayant l'air de tomber en poussière de vieillesse ; — le sol brûlé, les hautes murailles brûlées par le soleil ; — des cours étonnantes de pittoresque, des mosquées converties en églises et barbouillées de chaux ; pourtant on gratte petit à petit et ce qu'on découvre est bien curieux ; des dessins, arabesques à couleurs encore vives, des plafonds de bois noirci, à caisson, avec des poutres se rencontrant curieusement tout en haut ; la cathédrale naturellement admirable comme celle de Burgos, — une profusion d'ornements. Ah ! les portes sont des merveilles, et le cloître, avec sa cour remplie de lauriers roses et de rosiers entrés dans la galerie et grimpant le long des piliers à statues graves et tristes ! Et lorsqu'il vient un rayon de soleil, c'est d'une poésie incomparable.
Du reste, les églises espagnoles sont quelque chose qu'on ne se peut figurer. Les guides en haillons, les sacristains en velours, les étrangers, les chiens, s'y promènent, prient, aboient, etc., et c'est d'un charme étrange. On voudrait là, au sortir d'une chapelle, rencontrer subitement, derrière un pilier, l'idole de son âme.
Il est incroyable qu'un pays si voisin du centre de la corruption européenne soit encore si neuf, si vierge, si sauvage !
A Tolède, on est au diable, ce semble... Je ne sais pas, moi, il y a trop de choses à voir et j'y suis restée quelques heures. Pourtant je reviendrai peindre certaines rues toutes noires... Et ces colonnettes, pilastres, plafonds, vieilles portes à gros clous espagnols et mauresques, des bijoux, des merveilles ! Mais il faisait chaud, j'ai mal vu... C'est pittoresque ; tout. est tableau, on n'a même pas à choisir, tout est étrange et intéressant ; mais ça n'a pas les sympathies de mon cœur... En voyant mieux peut-être ?... Mais c'est ce mélange des Goths, des Arabes et des Espagnols ; enfin, ça ne me regarde pas. Le Coro de la cathédrale est vraiment une merveille ; par exemple, les stalles ont des bas-reliefs historiques en bois sculpté avec tant de détail et une telle finesse qu'on est saisi d'admiration. Ah ! je vous l’ai dit, la cathédrale est prodigieuse d'élégance, de richesse et surtout de légèreté ; il semble que ces colonnettes et ces ciselures et ces voûtes ne puissent résister au temps ; on craint que de tels trésors ne tombent en ruine, c'est si beau qu'on sent comme une appréhension personnelle ; mais voilà quatre ou cinq siècles que ce prodige de patience est debout, inébranlable et admirable. Je vous dis, la pensée qu'on emporte de là, c’est : pourvu que ça dure ! Et une frayeur que ce ne soit abîmé, détérioré, usé ; je voudrais qu'on n'eût pas le droit de toucher du doigt cette création, et les gens qui y marchent sont déjà coupables, car il me semble qu'ils contribuent à la très lente mais inévitable destruction du merveilleux édifice. Je sais bien que pendant des siècles encore, mais... Et au sortir de là, les grands murs crénelés à fenêtres arabes, desséchés au soleil ; les mosquées avec leurs grandioses suites de piliers à ornements arabesques. — Allez donc à Rome voir le soleil se coucher derrière la coupole, et toutes ces prodigieuses fanfreluches, toutes ces élégances de pierres ciselées, de portes gothiques et arabes, toutes ces merveilles grêles et cassantes à caractère altier et inquiétant, tout cela tombera comme des écailles et vous semblera de puérils ornements.
Je regarde les photographies de Tolède, il me semble que je me suis trompée, j 'ai mal vu…
Samedi 15 octobre 81.
J'ai passé la journée à l'Escurial avec ma tante que ça embêtait et qui, tout en gardant une contenance indifférente, tâchait de tricher. Si je n'avais entendu parler le guide, elle m'aurait escamoté les caveaux... pour ne pas me fatiguer, « et puis des cercueils, c'est affreux. » Quel ennui de faire ce voyage comme ça ! Enfin j'ai vu comme dans un rêve cet immense bloc de granit, sombre, triste, grandiose Eh bien moi ! je trouve ça superbe ; cette majestueuse tristesse est un charme. Le palais affecte la forme du gril de saint Laurent (consultez les guides), ce qui lui donne l'air un peu caserne, excusez le mot ; mais il s'élève au-dessus d'une campagne brûlée, sombre, houleuse comme une mer et produit une impression profonde avec ses murs de granit de l'épaisseur d'un maison parisienne, ses cloîtres, ses colonnes, ses galeries, terrasses, pièces d'eau verte, ses cours. C'est froid dit-on, c'est triste, oui ; mais cela repose des irritantes visions de Tolède ! Nous avons visité les appartements royaux, couverts de tapisseries assez laides et assez criardes...; pourtant le cabinet du roi est un bijou ; il y a là des portes de bois incrusté à ornements de fer poli et d'or pur... ; puis un salon-oratoire en soie brodée, ravissant. Quel contraste avec la chambre de Philippe II ! Ce tyran habitait une cellule nue et pauvre, donnant dans une espèce de chapelle basse tout en marbre, donnant elle-même sur l'église. De son lit il voyait l'autel et pouvait entendre la messe. Je ne puis pour mon compte bien me souvenir des salles, escaliers, cloîtres qu'on nous fait traverser, c'est si grand ! Et ces longues galeries à immenses fenêtres fermées de volets en bois à caisson, avec portes massives et peu ornées !...
L'église est d'une admirable simplicité, ses voûtes grandioses et nues sont d'un effet tout à fait imposant. Le caveau royal et les escaliers qui y mènent, tout en marbres divers, sont d'une richesse très grande.
Des cercueils sont en marbre de Tolède, avec ornements en cuivre repoussé. C'est splendide. Il ne reste plus que cinq places. La touchante Mercédès attend, dans une petite chapelle latérale, que le caveau des Infants et des reines sans enfants soit reconstruit.
Le Coro est en bois sans sculpture, mais il y a au milieu un lutrin merveilleux avec des livres grands comme moi.
La bibliothèque, oh ! il y a là des manuscrits que j'ai admirés longtemps, bien que je n'y connaisse pas grand'chose.
Et vous voulez que je préfère des mièvreries à cette sombre majesté ! Quel caractère, quelle sobriété et que nous voilà loin des indescriptibles amas d’ornements à profusion et des cassantes gravités de Tolède.
Puis on vous fait traverser un parc où le Roi chasse les lapins et on nous fait visiter le pavillon construit en 1781, je crois. Un bijou. Les escaliers et les parvis en marbre de couleur, et une quantité de petits salons tapissés de tableaux, de beaux tableaux même, ou de soie pâle délicieusement fanée, à broderies ravissantes, des fleurs bleues et roses ; — le vert harmonieusement flétri se détache finement sur du blanc devenu d'un ton d'ivoire incomparable.
Ces petits salons de satin blanc passé ou à peine bleu avec du satin or pâle, avec des plafonds délicieusement peints ou incrustés, c'est à en perdre la tête.
Il y a un cabinet orné de tableaux brodés sur la tenture ; à quelques pas, on dirait des peintures. Et puis des ivoires et des pâtes de riz miraculeuses.
Dimanche 16 octobre 81.
Une des choses les plus curieuses ici, c'est le Rastro, une rue occupée par toute espèce de baraques, comme les foires des villages russes, où l'on trouve de tout. Et une vie, une animation, un grouillement, sous ce soleil brûlant. C’est. Admirable ! Ces infiniment riches bric-à-brac se logent dans de sales maisons ; des arrière-boutiques et des escaliers légendaires ; il y a là des masses d'étoffes, de tapisseries et de broderies à devenir fou.
Et ces misérables semblent absolument insouciants, ils trouent avec des clous de belles étoffes accrochées au mur pour suspendre des vieux cadres ; ils marchent sur des broderies étalées par terre, de vieux meubles, des cadres, des sculptures, des châsses, de l'argenterie, de vieux clous rouillés !... J'ai acheté un rideau de soie rouge saumon, tout brodé, dont on m'a demander 700 francs et qu'on m'a donné pour 150, et une jupe de toile brodée de fleurs pâles d'un joli ton, qu'on m'a laissée pour cent sous après en avoir demandé 20 francs.
C'est malheureux de ne pas avoir 100,000 francs à dépenser ; on se meublerait un atelier... mais avec 100,000 francs seulement ! On achèterait beaucoup.
Escobar vient nous prendre pour aller aux taureaux. Nous sommes dans une loge avec Mlle Martinez, son père, deux autres et Escobar. J'ai voulu retourner pour avoir une seconde impression. On avait annoncé huit taureaux et c'est, je crois, le dernier dimanche Bref, brillante représentation. Le Roi, la Reine, les Infantes à leur poste. Musique, soleil, clameurs folles, trépignements, sifflets, mouchoirs agités, chapeaux lancés. C'est un spectacle unique, d'une grandeur entraînante et qui ne ressemble à rien. — Je commence à être au courant et je me suis intéressée à la représentation. J'y suis allée à contre-cœur, avec un frisson de dégoût ; pourtant j'ai gardé bonne contenance devant cette boucherie à cruautés raffinées. C'est très beau, à condition de ne rien voir... Pourtant on finit par s'intéresser et on garde un air brave devant ces ignominies, par orgueil. J'ai regardé tout le temps. On sort de là un peu ivre de sang ; pour un peu on piquerait des pointes de fer à tout le monde dans la nuque.
J'ai découpé mon melon à table comme si je plantais une banderilla... Et ma viande me semblait sortir toute pantelante de la peau déchirée du taureau. Oh ! ça vous crispe aux jambes et ça vous serre la tête ; c’est une école d'assassins. Maintenant, sans doute, ces hommes sont élégants, gracieux, ils ont des mouvements parfaitement harmonieux et dignes, malgré leur extrême souplesse.
On trouve magnifique ce duel de l’homme avec cette immense bête ; mais est-ce bien un duel, lorsqu'on sait toujours qui doit succomber ? J'avoue que le matador arrivant avec son brillant costume dessinant ses formes, après avoir fait ses trois saluts d'un caractère si particulier (il tord trois fois son bras haut et droit devant lui), calme, froid, venant se placer tout près devant l'animal, avec ce manteau et cette épée... et tenez c’est presque la meilleure partie du jeu, il ne s'y verse presque pas de sang. Oui, je le dis, cela a un caractère étonnant. Bref, les Espagnols eux-mêmes n’aiment pas la partie des chevaux. Alors je suis réconciliée avec ce sauvage plaisir ? Je ne dis pas cela, mais il y a là un côté très beau, presque grand : ce cirque, ces quatorze ou quinze mille spectateurs ; on a là comme une vision de l'antiquité que j'aime tant. Et puis, alors, le côté sanglant, horrible, ignoble... Si les hommes étaient moins adroits, s'ils avaient plus souvent quelques bonnes blessures je ne crierais pas, mais c'est cette lâcheté humaine qui me révolte. Pourtant on dit qu'il faut un courage de lion... Eh bien, non, ils sont trop adroits et évitent trop sûrement les attaques terribles, mais naïves, prévues et provoquées de la bête... Le vrai danger est pour les banderillas, car l'homme court à la rencontre du taureau et, au moment où celui-ci veut donner des cornes, il le prévient en lui plantant ses banderillas entre les deux épaules ; il faut là un courage et une adresse exceptionnels.
Lundi 17 octobre 81. — Mardi 18 octobre.
Qu'il y a des gens heureux et comme, ayant tout pour l'être, je ne le suis pas !
J'ai assez d'argent pour aller, venir, peindre, voyager; on fait ce que je veux. Vous savez le reste. J'aimerais mieux manquer d'argent et ne pas faire ce que je veux, que d'être avec des gens qui m’enragent avec leur entêtement pour mon bien.
Quand on est convaincu qu'on fait bien, il n'y a rien à faire. Ma famille est convaincue. Elle n'aurait pas ce tort sciant, crispant, assassinant de me persécuter par amour, que je lui pardonnerais peut-être de n'être ni artiste, ni agréable. Ah ! qu'il y a des gens heureux ! Non, voyez-vous, ce voyage avec ma tante l C'est à partir demain pour Paris…
Mercredi 19 octobre 81.
Il n'y a pas à dire, je tousse tellement que ça doit tout me détériorer là-dedans. Et avec cela je maigris, ou plutôt... oui, je maigris, à regarder les bras, par exemple ; quand j'allonge le bras, il prend un caractère atteint au lieu de l'insolence d'autrefois. C'est même joli, je ne me plains pas encore. A présent, c'est la période intéressante, on devient mince sans maigreur, et je ne sais quoi de languissant qui va bien ; mais, si je continue, dans un an, je finirai squelette…
Jeudi 20 octobre 81.
Ce matin, j'ai passé deux heures à Cordoue, juste le temps de jeter un coup d'œil sur la ville qui est ravissante... à sa façon ; enfin, j'adore les villes comme ça : il y a là des restes romains qui me ravissent, et la mosquée est une véritable merveille.
On aimerait rester un mois à Cordoue. Mais pour ça il ne faudrait pas voyager avec sa tante qui, en dix minutes, trouve le moyen de vous enrager dix fois, d’abord, en rageant elle-même : tantôt, c'est « il n'y a rien à voir et le guide nous mène exprès pour gagner de l'argent et nous faire manquer le train ». Puis c'est une voiture qu'il faut pour aller à la mosquée ! A Cordoue ! A huit heures du matin ! Songez donc, on peut s’enrhumer et puis moi, qui me meurs, je ne puis marcher ; bref, un air furieux. Douce société, adorable compagnie pour un voyage artistique à travers l'Espagne ! Moi, je prie Dieu tout le temps pour qu'il fasse que ça ne fasse rien ; car c'est désespérant de voir tout abîmer comme ça. C'est égal, je n'ai pas de chance ; c 'est à pleurer.
Je me soigne et aime le confort, et suis très gourmande ; mais quand on vient m'ennuyer avec ça toute la vie, j'aime mieux être abandonnée dans la rue !...
Ah ! Seigneur, que ces gens-là m'ennuient ! !... Au moins, tant qu'il y avait le petit Pollack, j'échappais jusqu'à un certain point à ces ennuis... Du reste, ma pauvre tante est ravie quand il y a quelqu'un, car elle sait bien qu'elle m'enrage, la pauvre femme.
Samedi 22 octobre 81.
Eh bien ! nous voilà dans cette Séville tant vantée. En somme, je perds bien du temps ici. J'ai vu le musée : une salle unique pleine de Murillo ; j'aimerais mieux autre chose, surtout là ; il n'y a que des vierges et d'autres saintetés. Moi, qui suis barbare, outrecuidante, ignorante et grossière, je n 'ai pas encore vu de vierge comme je m'imagine qu'elles devraient être. Les vierges de Raphaël sont belles en photographie... Du reste, je vous dirai ma précieuse opinion quand j'aurai revu cela. Murillo ne me dit pas grand'chose, je l'avoue, avec ses vierges aux joues roses et aux visages ronds. Il y a celle du Louvre qu'on a tant copiée ; c'est la mieux sentie, on peut même la qualifier de divine.
Et la fabrique de cigares et de cigarettes ! Une odeur ! Si ce n'était que le tabac ! Un pêle-mêle de femmes avec bras et cou nus, de fillettes et d'enfants. Pour la plupart, ces êtres grouillants sont jolis, et c'est une visite curieuse. Les femmes espagnoles ont une grâce que les autres femmes n'ont pas. Des chanteuses de café, des rouleuses de cigarillos marchant comme des reines, et avec cela une souplesse, une grâce incomparables. Et des cous attachés d'une façon ! Des bras ronds et d'une forme très pure avec un ton magnifique. Des créatures victorieuses et étonnantes.
Il y en avait une surtout qui se levait pour aller prendre des feuilles de tabac : un port de reine, une souplesse de chatte, une grâce divine..., avec une tête superbe, une carnation éblouissante, des bras, des yeux, un sourire !... Nom d'un chien ! Sans compter celles qui n'ont que du chic. Les fillettes sont toutes drôles et ravissantes ; il y a des laides, mais peu. Et les laides mêmes ont quelque chose.
Mardi 25 octobre 81.
Eh bien ! tâchons de justifier du temps... Je m'embrouille.
J'ai vu la cathédrale qui est une des plus belles du monde, selon moi, et une des plus grandes ; — l'Alcazar, avec ses jardins délicieux, le bain des sultanes ; et puis nous avons fait une promenade dans les rues. Je n'invente rien en disant que nous étions les seules femmes en chapeau ; aussi c'est à nos chapeaux que j’attribue l'ébahissement des populations.
Encore si j'étais élégante, mais je portais une jupe de laine grise, un paletot noir collant et un chapeau noir de voyage. Mais les étrangers sont regardés ici comme des singes savants ; on s'arrête, on les hue ou on leur dit des choses aimables.
Je suis huée par les enfants, mais les grands me disent que je suis jolie et salée ; c'est, comme on sait, très chic d'être salada.
Séville est toute blanche, toute blanche ; les rues sont étroites; dans la plupart, les voitures ne passent pas et avec tout cela ce n'est pas aussi pittoresque qu'on le voudrait. Ah ! Tolède, je vois ma barbarie à présent !...
Tolède est une merveille. Séville, avec ses maisons basses, blanchies à la chaux, est d'un caractère un peu bourgeois. Il y a bien les bas quartiers..., mais dans tous les pays du monde, les mauvais quartiers sont intéressants. Ce qu'il y a, c'est une harmonie et une richesse de tons telles qu'on voudrait tout peindre.
Je suis très agacée de ne pas parler espagnol ; c'est une gêne affreuse, surtout pour travailler, faire des études...
Ces femmes et ces enfants à moitié sauvages sont d'une couleur prodigieuse, ainsi que leurs loques. C’est ravissant, malgré la crudité des maisons blanches. — Mais il pleut toujours, et puis je suis en famille.
Je comprends qu'on soit heureux de vivre en famille et je serais malheureuse seule. On peut aller faire des achats en famille, aller au bois en famille, quelque fois au théâtre ; on peut être malade en famille, faire des cures en famille, enfin tout ce qui est de la vie intime et des choses nécessaires ; mais voyager en famille ! ! ! C'est comme si on prenait plaisir à valser avec sa tante. C'est ennuyeux mortellement et même quelque peu ridicule.
J'ai fait hier une étude de mendiant en quatre ou cinq heures. Tête grandeur nature. Il faut de temps en temps essayer des esquisses très rapides pour s'assouplir la main.
Il me semble être en exil ; les journées sont si longues sous ce ciel gris ; et, dormant peu, à cause des moustiques, je suis énervée et ne puis travailler.
Je m'imaginais trouver à Séville un tas d'aventures amusantes, mais je m'ennuie tant que je reste enfermée à l'hôtel, et il pleut.
Pas d'amour, pas de poésie, pas même de jeunesse. Rien ; c'est vrai, il n'y a rien dans ma vie à Séville. Il me semble que je suis enterrée comme en Russie, cet été. Tous ces voyages !... Pourquoi ? Et la peinture ?... Voilà cinq mois que je n'ai été à l'atelier ; de ces cinq mois, avec tous ces voyages, j'en ai perdu trois. Moi qui ai tant besoin de travailler !... La mention de Breslau a réveillé tout un monde de pensées ou plutôt a rapproché de moi, a rendu possible... a transporté dans la vie réelle ce rêve de médaille au Salon, qui paraissait si lointain que j'y songeais dans mes contes à dormir, comme je songeais à avoir la Légion d'honneur ou à être reine d'Espagne. Lorsque Villevieille vint m'annoncer la probabilité de la mention Breslau, elle eut l 'air de croire que cela me faisait... Enfin les autres, en admettant que je pouvais oser songer à une récompense pour moi, m’ont donné l'audace d'y songer, ou plutôt de me dire que, puisque les autres pensent que je puis y rêver, il faut donc que cela soit possible... Bref, voilà bien cinq mois que j'y rêve.
J'ai l'air de divaguer, mais tout s'enchaîne. — L’étude de chez Lorenzo peut faire un tableau.
Jeudi 27 octobre 81.
0 bonheur ! j'ai quitté l'affreuse Séville.
Je dis d'autant plus « affreuse » que je suis à Grenade depuis hier soir, que nous sommes en courses depuis ce matin, que j'ai déjà vu l'inévitable cathédrale, le Généralife, une partie des caves des bohémiens. Je suis dans l'enthousiasme. A Biarritz et à Séville, j'avais les bras coupés, tout semblait fini, mort. Pendant les trois heures que j'ai passées à Cordoue, j'ai eu l'impression d'une ville artistique, c'est-à-dire que j'y aurais travaillé avec un entrain parfait. Quant à Grenade, il n'y a qu'un malheur, c'est de ne pouvoir y rester six mois, un an. On ne sait de quel côté courir, tellement il y a des choses à faire. Des rues, des silhouettes, des vues !
On devient paysagiste ; mais alors apparaissent ces types étranges et intéressants aux couleurs éclatantes et si harmonieusement chaudes.
Mais ce que j'ai vu de curieux, c'est le bagne de Grenade, la prison où travaillent les forçats. Je ne sais comment m'est venue cette fantaisie, et certes je ne la regrette pas, bien qu'on sorte de là avec les tempes serrées comme après la course de taureaux. Le commandant de la prison a tout de suite accédé au désir des nobles étrangères et on nous a fait tout visiter. Un gardien marchait devant, et nous étions flanquées de six caporaux choisis parmi les plus braves des criminels, armés de bâtons et chargés du service de l'ordre. Je ne saurais décrire l'impression causée par ce troupeau d'hommes se rangeant et se découvrant avec une rapidité qui ressemblait à de la peur, devant les galons et les bâtons des gardiens. On les bat, à ce que m'a dit le guide.
Désarmés, enfermés, contraints au travail comme des enfants, ces hommes ne m'inspirent que de la pitié au lieu de me faire penser aux crimes et méfaits qui les rassemblent là. Je dirai plus, c’est presque de l'attendrissement, un attendrissement singulier qu'on ressent en face de cette horde de misérables qui saluent d'un air si humble, qui semblent travailler avec tant de zèle, et nous montrent les cahiers où ils apprennent à lire, et cela avec des airs craintif et enfantins.
Oui, on les bat, cela se voit ; ils ont l'air de ces pauvres chiens de la rue qui se couchent tout résignés, à recevoir les coups.
Mais quelles têtes ! Je voudrais bien faire un tableau là... J'ai la permission et si je trouve quelque coin et trois ou quatre personnages... Malheureusement, cela vous entraîne à un trop grand tableau...
Je recommande cette sombre visite, avant de voir le Généralife dont les jardins sont une succursale du paradis, bien certainement. Ah ! comment vous décrire ces enchevêtrements de lauriers roses, d'orangers, de plantes les plus riches et les plus exquises ; — ces allées de cyprès, de murailles arabes lézardées et couronnées de roses ?... Des ruisseaux entre des parterres de violettes. Allez au bagne, puis au Généralife.
A demain l'Alhambra et la tête d'un forçat que vais peindre.
Vendredi 28 octobre 81.
Donc, j'ai passé ma journée dans les prisons de Grenade. Les prisonniers jouissent d'une liberté charmante ; la cour ressemble à un marché, les portes n'ont pas l'air de bien fermer et enfin ce bagne ne ressemble pas du tout aux descriptions des maisons centrales de France.

Mon pauvre diable de forçat a très bien posé toute la journée ; mais comme j'ai fait la tête grandeur nature et ébauché les mains en un jour (sublime génie !), je n'ai pas rendu aussi exactement que d'habitude le caractère étonnamment louche de l'individu. Et j'ai tort d'en accuser le manque de temps, car si je ne suis pas plus satisfaite, cela tient à la lumière, qui a changé plusieurs fois, et aussi à ces bons forçats dont j'avais tout le temps une douzaine derrière le dos ; ils se relayaient, mais j'en avais toujours, et c'est agaçant de sentir des yeux derrière soi. L'excellent sous-chef, dans le cabinet duquel je travaillais, avait mis des chaises derrière moi comme au spectacle, pour ses amis qui se sont succédé là pendant toute la journée. Et à chaque instant on frappait à la porte ; c'était des prisonniers, — les pas méchants, — les caporaux, qui demandaient à entrer et entraient. L'interprète et Rosalie sont restés là tout le temps, et j'ai appris ainsi qu'un homme qui a assassiné sa femme va être étranglé publiquement la semaine prochaine. Puis il y a un prisonnier enfermé pour n'avoir pas voulu saluer la procession, et d'autres choses étonnantes. Avez-vous remarqué que lorsqu'on dit, comme moi tout à l'heure, et d'autres choses étonnantes, ou bien j’en passe et des meilleurs, ou encore et ce que je dis là n'est rien auprès du reste, c'est toujours qu'on ne passe rien, pas même ce qu'il y a de pis ; qu'on a dit ce qu'il y avait de plus fort, et qu'il n'y a plus rien à dire, du reste, mais qu'on veut renchérir sur la vérité. Très souvent, en parlant d'une personne, on cite ce qu’elle a fait de pis en disant : Voici quelque chose qui lui est habituel, jugez donc de ce que sont ses gros péchés. — Mais revenons à mon forçat. Je l'avais paré des crimes les plus énormes et il n'a fait, paraît-il, que de changer de la fausse monnaie.
Cette idée de son innocence relative m'a peut-être empêchée de lui donner l'air criminel qu'il a. Car il a une tête à tout faire ; aussi vais-je lui broder un petit roman que je raconterai à Paris. La fenêtre-balcon donnait sur la cour, et tous ces pauvres diables regardaient avec une avidité espagnole le modèle et le chevalet et le peintre. En sortant, ils sont accourus comme des chiens affamés, et ce furent des mines, des mains jointes, des exclamations en voyant le portrait du camarade.
Au moment de franchir la porte, le sous-chef a eu l'amabilité de montrer la toile à toute la cour qui se hissait sur la pointe des pieds, puis il l'a portée au chef et au commandant, qui est descendu dans la rue me saluer dans ma voiture. Puis, le sous-chef marchant devant les chevaux, on s'est arrêté devant la maison d'un autre dignitaire de la prison, qui est venu voir. Et après que le commandant et le sous-chef m'eurent renouvelé l'assurance qu'ils me reverraient avec plaisir, je suis enfin partie avec ma tante faire un tour à la promenade.
J'ai écrit dans le coin de ma toile : « Antonio Lopez « condamné à mort; 1881, octobre, » pour assassinat et fausse monnaie. Pauvre homme ! mais enfin je le calomnie sous un pseudonyme ; il s'appelle peut-être Rodrigue, ou Perez, ou bien de Lopez. Je l'ai représenté avec son tricot ; la plupart de ces aimables citoyens c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas occupés aux ateliers de charpenterie, menuiserie, cordonnerie, etc., etc. tricotent des bas comme de paisibles ménagères.
Le condamné à mort se promenait dans la cour aussi libre que ceux qui ne sont là que pour un an ou deux, pour des bagatelles.
Plusieurs de ces messieurs préfèrent la cuisine de famille à celle de l'établissement, et leurs gracieuses compagnes leur apportent de délicieux dîners, dont Coco ne voudrait certainement pas, — Coco, surnommé l'assassin, on n'a jamais su pourquoi, et qui, chaque fois que ses collègues se conduisaient avec moi comme François 1er avec le Titien, leur sautait dessus sans aboyer, pour mordre plus sûrement.
Samedi 29 octobre 81.
Enfin j'ai vu l'Alhambra, j'ai fait exprès de ne pas m'attarder devant ce qu'il y a de plus beau, d'abord pour ne pas m'attacher à Grenade, et puis le guide qui nous conduisait troublait par sa présence mes jouissances artistiques. Je me promets de revoir tout cela.

Grenade, vue de la tour, est d'une beauté admirable, complète. Les montagnes couvertes de neige, les arbres gigantesques, les plantes et les fleurs exquises, le ciel pur et Grenade elle-même avec ses maisons blanches, couchée au soleil au milieu de toutes ces beautés de la nature ; les murailles arabes, les tours du Generalife et de l'Alhambra !... Et au loin un vaste horizon, on dirait la mer ; en effet, il ne manque que la mer pour que ce soit le plus beau pays du monde. Quant au palais lui-même, il est d'une beauté fantastique.
Le costume arabe est certainement le plus beau du monde. Rien n'est comparable à la hautaine élégance de ces draperies superbes. Je suis empoignée par feu Boabdil et ses Maures, que je rêve se promenant dans ce palais unique au monde.
L'après-midi, je fais une étude dans une petite rue et, ayant fini, j'inscris sur le mur : « Ici a travaillé Andrey 1881. » Seulement l'ombre du côté droit de l'étude est d'un ton trop chaud, ce qui enlève de l'éclat à la lumière et j'en suis désolée ; savez-vous qu'il fait froid et que j'ai eu les doigts engourdis, au point d'être obligée d'aller me chauffer au soleil ? Voilà qui ne m'encourage pas à rester ici, puisque je ne puis travailler en plein air ; pourquoi me morfondre ici, m'ennuyer cruellement le soir, ne pas dormir sur ces lits d'une dureté infâme et ne manger par jour qu'un potage avec un morceau de viande, en y ajoutant une tasse de café le matin ? C'est que je voudrais bien rapporter au moins une bonne étude…
Dimanche 30 octobre 81.
J'ai passé toute la journée chez les Gitanes, et pour ne rien faire. Il fait un temps glacial, j'ai eu la figure gercée de froid, la toile couverte de sable et de poussière ; en somme, rien fait. Mais quelle mine précieuse pour les artistes ! Rester là tout un jour, surprendre ces attitudes, ces groupes, ces effets de lumière et d'ombre ! D'abord, ils sont très bienveillants avec les étrangers, parce que les Espagnols les méprisent. Il faudrait venir pour deux ou trois mois et faire des études tous les jours, et il en resterait toujours à faire. Je suis folle de ces types Gitanes. Ils ont des poses, des mouvements, des attitudes d'une grâce si naturelle et si étrange. On ferait là de merveilleux tableaux. Les yeux s'enfuient dans toutes les directions, comme on dit en russe, tout est tableau. C'est enrageant d'être venue si tard ; mais, malgré la meilleure volonté du monde, on ne peut travailler ; le vent de la montagne couverte de neige est perçant, on n'y peut tenir. Mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau ! Lorsque je me suis installée pour travailler, ils sont accourus et se sont groupés tout autour, sur les degrés naturels de la montagne ; je vous laisse à penser si cela faisait bien, et cette curiosité est toute sympathique, tandis que les gens qui m'entouraient l'autre jour dans la rue m'agaçaient profondément. Les Espagnols ne font rien ; ce qui fait que, au lieu de venir voir et de passer, il y en a un tas qui restent derrière vous, deux ou trois heures. Et notez que j'ai travaillé dans une rue déserte, au diable au vert, et il y a beaucoup de peintres ici.
Grenade est aussi artistique et pittoresque que Séville est bourgeoise, bien qu'elle possède une école célèbre. Toutes les rues de Grenade, presque toutes, sont ravissantes pour un peintre.
On est ébloui et tiraillé dans tous les sens. On peut s'arrêter au hasard et faire ce qu'on trouve devant soi, et ce sera un tableau.
Je veux revenir ici en août, septembre et moitié octobre prochains.
Lundi 31 octobre 81.
Je suis heureuse que le froid me chasse, sans cela je ne partirais pas et il faut rentrer. Voilà cinq mois que je n'ai vu Tony et il faut songer à louer un atelier, à faire mon Salon sans me presser et à faire tout ce que je puis. La première année, ce n'était rien. L'année dernière, vous savez le peu de temps, etc., etc. Sans compter que le sujet n'était pas de moi... Mais cette année, je crois tenir quelque chose d'intéressant.
Je voudrais faire le bric-à-brac de Lorenzo, qui a un escalier au fond et une lumière éclatante, avec une femme raccommodant les tapis sur cette sorte d'estrade ; sur le devant, une autre femme accroupie nettoie des cuivres et l'homme la regarde faire, debout, les mains dans les poches et fumant un cigare.
Les femmes seront vêtues de leurs robes de perse ordinaire que j'achèterai sur nature à Madrid. Et j'ai presque tous les chiffons nécessaires ; reste l'estrade à installer, ce qui coûtera une centaine de francs. Mais il faut trouver un atelier assez grand... Enfin, je part ce soir et je ne puis m'empêcher de chanter de joie.
Mon voyage en Espagne m'aura servi à m'ôter l'habitude de manger pour manger, ce qui prend du tempe et alourdit l'intelligence ; je suis devenue d'une sobriété arabe et ne prends que le strict nécessaire, juste assez pour vivre.
Le beau-fils du chef Gitane chez qui j'ai travaillé sortait des galères, où il a passé quatre ans pour avoir... enlevé une petite fille de treize ans.
Mercredi 2 novembre 81.
Nous revoilà à Madrid où je me fais fête, depuis une semaine, de rester trois jours pour refaire une esquisse de Lorenzo.
En ne m'entendant parler que de cela et en voyant mon impatience de revenir à Madrid, il est tout naturel, n'est-ce pas, que ma tante, tout habillée, vienne me dire : « Eh bien, nous allons passer le jour à faire nos achats ? » Et comme je réponds que je vais peindre, elle a l'air absolument étonnée et me dit que je suis folle.
Une idée vous vient, vous croyez tenir un sujet ; là dessus on s'emballe, le rêve prend corps, on fait une esquisse, on est tout entier à son travail, on se creuse la tête pour trouver des arrangements harmonieux et, au moment où on pressent quelque idée encore très vague qui peut s’envoler sans qu'on la saisisse..., arrive cette chère famille qui m'aime tant et qui est si inquiète quand je tousse. Et je ne suis pas d'une sensibilité exagérée, je me crois très pratique auprès des autres artistes... Pas assez, comme vous voyez... Ah ! famille inconsciente et insouciante, jamais elle ne comprendra qu'une moins forte, moins énergique, moins exubérante, serait déjà morte !
Samedi 5 novembre 81.
Je suis à Paris ! Ravissement immense. Je comptais les heures en me morfondant en wagon. L'air vif ou le soleil brûlant de l'Espagne me font trouver délicieux le calme gris de la belle ville et je pense avec plaisir aux céramiques du Louvre, moi que ça ennuyait rien que d'y penser.
Julian croyait que je n'allais revenir que beaucoup plus tard, et malade, et peut-être ne pas revenir du tout.
Ah ! que la sympathie est une douce chose, mais la peinture surtout.
Dimanche 6 novembre 81.
Le procès est fini, gagné. C'est-à-dire que l'enquête démontre qu'il n'y a pas motif à procès. Ça paraît impossible, tellement il y a longtemps que ça dure, et pourtant cela est. Nous venons de recevoir la dépêche de maman. Voilà un jour heureux.
Mardi 15 novembre 81.
J'ai montré un projet de tableau à Julian qui l'approuve. Mais il ne m'inspire plus de confiance, il a l'air confus, enfin j'imagine tout cela.
Il reste Tony, mais je l'ai moins cultivé et enfin... on verra.
La pauvre Collignon est morte depuis plus de vingt jours déjà.
Nous ne nous sommes jamais beaucoup aimées, mais, le dernier temps, elle était si malheureuse que je compatissais à ses tristesses, tout en restant indifférente.

Probablement Catherine Collignon
Jeudi 17 novembre 81.
Hier, je ne pouvais pas me traîner, ayant mal à la poitrine, à la gorge, au dos, toussant, enrhumée, ne pouvant rien avaler et passant dix fois par jour du froid au chaud.
Je suis un peu remise aujourd'hui, mais c'est égal !... pour quelqu'un qui se soigne chez les plus grands savants du monde ! Et depuis si longtemps ! car depuis que j'ai eu mes premières extinctions de voix, on m'a soignée. Oui, voilà l'anneau de Polycrate que je jette bien malgré moi à la mer. Eh bien ! puisque ce mal affreux me tient, il devrait suffire comme contrepoids à d'autres bonheurs. On ne dira pas que j'ai tout..., si j'arrive à quoi que ce soit. Cela devrait me rassurer..
Lundi 21 novembre 81.
On a envoyé chercher Potain mercredi, il est venu aujourd’hui ; pendant ce temps là j’aurai pu crever.
Je savais bien qu'il m'enverrait encore dans le Midi, j'en avais d'avance les dents serrées et la voix tremblante, et des larmes que je fais rentrer par des effort considérables.
Aller dans le Midi, c'est se rendre. — Et les persécutions de ma famille me font un point d'honneur de rester debout, quand même. M'en aller, c'est le triomphe de toute la vermine de l'atelier.
« Elle est très malade ; on l'a emmenée, dans le Midi ! »
Mardi 22 novembre 81.
Il est impossible de se figure ce que cet exil dans le Midi est désespérant pour moi. Il me semble que tout va être fini, moi qui revenais enivrée à l'idée de rester tranquille et de travailler, de travailler ferme, sans relâche, en suivant le mouvement... Et puis voilà que de nouveau tout s'efface !
Et pendant que d'autres iront toujours en avant au milieu de ce Paris artistique, moi je serai là-bas à ne rien faire ou à courir après un tableau en plein air qui est une chose horriblement difficile...
Voyez Breslau, ce n'est pas sa paysanne qui lui a valu quelque chose... En un mot, mon cœur se fend et se brise devant tout cela.
Ce soir, j'ai vu Charcot qui dit que le mal, depuis l'année dernière, n'a pas empiré ; quant à ce que j'ai depuis six jours, c'est un refroidissement sans gravité et qui partira très vite. Quant au Midi, c'est la même chose : il faut y aller ou bien s'enfermer absolument comme une prisonnière. Sans quoi on court risque d'attraper des choses graves ; vu que le poumon droit est pris et encore, paraît-il, j'ai de la chance : c'est un mal curable qui s'est localisé et qui n'augmente pas, malgré toutes mes prétendues imprudences. Ils m'ont dit la même chose, l'hiver dernier, et je n'ai seulement pas voulu écouter ; maintenant, j'hésite et reste des quatre heures à pleurer, comme hier, à cette idée de quitter encore Paris, de m'interrompre...
Il est vrai que si je suis souvent comme ces derniers jours, Paris ne me profitera guère...
Et voilà ce qui me désespère !
Me rendre, m'avouer vaincue, dire : Oui, ils ont raison, les médecins. Oui ! je suis malade.
Ah ! non, tout va mal décidément.
Samedi 26 novembre 81.
Je devais aller chez Tony, vous vous rappelez, pour travailler sous ses yeux et pour lui montrer mon esquisse et décider quelque chose, mais je ne suis pas sortie. Je suis faible et ne puis rien manger, ayant probablement toujours la fièvre. C'est horriblement triste d'être maintenue dans l'inaction par... par... je ne sais quoi ; de n'avoir pas la force enfin ! Charcot est revenu.
Maman et Dina sont arrivées hier, appelées par des dépêches insensées de ma tante. Ce matin, Dina reçoit une lettre de sa sœur qui demande comment je vais
J'ai pris froid, je sais, mais ça peut arriver à tout le monde.
Et puis, non, tout est fini, j'ai les oreilles dans un triste état avec ce rhume et cette fièvre ; à quoi puis-je aspirer ? Qu'est-ce que je puis avoir ? il n'y a plus rien à attendre. C'est comme un voile qui s'est déchiré l'autre jour, il y a cinq ou six jours ; tout est fini, tout est fini, tout est fini !
Mardi 29 novembre 81.
Eh bien ! voilà quinze jours que ça dure et j'en ai encore au moins pour autant.
Madame Nachet m'apporte un bouquet de violettes aujourd'hui ; je la reçois comme tout le monde, car, malgré la fièvre qui ne me quitte pas depuis quinze jours et une congestion pulmonaire du côté gauche, alias pleurésie, et deux vésicatoires, je ne capitule pas ; je suis levée et me comporte comme une personne naturelle. Seulement la quinine me rend sourde ; l'autre nuit, j'ai pensé mourir de terreur n'entendant plus ma montre. Et il faudra en prendre encore et toujours.
Du reste, je me sens presque forte, et si ce n'était que depuis quinze jours je ne puis rien avaler, je ne sentirais pas ma maladie.
C’est égal, mon travail, mon tableau, mon pauvre tableau ! Nous sommes au 29 novembre, je ne pourrai jamais commencer avant fin décembre. En deux mois et demi je n'aurai jamais le temps ; quelle malchance et comme, quand on est né malheureux, il n'y a pas à lutter ! Voyez-moi ; la peinture semblait un refuge, et voilà que je suis parfois presque sourde ; d'où, gêne affreuse avec les modèles, angoisses perpétuelles et impossibilité de faire des portraits à moins d'avouer, et je n'ai pas encore ce courage. Puis, avec cette maladie, impossibilité de travailler et obligation de rester enfermée un mois. Mais c'est par trop triste !
Dina ne me quitte pas ; elle est si gentille !
Paul et sa femme sont arrivés hier. Les Gavini et Géry sont venus, Bojidar, Alexis. Et moi, toujours en train et me tirant des mauvais pas à force de courage et de blagues....
Les médecins sont le sujet des plaisanteries à présent. Potain, ne pouvant toujours être là, m'envoie un docteur qui viendra tous les jours.
Et ça m'amuse ; car je joue la folle et je profite de cet état pour débiter des insanités.
Mercredi 30 novembre 81.
Julian est venu hier au soir ; il me croit bien malade, je l'ai bien vu à sa gaîté, un peu affectée ; quant à moi, je suis dans une affliction profonde. Je ne fais rien, et mon tableau ! Mais surtout ne rien faire ! Comprenez-vous ce désespoir ? rester là et les bras ballants, pendant que les autres travaillent, font des progrès, préparent leurs tableaux !
Je croyais que Dieu m'avait laissé la peinture et je m'y étais enfermée comme dans un suprême refuge. Et voilà qu'elle me manque, et je ne puis que m'abîmer les yeux à force de larmes.
Jeudi 1er décembre 81 — Vendredi 2 décembre.
2 décembre déjà, je devrais être à l'ouvrage, chercher des étoffes, le grand vase qui figure dans le fond... A quoi bon ces détails ? Seulement à me faire pleurer. Je me sens beaucoup plus forte ; je mange, je dors, je suis, presque aussi forte que d'habitude.
Mais il y a la congestion pulmonaire, en bas, à gauche. Le côté droit, le chronique, est mieux, paraît-il mais ça m'est indifférent, c'est ce mal aigu, qui peut se guérir, qui m'enferme chez moi pour quelques semaines encore. C'est à aller se noyer.
Ah ! c'est si cruel à Dieu ! J'avais des ennuis, des tristesses de famille, mais cela ne m'atteignait pour ainsi dire pas jusqu'au fond de mon être, - et puis des espérances énormes... Je perds ma voix — première attaque personnelle — enfin je m'y habitue, je m’y résigne, je m'en tire, je m'en console.
Ah ! puisque tu t'accommodes de tout cela, eh bien on t'ôtera le moyen de travailler !
Ni étude, ni tableau, plus rien, et un retard de tout un hiver ; moi, qui avais mis toute ma vie dans mon travail. Ceux-là seuls qui ont été à ma place peuvent me comprendre.
Mercredi 7 décembre 81.
Ce qui m'exaspère, c'est ma maladie. Hier, l'horrible sous-Potain, qui vient tous les jours — le grand homme ne pouvant se déranger que deux fois par semaine — donc le sous-Potain m'a demandé d'un air détaché si je me préparais à voyager !
Leur Midi ! Oh ! rien que cette idée me met l'esprit en convulsion ; je n'en ai pas dîné et si Julian n'était pas venu, j'aurais pleuré toute la soirée de rage.
Eh bien ! non, tant pis ! mais je n'irai pas dans leur Midi.
Vendredi 9 décembre 81.
Il y a un dessin de Breslau dans la Vie moderne. Si je n'avais tant pleuré, j'aurais pu utiliser ma maladie, faire des croquis, des esquisses. Mais mes mains tremblent encore un peu.
Le poumon est dégagé, mais la température est toujours à 38 degrés. Me voilà belle en vous faisant part de tous ces détails !
Je me sens perdue et je n'ose rien demander, de peur d'entendre dire ce que Breslau est en train de faire.
Ah ! mon Dieu, écoutez-moi, donnez-moi la force, ayez pitié de moi !
Jeudi 15 décembre 81.
Voilà quatre semaines et deux jours que je suis malade. Je fais une scène à larmes au sous-Potain, qui ne sait comment me calmer ; car, quittant les calembredaines, coq-à-l'âne et autres choses exquises dont je régale son imagination, je me suis mise à me plaindre et à pleurer de vraies larmes, les cheveux tombés, et j'ai balbutié des griefs enfantins dans un langage de petite fille. — Et dire que je me suis montée à froid et que je n'en pensais pas un mot. Du reste, c'est comme lorsqu'il m'arrive de jouer certain rôle de comédie, je suis pour de bon pâle, et je pleure ; bref, il me semble que je ferais une actrice étonnante ; mais je tousse et n'ai pas le souffle nécessaire pour le moment.
Monsieur mon père est arrivé ce matin. Tout se passe très bien, il n'y a que la pauvre femme de Paul qui est toute démontée, sentant chez lui une indifférence frisant l'hostilité. Moi, je suis convenable, je lui donne une très belle émeraude que m'a donnée maman et dont je n'ai que faire.
J'ai eu un peu de regret après ; j'aurais pu la donner à Dina qui adore les bijoux, mais bast !
Je ne dis pas que papa soit embêtant, au contraire il me ressemble un peu d'esprit comme de corps (c’est un éloge); mais cet homme-là ne me comprendra jamais.
Imaginez-vous qu'il a le projet de nous emmener à la campagne pour Pâques !
Non ! C'est trop fort, et l'indélicatesse est trop grande avec ma santé, parler de me mener en Russie en février ou mars ! ! ! Je vous laisse apprécier. Passons ! Sans compter tout le reste ! ! ! Ah ! Non ! moi qui refuse d'aller dans le Midi ! Non, non, non. N'en parlons plus décidément.
Dimanche 18 décembre 81.
Après des plaintes à Julian en tête-à-tête, où il tâche de me consoler en me conseillant de faire tous les jours des esquisses sui les choses qui me frappent. — Ce qui me frappe ? — Et que voulez-vous qu'on trouve dans le milieu où je vis ? Breslau est pauvre, mais elle vit dans une sphère éminemment artistique. La meilleure amie de Maria est musicienne ; Schœppi est originale, quoique commune, et il y a en plus Sara Purser, peintre et philosophe, avec laquelle on a des discussions sur le Kantisme, sur la vie, sur le moi et sur la mort qui font réfléchir et qui gravent dans l'esprit ce qu'on a lu ou entendu ; tout, jusqu'au quartier qu'elle habite : Les Ternes. Mon quartier à moi, si propre, si uniforme où l'on ne voit ni une pauvresse, ni un arbre non taillé, ni une rue tortueuse. Bref, je me plains contre la fortune ?... Non, mais je constate que l'aisance empêche le développement artistique et que le milieu dans lequel on vit est la moitié de l'homme.
Mercredi 21 décembre 81.
Aujourd'hui, je suis sortie ! Oh ! en fourrure, les glaces levées, une peau d'ours aux pieds. Potain a dit ce matin que je pourrais sortir s'il faisait moins de vent et si je prenais des précautions. Le temps était splendide, — et des précauions !
Mais là n'est plus la question, c'est « Breslau tout entière à sa proie attachée » : — mon Salon est raté. Oui. Qu'aurais-je à opposer à son tableau de cet été ?
Cette fille est une force ; elle n'est pas la seule, d'accord ; mais nous sortons de la même cage, pour ne pas dire du même nid et je l'ai devinée et pressentie, et vous l'ai annoncée dans les premiers jours, moi ignorante et très ignorante alors. Je me méprise, je me haie, je ne comprends pas que Julian et Tony disent ce qu’ils disent. Je ne suis rien, je n'ai rien dans le ventre (0 Zola !). A côté de Breslau, je me fais l'effet d'une boîte de carton mince et cassante, auprès d’une cassette en chêne massif richement sculptée... Je suis désespérée de moi et si convaincue, que si j'en parlais aux maîtres, ça les gagnerait.
Mais je veux marcher tout de même, les yeux fermés et les mains étendues, comme quelqu'un de prêt à être englouti.
Jeudi 29 décembre 81.
Voilà huit jours que je n'ai écrit; ça vous démontre que ma glorieuse existence a roulé entre un peu de travail et des gens du monde. Rien de neuf ; pourtant si, je me porte bien, je sors ; je suis allée essayer des robes, et au bois, et chez Julian, samedi avec maman et Dina. Et dimanche à l'église, pour que l'on ne dise pas que je suis à la mort, comme la charmante Berthe le raconte partout.
Au contraire, je me remplume ; les bras, maigres, il y a dix jours encore, deviennent ronds, c'est-à-dire que, je vais bien mieux qu'avant ma maladie.
Encore huit jours comme cela et il faudra s'arrêter d'engraisser, je serai à point ; car je ne désire pas retrouver les hanches un peu brusques d'il y a trois ans. Julian, qui est venu hier soir, me trouve bien plus harmonieuse ainsi. Nous avons ri toute la soirée. Je fais le portrait de la femme de Paul ; hier, c'était une telle reprise de forces, que je voulais faire à la fois Dina, Nini et Irma. — Irma n'est pas un modèle ordinaire, c'est le type disparu, dit-on, — de la grisette ; elle est drôle et sentimentale avec des naïvetés de vice ! — « Quant vous serez devenue cocotte... » lui disais-je l'autre jour. — « Oh ! moi, a-t-elle répondu, je n'ai pas assez de chance pour cela ! » Elle pose avec intelligence ; on peut en faire ce que l'on veut, avec sa pâleur étonnante car elle est aussi bien une candide jeune fille qu'un abîme de dépravations, comme toutes ces coureuses.
Elle a demandé la permission de rester, bien que ne travaillant pas, et a passé l'après-midi à faire du crochet devant le feu.
Vendredi 31 décembre 81.
Toute la journée, tout le monde se querelle...
Enfin, je vais, pour me remettre, chez Tony et lui montre l'esquisse du portrait de la femme de Paul. Il l'a trouvée très originale, très originale d'arrangement et bien partie. Le très sympathique Tony s'est montré très enchanté de me voir en bonne santé ; et, après avoir causé gaiement, nous avons abordé le très grave sujet de l'Art et de Breslau, entre autres... « Son tableau est très bien, certainement, dit-il, elle est très bien douée. »
Ah ! ce papier est incapable de m'interpréter ! Tout le feu, toute la fièvre... Oh ! travailler nuit et jour, tout le temps, tout le temps, et faire quelque chose de bien ! ! ! Je sais bien qu'il dit que le jour où je voudrai, je ferai autant qu'elle ; je sais bien qu'il m'a gratifiée des mêmes qualités, mais je suis à pleurer, à mourir, à m'en aller n'importe où, où je pourrai... Mais, est-ce que je pourrai ? Ah ! Tony a confiance en moi, mais je n'ai pas confiance... Je suis dévorée du désir de bien faire et je sais mon impuissance... Là, je m'arrête. — Comme on me croit à la lettre, on n'aurait qu'à croire vraiment... Je le dis avec le désir d'être démentie...
Ah ! Seigneur, je vous écris tout cela et dépense mon temps à chercher de la littérature pour exprimer mes tracas, et Breslau, moins bête, dessine et travaille
1882
Lundi 2 janvier 82.
Ce qui me passionne, c'est ma peinture ; je ne me sens pas digne de dire « mon art » ; pour parler de l'art (et ses aspirations ou inspirations), il faut déjà être quelqu'un. Sans cela, on a l'air d'un amateur ridicule, ou plutôt il y a là..., je ne sais quoi d'indélicat qui blesse ce qu'il y a de supérieur dans ma nature ; c'est comme si on avouait quelque belle action... Une fausse honte, enfin.
Mercredi 4 janvier 82.
Julian passe la soirée à nous taquiner sur nos passions pour Tony et sur celles que nous lui inspirons. A minuit, nous prenons du chocolat. Dina, très gracieuse...; du reste, je comprends qu'on réserve ses grâces pour les connaisseurs.
Je me mets toujours avec un soin particulier pour les artistes, et tout autrement : — de longues robes sans corset, des draperies ; — dans le monde, on ne trouverait pas ma taille assez mince ni ma robe assez à la mode ; aussi toutes mes plus jolies fantaisies, trop extravagantes pour le monde, me serviront pour le ministère des Beaux-Arts... Je rêve toujours de me faire un salon plein de gens célèbres... ».
Vendredi 6 janvier 82.
L'art, même chez les plus humbles, élève l'âme et fait qu'on a quelque chose de plus que ceux qui ne sont pas de la sublime confrérie.
Mercredi 11 janvier 82.
Nous donnons une soirée demain, veille de notre jour de l'an ; il y a huit jours que cela est en train ; on a envoyé plus de deux cent cinquante invitations, car on en a demandé beaucoup, beaucoup parmi nos amis. Comme personne ne reçoit encore, c'est un événement, et je crois bien que nous aurons du monde très chic ; bref, ce sera très bien. Étincelle dit un mot dans son carnet du Figaro, en l'accompagnant d'un dithyrambe en l'honneur de Mlle Marie, jolie, peintre, etc., etc. Du reste, elle est charmante, elle n'aura rien écrit, que je lui trouverais encore la plus charmante des laideurs ; elle est plus séduisante que cinquante jolies femmes, et puis, marquée de ce je ne sais quoi de parisien, de personnalité connue. — Remarquez bien ce que je dis, car c'est très insaisissable ; — tous les gens en vue, célèbres, qu'ils soient femme ou homme, vieux ou jeune, ont tous une certaine note dans la voix, un certain air qui est le même chez tous et que j'appellerai l'air de famille de la notoriété.
Nous aurons les deux Coquelin. Coquelin aîné, l'ami de Léon, est venu hier voir les salons et s'entendre sur le choix des pièces. G. était là et il m'ennuyait avec ses airs connaisseurs ; encore un peu, et il donnait des conseils à Coquelin, qui est très agréable, — soit dit en passant — bon garçon et ne vous fait pas éprouver un instant cet embarras que bien des gens ressentent en face d'un étranger qui est quelqu'un.
Vendredi 13 janvier 82.
Les deux Coquelin ont été superbes et le salon présentait un coup d'œil charmant, une quantité de jolies femmes ; — d'abord, le ravissant trio, la marquise de Reverseaux, fille de Janvier de La Motte, Mme Thouvenel et Mme de Joly. La comtesse Kessler, presque toutes belles du reste... et, somme toute, comme dit Tony, qui n'est pas plus venu que Julian, des invités convenables. Mme G. était ravie et a fini par danser et valser, parole d'honneur, avec le comte Plater.
Il y a eu dîner d'abord.
Puis, comme artiste, le frère de Bastien-Lepage encore absent. Le frère, c'est toujours ça ; et jeudi, nous allons chez le vrai. Et Georges Bertrand... L'année dernière, il a fait un admirable, un émouvant tableau intitulé le Drapeau ; je l'ai apprécié dans ma chronique et il m'a envoyé quelques mots très aimables. Je lui ai envoyé une invitation de la part de « Pauline Orell ». C'est Pollak qui me le présente. C'est amusant, il me fait de grands compliments , car bien que je les eusse cachées, Dina a montré certaines études à qui de droit. Carrier-Belleuse fondait sous mes yeux, et en me regardant, vers la fin, il était tout ramolli et sentimental, en insistant sur la cruauté de la devise : Gloriæ Cupido.
Voilà un garçon capable de devenir très amoureux ; c'est peut-être déjà ; mais ça passera, il voit bien que Gloriæ Cupido — et rien d'autre.

On a soupé à trois heures. Gabriel à ma droite, il restait encore près de soixante personnes. Nini était charmante, jolie, des épaules magnifiques, une très belle robe, ainsi que Dina, maman et ma tante. J'ai porté une robe faite par Doucet et moi, de compagnie, la reproduction presque fidèle de la Cruche cassée, de Greuze. Des cheveux qui s'envolent, tordus à un petit chignon assez haut sur la nuque. Un grand cordon de roses du Bengale allant se perdre dans la jupe en s'effeuillant. Jupe toute plissée et courte en mousseline de soie. Corsage de satin merveilleux, lacé devant, très large, faisant des plis sur la taille sans pointe ; fichu noué de travers. Seconde jupe de mousseline doublée de satin, ouverte devant et retroussée en revers, formant paniers dont l'un rempli de roses. J'avais une mine charmante. Le sous-Potain odieux se promenait comme une ombre et m'attrapait pour que je ne danse pas.
Dimanche 15 janvier 82.
Il y a eu un grand article d'Étincelle sur notre soirée, mais, comme on s'y attendait, on n'est pas content. Elle me compare à la Cruche cassée et on craint qu'à Poltava cela ne passe pour une injure. On est trop bête ! L'article est très bien; seulement, comme elle avait dit, il y a deux jours, que je suis une des plus jolies femmes de l'empire russe, elle s’est contentée cette fois de décrire ma robe. De là, désillusion.
Je suis tout à l'art; je crois qu'en même temps que ma pleurésie, j'ai attrapé le feu sacré quelque part en Espagne ; je commence, d'ouvrière, à devenir artiste ; c’est une incubation de choses célestes qui me rendent un peu folle... Je fais des compositions le soir, je rêve d’une Ophélie. Potain m'a promis de me mener à Sainte-Anne voir des têtes de folles ; en outre, un Arabe, un vieil Arabe, assis et chantant avec une sorte de guitare, m'obsède, et je pense à un grand machin pour le Salon prochain, un coin de carnaval...; mais pour cela il faut aller à Nice. Oui, Naples pour le carnaval, bien ; mais pour exécuter mon machin en plein air à Nice, j’ai ma villa et... — Je vous dis tout cela et j'ai envie de rester ici.

Samedi 21 janvier.
Mme C.... vient nous prendre pour aller chez Bastien-Lepage. Nous trouvons là deux ou trois Américaines et le petit Bastien-Lepage, qui est tout petit, tout blond, les cheveux à la bretonne, le nez retroussé et une barbe d'adolescent. — On est tout démonté. — J'adore sa peinture et il est impossible de le regarder comme un maître. On a envie de le traiter en camarade et ses tableaux sont là pour nous remplir d’admiration, d'effroi et d'envie. Il y en a quatre ou cinq, tous grandeur nature et faits en plein air. C'est tout à fait beau ; un d'eux représente une gardeuse de vaches de huit à dix ans dans un champ ; — un arbre tout nu et la vache là-bas, c'est d'une poésie pénétrante, les yeux de la petite ont une expression de rêverie enfantine et campagnarde que je ne sais pas décrire. — Il a l'air d'un petit bonhomme très content de lui-même... ce Bastien !
Je rentre pour aider maman à recevoir une très grande quantité de monde. — Ce que c'est que de donner des soirées à Paris, vous voyez ! dit une de nos amies.
Dimanche 22 janvier.
Je suis possédée pour le moment par le carnaval, je fais des esquisses au fusain. Si on avait du talent, ce serait beau à faire.
Vendredi 27 janvier 82.
Gambetta est tombé, c 'est-à-dire qu'il n'est plus ministre ; mais cela n'est rien, à mon avis.
Seulement, admirez dans ce qui se passe la lâcheté et la mauvaise foi des hommes ! Ceux qui mangent Gambetta, les meneurs intransigeants, ne pensent pas un mot de toutes ces accusations idiotes de dictature.
Ah ! je serai toujours révoltée par les infamies qui se commettent tous les jours !
Lundi 30 janvier 82.
C'est décidément à la villa Géry que nous irons à Nice. Quant à samedi, j'ai eu une bonne journée. Baslien, que j'avais vu au bal, la veille présidé par la reine, à l'Hôtel Continental, au profit des sauveteurs bretons, est venu et est resté plus d'une heure ; je lui ai montré des choses de moi, et il m’a donné des conseils avec une sévérité flatteuse. Du reste il a dit que j'étais merveilleusement douée. Cela n'avais pas l'air d'une complaisance ; aussi j'ai eu un mouvement de joie si violent que j'étais sur le point de saisir le petit bonhomme par la tête et de l'embrasser.
C'est égal, je suis bien aise de l'avoir entendu. Il a donné les mêmes conseils que Tony et Julian, et dit les mêmes choses. Du reste, n'est-il pas élève de M. Cabanel ? Chacun a son propre tempérament, mais quant à la grammaire de l'art, il faut toujours aller la chercher chez ce que l'on nomme les classiques. Bastien ni aucun autre ne peuvent enseigner leurs qualités ; on n'apprend que ce qui s'apprend, le reste dépend de soi.
Mme de Péronny (Etincelle) est arrivée et j'ai passé un bon quart d'heure entre cette femme supérieure et ce grand artiste, devant ma cheminée et puis sous le palmier, me gonflant de vanité et de plaisir. — Je ne m’occuperai pas des autres visites que j'ai laissées au salon officiel, avec maman.
*
* *
Nice — Nous sommes partis à huit heures du soir, Paul, Dina, moi, Nini, Rosalie, Basile et Coco. La villa Géry est tout ce qu'il faut, et en pleine campagne, et à dix minutes seulement de la promenade des Anglais : — une terrasse, des jardins, une grande maison confortable.
Nous trouvons tout préparé et le gérant, M. Pécoux, avec des bouquets.
J'ai fait ce soir une course en tramway qui m'a enchantée ; c'est la gaieté française mélangée d'Italie, moins le genre canaille de Paris. — Comme je l'écris à Julian, c'est aussi commode que Paris, aussi pittoresque que Grenade ; à cinq mètres de la promenade des Anglais, on trouve des costumes, des guenilles, des types, et tout cela est d'un ton ! Pourquoi aller en Espagne ! 0 Nice ! 0 Midi, Méditerranée ! 0 mon pays aimé, qui m'a tant fait souffrir ! 0 mes premières joies et mes plus gros chagrins ! 0 mon enfance, mes ambitions, mes grâces !
J'aurai beau faire, ce sera toujours là le commencement de tout, et, à côté des souffrances qui ont noirci mes quinze ans, il y aura toujours les souvenirs de la première jeunesse, qui sont comme les plus belles fleurs de la vie.
Mardi 7 février 82.
Je suis cuite. — Wolff consacre une dizaine de lignes des plus flatteuses à Mlle Breslau.
Ce n'est du reste pas ma faute. On fait comme on est doué. Elle est uniquement à son art ; moi, je m'invente des robes, je rêve à des draperies, à des corsages, à des revanches dans la société niçoise ; je ne veux pas dire que j'aurais son talent si je faisais comme elle ; elle suit son naturel, moi le mien. Mais j'en ai les bras coupés. — C'est que je sens mon impuissance, au point de vouloir y renoncer à tout jamais. — Julian disait que j'en ferais autant si je voulais. — Vouloir : mais pour vouloir, il faut encore pouvoir. Ceux qui réussissent avec je veux sont à leur insu soutenus par des forces secrètes qui me manquent. — Et dire que, par moment, j'ai non seulement foi dans mon talent à venir, mais que je sens le feu sacré du génie! ! ! 0 tristesse !
Au moins ici, il n'y a de la faute à personne, c'est moins enrageant. Rien d’horrible comme de se dire : Sans celui-là ou sans ceci, je l'aurais peut-être. — Je crois faire tout ce que je puis et je n'arrive à rien.
0 mon Dieu, faites que je me trompe et que la conscience de ma médiocrité ne soit qu'une injustice !
Vendredi 10 février 82.
Ca été un coup si rude que je viens de passer trois journées vraiment malheureuses.
Je ne fais plus mon grand tableau, mais des choses plus raisonnables, plus simples et des études. — Une résolution solennelle de ne plus perdre une minute et de ne plus faire un trait en l'air. — Me concentrer. Bastien me le recommande ainsi que Julian, ainsi que l'heureuse Breslau. Oui, vraiment heureuse, et je donnerais pour l'être autant qu'elle, sans hésiter, tout ce qu'on appelle mes bonheurs et mes richesses. — 40,000 fr. de rente pour être indépendante, et du talent ; avec cela, on a tout.
C'est égal, elle est terriblement heureuse cette fille ! Je me sens si malheureuse chaque fois que je pense à cet article de Wolff ! Pourtant, ce n'est pas ce qu'on nomme l'envie. Je n'ai pas le cœur à analyser cela et à chercher des expressions littéraires...
Lundi 13 février 82.
Depuis samedi, j'ai commencé un tableau. Voilà quinze jours que je cherche. Je m'étais arrêtée à deux ou trois choses, mais cela n'est pas allé au delà de la seconde séance. C'est toujours ainsi quand ce n'est pas cela...
On se résigne à un sujet pour ne pas perdre de temps en recherches, puis on croit tenir ; du reste, ce qui est cherché réussit rarement ; cela ne réussit pas toujours non plus lorsque c'est trouvé, mais au moins on a eu le plaisir d'avoir été empoigné. Quand donc me persuaderai-je que le sujet n'est rien en des mains malhabiles ?
Pourtant, même pour de simples études, il faut que ce que vous faites vous plaise ; tenez, me disant que le sujet ne doit pas préoccuper, j'avais entrepris un tableau qui m'a rendue très malheureuse pendant quatre ou cinq jours ; je n'osais pas le lâcher et je n'avais pas le cœur de travailler ; depuis que j’y ai renoncé, je me sens délivrée ; je fais des esquisses, de l'aquarelle pour la première fois ; toutes mes minutes sont prises et j'ai trouvé mon tableau ; car, excepté les petites choses, il faut que je rapporte une grosse étude à Julian. Ce sont trois gamins auprès d'une porte cochère. Cela me paraît extrêmement vrai et amusant. Le coup de l’article de Wolff m'a fait du bien ; j'ai été écrasée, anéantie, et la réaction m'a fait comprendre des choses en art, qui me tourmentaient, parce que je ne les trouvais pas, tout en me doutant de leur existence. Cela m'a fait faire un effort salutaire ; je commence aussi à comprendre ce que je lisais, des luttes, souffrances, etc., etc., des artistes ; j'en riais comme d'un romantisme creux. Cette fameuse volonté de Breslau, j'y ai fait appel et je vois qu'il faut faire de grands efforts pour obtenir ces résultats que je croyais tombés du ciel. C'est que je n'ai eu aucun effort véritable à peu près jusqu'à présent. Cette extrême facilité de travail m'a gâtée. Breslau obtient de beaux résultats, mais très laborieusement ; moi, lorsque cela ne vient pas tout de suite et tout seul, je reste stupide. Il faut vaincre cela. Ainsi pour les esquisses, les compositions au fusain, j'ai essayé de me forcer à pousser cela jusqu'à la netteté voulue, et j'ai réussi à faire des chose dont je me croyais incapable, et que je croyais que les autres faisaient avec des trucs et presque des sortilèges, tellement on accorde difficilement aux autres les facultés qu'on n'a pas.
Si je pouvais continuer à travailler comme ces jours-ci, je serais bien heureuse ! Il ne s'agit pas seulement de travailler comme une machine ; mais être occupée tout le temps et penser à ce qu'on fait, c'est le bonheur. Aucune préoccupation n'y résiste. Et moi qui me plains si souvent, je viens rendre grâce à Dieu de ces trois jours, tout en tremblant que ça ne dure pas.
Tout change d'aspect alors, les petites misères ne tracassent presque plus ; on est au-dessus de cela, avec, quelque chose de radieux dans son être : une divine indulgence envers la vile multitude qui ignore les causes secrètes, changeantes, ondoyantes et diverses, de votre béatitude plus fragile que la plus fragile des fleurs.
Mardi 14 février 82.
Ah ! que nous autres qui avons lu Balzac, et qui lisons Zola, nous avons de jouissances d'observation !
Mercredi 15 février 82.
C'est petit à petit que les yeux s'ouvrent ; avant, je ne voyais que le dessin et le sujet des tableaux ; à présent... ah ! à présent si je faisais comme je vois, j'aurais du talent. Je vois le paysage, je vois et j'aime le paysage, l'eau, l'air, la couleur, — la couleur !
Dimanche 19 février 82.
Si vous saviez quels tourments ! Je lutte contre la paresse et contre ce terrible ce sera mauvais qui m'empêche de rien faire. — Et j'ai des remords cuisants pour chaque heure perdue... Et pourquoi ne fais-tu pas des croquis, et ceci, et cela ? Et quand je vois les dessins de la Vie moderne, je deviens rouge et pâle, et je voudrais du premier coup faire comme ces gens qui en font depuis dix ans, ne comprenant pas qu'il faut en faire toujours et encore, et de mauvais, et continuellement, pour en faire de bons ensuite. Ah ! quel terrible et dangereux moment lorsqu'on sort du travail réglé et mécanique de l'atelier, et qu'on sent la nécessité de s'assouplir, se morceler pour ainsi dire, faire de tout ; être livré à soi-même, comprendre ce qu'il faudrait, savoir ce qui manque. Avoir conscience de son état !
C'est bon signe, mais c'est diablement tourmentant...
Voilà plusieurs mois déjà que cela dure et cette lutte de tous les instants serait abominable si on n'avait un vague espoir que cela mène peut-être vers quelque belle série de mois de travail fécond, calme, réfléchi, qui vous ouvrira des horizons nouveaux, et puis...
Je me rappelle il y a deux ou trois ans... L'heureuse Breslau a passé par les mêmes tourments que moi ; pendant des mois entiers, elle ne pouvait sortir de rien et je lui ai vu des samedis horribles, — prête à faire de la sculpture par désespoir...
Lundi 27 février 82.
Après mille tiraillements, j’ai crevé ma toile. Les gamins ne posaient pas ; mettant ces insuccès sur le compte de mon incapacité je recommençais toujours, et enfin... c'est bien heureux ; ces affreux monstres remuaient, riaient, criaient, se battaient... Je fais tout bonnement une étude pour ne plus être torturée par les tableaux ; tout ce que j'entreprenais devenait, au bout de vingt-quatre heures poncif ou romance, ou banal, ou maladroit, ou prétentieux, après m'avoir beaucoup plu... Du reste, il vaut mieux faire de simples études ; je suis dans un passage si critique, et que de temps perdu : Biarritz, la maladie et un mois déjà ici !
Si je n'y avais couru comme une sotte après les tableaux, ou plutôt si je n'avais pas été moitié assommée par les quelques lignes de Wolff pour Breslau... Il n'y a qu'un moyen de me remettre sur pied, c'est de rapporter des choses qu'on trouvera très bien; mais voilà !...
Paris. Jeudi 20 avril 82.
Eh bien, ce n'est pas comme après l'Espagne, je ne suis pas ravie de revoir Paris, seulement contente... Du reste, je ne puis me rendre compte d'aucun sentiment, tellement je suis inquiète de mon travail. Je tremble en pensant à ce qu'on dira et je suis écrasée par le souvenir de Breslau, qui est traitée parle public comme une artiste arrivée. J'ai été chez Julian hier (nous sommes à Paris depuis hier matin) et il ne me traite plus comme une travailleuse sérieuse ; — brillante oui, mais pas de fond, pas de volonté ; — il aurait désiré plus, il avait espéré autre chose. Tout cela, tout en causant, me fait beaucoup de mal ; j'attends qu'il voie mon travail de Nice et je n'espère plus rien de bien.
J'ai fait la Thérèse, une enfant de six ans allant aux provisions, dans une allée de ferme, grandeur nature ; puis un vieillard à sa fenêtre à côté d'un pot d'œillets roses, grandeur nature, puis un gamin portant un sac, grandeur nature, mi-corps ; — un paysage sur toile de 1m30, — un autre sur toile de 1m10, — trois marines — cinq ou six petites études et quelques dessins au fusain ; en outre deux pastels pas finis et des dessins à la plume dans l'album.
Je ne sais pas si c'est bien ou horrible, et toutes ces peurs me font passer comme du feu sur toute la peau du corps.
Samedi 22 avril 82.
Non, voyez-vous, ce qu'il faudrait pour que je vive, moi, ce serait avoir beaucoup de talent. Je ne serai jamais heureuse comme tout le monde. Etre célèbre et être aimée, comme écrivait Balzac, voilà le bonheur !... Et encore être aimée n'est qu'un accessoire ou plutôt le résultat naturel d'être célèbre. Breslau est maigre, biscornue, ravagée, quoique avec une tête intéressante, aucune grâce, et garçon, et seule !
Elle n'arrivera à être un peu femme que si elle a du génie; moi, si j'avais son talent, je serais comme personne à Paris... Mais il faut que cela vienne... Dans le désir fou que cela vienne, il me semble voir comme un espoir que cela viendra.
Cette absence, ce travail interrompu... ne plus avoir de conseil, d'encouragement... on s'y perd !... On a l’air de revenir de la Chine, on n'est plus dans le mouvement.
Ah !... je crois que je n'aime rien comme la peinture, qui, à mes yeux, devait me donner les autres bonheurs ! Fausse vocation, fausse disposition, fausse espérance ! Ce matin, je suis allée au Louvre et tenez, je me calomnie, on doit pouvoir rendre quand on voit comme moi. Avant j'avais la confiance de l'ignorance, mais depuis quelque temps mes yeux s'ouvrent. — Ce main, c'est le tour de Paul Véronèse qui m est apparu dans toute sa splendeur et tout son éclat ; cette richesse inouïe de tons ! comment expliquer que ces splendeurs me soient apparues jusqu'ici comme des grandes toiles ternes, grises et plates ?... Ce que je ne voyais pas, je le vois à présent... Les toiles célèbre que je regardais par respect humain seulement, me charment et me retiennent ; je sens les finesses des coloris, j'apprécie la couleur, enfin ! !
Un paysage de Ruysdael m'a fait revenir deux fois sur mes pas... Il y a quelques mois, je ne voyais là rien de ce que j'y vois ce matin : — de l'air véritable... de l'espace, — enfin, ce n'est pas de la peinture, c'est la nature vivante. Eh bien, puisque toutes ces beautés que je ne voyais pas, je les vois à présent, c'est que mes yeux se sont exercés ; il se peut donc que le même phénomène se produise dans la main.
Je ne veux pas dire que, jusqu'à l'Espagne, j'ai été absolument de bois, mais il est certain que ce voyage m'a ôté un voile des yeux... Eh bien, maintenant, il faut travailler à l'atelier ; je fais assez de choses indépendantes pour m'assouplir la main pour le moment, à présent, il faut devenir un exécutant de première force et faire un tableau...
Dimanche 23 avril 82.
Je viens de passer quelques minutes devant mes études de Nice. La seule pensée que peut-être on y trouvera quelque chose de bon me fait passer un frisson dans le dos. Car Tony, Julian, Bastien me paraissent si mesquins, si peu de chose à côté de l'effet immense que peuvent produire pour moi leurs paroles !
Il n'y a de vraies anxiétés et de vrais bonheurs que dans les choses de la gloire. Quel grand mot !
Ma vie ne se dessine pas. Lundi, j'irai à l'atelier pour m’y remettre. On dirait que je suis oisive depuis des mois et qu'un malheur est arrivé.
Je n'ai pas donné tout ce que je pouvais; je me pressais de rentrer à Paris... J'ai encore bâclé ! ! ! Ces pensées me passent dans la tête comme de gros nuages, qui m'enveloppent d'angoisses, qui me donnent froid et me font passer comme des langues de feu dix fois par heure...
Le ciel est gris, orageux, il pleut, un vent brûlant ; il se passe dehors ce qui se passa en moi... effet physique alors !
Mais j'avais autre chose à dire : je ne sais plus quelle considération sur l'amour, à la suite d’une lecture faite ce matin.
L'amour, voilà l'éternel sujet. Se laisser aimer par un homme qui ait assez de désavantage pour vous considérer en déesse descendue du ciel, cela aurait un certain charme... Quelqu'un qui reconnaisse son humilité... Savoir que d'un regard on verse des milliards de félicité !... Il y a là un côté charitable qui flatte les générosités qu'on peut avoir.
Mardi 25 avril 82.
Mon inquiétude me suffisait et je n'avais nul besoin de voir les têtes anxieuses de ma famille, me regardant pour voir si j'ai de l'émotion. En somme, voilà ce que Tony a dit : — Le costume de Dina déguisée, très bien, très bien. — le bonhomme au bord de la mer, très bien aussi ; idem, la tête de Thérèse, pas mal du tout ; seulement, les valeurs du paysage par rapport à la robe, pas justes ; le petit paysage, très bien ; les vêtements du vieux, très bien ; le vieux, bien dessiné, mais pas assez simple et pas assez autre chose ; en somme, il y a du bon... Eh bien ! direz-vous, tu dois être contente ? Ah ! il a encore ajouté qu'il me faut faire une étude très serrée et qu'il me suis très attentivement de près et qu'il est à ma disposition chaque fois que je l'appellerai. Eh bien ! ensuite on lui a fait prendre au salon une tasse de bouillon, en quêtant une tirade sur mon immense talent. — Seulement, comme à cinq heures il était attendu à la commission du Salon (c'est même pour cela qu'il a choisi ce jour pour venir ici, ayant à aller au Salon qui est à côté), donc comme il était très pressé, il s'est contenté d'adresser de malheureux remerciements pour le verre de Marsala et le bouillon, et a filé au plus vite. — Alors ma tante dit qu'il est un imbécile et ne comprend rien ; maman ajoute qu'il est vraiment étonnant que je sois ainsi anéantie. — C'est vrai que j'avais l'air ennuyée à cause de leurs anxiétés curieuses... Il paraît que tout les mères sont ainsi ; mais ça n'en est pas moins embêtant pour cela. — Enfin, je suis enivrée au point de pleurer et viens verser le trop plein de ce pauvre cœur ici.
Je devrais être contente... Non, je suis presque anéantie et maman a presque raison... Ça ne suffit pas... je voulais qu'il me dit, cet homme... Pour que je ne sois pas anéantie il eût fallu qu'il dît : A la bonne heure ! Ca y est cette fois, c'est bien ça, vous êtes aussi forte que Breslau et vous avez plus de qualités qu'elle.
Tout ce qui n'est pas les paroles susdites ne pouvait pas me contenter ou même me tirer du désespoir où je me trouve depuis un an, à cause de ma peinture Il a bien dit, en voyant le bonhomme au bord de la mer, que c'est très bien, très bien ; puis, indiquant la valeur du vêtement par rapport à l'horizon, que c'était très bon ; ainsi que le petit paysage, qu'il a regardé plusieurs fois ; ainsi que le pastel de Dina et le mien, qui est à moitié bon ; et la tête de Thérèse, qui n'est pas mal du tout. Enfin, qu'est-ce que je demande alors ? Je ne sais pas... Et d'abord, il était trop pressé ; il me semble qu'il n'a pas assez regardé... J'aurais voulu qu'il me fit une longue tartine sur mes dispositions extraordinaires.
Comment tous ces bien ne me satisfont pas, quand je garde encore sur le cœur le très bien accordé à Breslau, pour un petit tableau qu'elle a fait en Bretagne, il y a deux ans !
Et quand il me dit la même chose pour mon petit tableau à moi, fait à Nice, il me semble que ça n'a pas la même valeur. Pourquoi ? Avant mon départ pour Nice, il m'a dit que la pêcheuse de Breslau est très bien. A présent que cette même pêcheuse est reçue avec le numéro 3, il m'a dit que ce n'est pas mal seulement. Enfin... je ne suis pas contente. Pourquoi ? D'abord parce que ma famille fondait des espérances si extravagantes sur ces quelques études que les compliments les plus fous étaient seuls capables de la satisfaire, et ensuite, effet du printemps, nerfs. Quand je suis surexcitée ainsi, le bras me brûle au-dessus du coude, c’est assez drôle. — Savants docteurs, expliquez !
Samedi 29 avril 82.
Je ne suis pas artiste, j'ai dessiné sans peine comme j'ai fait tout, mais je ne puis... pourtant, quand j'étais enfant, à trois ans, je dessinais des profils à la craie sur les tables de whist à la campagne, et puis, après et toujours... On jurerait que c’était une vocation... et vous voyez !... Mais je n’ai rien à dire, seulement voilà des moments à passer ; les bras me tombent. Au bout du compte, qu'est-il arrivé ? Mais rien... Breslau travaille depuis plus longtemps que moi, presque deux fois... En admettant que je sois aussi douée qu'elle, les choses marchent donc naturellement ; mais il y a trois ans que je peins, moi ! mais y a plus de cinq ans qu'elle peint, elle.
Dimanche 30 avril 82.
Dès le matin, je suis au vernissage avec Villevieille, Alice et Webb. En noir, très gentille. Je m'amuse à voir que je connais pas mal de monde dans ce tout Paris. Carolus Duran vient me parler — très aimable — cet homme est un charmeur. Le tableau de Breslau est placé tout en haut et fait un effet déplorable. J'étais si inquiète du succès qu'elle devait avoir, que c'est un grand soulagement ; je ne le cache pas. Les intimes éplorés viennent savoir mon opinion, et je leur dis que ce n'est pas beau, mais qu'on aurait dû lui donner une meilleure place.
Le résultat de cette brillante journée, c'est notre conversation avec Julian, où il me reproche de me gaspiller, de ne pas justifier les magnifiques promesses..., etc. Enfin, il me croit noyée, moi aussi, et nous allons tâcher de me repêcher ; je lui dis bien que je me rends compte de cet état déplorable et que cela me désespère et que je me crois finie ; il me rappelle comme j'étais forte et qu'une ébauche qu'il a arrête tout le monde chez lui... et enfin. Ah ! mon Dieu, sortez-moi de là, sortez-moi de là ! Dieu, j'allais dire que... Dieu était bon pour moi en permettant que je ne sois pas tout à fait tuée par Breslau, au moins pour aujourd'hui. Enfin, je ne sais comment dire pour que cela n'ait pas l’air d'un sentiment bas. Si le tableau avait été comme je me suis imaginé, ce serait- ma fin... dans l’état piteux où se trouve mon travail... Je n'ai pas un seul instant souhaité que ce fût mauvais, ce serait ignoble; mais je tremblais tant de voir éclater un formidable succès ; j'avais de telles émotions en ouvrant les journaux, que Dieu a eu peut-être pitié de moi...
Mardi 9 mai 82.
Tony et Julian dînent ici. Je me mets en toilette fantastique et la soirée se prolonge jusqu'à onze heures et demie. Julian est très drôle après le champagne et Tony très gentil, très sobre, très calme avec sa belle tête fatiguée. On a envie de remuer cette âme qui a l'air tendre et mélancolique, tout en demi-teinte. Je ne me figure pas ce professeur envahi par des sentiments accentués ; il est logique, il est calme et, s'il s'agissait de choses du cœur, il vous en démontrerait la provenance et la cause posément comme pour expliquer les valeurs d'un tableau. Somme toute, et pour nous résumer, comme il dit, il est charmant...
C'est le portrait de jeune fille par Sargent qui me hante; il est ravissant. C'est une œuvre exquise qu'on placerait volontiers dans un musée avec des Van-Dyck et des Velazquez.
Samedi 20 mai 82.
Ah ! je suis découragée. Qu'est-ce que je fais depuis que je suis à Pars ? Je ne suis même plus excentrique... Et en Italie, qu'ai-je fait ? Une fois, je me suis laissé embrasser en cachette par le stupide A... Eh bien ! après ? Moi, ça me dégoûte ? Mais pas mal de jeunes filles l'ont fait et le font, et on n'en lit pas d'horreurs. Je vous assure que lorsqu'il m'arrive comme cela des bribes de ce que l'on dit de nous et de moi, j'éprouve de la stupeur, tellement c'est immense.
Le procès a été désastreux, mais c'est fini. Alors c’est autre chose, c'est moi qu'on attaque... Et lorsque, bien tranquille et seule dans ma chambre, au milieu de mes livres, après avoir travaillé huit ou dix heures, :je songe à ce qu'on peut raconter de moi ; que je suis moralement arrachée de ce milieu sépulcral, déshabillée, commentée, défigurée; qu'on me prête des pensées, des actes... On me donne vingt-cinq ans et l'on me prête une indépendance blessante que je n’ai jamais eue. Eh bien ! les bras en tombent et l'on a envie de pleurer.
Hier, nous avons été au Salon avec G..., le frère de Bastien et Beaumetz. Bastien-Lepage va faire un tableau qui représentera un petit paysan regardant un arc-en-ciel; ce sera sublime, c'est moi qui vous le dis. Quel talent, quel talent !
Lundi 22 mai 82.
Je crois bien que je n'aimerai jamais... qu'un seul... et celui-là, il est probable qu’il ne m'aimera jamais. Julian a raison; pour prendre ma revanche, il faudrait une supériorité écrasante..., faire un mariage immense, avec un grand de ce monde, et riche et connu. Ce serait beau ! ou bien avoir un de ces talents à la Bastien-Lepage, qui ferait retourner sur mon passage les têtes de tout Paris. Je suis charmante : j'en parle comme si cela pouvait m'arriver ! Je n'ai que des malheurs. 0 mon Dieu, mon Dieu faites que je prenne enfin ma revanche !... Je serai bonne pour tout ce qui souffre...
Jeudi 25 mai 82.
Ce matin, nous avons été chez Carolus Duran. Quel être étonnant et charmant ! On en rit un peu parce qu'il fait de tout.. Qu'est-ce que ça fait ? Il tire très bien, il monte à cheval, il danse, il joue du piano, de l'orgue et de la guitare ; il chante. On dit qu'il danse mal ; mais pour le reste, il le fait avec une grâce infinie. Il se croit Espagnol et Vêlazquez. Un physique très séduisant, une conversation enveloppante, et dans toute sa personne, quelque chose de si bon garçon, un si grand contentement de soi même, tant de. franchise et de bonheur dans l'admiration de sa propre personne, qu'on ne lui en veut pas, au contraire. — Et si par moment on sourit, on est tout de même conquis, surtout lorsqu'on pense à tous ceux qui se gobent, sans avoir le quart de ce qu'il a.
Il se prend absolument au sérieux ; du reste, mettons-nous à sa place : qui n'aurait pas la tête un peu tournée ?
Ce matin, l'atelier n'a pas désempli ; le jour venant d’en haut donne quelque chose de recueilli à l’atelier très moderne ; les visiteurs ont l’air solennel et admiratif, et Carolus joue au maître avec un faux air de faune dans Don Juan ou Rigoletto ; va de groupe en groupe, les moustaches en crocs, le jarret tendu, la barbe diabolique, les cheveux inspirés et, de temps en temps, va écrire quelque chose à son bureau. Le regard hagard et frottant la main au front comme pour y comprimer le génie. — Il est exagéré, c’est évident ; mais je suis toujours charmée, lorsqu'on se taille une personnalité intéressante qui vous fait penser à des temps romanesques disparus. Ce mélange de musique, de brosse et d'épée est très amusant, et si par le temps qui court, cela prête un peu à rire, tant pis pour ceux qui rient ! Carolus Duran a raison ; d'autant plus que son talent justifie sa pose et ses prétentions.
Et puis, c'est un être aimable avec toutes les femmes, à ce qu'on dit. — Il dit des banalités qui plaisent.
— Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau l’autre jour au Salon ? lui ai-je demandé.
— Vous y étiez, que pouvait-on y regarder d'autre ?...
Ou bien, comme je me plaignais de la peinture…
— Ah ! l'art est terrible !... Vous voudriez qu’il fut à vos pieds, comme les hommes prosternés dans la poussière. Eh bien, non ! il vous résiste et vous l’adorez.
Poseur, cabotin, tout ce que vous voudrez ! Je ne vous cacherai pas que j'ai horreur des gens ternes, et tant pis pour ceux qui ne voient que le côté comique de ces natures exceptionnelles, cabotines, poseuses mais charmantes ; vous m'opposerez des talents supérieures qui restent modestes et tranquilles, ah ! tant pis pour eux et pour nous !
Lorsque le ciel vous gratifie de tous ses dons, vous êtes un être incomplet, si vous restez dans votre coin au lieu de profiter de votre valeur réelle pour faire un peu de cabotinage, comme disent les imbéciles vulgaires.
Vendredi 26 mai 82.
Les récompenses accordées sont révoltantes ; celle de Zilhardt est une des mieux justifiées. — Mais il y en a d'autres, c'est écœurant et cela vous remplit de tristesse !
Il semblerait que les artistes devraient être plus consciencieux et plus honnêtes que les autres hommes. Eh bien ! pas du tout, et j'en suis attristée.
Dimanche 28 mai.
La duchesse de Fitz-James est venue dire qu'elle nous présenterait le soir chez sa belle-fille. Il y avait bal. Maman assure que cette dame est tout ce qu'il y a de plus aimable. Elles se voient assez souvent, mais je ne sais rien au juste. Donc, nous allons la prendre et arrivons ensemble.
C’est tout ce qu'il y a de plus chic : du vrai monde, de vraies jeunes filles, ravissantes et fraîches. De vraies toilettes. La vieille duchesse a je ne sais combien de neveux et de petits-enfants. Les noms que j'ai entendu prononcer sont les plus connus et les plus aristocratiques, et le peu de personnes que je connais sont ce qu 'il y a de plus élégant. Quant à moi, tout enchantée de me trouver dans ce salon, je pensais tout le temps à un pastel fait le matin et qui me poursuivait, comme mauvais.
Du reste, on ne peut pas sortir comme cela... Il me faudrait deux mois au moins de monde pour m'y entraîner. Mais au fond, pensez-vous que cela m'amuse ?.. Est-ce assez bête, assez creux, assez terne ! Et dire qu'il y a des gens qui ne vivent que de cela ! Moi, j'en voudrais rarement; juste assez pour être dans le mouvement, mais comme les hommes célèbres par exemple, qui n'y vont que pour se délasser; assez pourtant pour ne pas avoir l'air hottentot ou habitant de la lune.
Lundi 29 mai 82.
Donc hier nous sommes allées au bois avec Adeline, qui dit que nous voilà lancées dans la société la plus aristocratique de Paris, et aujourd'hui nous faisons des visites à la reine, aux deux duchesses de Fitz-James, à la comtesse de Turenne, à Mme de Briey et enfin à l'Américaine.
J'ai vu Julian le matin ; il trouve le grand pastel de Dina très bien.
Mais il s'agit d'un grand tableau pour l'année prochaine ; seulement l'idée n'empoigne pas Julian, boulevardier et ne donnant pas là-dedans. Moi, je suis très empoignée et n'ose pas le dire, car ce n’est permis qu'à ceux qui ont du talent d'être empoignés, de se monter la tête sur un sujet. De ma part, c’est prétentieux et ridicule. J'avais songé à un épisode du carnaval... et j'y renonce. Ce ne serait qu'un étalage de couleur... Ce que je veux faire, je le sens profondément ; je suis prise au cœur et à la tête, et voilà des mois déjà presque deux ans... Je ne sais pas si je serai assez forte cet hiver pour le bien faire.. Eh bien ! tant pis, ce sera un morceau de peinture médiocre, mais ça aura toutes les autres qualités de vérité, d'émotion et de sentiment. On ne peut pas mal faire quelque chose qui vous remplit l'âme, surtout quand on dessine bien Enfin c'est lorsque Joseph d'Arimathie a enseveli le corps de Jésus et qu'on a roulé la pierre devant le sépulcre ; tout le monde est parti, la nuit tombe et Marie Madeleine et l'autre Marie restent seules assises devant le sépulcre.
C'est un des plus beaux moments du drame sublime, et des moins exploités.
Il y a là une grandeur, une simplicité, quelque chose d'épouvantable, de touchant et d'humain. — Je ne sais quel calme formidable ; l'épuisement de douleur des deux pauvres femmes... Il reste le côté matériel à étudier...
Samedi 3 juin 82.
Le concours est jugé ; c'est une plaisanterie, il n'y en a que deux de classés et les plus mauvais ; pas de médailles. Je crois que les professeur. se moquent de nous.
De trois à cinq heures, nous quêtons sur le grand escalier du Salon ; je suis charmante en robe Louis XV, rose pâle et velours mousse. Pas mal de monde, la reine Isabelle, très gracieuse pour moi ; puis des amis et la sympathique Américaine, qui donne 20 francs. Du reste, tous les passants me donnent. Quand je ne suis pas tourmentée, j'ai quelque chose de gentil qui attire le monde. Trois jeunes artistes qui avaient passé assez vite se sont consultés après m'avoir regardée, et l'un d'eux est revenu pour me donner 40 sous. C'est assez gentil, car on fuit les quêteuses et on court à toutes jambes, obligé qu'on est de passer entre leurs rangs. A cinq heures, chez la duchesse ; elle nous mène chez la vicomtesse de Janzé, qui a un hôtel rempli de merveilles et qui est une des reines de Paris, comme disait Balzac. Et après, au Bois, avec la duchesse de Fitz-James et sa petite-fille, Mlle de Charette.
Jeudi 8 juin 82.
Il est plus de quatre heures, il fait grand jour ; je ferme hermétiquement les volets pour me faire une nuit artificielle, tandis que les blouses bleues des ouvriers passent dans la rue, allant au travail déjà. Pauvres gens ! Il pleut avant cinq heures du matin ; ces malheureux peinent, et nous qui geignons sur nos malheurs, avec des dentelles de chez Doucet ! Voilà que je fais une phrase commune et une banalité. Chacun dans sa sphère souffre et se plaint, et chacun a de bonnes raisons pour cela. Moi, à l'heure qu'il est, je ne me plains de rien, car si je n'ai pas de talent, personne n'en est coupable. Je ne me plains jamais que de choses injustes, pas naturelles, détestables comme une quantité de choses dans le passé... et dans le présent encore, bien que pourtant cet isolement soit un bien qui me mènerait peut-être au talent. Heureux Carolus Duran, qui est célèbre et qui se croit le plus sublime artiste de tous temps !
Je veux partir pour la Bretagne et y travailler.
Mardi 20 juin 82.
Eh bien ! rien de neuf. Quelques visites échangées et la peinture... et l'Espagne. Ah ! L’Espagne ! c'est un volume de Théophile Gautier qui est cause de tout cela. Est-ce possible ? Comment ! j'ai passé à Tolède, Burgos, Cordoue, Séville, Grenade ? Grenade ! Comment ! j'ai parcouru ces pays dont les noms seuls sont une noblesse à prononcer, eh bien ! c'est de la fièvre. Y retourner ! Revoir ces merveilles! Y retourner seule ou avec des semblables ; ai-je assez souffert d'y avoir été en famille ! 0 poésie ! ô peinture ! ô Espagne ! Ah ! que la vie est courte ! Ah ! Que l'on est malheureux de vivre si peu ! Car habiter Paris n'est que le point de départ de tout. Mais faire de ces sublimes voyages, voyages de délicats, d'artistes ! Si mois en Espagne, en Italie ! Italie, terre sacrée, Rome divine, incomparable ! j'en perds la tête.
Ah ! que les femmes sont à plaindre, les hommes sont libres au moins. L'indépendance absolue dans la vie ordinaire, la liberté d'aller et venir, sortir, dîner au cabaret ou chez soi, aller à pied au Bois ou au café cette liberté-là est la moitié du talent et les trois quarts du bonheur ordinaire.
Mais, direz-vous, femme supérieure que vous êtes, octroyez-vous-la, cette liberté !
C'est impossible, car la femme qui s'émancipe ainsi, la femme jeune et jolie s'entend, est presque mise à l'index ; elle devient singulière, remarquée, blâmée, toquée et, par conséquent, encore moins libre qu'en ne choquant point les usages idiots.
Donc, il n'y a qu'à déplorer mon sexe, et à revenir aux rêves d'Italie et d'Espagne. Grenade ! Arbres géants, ciel pur, ruisseaux, lauriers-roses, soleil, ombre; paix, calme, harmonie, poésie !
Mercredi 21 juin 82.
Tout est gratté et j'ai même donné la toile pour ne pas la voir ! cela tue. O peinture je n'y arrive pas. Mais sitôt qu'on a anéanti ce qu'on a fini, on se sent soulagé, libre et prête à recommencer. L'atelier où je travaille est prêté à Mlle Loshooths par un Américain nommé Chadwick, qui est venu aujourd'hui et nous lui rendons son temple.
Jeudi 22 juin 82.
Cet hôtel m'a plu à un tel point que j’en étais folle et, comme on avait déjà arrêté un appartement, j'étais affolée de ne pouvoir louer l'hôtel, 30, rue Ampère, qui m'a paru comme une espèce de bonheur complet.
Tout un étage à moi, avec atelier, balcon. Ces dames au premier, en bas les salons. Un jardin, peindre dehors sans sortir. Enfin c'était trop beau, ça n'arriverait pas. J'étais prête à payer 5,000 francs de dédit au propriétaire de l'appartement. Eh bien ! c'est fait et sans dédit ; nous pouvons avoir l'hôtel et me voilà tout fait refroidie. Je trouve que c'est loin, que l'atelier est pas si grand, que c'est cher et je suis désolée, mais là désolée de quitter les Champs-Elysées. Notez qu'en les habitant, je n'avais qu'un rêve, l'avenue de Villiers et les voisinages artistiques, et de connaître des artistes. A présent, cette partie de mes rêves est réalisée. Eh bien ! me voilà tracassée de l'idée que si j’ai des médailles, je les devrai à des amis. Et puis, ceci encore : J'ai trépigné parce que je n'avais personne à qui montrer des dessins, des peintures, enfin, disons le mot, parce que mon talent était ignoré des artistes ; à présent il y a les artistes, mais il n'y a plus rien à leur faire voir. Ce soir à cinq heures, nous sommes allées voir les esquisses de Bastien-Lepage qui est à Londres, mais son frère Emile nous a fait les honneurs de l'atelier. J'avais amené Brisebane et L...., ce qui fait que nous avons passé une heure charmante, riant, causant, faisant des croquis, et tout cela si convenable, si bien. Si j'avais entendu tout cela de Breslau, je serais là à me lamenter et à envier son milieu. Eh bien ! j'ai ce que je voulais, cela me donne-t-il du talent ?
Vendredi 23 juin 82.
A cinq heures, L..., Dina et moi sommes chez Emile Bastien qui pose pour nous. Je le fais sur un petit panneau de 3 ou 4, je crois.
Je peins sur la propre palette du vrai Bastien, avec des couleurs à lui, son pinceau, son atelier et son frère pour modèle.
Enfin c'est un rêve, et des enfantillages, des superstitions ; la petite Suédoise voulait toucher à sa palette J'ai gardé de sa vieille couleur, et la main me tremblait, et nous riions.
Samedi 24 juin 82.
C'est fait. Nous avons l'hôtel. Je suis navrée : quitter les Champs-Elysées, sans compter l'habitude ; cela me fait l'effet d'une déchéance. Pourtant, cela se compose de vastes sous-sols avec cuisine et salle de billard. Le rez-de-chaussée, élevé d'une dizaine de marches, possède un vestibule ; puis, ayant franchi une belle porte vitrée, on se trouve dans une antichambre dans laquelle est l'escalier menant aux autres étages; à droite, une pièce dont on fait un salon en perçant une ouverture, et en réunissant cette pièce avec une petite chambre toute petite donnant sur le jardin ; une salle à manger et un jardin où les voiture peuvent entrer et auquel on descend par des marches du salon et de la salle à manger.
Au premier, il y a cinq chambres avec cabinets de toilette et une salle de bains. Quant au deuxième, il est à moi et se compose d'une antichambre, de deux chambres, d'une bibliothèque, d'un atelier et d'une chambre de débarras. L'atelier et la bibliothèque sont réunis par une immense ouverture, ce qui fait un espace de douze mètres de long sur sept de large.
Le jour est superbe, on en a de trois côtés et d'en haut. En un mot, comme hôtel loué, on ne peut rien rêver me convenant mieux. Eh bien, alors? Eh bien ! Il me semble que c'est loin, et c'est à dix minutes de voiture de la Madeleine en prenant le boulevard Malesherbes. Enfin, c'est 30, rue Ampère, au coin de la rue Brémontier, et l'hôtel se voit de l'avenue de Villiers.
Enfin, que voulez-vous ? Et puis ce déménagement, c'est énervant au possible. Et quitter cet appartement où j'ai été si tranquille...
Ah ! tant pis ! c'est fait ; oui, signé chez le notaire.
Vendredi 30 juin 82.
Je ne me trouve pas de place, j'erre.., je ne fais rien ! Voilà le malheur ! L'autre jour, avec Julian, nous avons causé de cela ; il dit que voilà un an et demi que je ne fais plus rien ; par-ci, par-là, un mois de travail, par bonds, par emportements, puis rien ! !
Pas de suite, pas d'esprit de conduite, pas d'énergie vraie ! C'est vrai. Je suis dévoyée, j’aurais besoin d’abattre de l'ouvrage, chaque semaine une étude, et au lieu de cela je cherche trente-six choses, et quand quelque chose me plaît, je suis découragée parce que je ne duis pas en état de la faire. J'ai essayé de retourner à l’atelier et je n'ai pas pu. Est-ce que je pourrai travailler seule ? je suis ahurie, je ne sais plus où aller et quoi faire, je n'ai pas la force de faire une simple étude ; il faut toujours que j'entreprenne trop, et comme cela ne vient pas bien, je tombe dans le désespoir. Et à présent c'est un état nerveux... Du reste, je ne peindrai jamais ; je n'ai jamais, jamais, jamais pu peindre un morceau bien. Voilà trois ans que je peins..., j'en ai perdu la moitié, je l'admets, mais c'est égal... Enfin, je suis hors d'haleine ; il faut avoir le courage, la volonté de se remettre, cela reviendra doucement. Je vais retourner... Non, il faudrait quelque grand coup qui me remette à flot . Et je crains bien que ce grand coup ne puisse être qu'une suite de patients efforts. Mais alors vient cette terrible conviction que je ne pourrai pas, que je ne peindrai pas.
Alors modeler ?
« Vous reviendrez tout de même à la peinture, mais encore plus affaiblie... »
Et alors? Alors il vaut mieux mourir.
Mercredi 12 juillet 82.
Je prépare mon fameux tableau qui va être bien difficile à faire. Il faudra trouver un paysage dans le genre de celui que je me figure et le tombeau creusé dans la roche... Je voudrais pouvoir le faire plus près de Paris, à Capri, c'est tout à fait l'Orient, et pas si loin, un rocher quelconque. Mais il faudrait un vrai tombeau, il doit en exister en Algérie et surtout à Jérusalem ; un tombeau juif quelconque creusé dans la roche. Et les modèles ? Oh ! là-bas j'en aurais de magnifiques et avec de vrais costumes. Julian dit que c'est folie. — Il comprend, dit-il, que des maîtres, ceux qui savent tout, aillent faire leurs tableaux sur place, car eux ils vont chercher la seule chose qu'ils n'ont pas, la saveur, la vérité vraie, tandis que moi, à qui il manque tant ! Eh bien ! mais il me semble qu'il me faut justement chercher cela, puisque je ne pourrais avoir du succès qu'à force de sincérité ; comment veut-il donc que je me refuse cette saveur, moi qui ne puis rien avoir d'autre ou presque rien ? Que signifiera ce tableau, s'il est fait à Saint-Germain avec des Juives de Batignolles, et dans des costumes arrangés ?... Tandis que là, je trouverai des vêtements usés, portés, vrais, et ces tons de rencontre donnent des choses qu'on ne peut faire exprès. Mais le temps perdu du voyage, quinze jours et quinze jours d'installation, total un mois. Je partirai le 15 septembre, j'arriverai le 22 ; le 10 octobre je pourrai commencer, je me donne trois mois... une semaine pour mettre en place et dessiner, une semaine pour préparer. Le 24 octobre, je commencerai à peindre et au 1er novembre la tête principale sera faite. Le corps se fera jusqu'au 10 novembre. Le 11 , je commencerai l’autre figure qui prendra dix jours. Les 27, 28, 29 et 30 novembre seront occupés à peindre les premiers plans. Je me donne dix autres jours pour le fond, ce qui m'amène au 10 décembre. Notez que j'ai calculé pour le tout presque le double de ce qu'il est vraisemblable que je mettrai.
Mardi 25 juillet 82.
Soirée charmante où tout le monde est à l'aise; causerie calme, amusante, mais comme éteinte par de la musique grave et pénétrante. Seulement on ne me dit pas un mot d'art. Heureusement avant dîner, Julian est monté à l'atelier revoir les esquisses et le grand panneau sur lequel j'ai indiqué la figure au fusain et pastel.
C'est ce qui s'appelle chercher son tableau.
Eh bien, sans doute, car cela me plaît, tandis que je ne pouvais pas chercher celui de l’année dernière, qui ne me disait rien.
Oh ! si je pouvais bien le faire ! ! ! Julian entre tout à fait dans mon idée ; je ne croyais pas (et j’avais bien tort) qu'il comprenait si profondément la beauté de la scène. Oui, c'est vrai. On doit en faire quelque chose de terrible dans son calme, de désolé, de profondément désolé... C'est la fin de tout ; la femme qui est là est plus que l'expression d'une douleur, c’est un drame immense, complet, effroyable. C'est la stupeur d’une âme où il ne reste plus rien... Il y a là, vu les antécédents de la créature, quelque chose de si humain, de si intéressant et de si grandiose, de si empoignant, que l'on sent comme un souffle qui vous passe dans les cheveux.
Et je ne le ferai pas bien ? Quand ça dépend de moi ? C’est quelque chose que je puis créer de mes mains, et ma volonté passionnée, tenace, inflexible ne suffirait pas ? ? Le désir ardent, fou, de faire partager l'émotion que je ressens serait insuffisant ? Allons donc ! Comment en douter ? Quelque chose qui me remplit la tète, le cœur, l'âme, les yeux, et je ne triompherais pas des difficultés matérielles ?... Je me sens capable de tout. Il n'y a que si je suis malade... Je prierai Dieu tous les jours pour que ça n'arrive pas.
Ma main serait impuissante à exprimer ce que veut ma. tête ?... Allons donc !
Ah ! mon Dieu, je tombe à genoux et je vous supplie, de ne pas vous opposer à ce bonheur. C'est en. toute humilité, prosternée dans la poussière que je vous; supplie de..., pas même de m'aider, de daigner, seulement permettre que je travaille sans trop d'obstacles.
Jeudi 27 juillet 82. — Vendredi 28. — Samedi 29.
Il me semble pourtant qu'il est impossible de faire ce tableau entièrement dehors. L'effet n'est pas de plein: jour, et le soir ne dure qu'une heure à peine. Donc je ne pourrai pas le copier, comme on fait pour les tableaux ordinaires, comme fait Bastien-Lepage et comme font tous ceux qui travaillent en plein air. Ah ! j’aborde là des difficultés trop grandes. Eh bien ! Voilà ! ; je le ferai en Algérie, comme je pourrai et puis, s'il y a des choses à refaire..., ou même si c'est à recommencer..., j'aurai rapporté le document.
Dimanche 30 juillet. — Lundi 31.
Robert-Fleury est venu le soir et nous avons eu une conférence à propos du tableau... et en général à propos du travail. — Je ne travaille pas comme il faut. Depuis deux ans, je n’ai pas de suite dans les idées, et puis il ne m'arrive jamais de pousser une étude jusqu'au bout. C'est vrai, ça... Il me le dit pour me prouver que je fais autant de progrès que possible vu la façon dont je travaille, et que les jeunes gens travaillent plus et mieux. Rien ne fait comme la ténacité, la suite, tandis qu'une bonne semaine et puis rien, ne représentent pas grand'chose, ne font pas avancer. Mais c'est vrai, j'étais malade, en voyage, sans atelier... A présent tout va bien et si je ne m'y mets pas, c'est que je ne vaux rien.
Le tableau est bien, je le ferai bien. La peinture de cette semaine est grasse, mais... je vous dis que pour sortir de mon désespoir, il faudrait qu'il me dît quelque chose de plus monté, enfin que je suis aussi forte que... quelqu'un de très fort ; que je puis faire ce que je veux, que... Et il me dit, quand je me plains, que c'est de la folie et qu'il n'a jamais vu personne faire plus en si peu de temps. Quatre ans ! ! ! alors il dit que les plus doués, les plus heureux ne parviennent qu'au bout de sept, huit et dix ans. Ah ! c'est atroce.
Il y a des moments où on se casserait la tête. La rhétorique ne sert à rien. Il faut produire quelque chose qui les fasse sauter d'étonnement, rien d'autre ne me rendra la paix...
Lundi 7 août 82.
La rue ! En revenant de chez Robert-Fleury, nous avons fait passer par les avenues qui entourent l'Arc de Triomphe, c'est vers six heures et demie, l'été ; les concierges, les enfants, les garçons en courses, les ouvriers, les femmes tout cela aux portes ou sur les bancs publics, ou causant devant les marchands de vins.
Mais il y a là des tableaux admirables ! Tout bonnement admirables ! Loin de moi de viser surtout à la parodie de la vérité, c'est le fait des vulgaires ; mais dans cette vie, dans cette vérité il y a des choses admirables. Les plus grands maîtres ne sont grands que par la vérité.
Je suis rentrée émerveillée de la rue, oui, et ceux qui se moquent de ce qu'ils appellent le naturalisme ne savent pas ce que c'est, et sont des imbéciles. Il s'agit de saisir la nature sur le fait, de savoir choisir et de la saisir. Le choix fait l'artiste.
Mon portrait sera incontestablement banal. Je suis assise dans un grand fauteuil, en robe de mousseline blanche à moitié décolletée. La pose est assez éveillée, j'ai l'air de causer, je suis de face. C'est très ordinaire.
Je reviens à la rue... On pourrait exploiter la mine. Je ne voudrais pas toucher à la campagne ; Bastien-Lepage y règne en souverain ; mais pour la rue, il n’y a pas encore eu de... Bastien. Et dans notre jardin on peut peindre presque tout.
Mardi 8 août 82.
J'ai la tête un peu troublée part les Rois en exil de Daudet ; je l'avais déjà lu, mais ça se recommence. Il y a là de si ravissantes pages, une finesse d'analyse, une netteté d'expression qui me ravit, des choses qui font pleurer. Des choses de sentiment...
Ce n'est pas une vie que la mienne ; quand je ne travaille pas, tout m'abandonne ; en peignant je m'imagine tisser mon bonheur ; inactive, tout s'arrête ; la nuit et le silence.
Mercredi 9 août.
Séance ; puis Robert-Fleury vient dîner. Je lui montre une esquisse faite ce matin, d'une chiffonnière que j'ai arrêtée au passage. Tony R.-F. trouve que c'est bien. Elle est devant moi et je la regarde. Tony dit de ne plus y toucher, quoique ce soit à peine indiqué et d'en faire une autre très poussée. Quand, par hasard, je fais quelque chose de passable, ce sont des ivresses d'enfant.
Je m'aime.
Jeudi 10 août 82.
Ce pauvre Tony a effacé la main gauche à la fin de la séance. On a beau être académique et avoir eu la médaille d'honneur, on n'en est pas moins sujet..., et d'abord il a envie de faire quelque chose de très bien ; il m'a dit qu'il avait eu presque le cauchemar et la migraine, après, parce que ça ne vient pas du premier coup.
Eh bien, comme je sympathise à ces maux que je connais bien..., et dont on ne se fait pas une idée, quand on n'est pas de la partie !
Il écrit un journal tous les soirs comme moi ; qu'est-ce que vous croyez qu'il peut y dire de moi ? Il croit que les lauriers de Breslau m'empêchent de dormir... Mais il sait à quel point je reconnais mon humilité... C'est vrai, que maintenant je dis mon tableau, et encore cela me paraît d'une outrecuidance ! C'est seulement en entendant d'autres nullités dire : mon esquisse, mon tableau, etc., que j'ai osé.... et si je considère cela comme une espèce de ridicule, c'est que je compte bien avoir le droit de le dire haut et que je ne veux pas le démonétiser, le rapetisser par un usage trop familier et disproportionné. Vous comprenez cela, n'est-ce pas ?
Dimanche 13 août 82.
Il est trois heures du matin, je ne peux pas dormir. Ce soir j'ai montré à Tony une étude de « chiffonnière » qu'il trouve « comme ça », et une nouvelle esquisse du tableau qu'il trouve très bien. En somme, l'esquisse n'est pas nouvelle ; elle est comme la toute première que j'avais déchirée et que j'ai refaite. Il me semble qu'on doit concevoir les choses du coup, surtout les choses qui vous frappent et vous empoignent aussi complètement. Maintenant R.-F. a raison, ce tableau est relativement facile à faire, il n'y a pas ce qu'on nomme de morceau, puisque ça se passe à une heure indécise ; les silhouettes se détachent en sombre. Le tout, entendez bien, le tout est de bien saisir les rapports du ciel, des figures et du terrain. Et puis, surtout, et puis rendre la poésie de l'heure, la désolation profonde, épouvantable de ce qui vient de se passer.
Maintenant il trouve que c'est trouvé, que les attitudes sont profondément senties, poignantes ; le tout est de rendre cela comme je le sens.
— Si vous trouvez bien juste les tons, les rapports de ceci avec cela et cela, ce pourra être une très belle chose, tout à fait.
Oui, voilà tout. D'un côté une sorte d'épouvante et de l'autre une frénésie.
Cela dépend de moi !
Et alors je me suis couchée à minuit, ne pensant plus aux discussions de la journée sur le naturalisme, la peinture, la rue ! Ne pensant plus qu'à ce tableau qui prend dans mon cerveau des proportions démesurées, et une fois l'imagination en branle, tout y a passé. — J'y travaille, c'est fait, je l'apporte, c'est exposé. Et la foule qui stationne devant, l'émotion qui me prend à la gorge, la peur de je ne sais quoi de fou, puis une joie extravagante succédant à cette angoisse. Et tout cela me passant en frisson et en sueur sur le corps, je me suis levée à trois heures, j'ai lu et maintenant j'écris avec l'esquisse devant moi. Mais je me prépare là une déception atroce ! ! Non, puisque je ne suis sûre de rien, je vais essayer... Du reste c'est peut-être les deux tasses de thé prises ce soir qui m'ont empêchée de dormir. Oh ! Non !...
Mardi 15 août 82.
Que Dieu me soit en aide ! Je voudrais n'y avoir pas pensé, et n'avoir compté sur rien ; d'abord on n'a du bonheur que par surprise et non lorsqu'on s'attend à quelque chose ; mais je ne m'attends à rien... Seulement cela m'ôte le sommeil. Ça pourrait être si beau ! Je le comprends si bien !
Jeudi 17 août 82.
Dernière séance, mon artiste cherche un sujet de tableau, quelque chose de moderne et de bien... et puis, il a envie de laisser dans son œuvre une figure de nu ; « seulement c’est si difficile de trouver un beau modèle » ; il a l'air d'entrevoir des difficultés si insurmontables... On dirait vraiment qu’une belle femme nue ne se trouve pas en Europe...
Je crois bien que R.-F. a de moi une opinion très juste ; il me croit ce que je voudrais paraître, c'est-à-dire tout à fait gentille, ou, pour parler plus sérieusement, très jeune fille, enfant même, en ce sens que, tout en causant comme une femme, je suis au fond de l'âme et pour moi d'une pureté d'ange. Je crois vraiment qu'il me respecte dans la plus haute acception du terme et que, s'il disait jamais devant moi quelque chose de... libre, je serais absolument étonnée. En somme, je dis toujours que je parle de tout... Mais il y a façon et façon ; il y a plus que la convenance, il y a la pudeur du langage ; je parle peut-être bien comme une femme, mais j’emploie des... métaphores, des choses arrangées, de façon à ce que tout en disant, j'ai l'air de ne pas y toucher. C'est comme si, au lieu de dire : Mon tableau, je disais : la chose que j'ai faite. Jamais même avec Julian je n'ai employé les mots : amant, maîtresse, liaison ; de ces termes précis et habituels qui font que vous avez l'air de parler de choses familières. On sait bien qu'on sait tout ça, mais on glisse ; si on ne savait rien, on me serait pas drôle, car il y a des coins de conversations où un peu de malice et de raillerie sur le nommé Amour est indispensable, même très en passant. Avec; R.-F. nous parlons surtout d'art, mais encore... Et enfin cela fait toucher à la musique, à la littérature.
Eh bien, je vois que Tony R.-F. prend ces... connaissances dans leur vrai sens, qu'il trouve cela très simple et que, si j'ai la franchise de ne pas faire la bête, il a le tact de ne jamais en dire autant que moi. Maintenant ajoutons que vous ne pouvez pas me juger dans ce journal où je suis sérieuse et sans fard ; quand je cause, je suis mieux ; il y a des airs, des poses de langage, des images, des choses neuves, trouvées, colorées, drôles...
Je suis bête et vaniteuse... Voilà que je crois que cet académicien me voit comme je me vois, et apprécie par conséquent toutes mes intentions, comme on dirait du jeu d'une actrice. On exagère ses mérites, cela est connu ; on s'en donne lors même qu'on en est totalement dépourvue, d'accord ; eh bien ! une fois cela admis, je vous dirai qu'il est bien agréable de se croire appréciée. Et puis avec R.-F. et Julian, je m'ouvre plus qu'avec les autres ; je me sens sur un bon terrain et la confiance me donne le charme que je n'aurais pas ailleurs.
Vendredi 18 août 82.
Nous n'avons pas trouvé Bastien chez lui ; je lui laisse un mot et j'entrevois ce qu'il a apporté de Londres. Il y a un petit commissionnaire, voyou, appuyé à une borne dans la rue ; on croit entendre le fracas des voitures qui passent. Et le fond est à peine fait, mais la figure ! Ce diable d’homme !
Ah ! les sinistres idiots, ceux qui le traitent d'exécutant. C'est un artiste puissant, original ; c'est un poète, c’est un philosophe ; les autres ne sont que des fabricants de n'importe quoi à côté de lui... On ne peut plus rien regarder quand on voit sa peinture, parce que c'est beau comme la nature, comme la vie. L'autre jour, Tony R.-F. a été obligé de convenir avec moi qu'il fallait être un grand artiste pour copier la nature, et qu'il n'y a même qu'un grand artiste qui soit capable de comprendre la nature et de la rendre. L'idéal est dans le choix, quant à l'exécution elle doit être le comble de ce que les ignorants appellent naturalisme. Faites, si bon vous semble, Enguerrand de Marigny ou Agnès Sorel, mais que leurs mains, que leurs cheveux, que leur yeux soient vivants, naturels, humains. Le sujet importe peu. Et les maîtres ont fait des sujets de leur époque souvent. Sans doute à tous les points de vue, le moderne est ce qu'il y a de plus intéressant, mais le vrai, le seul, le bon naturalisme consiste dans l’exécution. Que ce soit la nature même, la vie, que les yeux parlent ! peu importe que ce soit Mlle de La Vallière ou Sarah Bernhardt !... Sans doute il est plus difficile de vous intéresser... et encore ! Si Bastien-Lepage faisait Mlle de La Vallière ou Marie Stuart, toutes mortes, poussiéreuses et usées qu'elles soient, elles revivraient encore. — Il y a aussi une ébauche du petit portrait de Coquelin aîné... J'en suis revenue médusée; c’est sa grimace, ses mains remuent, il parle, ses yeux clignent !
Samedi 19 août 82.
Je travaille dans le jardin qui me donne tout à fait le décor du parc Monceau ; je fais un gamin d'une douzaine d'années avec la blouse et le tablier, assis sur un banc, et lisant une feuille illustrée, son panier vide à côté de lui... On voit cela continuellement au parc et dans les rues ici.
Lundi 21 août 82.
Je suis... à griffer tout le monde ! Je ne fais rien ! ! Et le temps passe ; depuis quatre jours je ne pose pas, j'ai commencé une étude dehors; mais il pleut et le vent renverse tout : je ne fais rien.
Je vous dis que je deviens folle devant ce néant ! On dit que ce tourment prouve ma valeur ! Non, hélas ! Cela prouve que je suis intelligente et que je vois clair...
Du reste, il y a trois ans que je peins.
Mardi 22 août 82.
Je vais au marché du Temple accompagnée de Rosalie. Et j'en ai les yeux encore tout agrandis. C'est un quartier merveilleux ; j'ai acheté quelques vieilles machines pour l'atelier ; mais je n'ai fait que regarder les types. Oh ! la rue ! ! Mais, c'est-à-dire que si on savait rendre ce que l'on voit !... Hélas ! j'ai la faculté de voir et je suis encore éblouie de tout ce que j'ai vu. Les attitudes, les gestes, la vie prise sur le fait, la nature vraie, vivante. Oh ! surprendre la nature et savoir la rendre !
Voilà le grand problème. Oh ! pourquoi n'ai-je pas ?... Cet animal de Tony R.-F. l'a bien dit : — Avec vos aspirations, Mademoiselle, je ferais tout au monde pour me rendre maître du métier.
Ainsi, je rentre et fais plusieurs esquisses des choses entrevues ; un banc dans la rue avec plusieurs petites filles causant et jouant ensemble. Cet assemblage de visages d'enfants est ravissant. Puis une table de café avec deux hommes, dont les attitudes si caractéristiques sont là, gravées dans la tète et esquissées sur toile ; la maîtresse du café appuyée dans la pénombre de la porte.
Et puis, au Temple, une jeune fille très blonde, qui est appuyée à sa boutique, une boutique de couronnes mortuaires. Ce dernier pourra se faire dans l'atelier...
Mais les deux autres demandent du plein air... Je ne sais pourquoi je vous raconte tout cela. Dès demain... c’est une fièvre !
Enfin, ces choses que l'on surprend, c'est comme des fenêtres ouvertes sur la vie des gens, on suppose, on devine la vie, le caractère, les journées de ces gens. C'est admirable, c'est d'un intérêt intense, palpitant ! vrais !...
Les imbéciles croient que pour être « moderne » ou réaliste il suffit de peindre la première chose venue. Sans l'arranger. Ne l'arrangez pas, mais choisissez et surprenez, tout est là.
Mercredi 23 août 82.
Au lieu de bien travailler à importe quelle étude, je me promène ; oui, mademoiselle fait des promenades d'artiste et observe ! Je suis allée deux fois à l'asile des enfants, le matin et l'après-midi.
La directrice est déjà mon amie ; quant aux enfants, à ma seconde visite, grâce à une aumône de bonbons, ils m'ont entourée, se serrant autour de ma robe, comme un troupeau de petites bêtes ravissantes. Tous ces yeux confiants, innocents, vagues encore, et tout cela me suivait à petits pas, de leurs jambes encore indécises. Alors on les a fait asseoir. Et tout en jouant sans avoir l'air de rien, les plus sages se sont mis à réciter, en me jetant de temps en temps un coup d'œil pour voir l'effet.
Sitôt rentrée, je fais une esquisse : Sinite parvulo venire ad me. Jésus et les enfants. Ah ! si on avait du talent !
Lundi 28 août 82.
Il y a des jours où je me crois vraiment quelque chose, là. Écoutez, c'est impossible que cette fièvre, ces élans, cet amour de ce que je fais, ne soient pas destinés à aboutir à quelque chose de grand. Il est impossible de voir et de sentir la nature et la forme comme moi, sans arriver à...
J'ai dessiné la deuxième figure du tableau ; puis comme Mme T..., étant arrivée pendant que je travaillais, lisait dans un coin, j'en ai fait une pochade. Il ne faut jamais rien arranger, aucun arrangement ne vaut la vérité ; le grand art consiste à saisir le bon moment et à faire ce qu'on voit...
Mais, pénétrez-vous donc de cette vérité que, pour copier la nature juste, il faut avoir du génie et qu'un artiste ordinaire ne pourra jamais que la parodier.
Un exécutant habile qui copie pour copier, fait une œuvre vulgaire, que le vulgaire appelle réaliste et dont il a souvent raison de faire fi.
Il ne s'agit pas de prendre n'importe qui et de le peindre tel qu'on le voit ; le mouvement surpris, la pose ne se garde qu'à peu près, et en posant, ça se raidit : il faut que l'esprit soit frappé et garde l'impression de l'instant où vous avez vu la chose. C'est là que l'on reconnaît l'artiste.
J'ai relu un livre de Ouida, une femme de pas trop de talent; cela s'appelle Adriane, c'est en anglais.
Un livre qui est fait pour émouvoir au suprême degré ; j'ai été sur le point de le relire vingt fois depuis trois ou quatre ans, et j'ai toujours reculé, sachant quelle agitation il m'a causée et devait me causer encore. Il s'agit d'art et d'amour, et cela se passe à Rome : — Trois choses réunies, dont une seule suffit pour me passionner, et l'amour en est la moindre. On ôterait l'amour du livre qu'il resterait bien assez pour m'affoler. J'ai pour Rome une adoration, une vénération, une passion que rien n'égale. Car la Rome des artistes et des poètes, la vraie, n'a pas même été atteinte chez moi par la Rome mondaine qui m'a fait souffrir. Je ne me rappelle que la Rome poétique et artistique, et celle-là me met à genoux.
Il s'agit de sculpture dans le livre ; je suis toujours sur le point d'en faire : hier soir je ne pouvais pas dormir !
0 divine puissance de l'art ! ô sentiment céleste et incomparable qui vous tient lieu de tout ! ô suprême jouissance qui vous élève au-dessus de la terre ! C'est la poitrine oppressée et les yeux mouillés de larmes, que je me prosterne devant Dieu pour qu'il m'accorde sa protection.
C'est à devenir folle ; je veux faire dix choses à la fois ; je sens, je crois, je crois, entendez-vous, que je vais faire quelque chose de bien. Et mon âme s’envole vers des hauteurs inconnues.
Pourvu que ce ne soit pas pour retomber plus bas... Ces retours sont terribles, mais il faut de tout dans la vie... Les jours d'abattement suivent les heures d'exaltation ; on souffre pendant les deux... Pourtant, je ne suis pas assez poseuse pour dire qu'on souffre également.
Ne rien arranger ! Et les tableaux ? Le mien ! Eh bien, c'est presque la même chose, un sujet vous arrête, vous frappe. Il est évident qu'à l'instant même, vous vous représentez la scène, vous voyez le tableau.
Si votre imagination a été vivement frappée, vous le voyez presque en même temps que vous lisez ou pensez.
Je suis sûre que tous les tableaux vraiment émouvants ont été conçus comme cela.
Hors de là, il n'y a que recherche et correction, académie. Il ne faut faire que ce qui s'impose, ce qui vous tracasse, vous tient.
Dumas a bien raison : — On ne tient pas son sujet, c'est le sujet qui vous tient. — Un homme qui joue cent sous peut éprouver les mêmes angoisses que celui qui joue cent mille francs. Je puis donc me rendre compte.
Non, non ! Il y a en moi un tel besoin de traduire mes impressions, une telle violence d'émotion artistique ; tant de choses confuses se pressent dans ma tête que cela ne peut manquer de se traduire un jour…
La formule, ô la formule !
Mardi 29 août 82.
Ce livre me bouleverse. Ouida n'est ni Balzac, ni Sand, ni Dumas, mais elle a fait un livre qui, pour des raisons... professionnelles, me donne la fièvre. Elle a des idées très justes en art et des opinions cueillies dans les ateliers, en Italie, où elle a vécu.
Il y a des choses... Elle dit par exemple que chez les vrais artistes, non chez les artisans, la conception est incommensurablement supérieure au pouvoir d'exécution. Et puis le grand sculpteur Marix (toujours dans le roman), qui voit les essais de modelage de la jeune héroïne, future femme de génie, dit : « Qu'elle vienne travailler, elle fera ce qu'elle voudra. » — Oui, disait Tony R.-F. en regardant longuement mes dessins à l'atelier, travaillez, mademoiselle, vous ferez ce que vous voudrez.
Mais j'ai travaillé à côté sans doute. Saint-Marceaux l'a dit, mes dessins sont des dessins de sculpteur, et j'ai toujours aimé la forme par-dessus tout.
J'adore bien aussi la couleur, mais maintenant, après ce livre..., et même avant..., la peinture me paraît misérable à côté de la sculpture. Du reste, je devrais la haïr, comme je hais toutes les imitations, les impostures.
Rien ne m'irrite comme de voir des choses en relief, imitées en peinture sur une toile nécessairement plate et unie. Quoi de plus horrible que les peintures de bas-reliefs, à partir des belles choses d'art, jusqu'aux papiers peints? Cela m'enrage, comme le rouge enrage le taureau. Un cadre imité en peinture dans certains plafonds, même au Louvre... Et les bordures des chambres d'appartements meublés qui imitent des bois sculptés ou des volants de dentelle ! C'est odieux.
Mais qu'est-ce qui me retient ? Rien. Je suis libre, je suis installée de façon à ce que rien ne manque à mon bonheur d'artiste. Un étage entier à moi. Antichambre, cabinet de toilette, chambre, bibliothèque ; atelier avec un jour splendide, donnant de tous côtés à volonté ; puis un petit jardin où je puis descendre travailler. J'ai fait mettre un porte-voix pour qu'on ne monte pas me déranger, et pour ne pas descendre souvent.
Qu'est-ce que je fais ? Une petite fille qui a mis sa jupe noire sur ses épaules et qui tient son parapluie ouvert. Je travaille dehors et il pleut presque tous les jours. Et puis... qu'est-ce que ça signifie ? Qu 'est-ce, comparé à une pensée en marbre ? Et qu’est-ce que je fais de mon esquisse d'il y a trois ans, car elle est d'octobre 1879. On nous a donné ce sujet chez Julian et j'en ai été saisie, comme des saintes femmes au sépulcre. — Ariane ! — Julian et Tony ont trouvé qu'il y avait là un bon sentiment ; moi j'en suis prise comme du tableau d'à présent. Voilà trois ans que je suis sur le point de sculpter pour faire ce sujet... Je me sens sans force devant des choses banales... Et le terrible « à quoi bon ? » me coupe les bras.
— Thésée s'est enfui pendant la nuit, Ariane se trouvant seule à l'aurore, parcourt l'île en tous sens, lorsqu'au premier rayon du soleil, arrivée à l'extrémité d'un rocher, elle voit, comme un point à l'horizon, le vaisseau... Alors... Voilà le moment à saisir et difficile à raconter : elle ne peut aller plus loin, elle ne peut pas appeler; l'eau est là, tout autour ; le vaisseau n'est qu'un point qu'on voit à peine ; alors elle tombe sur le rocher, la tète sur le bras droit, dans une pose qui doit exprimer toute l'horreur de l'abandon, du désespoir, de cette femme laissée là, lâchement... Je ne sais pas dire, mais il y a là une rage d'impuissance, un abattement suprême à exprimer, qui m'empoignent complètement. Vous comprenez, elle est là, sur la limite du rocher, épuisée de douleur et, selon moi, de rage impuissante ; il y a là un laisser aller de tout l'être, la fin de tout !... Ce rocher abrupt, cette force brutale..., qui enchaîne la volonté... enfin !
Oui, la préoccupation de la perspective des lignes est une tromperie, la préoccupation des tons, de la couleur est une chose misérable, une chose de métier et qui, petit à petit, absorbe tout, ne laissant plus de place à la pensée.
Les penseurs et les poètes en peinture sont des exécutants de huitième ordre. Comment ai-je pu méconnaître à ce point cette vérité et me cramponner avec cette folle énergie ?...
Jeudi 30 août 82.
Je dessine ma Madeleine, j'ai un modèle qui est admirable pour cela ; du reste j'ai vu la tête qu'il me faut, il y a trois ans, et cette femme a justement ces traits et même cette expression intense, terrible, désespérée.
Ce qui me charme dans la peinture, c’est la vie, c’est la modernité, les mouvements des choses qu'on voit. Mais comment dire ?... Outre que c'est désespérément difficile, presque impossible... cela n'émeut pas !
Rien en peinture ne m'a touchée comme la Jeanne d'Arc de Bastien-Lepage, car il y a là ce je ne sais quoi de mystérieux, d'extraordinaire... Un sentiment compris par l'artiste, l'expression parfaite, intense d’une grande inspiration; enfin... il est allé chercher là quelque chose de grand, d'humain, d’inspiré et de divin en même temps ; ce que c'était en somme et ce que personne n'avait compris avant lui. En a-t-on fait des Jeanne d'Arc ! Bonté divine ! « la croix de ma mère ! » C'est comme les Ophélie et les Marguerite ! Il est en train de faire une Ophélie ; ce sera, j'en suis sûre, divin. Quant aux Marguerite, moi chétive, j’ai le projet d'en faire une... car il y a un moment à voir. Comme pour la Jeanne d'Arc... C'est lorsque la jeune fille, non pas la Marguerite d'opéra en robe de fin cachemire, mais la fille de village ou de petite ville, simple, — ne riez pas, — humaine, — si vous comprenez vous ne rirez pas, — lorsque la jeune fille introublée jusqu'alors, rentre dans son jardin après avoir rencontré Faust et s'arrête, les yeux à moitié baissés, regardant au loin, moitié étonnée, moitié souriante, moitié pensive et sentant s'éveiller en elle on ne sait quoi de nouveau, d'inconnu, de charmant et de triste. Les mains tiennent à peine, le livre de prière, près d'échapper... Pour cela, j'irai dans une petite ville d'Allemagne et je peindrai le tableau l'été prochain.
Mais mon Dieu, qu'ai-je donc fait tout cet été ? Rien ! D'ailleurs je ne le pourrai peut-être pas mettre à exécution à présent, et Marguerite peut attendre encore. Mais mon tableau... c’est si beau, si sublime à faire. Ne vaudrait-il pas mieux attendre encore un an pou être plus en possession des moyens d'exécution ?... Ah je suis folle, je devrais apprendre la grammaire, et je ne pense qu'à écrire des poèmes. Je devrais aller tous les jours à l'atelier jusqu'à trois heures et puis modèle pendant trois ou quatre heures. Voilà la vérité. Et pourquoi ne le fais-je pas ? Pourquoi est-ce ainsi dans ce monde ?...
Il est vrai que des gens moins forts que moi se permettent de faire des tableaux, mais ce sont ceux qui sont arrivés et ne peuvent aller plus loin ; je ne suis pas forte, mais je puis le devenir, mais j'ai la consolation d’être au début ; car enfin il n'y a pas cinq ans que je travaille en tout. Et Robert-Fleury, le père, est resté quatre ans à dessiner avant de toucher à une couleur, et combien y en a-t-il qui sont restés deux ans au plâtre et des années au dessin ?... Et je dessine bien, moi, et je commence à peindre pas mal ; il y a dans ce que je fais de la vie ; cela parle, cela regarde, cela vit... Alors quoi ? Rien, travaillez !... Seulement je ne vois pas ma grandeur dans la peinture... c'est-à-dire... Je suis troublée, je ne sais plus... Je suis troublée. O folle, il faut avant tout savoir son métier. La pensée, la beauté et la philosophie de la peinture sont dans l'exécution, dans la compréhension exacte de la vie...
Saisir la vie avec des tons qui chantent, et tous les tons vrais chantent. N'importe qui ou quoi, exactement reproduit, est un chef-d'œuvre, car c'est la vie même.
Quant à la sculpture, vous vous imaginez donc qu'il n'y a pas d'exécution ? Eh bien, presque pas, il y a plus, il y a la création ? Oui la tromperie des lignes et de la couleur sont de misérables préoccupations ; on exécute, on est habile en sculpture, mais autrement ; — on crée. — C'est la vérité, l'être réel, entier, véritable auquel si vous êtes artiste vous communiquez la vie d'abord ; une pensée, un sens intime ou mystérieux ou grand, si vous êtes ému et si vous avez le feu sacré. Il y a le travail matériel dans les deux ; mais dans la sculpture il est plus simple, plus noble, plus... honnête, si je puis dire ainsi. Enfin on peut y mettre cette étincelle, ce suprême mystère de quelque chose qui est en vous, qui est divin et que je ne sais pas dire...
Vendredi 1er septembre 82.
Je reçois une lettre de maman qui m'écrit que les jeunes voisins arrivent pour deux mois avec des amis et qu'on va organiser de grandes chasses. Elle est prête à revenir, mais comme j’avais dit de m'avertir si... Elle m'avertit. Voilà. Eh bien, cela me plonge dans un océan d'incertitudes, de doutes et de trouble. Si j'y vais, mon exposition est flambée... Si encore j'avais travaillé tout l'été, j'aurais eu pour prétexte qu'on a besoin de se reposer, mais non. Enfin, avouez que ce serait magnifique, oui, mais rien n'est moins probable... Faire quatre jours et quatre nuits de chemin de fer, et sacrifier les efforts d'une année pour aller essayer de plaire et de se faire épouser par des gens qu'on n'a jamais vus. La raison et les réflexions n'ont rien à voir là dedans... Du moment que je discute cette insanité, je la ferai peut-être..., car je ne sais plus ce que je fais... J'irai chez une tireuse de cartes, chez la mère Jacob qui m'a prédit que je serais très malade.
*
* *
Pour 20 francs, je viens de m'acheter du bonheur pour deux jours au moins. La mère Jacob me prédit des choses ravissantes, un peu embrouillées... Mais ce qui revient avec insistance, c'est que je vais avoir une succès énorme, éclatant, les journaux en parleront ; un grand talent que j'aurai... et puis un grand changement heureux, mariage très beau, beaucoup d'argent et de voyages, de grands voyages.
Je vais me coucher dans une joie bébête si vous voulez, mais ça ne m'a coûté que 20 francs. Je n'irai pas en Russie, mais à Alger..., car si ça doit arriver ça arrivera aussi bien là qu'en Russie...
Bonsoir, ça m'a fait du bien, je travaillerai bien demain.
Mardi 5 septembre 82.
Il pleut tous les jours. C'est désespérant pour moi, qui ai envie de travailler dehors. J'ai fini une petite fille avec un parapluie, c'est mauvais et la petite avait une tête odieuse; une de ces petites gamines de neuf ans, jolie et antipathique comme tout.
Alors j'ai été à l'asile et je n'ose pas entreprendra deux petits garçons à la fois ; je serais forcée de mal finir, il faut compter huit jours pour chaque tête. Et; si je faisais les hommes du café ?... Je ne sais plus ; les choses me frappent et puis... Nature mal équilibrée ; tête à l'envers, et avec ça... Enfin une folle qui a conscience !...
Dumas père a dit que, lorsqu'on hésite entre deux choses, c'est que ni l'une ni l'autre ne sont bonnes... il ajoute qu'il n 'a jamais hésité plus de cinq minutes dans sa vie. Il est bien heureux ou bien menteur !...
Mercredi 6 septembre 82.
Je ne suis pas artiste, j'ai voulu l'être, et comme je suis intelligente, j'ai appris certaines choses... Alors comment expliquer ce que Robert-Fleury disait, quand j'ai commencé : — Vous avez tout ce qui ne s'apprend pas. — Il s'est trompé...
Mais je fais de l'art comme je ferais autre chose..., avec intelligence et adresse, voilà tout. Alors pourquoi ai-je dessiné des tête à la craie sur les tables où l'on jouait aux cartes à la campagne, quand j'avais quatre ans ?
Tous les enfants dessinent. Et pourquoi le désir continuel de dessiner, les essais d'après des gravures, en Russie encore ; puis à Nice, à onze ans ? Là on m'a trouvé des dispositions extraordinaires, ça a duré deux ans... Puis, toujours cherchant la vraie instruction, j'ai eu deux ou trois autres maîtres qui m'ont chacun donné deux ou trois leçons, c'est-à-dire avec lesquels j'ai travaillé deux ou trois heures.
Enfin... En cherchant bien, je découvre qu'il y a toujours eu le désir d'apprendre, des élans, des tentatives et personne pour diriger ça ; et puis le voyage en Italie, Rome... C'est que dans les romans on raconte qu'on a tout de suite des yeux pour découvrir les belles choses, et moi j'avoue que mes yeux s'ouvrent petit à petit pour voir les beautés, c'est-à-dire les qualités des pentures... Enfin... j'ai perdu confiance, j'ai perdu courage, il me manque quelque chose... Je vois la beauté de la couleur, mais... Je ne peux même pas dire carrément que je n'y arrive pas car il y a une ou deux choses qui sont d'une jolie couleur et d'une bonne peinture. Si j'en ai fait, c'est que je puis en faire encore... Voilà que je m'encourage... Et j'étais venue pour me donner mon congé d’artiste et de peintre... de peintre surtout. Enfin, je puis peindre pas mal, mais je crois que je sculpterais mieux... Je sens des choses qui ne peuvent rien dire en couleur... des formes, des mouvements, des expressions...
Jeudi 14 septembre 82.
J'ai porté mes toiles à Julian et il est très content. Il faut bien finir le pêcheur qui peut être un petit succès... oui, finir, rien que ça... Il n'est pas exigeant le père Julian !... Enfin il dit que le Père Jacques de Bastien était admirablement fait ; mais que ça ne signifiait pas grand'chose, tandis que ce pêcheur est vrai... C'est un type, on en voit beaucoup comme ça, c'est le bonhomme placide qui reste des heures sans rien prendre ; la tête se détache sur l'eau. Si c'était bien fait !... Mais il y a déjà de bonnes choses, il ne s'agit que... Et puis la petite avec le parapluie, et puis alors j'ai fait un déballage de toutes ces idées sur les arts dont il y a des échantillons dans mon journal ; il dit qu'on m'a changée, que je suis littéraire et « artiste » et qu'enfin il y a quelque chose de plus que la tête... Mais il ne s'agit pas de ça, c'est-à-dire que si, puisque ça me fera faire des progrès... L'idée de mon tableau me rend folle.

|
 |
Lundi 18 septembre 82.
Mon pauvre modèle étant malade, je suis rentrée vers cinq heures et j'ai trouvé R.-F. qui cherchait son fond. Nous avons encore causé plein air... Si vous saviez quelle souffrance continuelle que ces efforts pour entendre ! I Je fuis tout ce que recherchais, je crains de me trouver avec les gens… C’est atroce. Mais enfin je crois que le peintre qui a l’honneur de diriger ma conscience d'artiste, sera converti par moi et fera un tableau en plein air. Du reste, il dit qu'il n'a rien à objecter contre le plein air, et qu'au fond nous sommes d'accord. C'est encore possible.
Je viens de lire du Balzac ! Et à ce propos, je me rencontre avec son de Marsay, lorsque je parle de ce second moi qui reste toujours spectateur impassible du premier. Et dire qu'il est mort, Balzac !... On ne peut connaître le bonheur d'aimer, qu'en aimant un homme de génie universel... Dans Balzac on trouve tout... Je suis toute fière d'avoir pensé plusieurs fois comme lui.
Vendredi 22 septembre 82.
Hier j'ai porté le pêcheur à R.-F. — Ce n'est pas mal, mais voilà tout ; il trouve le c'est très bien arrangé, que l'expression de la tête est très bien, que c'est bien en toile. Mais c'est mince de peinture, les bords sont secs, le bonhomme n'est pas baigné d'air ; ces réflexions sont de R.-F. et de moi ; je le savais. Alors je parle de mes progrès, de mon travail et j'ai le tort involontaire d'exprimer mon découragement, le peu de confiance que je m'inspire... J 'ai osé aujourd'hui, et R.-F. me dit qu'il a causé de moi avec Julian, de mes tentatives, de mes ambitions. Enfin je lui ai fait pitié hier et ils ont trouvé ensemble, avec Julian, que je ferais bien de faire de simples études à l’atelier ; que les difficultés du plein air sont au-dessus de mes forces actuelles et que cela me décourage. Il me le dit avec des ménagements qui font que j'ai beaucoup de peine à ne pas pleurer. Je crois qu'il pense que je suis désespérée de n'avoir pas réussi le vieux, sur le succès duquel Julian m'avait permis d 'espérer, et il veut m'éviter ce qu'il croît être des désespoirs. Il m’a toujours répété que personne ne va plus vite, que je vais très bien, et il riait beaucoup de mes désirs d'aller plus vite que nature. Hier encore, il disait que suis admirablement douée, que je n'ai qu'à continuer, et voilà que j'ai tout gâté par mes folles plaintes d'hier et par mon attitude consternée d'aujourd'hui ; je ne croirai plus aux encouragements, je me suis montrée trop malheureuse pour ne pas croire que c'est de la pitié.
Pour mon tableau... je n'ai même pas osé en parler c'est comme si l'air devenait du plomb et me tirait la peau du visage vers la terre, et le feu aux bras...
Puisque je me plains, puisque j'ai eu la sottise de laisser voir la grandeur de mes ambitions, ces deux hommes ne peuvent que me donner des conseils raisonnables, voyant que ce n'est ni un jeu, ni un passe-temps pour moi, et que j'en suis désespérée. Alors comme deux honnêtes médecins, ils m'ordonnent les remèdes énergiques. De tout cela il appert que je suis pas en état de peindre une figure... un tableau, car une étude d'atelier passe toujours, tandis que... Il ne fallait pas se montrer affectée, comme si j'avais fondé des espérances folles sur le vieux... Je n'aurai plus la vérité, et puis... Breslau ? Breslau a deux ans et demi d'avance sur moi. Qu'est-ce que ça prouve ? Rien Car il y a deux ans, elle était plus forte que moi aujourd'hui. Il y a six ans et demi qu'elle peint, et moi quatre ans juste. Je ne compte le dessin ni pour elle, ni pour moi. Donc, si en 1884, je n'ai pas fait ce qu'elle fait, je lui suis inférieure.
Je n'ai pas besoin d'entendre cela pour le savoir. Et voilà un an que je subis le martyre. Des souffrances cruelles, je vous assure ; perdre la bonne opinion qu'on avait de soi, confiance, courage, espoir. Ne travailler qu'avec l'horrible conviction que cela ne mène à rien. Et voilà ce qui paralyse ! Et rien ne peut me relever, sinon une bonne toile..., et c'est impossible dans ce désastre moral.
Enfin, il n'y a qu'une chose à considérer : c'est que je n'ai pas pu faire mon vieux très bien, que j'ai eu le bonheur de mettre la main sur un sujet original, intéressant, artistique, et que je n'ai rien pu en faire. Voilà le monstre.
Je suis sans force, tout est fini, un anéantissement de tout l'être.. et pas même de rhétorique pour exprimer cette consternation qui m'enlève la force de tenir matériellement la plume... Maintenant, des excuses ; il pleuvait et j'ai toujours été interrompue au milieu de l'exécution d'un morceau, c'est vrai... Il ne fallait pas présenter cette toile que je ne considérais pas comme présentable encore ; mais j'ai voulu avoir un conseil, ne pouvant travailler.
Alors voyant cette impuissance, Tony dit que le plein air est trop difficile pour moi... Et demain je retourne à la Grande-Jatte, et avec l'énergie, la rage du désespoir, je vais recommencer.
Dimanche 24 septembre 82.
Les jours se suivent et se ressemblent : de huit à cinq heures, peinture ; une bonne heure pour le bain d'avant dîner, puis un dîner silencieux ; je lis les journaux. Quelques rares paroles échangées avec ma tante. Elle doit bien s'embêter, la pauvre ! et je ne suis pas gentille vraiment ; elle n’a rien eu, car on l'a toujours sacrifiée à maman qui était belle, et à présent elle ne vit que pour nous, pour moi, et je ne trouve pas moyen d’être gaie et gentille pendant les rares moments où nous sommes ensemble ; et puis je suis heureuse du silence pendant lequel je ne pense pas à mes infirmités…
En Russie. Samedi 14 octobre 82.
Ma tante m’a lâchée à la frontière et c'est avec Paul que je voyage. Je fais des croquis aux stations, et en chemin, je lis Tra los montes ; de cette façon, je revois l'Espagne, car c'est une photographie coloriée que le voyage de Gautier. Qu'est-ce que c'est donc qui m'arrête pour aimer tout à fait Th. Gautier ? Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce voyage qui accroche ? Lorsqu'il raconte quelque épisode drôle, on ne rit pas, et il dit : C'était la chose la plus bouffonne du monde, ou bien la plus comique du monde, ou c'était d'une bouffonnerie, etc., etc. Ça fait l'effet d'un monsieur qui, avant de raconter, dit qu'il en a ri comme un fou... Mais il y a encore autre chose. Ce n'est peut-être pas sincère comme littérature, ou plutôt ça ne coule pas de source...; maintenant c'est surtout lorsqu'il parle d'art qu'il faut l'admirer, dit-on ; il n'en parle pas trop dans ce voyage, et surtout omet Velazquez. Je ne comprends pas ça d'un homme qui était si amoureux de la peinture.
Il parle de Goya. Goya était sans doute un grand artiste, bien que je n'en connaisse que des peintures ; iI paraît que ses dessins et eaux-fortes sont admirables I il parle donc de Goya, mais... Velazquez ? Il parle de Murillo et de la magie de sa peinture. Mais Velazquez ? c'est l'homme qui a peint le plus admirablement ; personne n'a fait plus vrai : c'est de la chair, et, au point de vue peinture, c'est le comble de l'art.
Nous avons cinq heures à attendre le train ici...
L'endroit s'appelle Znamenka et j'y suis pour parler de Gautier, de Velazquez, etc. Il fait froid et gris... S'il faisait moins froid, quel temps pour le plein air ! Je regardais les paysans avec leurs vêtements décolorés par le grand air, comme dans tous les pays, et pas de soleil ; eh bien ! je vous assure que les peintures de Bastien sont prodigieusement justes. — C'est gris, ça a l'air plat, ça n'a pas de consistance, disent ceux qui n’ont pas bien regardé la nature dehors et les gens habitués aux violences de l'atelier, — mais c'est comme cela, mais c'est tout à fait juste, c'est admirablement vrai. Voilà un homme heureux, ce Bastien ! Moi je suis partie avec le chagrin de mon pêcheur raté.
Mas je tâcherai de le refaire en mars pour le salon.
C'est Robert-Fleury qui me l'a fait refaire ! Il fallait laisser le fond et les vêtements, et ne travailler qu'à la tête.
Gavronzi. Dimanche 15 octobre 82.
Nous nous sommes couchés à sept heures du matin, car on est parti de la gare de Poltava à Gavronzi directement. Il y avait maman, papa, Dina et Kapitan à la gare. La femme de Paul a un garçon de quinze jours ; la petite fille a un an et est charmante avec des cils noirs longs comme cela. Les petits P.... doivent venir demain. Michka est allé chez eux, au lieu de me voir arriver avec les autres.
Jeudi 19 octobre 82.
Nous les avons enfin. Ils arrivent pour déjeuner avec Michka. L'aîné, Victor, est mince, brun, un grand nez aquilin et assez gros, des lèvres assez épaisses, distingué et plutôt sympathique. Le cadet, Basile, est aussi grand, beaucoup plus gros, très blond, le teint rouge et les yeux sournois ; l'air batailleur, remuant, en dehors, brutal et... ma foi oui, commun. J'ai gardé ma robe d'hier, une robe de laine blanche courte et extrêmement simple. Des souliers à l'enfant en chevreau vieux rouge. Les cheveux tordus et attachés assez bas au-dessus de la nuque. Je ne suis pas dans un de mes jours éclatants, mais pas trop à mon désavantage non plus.
Comme il fait très beau, on va se promener sur la montagne d'où le panorama est magnifique ; cela ressemble à la campagne de Tolède. Ces jeunes gens causent comme des gens du monde et des militaire russes. Ils sont tout jeunes. L'aîné n'a pas vingt-trois ans, je crois. Je suis très fatiguée d'avoir eu à sourire et à parler toute la journée, car papa les a gardés à dîner de force, bien qu'ils eussent assuré avoir une conférence importante avec l'intendant, qui leur fait faire le tour de leurs domaines, etc., etc. C'est bête cette habitude campagnarde de retenir les gens ; ça m'a un peu gênée.
Un incident. Leur cocher s'est grisé et c'est, parait-il, chaque fois comme cela ici ; alors sans avoir l'air de rien, le prince Basile est sorti et a assommé le pauvre homme à coups de poings et à coups de pieds avec ses éperons. N'est-ce pas que ça fait froid dans le dos ? Ce garçon est horrible et son frère m'en parait sympathique.
Je ne crois pas que je fasse la conquête ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai rien qui puisse leur plaire ; je sui de taille moyenne, de formes harmonieuses, d'un blond modéré ; j'ai des yeux gris, pas de grosse poitrine, pas de taille de guêpe... et au moral je crois que, sans trop d'orgueil, je leur suis assez supérieure pour qu'ils ne m'apprécient point.
Et comme femme du monde je ne suis pas plus charmante que beaucoup d'autres, dans les sphères qu'ils habitent.
On a sifflé Sarah Bernhardt à son arrivée à la gare de Pétersbourg, parce qu'on s'attendait à la voir grande, brune, avec des yeux noirs énormes et une masse de cheveux noirs ébouriffés. A part cette stupidité, le jugement porté sur le talent et la femme a été très sain, et je suis tout à fait de l'avis des journaux russes qui mettent au-dessus de Sarah Mlle Delaporte. Et Desclée donc ? Moi, Sarah ne me dit pas grand'chose, sauf l'adorable musique de sa voix, lorsqu'elle dit des vers. Mais qu'est-ce que je viens vous parler de Sarah ?
Vendredi 20 octobre. — Lundi 23 octobre 82.
Consternation générale, samedi matin. Les princes s'excusent ! Ils ne viendront pas chasser, appelés par une dépêche dans une propriété à côté. Et moi qui avais tant de peine à m'habiller ! car il faut vous dire qu'ayant bu du mauvais lait, j'avais tellement mal au cœur que ce n'est que par un grand effort que je suis arrivée à mettre cette robe noire, en velours, avec laquelle il est impossible d'être laide. Papa en était vert et maman rouge.
Moi, je riais et de bon cœur. Enfin on est parti, par dépit, la mort dans l'âme et jurant de n'aller que jusqu'à chez Michel, où on devait laisser souffler les chevaux et qui attendait avec un déjeuner magnifique.
Puis, les esprits un peu calmés, on a continué le chemin, tout en se querellant chaque cinq minutes, pour revenir en arrière. On arrêtait en pleins champs ; papa, Paul et Michka descendaient, et les discussions s'engageaient par la portière. A Michka on donnait comme prétexte le malaise de maman.
Enfin papa ayant dit à notre cocher de ne plus nous écouter, on est reparti, moitié riant et moitié désolé. Il est évident que personne ne peut se douter de nos projets si fous ; on peut bien supposer que nous serions enchantés si cela arrivait, mais personne ne peut imaginer que je sois venue comme je l'ai fait ; seulement, nous qui savons ce qui en est, nous craignons comme des voleurs que ce soit écrit sur nos figures. Alexandre nous attendait avec les princes ; il n'oserait pas dire qu'il n'aurait pas restreint les frais s'il avait prévu qu'il n'y aurait que nous et Michka, qui a dû éprouver un petit désappointement, lui aussi. On ne s'imagine pas ce que ces deux bêtards représentent dans les imaginations d'ici. Alexandre a été chercher trois cuisiniers de Karkoff, le fameux Prosper du club enfin...
Du reste, la chasse a été magnifique; on a tué quinze loups et un renard. Il a fait beau, on a lunché en plein bois, avec plus de quatre cents paysans qui nous regardaient, après avoir chassé les bêtes vers nos fusils... Nos fusils est un peu gascon, car je n'ai rien tiré, n'ayant rien vu ; les loups ont donné à gauche et j'étais à droite, ainsi que papa, Michka et Garnitsky. J'ai vu un renard, et pas à portée. Puis on a donné à boire aux paysans. Ah ! j'oublie mon triomphal coup de fusil...
Un paysan est monté au haut d'un arbre, on lui a jeté une bouteille d'eau-de-vie qu'il a accrochée sur la plus haute branche, après l'avoir vidée bien entendu, et on s'est amusé à tirer dessus ; chacun en a cassé un morceau, même moi. Alexandre se mettait en quatre pour être agréable, avec mille flatteries à mon égard. Nadine aussi. Leur fils Étienne est un charmant garçon de quatorze ans, et qui est le premier élève du gymnase militaire.
Quant au menu et aux vins, on ne pouvait rien exiger de mieux. Et puis cette campagne est ravissante. La maison est disposée admirablement, et ce n'est que maintenant que je suis en état de comprendre combien Grand-papa (Babanine) était artiste, intelligent, supérieur, bien qu'enterré dans son village. Le jardin et le parc et les étangs et les allées, je ne voudrais rien y changer. Quel éloge ! L'automne et l'abandon dans lequel cela se trouve depuis dix ans leur prêtent un grand charme. Gavronzi est horrible à côté de Tcherniakowka.
Les chambres ici sont si bien disposées, si homely, on se sent si bien ! Les paysannes sont belles, le peuple est si pittoresque ! Vous vous rappelez, l'année dernière, quelle peine j'ai eue à trouver quelque chose à faire à Gavronzi. C'est peut-être parce que, ici, j'ai été petite... Non, c'est parce que c'est adorable tout simplement. Pour qui est des souvenirs, ils sont dans une autre case.
Et le billard, un petit billard qui est là depuis... Maman se le rappelle dans son enfance, et je me souviens quand j'étais plus basse que lui. J'ai joué du piano ans le grand salon blanc et vide, et j'ai pensé à grand'maman qui écoutait jadis, du fond de sa chambre, à extrémité du long, long corridor. Si elle avait vécu, elle n'aurait pas plus de soixante-cinq ans à présent.
On a dîné au milieu de cette salle où son corps a été exposé pendant trois jours. Je ne sais pas si les autres y ont pensé, mais moi cela m'a fait quelque chose... Mais on oublie tout. Si elle avait vécu, elle serait si fière de moi, si heureuse !
Ah ! si l'on pouvait faire revivre les vieux, comme on les entourerait de soins ! Grand'maman n'a eu que des souffrances.
On retrouve ce soir une de ces bonnes soirées, comme il y en avait sous le règne de maman. Toutes les bougies allumées, toutes les portes ouvertes, sept salons très grands et qui semblaient tout remplis, bien que nous ne soyons pas plus de seize.
Étienne a joué du piano, assez bien, puis une valse et Michka, chargeant sur ses épaules un Starovoï, a fait trois fois le tour de la salle en valsant.
On avait invité à dîner les policemen qui avaient surveillé la chasse.
On tire un feu d'artifice et, pour que la fête soit complète, une fusée met le feu à un infime poulailler couvert de chaume. Cela procure à tout le monde un semblant d'émotion à très bon marché. Les hommes et les femme de service courent comme des lièvres, les seaux d'eau se croisent, on crie ; les maîtres, les invités, c'est une course dans la nuit ; avec cette flamme, les arbres, c'était charmant ! Nous nous précipitions sur les lieux du sinistre en robe blanche et en mules de satin ; autrement j'aurais été dans le feu comme Michka et papa et Paul et les policiers. Papa a été tout à fait dans les flammes, il a sauvé toutes les poules et a peut-être bien couru quelque danger. C'est si amusant... il n'y avait rien craindre. Quant au malheureux juif, auteur du feu d'artifice et du désastre, il s'est enfui à toutes jambes et a passé la nuit chez Paul, dont la maisonnette se trouve à une demi-heure à peu près de là. Papa lui donné trois roubles pour son voyage, le lendemain mais il a préféré faire le trajet accroché derrière le landau, et cela pendant quarante verstes, à peine à cheval sur une espèce de morceau de bois. Nous ne nous sommes aperçus de ce voyageur qu'à moitié chemin.
Vendredi 27 octobre 82.
Il fait gris après le beau soleil d'hier, et, énervée de ne pas travailler, je propose d'aller à Poltava, maman, Paul et moi. Sur le chemin nous rencontrons la Princesse et Dina qui en reviennent et Dina y retourne avec nous... A l'hôtel, nous trouvons Michka et Lihopay, et nous allons au théâtre. Une pièce qui confirme encore davantage mes idées sur le théâtre russe... Le théâtre et les romans sont toujours plus ou moins un reflet de la vie réelle ; eh bien, je ne fais pas mes compliments à mon pays. C'est d'une grossièreté naïve et dépravée en même temps...
On s'embrasse sur les lèvres, comme si c'était tout simple, et ça se passe entre amants ou femme et mari... puis on s'embrasse sur le cou, sur les joues, etc., et le public ne dit rien, ça leur paraît simple. Et des situations qu'on aurait huées... Des demoiselles du monde, les jeunes filles sympathiques de la pièce, donnent des soufflets à des jeunes gens qui leur font des déclarations et qu'elles soupçonnent n'aimer que leur dot. Enfin... si tout ça se passait dans le monde des cocottes ou dans des royaumes de fantaisie, ou l'antiquité d'Offenbach, et avec accompagnement de toutes les gaietés, de toutes les folies d'usage..., passe ; mais on nous montre des bourgeois, des propriétaires, des gens comme vous et moi, et c'est sérieux...
On ne sait qu'en dire.
Ce soir, c'est une petite sauvage, une ingénue qui adore un homme aussi marié que mûr, corrompu et spirituel (dans la pièce) ; chaque fois qu'ils se trouvent seuls, et cela arrive à chaque instant, ils s'embrassent à bouche que veux-tu, l'ingénue sans se douter de rien et lui par plaisir ; puis le soir, il arrive un moment où le monsieur recule, et l'ingénue lui dit : « Pourquoi me fuis-tu ? à quoi penses-tu ? je suis un être vivant en somme, mon sang bout, etc., etc. » Enfin... elle va passer une nuit chez un jeune homme qui l'aime, et revient dire au vieux et à son épouse (car il a une épouse jeune et jolie) que c’est lui, le vieux séducteur, qui est cause de tout ; car il lui a troublé les sens au point qu'elle a été obligée de... s'épancher avec quelqu'un. Le jeune l'épouse et, l'appelant « ma fiancée », il lui applique un si furieux baiser sur la bouche qu'elle aura un bleu demain tout autour, pour sûr. C'est grossier, mais en somme ce n'est pas immoral, ça vous dégoûte de l'amour et n'éveille absolument rien.
Lundi 6 novembre 82.
— Enfin, sans doute ces gens-là ne peuvent pas comprendre... Paris, l'élégance, la célébrité ? Pourquoi faire, à quoi bon ? — Les acteurs sont célèbres, les peintres ne sont connus que de nom, et, en fait de noms, on ne cite et on ne connaît que Raphaël ; et puis on a des oléographies de barbouilleurs russes, dont le talent est faux, mièvre et vide comme le caractère. Quant à l'élégance, ils ne croient qu'à celle des! couturières de Karkoff « qui a les modes de Paris » et nos robes à nous sont « outrées », « exagérées » et vraiment, pour venir de Paris, nous ne sommes pas bien mises.Comment voulez-vous donc qu'on comprenne ce que je souffre à rester ici les bras croisés ?
Mardi 7 novembre 82.
Ici on va au bal, on se grise entre camarades, on joue aux cartes, on soupe avec des danseuses. Et si l'on cause avec des dames, c'est qu'on en est amoureux.
Mais causer avec des indifférents, comme en France, — et de toutes choses, — c'est inconnu dans ces parages. Aucune nouvelle n'y pénètre, il n'y a pas d'autres conversations que les commérages les plus vulgaires, les plus ternes. Et la grande distraction, c'est l'hôtel ; — des propriétaires (nobles) des environs viennent y passer quelquefois des semaines, et on se visite de chambre en chambre, on boit, on joue aux cartes. Le théâtre est désert, et l'on a en horreur tout ce qui pourrait avoir l'ombre de ressemblance avec un passe-temps intelligent.
On est extraordinairement à plat ventre devant l’aristocratie, dans cette noble contrée... Ah ! je veux m'en aller, si j'allais devenir comme ça !... Donc, pour en revenir à nos princes, que je m'obstine, au grand étonnement des Poltaviens, à traiter comme je traite tous les gens du monde, mes égaux... et comme c'est d’usage dans le monde civilisé, nos princes ne me plaisent pas trop, Pourtant le petit, — celui qui a battu le cocher, — est gai, aimable et pas bête ; je ne dis pas ça parce qu'il a joué l'esprit en se fourrant sous une table chargée de fruits et de Champagne, pour les faire tourner... Il est vrai qu'il a battu le cocher... Oui, mais ça s'explique jusqu'à un certain point, dans ce pays et à cet âge. — Vous croyez qu'on est étonné ou choqué ici ? Pour un autre, c'est tout simple, pour le prince R…, c'est charmant. Je veux m'en aller !
Paris. Mercredi 15 novembre 82.
Je suis à Paris ! Nous sommes partis jeudi soir. L'oncle Nicolas et Michka nous ont accompagnés jusqu'à la première station, et Paul et sa femme jusqu'à Karkoff. Nous sommes restés vingt-quatre heures à Kiew, où Julie (la fille de l'oncle Alexandre) est à l'institut. Elle a quatorze ans, elle est charmante.
Jeudi 16 novembre 82.
Je suis allée chez un grand docteur, un chirurgien des hôpitaux, — inconnu et modeste, pour qu'il ne me trompe pas.
Oh ! ce n'est pas un monsieur aimable. Il m'a dit cela très simplement. JE NE GUÉRIRAI JAMAIS. Mais mon état peut s'améliorer d'une façon satisfaisante, en sorte que ce sera une surdité supportable ; elle l'est déjà ; elle le sera davantage à ce qu'il paraît. Mais si je ne suis pas rigoureusement le traitement qu'il m'indique, ça augmentera. Il m'indique aussi un petit médecin qui me surveillera pendant deux mois, car il n’a pas le temps lui-même de me voir deux fois par semaine, comme cela est nécessaire.
J'ai eu pour la première fois le courage de dire : — Monsieur, je deviens sourde. Jusqu'ici, j'ai usé de : « Je n'entends pas bien, j'ai les oreilles bouchées, etc. » Cette fois j'ai osé dire cette chose atroce, et le médecin m'a répondu avec la brutalité du chirurgien.
Je souhaite que les malheurs annoncés par mes rêves soient cela. Mais ne nous occupons pas d'avance des tuiles que Dieu tient en réserve pour son humble servante. Pour le moment, je ne suis qu'à moitié sourde.
Enfin il dit que ça s'améliorera certainement. Tant que j'ai ma famille qui guette autour de moi et qui vient à mon aide, avec l'adresse de l'affection, ça va encore... Mais seule, au milieu d'étrangers !
Et si j'ai un mari méchant ou peu délicat ?... Si encore c'était racheté par quelque grand bonheur dont j'aurais été comblée sans le mériter ! Mais... Pourquoi donc dit-on que Dieu est bon, que Dieu est. Juste ?
Pourquoi Dieu fait-il souffrir ? Si c'est lui qui a créé le monde, pourquoi a-t-il créé le mal, la souffrance, la méchanceté ?
Alors je ne guérirai jamais... Ce sera supportable, mais il y aura un voile entre moi et le reste du monde. Le vent dans les branches, le murmure de l'eau, la pluie qui tombe sur les vitres..., les mots prononcés à voix basse... Je n'entendrai rien tout cela ! Avec les K... je ne me suis pas trouvée en défaut une seule fois ; à dîner non plus; dès que la conversation est seulement un peu animée, je n'ai pas à me plaindre. Mais au théâtre je n'entends pas les acteurs entièrement, et avec les modèles, dans ce grand silence, on ne parle pas haut... Enfin..., sans doute, c'était prévu en quelque sorte ; depuis un an, je devrais y être habituée ?... J'y suis habituée, mais c'est tout de même épouvantable.
Je suis frappée dans ce qui m'était le plus nécessaire, de plus précieux...
Pourvu que ça s'arrête là !
Vendredi 17 novembre 82.
Ainsi je vais désormais être moins que n'importe qui, incomplète, infirme...
J'aurai besoin de la complaisance et de la complicité des miens, de la délicatesse des étrangers. L'indépendance, la liberté, tout cela est fini.
Moi si fière, il me faudra rougir et me défier de moi à chaque instant.
J'écris ceci pour m'en pénétrer, mais je n'y crois pas encore ; — c'est tellement horrible ; — mais je ne me rends pas encore compte ; c'est si cruel, si incroyable.
La vue de ma figure fraîche et rose dans une glace me remplit de pitié...
Oui, tout le monde le sait ou va le savoir, tous ceux qui étaient déjà si heureux de me décrier... — Elle est sourde. — Mais, mon Dieu, pourquoi tout à coup cette chose épouvantable, affreuse, atroce ?
Mardi 21 novembre 82.
Depuis hier je travaille à l’atelier, revenue à la plus infime simplicité, ne m'occupant ni du choix du modèle, ni de sa beauté, ni d’aucune prétention. — Six mois de ce régime, dit Julian, et vous ferez tout ce que vous voudrez. — Il est convaincu que depuis trois ans je ne fais rien, et je finirai par le croire. — En réalité, depuis que je peins ça ne marche pas ; est-ce à dire que je fais moins ? Non ; je me suis donné un mal horrible, et depuis deux ans j'entreprends des choses trop difficiles peut-être, mais je travaille.
Mais Julian veut que ce soit parce que je ne travaille pas que je m'éparpille...
Ils m'ennuient tous, je m'ennuie !... Je ne guérirai jamais. Vous ne sentez pas ce que cela a d'horrible, d'injuste, de désespérant ?
Je supporte cette pensée avec calme, j'y ai été préparée, mais ce n'est pas encore pour cela ; — c'est que je ne puis croire que ce soit pour toujours.
Comprenez-vous bien, pour toute la vie, jusqu'à la mort ?...
Évidemment ça va influer sur mon caractère et sur mon esprit, sans compter que cela m'a fait déjà des cheveux blancs.
Je le répète, je n'y crois pas encore. C'est impossible qu'il n'y ait rien, rien à faire; que ce soit pour l'éternité, et que je mourrai avec ce-voile entre l'univers et moi, et que jamais, jamais, jamais !...
N'est-ce pas qu'on ne peut pas croire à un arrêt aussi définitif, aussi irrévocable ? Et pas l'ombre d’espoir, pas l'ombre, pas l'ombre !
Ça me rend si nerveuse en travaillant, je crains toujours que le modèle parle sans que j'entende, ou que!qu'un à l'atelier, ou qu'on rie..., ou bien qu'on parle trop haut pour moi.
Et avec le modèle chez moi ?... Mais sapristi, on lui dit carrément que... que quoi ? Que je n'entends pas bien ! ! Essayez-le donc. Un pareil aveu d'infirmité ! Et une infirmité si humiliante, si sotte, si triste, une infirmité !
Je n'ai pas ce courage et j'ai toujours l'espoir qu'on ne s'apercevra pas.
Vous savez, je tâche de faire des phrases ici, mais je n’y crois pas... Il me semble que je parle d'une autre.. et comment réaliser cet horrible cauchemar, cette chose épouvantable cruelle, atroce ?... en pleine jeunesse, en pleine vie ? Comment croire que c'est possible, que ce n'est pas un mauvais rêve, que c'est éternel ?
Jeudi 23 novembre 82.
Ce que je fais celte semaine est si mauvais que je n'y comprends rien moi-même. Julian m'a appelée chez lui et m'a dit des paroles si futiles, si cruelles... si... Je ne le comprends pas ! L'année dernière, il me disait à peu près la même chose ; maintenant, en voyant les études de l'année dernière, il dit : « Vous n'en feriez pas autant a présent, c'était du bon travail. » — A le croire, voilà trois ans que je ne fais plus rien, c'est-à-dire qu'il a commencé ses reproches et ses lamentations et ses petits sarcasmes, depuis que je peins, depuis trois ans.
Il croit peut-être me pousser à travailler ; c est le contraire : cela m'a anéantie, je suis restée pendant trois heures perdue, les mains incertaines et le feu aux bras.
L'été dernier, j'ai fait Irma qui rit, et tout le monde a trouvé cela bien. Cet été, après l'Espagne, après la maladie, j'ai fait un pastel que tout le monde a trouvé excessivement bien, et une peinture bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? J'ai raté mon pêcheur. Oui, et puis j'ai été en Russie — six semaines de vacances — je rentre, je tombe sur un modèle immonde, une mauvaise place, je me force à travailler quand même, à contre cœur ; je fais une horreur que je gratte, que je salis ; j'essaye dans ce tas de peindre un bras, Julian arrive comme je venais de l'ébaucher, et très mal, et alors il me dit cela, chez lui encore, en particulier : — Que je ne suis pas Breslau, je le sais ; que j'ai besoin d'étudier, je le sais ; mais de là à venir me dire que tout est perdu, que je ne sais plus rien, qu'il est arrivé je ne sais quelle chose... Enfin, on dirait que je n'y comprend rien, ma parole d'honneur !
Je ne le fais pas exprès. Alors quoi ! Après ma maladie à Nice, tous les efforts que j'ai faits, il les a traités d'horreurs ; mais si c'est son sentiment, c'est aussi le mien ; seulement il ne faut pas venir dire que c'est parce que je m'éparpille que je ne fais rien, que je suis sûre de moi, que je ne veux pas, que je me crois arrivée. Il ne le croit pas, c'est une dérision. — Mais c'est bien bête, car cela m'anéantit.
Si je ne fais pas en peinture de rapides progrès, comme en dessin, ce n'est pas une raison pour me dire toutes ces infamies.
Lundi 27 novembre 82.
Une élève pose pour moi, et volontiers, car je lui donnerai l'étude. Anéantie par Julian, je n'osais le demander à personne, croyant que ce serait ridicule de la part de quelqu'un qui est dans l'eau, qui ne fait plus rien, qui, etc., etc.
Maintenant qu'il ne peut plus dire que je ne fais rien, parce que je travaille dans sa boutique, il dit que je fais semblant. Cela tourne à la scie. — Avant-hier, il dit qu'il n'y a que deux ans que je ne fais rien. — De ces deux années, j'ai été malade cinq mois et convalescente ou fiévreuse, six. Dans ce qui reste du temps, j'ai fait le tableau du Salon, une femme grandeur nature, en plein air, en Russie ; le Vieux de Nice, Thérèse, Irma, Dina. Voilà pour les grands tableaux ; je ne compte pas les études assez nombreuses. Que ce soit mauvais, je le veux bien, mais ce n'est pas mon cordonnier qui y a passé son temps.
Enfin, il trouve que cela doit me stimuler et que c'est peut-être spirituel. — C'est exaspérant ! — Sans doute je ne suis pas favorisée comme Breslau, qui vit dans un petit cercle artistique et où chaque parole, chaque pas rapportent quelque chose à l'étude. Mais je vous jure que je fais ce que je peux, dans le milieu où je me trouve.
On me fait perdre du temps, sans doute ; le soir, par exemple, que Breslau emploie à dessiner, à composer, — et moi je suis distraite et tiraillée par les personnes qui m'entourent.
Le milieu, c'est la moitié du talent pendant la phase où on est élève. Tout cela me donne une contenance de rage froide ou bien qui paraît détachée, à force d'avoir une idée fixe. — Si je ne craignais de m'attirer d'autres horreurs, je dirais que Dieu n'est pas juste. Au fait, non, pourquoi ? J'ai horreur de moi, j'ai engraissé, les épaules étaient déjà assez larges sans cela, les bras sont forts et la poitrine grossit.
Dimanche 3 décembre 82.
Ah ! mon Dieu, donnez-moi la force de ne faire que des études, puisque leur avis à tous est qu'il faut que je me rende maîtresse du métier ; — on fait ensuite ce qu'on veut. — Je raisonne si bien, et je n'ai pas la force... Quand on sait bien son métier, tout ce qu'on fait est bien, ou à peu près, tandis qu'entre mes mains actuellement... Qu'est-ce que c'est que six mois ? ne pourrai-je patienter six mois ? oublier tout ce qui m'amuserait à peindre et ne faire que des études et ne pas perdre de temps ?
La continuité d'efforts, et puis après ?...
Mardi 5 décembre 82.
Je sors de lire d'un trait Honorine, et je voudrais posséder cette sublime éloquence de la plume, afin qu'en me lisant on s'intéressât à ma plate existence.
Ce serait curieux, si le récit de mes insuccès et de mon obscurité allait me donner ce que je cherche et chercherai encore. Mais je ne le saurai pas... et, d'ailleurs, pour qu'on me lise et se débrouille dans ces milliers de pages, ne faut-il pas que je devienne quelqu'un ?...
L'incertitude et le découragement me font rester oisive, c'est-à-dire lisant toute la soirée, et j'en ai ensuite des remords qui me mettent le feu aux bras. Mais aussi je suis, ou toute seule ou avec ma famille, et c'est abrutissant.
J'écris en m'arrêtant à chaque mot, car je n'en trouve pas pour peindre le trouble affreux, la prostration, la terreur que j'éprouve de ne me retenir à rien.
Qu'est-il arrivé ? Rien.
Alors quoi ? Je consentirais avec joie à ne vivre que dix ans, pour avoir du talent tout de suite et réaliser mes rêves...
Il y a deux ou trois jours, nous sommes allés à l'hôtel Drouot ; il y avait une exposition de bijoux ; maman, ma tante, Dina admiraient plusieurs parures ; moi j'en faisais fi, sauf d'une rangée de diamants énormes, prodigieux et dont j'ai eu un instant bien envie ; en avoir deux serait déjà joli, mais il ne fallait pas songer à un miracle pareil ; aussi me suis- je contentée de penser que peut-être, un jour, en me mariant avec un millionnaire, je pourrais avoir des boucles d'oreilles de cette grandeur ou une agrafe, car des pierres de ce poids peuvent difficilement se suspendre aux oreilles. — Voilà bien la première fois que je comprenais les bijoux. — Eh bien ! hier soir on me les a apportés, ces deux diamants ; mes mères les ont achetés pour moi et j’avais seulement dit, sans le moindre espoir de les avoir : « Voilà les seules pierres qu'on aurait envie d'avoir. » Ça vaut vingt-cinq mille francs ; les pierres sont jaunes, sans cela elles coûteraient le triple.
Je m'en suis amusée toute la soirée, les tenant dans ma poche, pendant que je modelais, que Dusautoy jouait du piano, et que Bojidar et les autres causaient. Ces deux pierres ont passé la nuit près de mon lit et je ne m'en suis pas séparée pendant la séance.
Ah ! si d'autres choses qui paraissent aussi impossibles pouvaient arriver aussi !... Quand même elles seraient jaunes et ne coûteraient que quatre mille au lieu de vingt-cinq mille !
Mais enfin ce grand chagrin est absurde ; je ne puis m'en plaindre à personne !
Jeudi 7 décembre 82.
Nous avons un instant causé avec Julian, mais plus de ces longues causeries !... Il n'y a pas d'aliment, tout a été dit; nous attendons que je travaille et produise. Pourtant je lui reproche son injustice, ou plutôt la façon dont il s'y prend pour me faire marcher.
Mon pastel ira dans un cercle, puis au Salon : — C'est une chose de premier ordre, dit le père Julian, et j'ai envie de lui sauter au cou.
— Eh bien, il faut faire un tableau qui arrête les artistes.
Et ce n'est pas encore à présent que je le ferai. Ah ! Seigneur, si je pouvais croire qu'en travaillant, j’y arriverai ! Ça me donnerait du courage. Mais il me semble à présent que je ne pourrai jamais.
Je travaille mal, je sais, oui, c'est vrai ; depuis Irma, j'ai pataugé dans la pluie avec le père Charles, et puis j'ai été en Russie ; total trois mois d'abrutissement. Et trois mois représentent douze études, douze torses grandeur naturelle ou douze-ensembles demi-nature. Je n'en ai jamais de ma vie fait quatre de suite. Julian a raison aussi, j'avais envie de l'embrasser !
Mais j'ai été malade un an !
Jeudi 14 décembre 82.
Le matin, nous allons voir les toiles que le vrai Bastien vient de rapporter de la campagne. Il est là, en train de rarranger les bords des tableaux et certaines choses dans le fond. Nous nous rencontrons comme des amis ; il est si gentil, si bon enfant !
Peut-être n'est-il pas tout cela ? Mais il a tant de talent ! Pourtant si, il est charmant.
Et le pauvre architecte est tout à fait effacé par le rayonnement fraternel. — Jules a rapporté plusieurs études : « Un soir au village, » la lune paraît déjà et les fenêtres s'allument : un homme rentrant des champs se retourne pour parler à une femme qui se dirige vers la maison dont la fenêtre est illuminée ; le crépuscule est rendu merveilleusement, le calme qui envahit tout, les gens qui rentrent chez eux ; tout se tait, seulement on entend aboyer quelques chiens. C'est d'une couleur, d'une poésie, d'un charme !...
— Le genre de Jules Breton — qu'on appelle poète, gros comme le poing, — mais mieux.
Il y a aussi une forge où un vieux bonhomme travaille. C'est tout petit, et ce n'est pas moins beau que ces merveilleuses petites toiles brunes qu'on voit au Louvre. A côté de ça, des paysages, de l'eau, Venise et Londres. — Et deux grandes toiles : — une bouquetière anglaise et une gamine dans un champ. — C'est grand comme nature et cela m'a remplie de stupéfaction, tellement cela me parait inférieur à lui-même.
D'abord on est ébloui par la variété et la toute-puissance de ce talent qui dédaigne la spécialité et fait tout supérieurement.
Son gamin anglais est une fois au-dessus de ces deux filles ; quant au gamin de l'année dernière intitulé Pas-mèche, c'était simplement un chef-d'œuvre.
Dimanche 17 décembre 82.
Le vrai, le seul, l'unique, le grand Bastien-Lepage vient aujourd'hui.
Je l'ai reçu affolée, maladroite et confuse, énervée et humiliée de n'avoir rien à lui montrer.
Il reste plus de deux heures, après avoir regardé toutes les toiles dans tous les coins ; seulement, je l'empêchais de voir, nerveuse et riant de travers. Ce grand artiste est très bon ; il essaye de me calmer, et on parle de Julian, qui est l'auteur de cet immense découragement. Bastien ne me traite pas en fille du monde ; il dit comme Tony Robert-Fleury, comme Julian, seulement sans ces horribles plaisanteries de Julian qui dit que c'est fini, que je ne ferai plus rien, que je suis perdue. Voilà ce qui m'affole.
Bastien est adorable, c'est-à-dire j'adore son talent. Et je crois avoir trouvé, grâce à mon trouble, des flatteries délicates et imprévues ; la façon dont je l'ai reçu était déjà une bien grosse flatterie. Il fait un croquis dans l'album de miss Richards, qui me l'avait confié pour que j'y dessine quelque chose. Et comme l'œuvre passait à travers la feuille et salissait la suivante, il voulut mettre un morceau de papier entre :
— Laissez, laissez, ça lui en fera deux. — Je ne sais pas pourquoi je fais le bonheur de Richards, quelquefois ça m'amuse de faire un grand plaisir à qui ne s'y attend pas et qui est pour moi un passant.
Quand je peignais à la Grande-Jatte, un jour est venue au bord de l'eau toute une famille, le père et quatre ou cinq enfants déguenillés avec un pauvre paquet de hardes ; ça avait l’air d'un déménagement de misère. Je leur ai donné deux francs. Il fallait voir la joie, la surprise de ces misérables ! Je me suis cachée derrière les arbres. — Le ciel ne m'a jamais si bien traitée, le ciel n'a jamais eu de ces bienfaisantes fantaisies
.Mercredi 20 décembre 82.
Je n'ai encore rien d'en train pour le Salon et rien ne se présente. — C'est une angoisse !…
Samedi 23 décembre 82.
Donc ce soir nous avons à dîner le grand, le vrai, le seul, l'incomparable Bastien-Lepage et son frère.
On n'avait invité personne d'autre, ce qui était un peu gênant ; ils dînaient pour la première fois et ça semblait peut-être un peu trop intime, et alors la peur que ça devienne ennuyeux, — comprenez !
Pour le frère, il est ici reçu presque aussi familièrement que Bojidar, mais le grand, le seul, le vrai, etc. Enfin ce petit bonhomme qui, si pourtant il était en or, ne vaudrait tout de même pas son talent ; ce petit bonhomme est gentil et flatté, je pense, d'être regardé comme cela ; personne ne lui a encore donné du « génie ». Je ne le lui dis pas non plus; seulement je le traite comme tel et, par d'artificieux enfantillages, lui fais avaler des flatteries énormes. Bojidar vient un instant le soir ; il est dans une lune aimable, il abonde dans mon sens, il est de la maison, très heureux de rencontrer des Bastien et autres célébrités.
Mais, pour que Bastien ne s'imagine pas que je pousse mon admiration à l'excès, je lui adjoins Saint-Marceaux, dont je .lui parle : — « Vous deux ! » — Enfin il est resté jusqu'à minuit. J'ai peint une bouteille qu'il a trouvée bien, ajoutant que « c'est comme cela qu'il faut travailler; de la patience, concentrez-vous, donnez tout ce que vous pourrez, tâchez de rendre scrupuleusement la nature ».
Mardi 26 décembre 82.
Eh bien ! il parait que je suis malade ; le médecin qui me soigne ne me connaît pas, n'a aucun intérêt à me tromper ; le côté droit est endommagé, le poumon est abîmé ; ça ne se guérit jamais complètement ; seulement si on se soigne, ça n'empirera pas et je vivrai autant qu'une autre. Oui, mais il est nécessaire d'arrêter ça par des moyens violents, des pointes de feu ou un vésicatoire. — Tous les bonheurs enfin ! — Un vésicatoire, c'est une tache jaune pour un an. Il faudra adopter une touffe de fleurs que je placerai de façon à cacher ça pour les soirées, sur la clavicule droite.
J'attendrai encore huit jours ; si la complication survenue persiste, je me déciderai peut-être à cette infamie.
Dieu est méchant.
Jeudi 28 décembre 82.
Il s'agit bien de cela ! Je suis poitrinaire. Il me l'a dit aujourd'hui, — soignez-vous, il faut tenter de guérir, vous le regretterez.
C'est un jeune homme et qui a l'air intelligent, mon docteur ; à mes objections contre les vésicatoires et autres infamies, il répond que je regretterai, — et qu'il n'a jamais vu de sa vie une malade aussi extraordinaire ; — et aussi qu'à mon aspect on ne me donnerait jamais, jamais ma maladie. — J'ai l'air florissant en effet, et les deux poumons sont atteints, le gauche beaucoup moins pourtant.
La première fois que j'ai eu mal à gauche, ça a été en sortant des saintes Catacombes de Kieff, où nous avons tous été demander au bon Dieu et aux reliques de ses saints de me guérir, à grand renfort de messes et de roubles. Il y a huit jours, on n'entendait encore presque rien au poumon gauche. Il m'a demandé si j'ai des parents poitrinaires.
— Oui, le père de mon grand-papa et ses deux sœurs, la comtesse de Toulouse-Lautrec et la baronne Stralborne ; un arrière-grand-père et deux grand'tantes. — Enfin, quoi qu'il en soit, vous l'êtes, poitrinaire.
Je vacillais un peu sur mes jambes en descendant l'escalier de ce brave homme, qui s'intéresse à une malade si originale. On peut enrayer cela si je fais ce qu'il faut. C'est-à-dire : des vésicatoires et le Midi. Me défigurer les épaules pour un an et m'exiler. — Qu'est-ce qu'une année auprès de toute la vie ? Elle est belle, ma vie, du reste !
Je suis très calme, mais un peu étonnée d'être seule dans le secret de mes malheurs. Et les tireuses de cartes qui me prédisent tant de bonheur ?... Pourtant la Jacob m'a annoncé une maladie. La voilà. — Pour que sa prédiction soit entièrement réalisée, il manque : Le grand succès, l'argent, le mariage et puis l'amour d'un homme marié. — Enfin ça me fait mal du côté gauche le moins malade. Potain n'a jamais voulu dire que les poumons étaient atteints ; il employait les formules ordinaires en pareil cas, les bronches, la bronchite, etc... Il vaut mieux savoir au juste ; ça me décide à tout faire, sauf le départ, cette année.
L'hiver prochain, j'aurai, pour expliquer ce voyage, le tableau des saintes femmes. Cet hiver, ce serait recommencer les embêtements de l'année dernière. Tout, sauf le Midi, et à la grâce de Dieu !
Enfin ce qui fait qu'il a tant dit, ce docteur, c'est que depuis qu'il me voit ça va plus mal. Il soigne mes oreilles ; je ne lui ai parlé de la poitrine que par hasard, en riant, et alors il a écouté et il m'a ordonné des granules (il y a un mois) et surtout des saletés sur la peau, ce à quoi je n'ai pas pu me décider, espérant que ça n'avancerait pas si vite.
Alors je suis poitrinaire ? Depuis deux ou trois ans seulement. Et, en somme, ce n'est pas assez avancé pour que j'en meure, seulement c'est bien ennuyeux !
Oh ! Oui ! Mais comment expliquer mon air bien portant et que je ne peux plus entrer dans mes corsages, qui ont été faits bien avant que je sois malade et au moment où il n'était question de rien ? Il faut croire que je maigrirai subitement ; c'est peut-être parce que je suis jeune et que j'ai des épaules si larges, la poitrine bombée, les hanches si espagnoles ? Je n'en reviens pas de toutes ces catastrophes.
Enfin, qu'on me laisse encore dix ans, et pendant ces dix années, de la gloire et de l'amour, et je mourrai contente à trente ans. S'il y avait avec qui traiter, je ferais un marché : — mourir à trente ans passés, ayant vécu.
Mais je voudrais guérir... c'est-à-dire... arrêter le mal ; ça ne se guérit jamais, mais on vit avec ça et longtemps, autant que n'importe quel concierge. Poitrinaire : le mot y est, et la chose. — Je mettrai tous les vésicatoires qu'on voudra, mais je veux peindre.
Je pourrai masquer la tache par des corsages à fleurs et des dentelles, et du tulle, et mille choses ravissantes, qu'on met sans en avoir besoin ; ça pourra être même joli. Ah ! je me console. On ne met pas de vésicatoires toute sa vie ; après un an, deux ans enfin de soins, je serai comme tout le monde, je serai jeune... je...
Ah ! je vous l'avais bien dit que je devrais mourir. Dieu, ne pouvant me donner ce qui me rendrait la vie possible, s'en tire en me tuant. Après m'avoir accablée de misère, il me tue pour en finir. Je vous l'ai bien dit que je devrais mourir, ça ne pouvait pas durer ; cette soif de tout, ces aspirations colossales, ça ne pouvais pas durer. Je vous l'ai bien dit, il y a longtemps, il y a des années, à Nice, lorsque j'entrevoyais vaguement encore tout ce qu'il me fallait pour vivre. Mais les autres ont davantage et ne meurent pas ! Voyons !...
Je ne le dirai à personne, sauf à Julian, qui a dîné ici et le soir, nous trouvant un instant seuls, je lui ai fait un signe de tête significatif, en indiquant de la main la gorge et la poitrine. Il ne veut pas croire ; je parais si forte. Il me rassure, me citant des amis sur le compte desquels les médecins s'étaient trompés...
Là-dessus, il me demande ce que je pense du ciel ; j'avais dit qu'il me maltraitait, le ciel. — Ce que j'en pense ? Pas grand bien. — Il croit que je crois qu'il y a tout de même quelque chose. — Oui, c'est possible. Je lui lis l'Espoir en Dieu, de Musset, et il me répond par l'invocation ou les imprécations de Franck... : « Je veux vivre ! »
Moi aussi. Tiens, ça m'amuse cette position de condamnée, ou à peu près. C'est une pose, une émotion ; je contiens un mystère, la mort m'a touchée du doigt ; il y a là un certain charme, c'est nouveau d'abord.
Et pouvoir pour tout de bon parler de ma mort, c'est intéressant et, je le répète, ça m'amuse. C'est dommage que l'on ne puisse sans inconvénients avoir d'autre public que mon confesseur Julian.
Samedi 30 décembre 82.
Ça marche là-dedans ! — Bon, voilà que je commence à exagérer ; non, mais c’est vrai ça marche, et impossible de me remettre, et le bon Dieu, qui n'est ni juste, ni bon, et qui me punira probablement encore, parce que j'ose le dire ! — Il me fait tellement peur que je vais me soumettre, soumission dont il ne me sera pas tenu compte, puisque c'est par peur.
Pourvu que... ; c'est que je tousse beaucoup et j'entends dans la poitrine des choses... Enfin, remettons tout au 14. Pourvu que je dure convenablement jusque là ! Pas de fièvre, pas de figure tirée... C'est que c'est si difficile... Après, peut-être il sera trop tard, ça fait des progrès si vite ; les deux côtés, songez donc. Ah ! Misère !
Dimanche 31 décembre 82.
Il fait trop sombre pour peindre, nous allons à l'église. Et puis nous allons revoir l'exposition de la rue de Sèze, Bastien, Saint-Marceaux et Cazin. C'est pour la première fois que je vois des peintures de Cazin, et je suis conquise. C'est de la poésie ; mais le Soir au village de Bastien ne le cède en rien à ce poète de profession appelé Cazin, et notez que Bastien a été souvent flétri du titre d'exécutant de premier ordre.
Là je passe une heure précieuse ; voilà des jouissances ! On n'a jamais fait de la sculpture comme Saint-Marceaux. Les mots si souvent employés et devenus banals : C'est vivant ! sont là d'une vérité absolue. Et, en outre de cette qualité maîtresse et qui suffit pour rendre heureux un artiste, il y a là une profondeur de pensée, une intensité de sentiment, un je ne sais quoi de mystérieux qui ne fait pas de Saint-Marceaux un homme d'un immense talent, mais qui en fait presque un artiste de génie.
Seulement il est jeune encore et il est vivant, voilà pourquoi j'ai l'air d'exagérer.
Par moment, je le placerais au-dessus de Bastien.
C'est une idée fixe à présent ; il me faut un tableau de l'un et une statue de l'autre.
1883
Lundi 1er janvier 83.
Gambetta, malade ou blessé depuis plusieurs jours, vient de mourir.
Je ne peux pas dire l'étrange effet produit par cette mort. Il est impossible d'y croire. Cet homme faisait tellement partie de la vie du pays entier que l'on ne s'imagine rien sans lui. Triomphes, défaites, caricatures, accusations, louanges, blagues, rien ne se tenait debout sans lui... Les journaux parlent de sa chute, il n'est jamais tombé ! Son ministère ! Est-ce qu'on peut juger un ministère de six semaines ? Quelle plaisanterie et quelle mauvaise foi ! On demande à un homme d'être Sully en quarante jours, avec la menace perpétuelle d'être renversé pour une question de soupière en caoutchouc à double détente !
Mort avec sept médecins, et quels intérêts autour de lui, quels désirs de le sauver ! A quoi bon se soigner, se tourmenter, souffrir ? La mort m’épouvante à présent comme si je la voyais.
Oui, il me semble que cela va venir... bientôt. Ah l qu'on se sent petit ! Et à quoi bon ? Pourquoi ? Il doit y avoir quelque chose au-delà ; cette existence passagère n'est pas assez, n’est pas en proportion avec nos pensées et nos aspirations. Il y a l'au delà, sans quoi cette vie ne s'explique pas et Dieu semble absurde.
La vie future... il y a des moments où on l’entrevoit sans la comprendre, et l'on est épouvanté.
Mercredi 3 janvier 83.
La lecture des journaux remplis de Gambetta me serre la tête comme dans un cercle en fer ; les tirades patriotiques, les mots sonores : patriote, grand citoyen, deuil national !... Je ne peux pas travailler ; j'ai essayé, j'ai voulu m'y forcer, et c'est même ce faux sang-froid de la première heure qui m'a fait commettre l'irréparable et à jamais regrettable bêtise d'être restée à Paris au lieu de courir à Ville-d'Avray, la nouvelle sitôt reçue, et voir la chambre, et faire même un croquis... Je ne serai jamais opportuniste !...
Jeudi 4 janvier 83.
On a amené le cercueil au Palais, c'est le président de la Chambre qui l'a reçu. — Je vous remercie de l'avoir amené ici, — dit-il à Spuller, en fondant en larmes. — Et moi de pleurer. L'austère, le grave, le simple Brisson qui pleure ! Il n'était pas son ami. — Je vous remercie de l'avoir amené ici ! — Il y a là une émotion réelle, que ne donnera jamais aucune comédie.
Nous n'avons pas pu entrer, après avoir fait queue pendant deux heures. La foule a été assez respectueuse, si l'on prend en considération le caractère français, la presse, les coups de coudes, les conversations engagées, la tentation perpétuelle de faire de l'esprit à propos de tout, les drôleries inévitables dans une cohue pareille.
Et lorsqu'on riait fort, il y avait des gens qui imposaient silence ; on criait : C'est indécent, respectez-le !.. Et on vendait partout les photographies, les médailles, des journaux illustrés : « La vie, la mort de Gambetta ! »
Le cœur se serre devant cette constatation brutale de l'événement, de cette publicité si naturelle pourtant et qui m'a paru comme une impudeur...
Samedi 6 janvier 83.
Nous allons voir passer le cortège, des fenêtres de Marinovitch, ministre de Serbie et beau-frère de la princesse Karageorgevitch, rue de Rivoli, 240. Il serait difficile d'être beaucoup mieux.
A dix heures, le canon annonce la levée du corps ; nous sommes à nos fenêtres.
Le char, — précédé magnifiquement des clairons des militaires à cheval, des musiciens jouant une marche funèbre et de trois énormes tombereaux surchargés de couronnes, — cause une surprise que je nommerais volontiers déception, — mot dur, mais juste, pour les deux Bastien-Lepage qui l'ont construit. — A travers les larmes arrachées par ce spectacle grandiose, j'ai reconnu les deux frères marchant tout près de leur œuvre, l'architecte tenant presque un cordon du poêle et auquel son frère a généreusement accordé la préséance, n'ayant pas besoin de cela pour être célèbre. Le char est bas, comme écrasé de douleur, un drap de velours noir jeté en travers, quelques couronnes au hasard, un crêpe, le cercueil enveloppé de drapeaux... Je lui voudrais plus de majesté, habituée peut-être aux pompes de l'église... Enfin, ils ont voulu avec raison s'affranchir du corbillard classique et imiter une sorte de char antique qui fait songer au corps d'Hector ramené à Troie.
Après le passage de trois camions de fleurs et de plusieurs gigantesques couronnes à pied, on pouvait croire que c'était assez ; mais ces trois camions s'oublient presque dans la suite, car jamais, au dire de tout le monde, on n'a vu un tel défilé de fleurs, de drapeaux en deuil et de couronnes.
Moi j'avoue sans honte être complètement empoignée par cette magnificence. On est ému, énervé, excédé, il n'y a plus de mots pour dire toujours la même chose. Comment, encore ? Oui encore, encore et toujours, des couronnes de- toutes les tailles, de toutes les couleurs, gigantesques, fabuleuses, comme on n'en a jamais vues, sur des brancards ; des bannières et des rubans, avec des inscriptions patriotiques, des franges d'or qui brillent à travers le crêpe. Des avalanches de fleurs, de perles, de franges, des parterres de roses se balançant au soleil, des montagnes de violettes et d'immortelles, et encore un orphéon dont la marche funèbre jouée trop vite meurt en s'éloignant en notes tristes ; puis le bruit des pas sur le sable de la rue, que je voudrais comparer au bruit d'une pluie de larmes... Et les délégations portant des couronnes passent toujours ; les comités, les associations, Paris, la France, l'Europe, les industries, les arts, les écoles, la fleur de la civilisation et de-l'intelligence.
Et encore des tambours voilés de crêpe et le son admirable du clairon après de formidables silences.
Les sauveteurs sont acclamés ainsi que les étudiants qui saluaient comme pour dire-: « Il y en a peut-être un autre parmi nous ! » Puis encore une marche funèbre et encore des couronnes. Les plus belles sont saluées par des murmures d'admiration. L'Algérie est acclamée.
Au passage de Belleville, avec cette faculté d'assimilation et de vibration que je possède à un degré si puissant, j'ai ressenti un mouvement de fierté attendrie qui m'a voilé les yeux. Mais lorsque paraissent les couronnes monumentales des villes d'Alsace-Lorraine et les drapeaux tricolores en deuil, il y a un frémissement dans la foule qui arrache des larmes. Et le défilé continue toujours, et les couronnes se succèdent, les rubans et les fleurs brillent au soleil à travers des voiles de crêpe.
Ce n'est pas un enterrement, c'est une marche triomphale. Je ne sais pas ce qui fait que je ne puis dire : apothéose. C’est un peuple entier qui marche derrière ce cercueil et toutes les fleurs de France sont coupées pour honorer ce génie atrocement tué à quarante-quatre ans, qui incarnait toutes les aspirations généreuses de cette génération, qui avait fini par s'approprier et par englober dans sa personnalité la vie entière du pays jeune, qui était la poésie, les arts, l'espoir, la tête des hommes nouveaux.
Mort à quarante-quatre ans, n'ayant eu le temps que de préparer le terrain pour son œuvre de revanche et de grandeur.
Cet incroyable et unique défilé dure plus de deux heures et demie, et enfin la foule se referme, la foule indifférente et tapageuse, ne songeant plus qu'à rire de la frayeur des chevaux des derniers cuirassiers. Il n'y a jamais eu rien de pareil : les musiques, les fleurs, les corporations, les enfants dans ce léger brouillard que le soleil faisait ressembler à des images d une apothéose. Cette vapeur dorée et ces fleurs feraient songer au convoi impossible de quelque jeune Dieu...
Même en mettant de côté la politique, je comprends que tout le monde soit porté à lui témoigner des regrets attendris. Il était l'ami, le camarade intellectuel de toute cette génération, il était la République, Paris, la France, la jeunesse, les arts. Il me semble voir un morceau d'étoffe d'où le principal ornement a été enlevé, ne laissant qu'une marque et des fils coupés.
Ah ! les fleurs, les couronnes, les marches funèbres, les drapeaux, les délégations, les honneurs, prodigue-les lui, peuple impatient, peuple ingrat, peuple injuste ! C'est fini à présent. Enveloppez d'étoffe tricolore la triste boîte qui renferme les restes horribles de cette lumineuse intelligence. Vous êtes bien dignes d'honorer ce cadavre mutilé, vous qui avez empoisonné la dernière année de la vie de cette âme ! Tout est fini. Il n'y a plus rien que de petits hommes stupéfaits devant la fosse béante de celui qui les gênait tant par sa supériorité. Combien y en a-t-il qui se disaient tout bas que Gambetta les empêchait de se faire une place par son absorbant génie ! Elle est à vous la place, montrez-vous ? Médiocres, jaloux et nuls, sa mort ne vous transformera pas.
Nous sortons de là vers trois heures. Tout le monde s'est porté à gauche. Les Champs-Élysées sont gris et déserts ; il y a si peu de temps encore cet homme s'y promenait si gai, si jeune, si vivant, dans cette très simple voiture qu'on lui a tant reprochée. Quelle mauvaise foi partout ! car les hommes intelligents, probes, instruits, français, patriotes, ne pouvaient pas, en leur âme et conscience, croire aux infamies dont on chargeait Gambetta.
On dit que son banc de député est déjà retenu par un insecte de la Chambre. Il n'y a donc là personne pour s'opposer à cette grossière injure à la mémoire de celui qui a illustré la tribune de cette Chambre, au perron jonché de couronnes, orné de lampadaires et voilé, comme une veuve, d'un gigantesque crêpe noir qui tombe du fronton en écharpe et l'enveloppe de ses plis transparents.
Ce voile est une inspiration de génie et on ne pouvait inventer une décoration plus dramatique. L'effet est saisissant ; cela fait mal et donne une impression de froid, de terreur, comme le drapeau noir de la patrie en danger.
Lundi 8 janvier 83.
Vraiment cet homme remplissait la France et presque l'Europe. Tout le monde doit sentir que quelqu'un manque ; il semble qu'il ne reste plus rien à lire dans les journaux, rien à faire à la Chambre.
Il y a sans doute des hommes plus utiles, obscurs travailleurs, inventeurs, administrateurs patients. Ils n'auront jamais ce prestige, cette magie, cette puissance. Exciter l'enthousiasme, le dévouement ; grouper, unir les partis ; être le porte-voix héroïque de la patrie, ce n'est donc pas utile, habile, admirable ? Incarner son pays, être le drapeau vers lequel tous les yeux se tournent au moment du danger... ce n’est donc pas plus que tous ces mérites de cabinet, ces vertus et ces habiletés sages des politiciens mûris ? — Mon Dieu, Victor Hugo mourrait ce soir que cela ne ferait rien à personne ; son œuvre est là, quoi qu'il advienne et il importe peu qu'il soit mort aujourd'hui ou il y a dix ans, et puis il a accompli sa carrière. Mais Gambetta, c'était la vie, la lumière du jour renaissant tous les matins ; c'était l'âme de la République, c’était la gloire, la chute, le triomphe ou le ridicule du pays entier. Il était les événements, il était la parole, c’était une épopée en action et en discours, dont on ne ressaisira plus jamais ni un geste, ni une inflexion de voix. Prodigieuse incarnation d'un parti qui est presque la France entière, et de toute façon dispensateur de tout ce qui faisait vibrer les cœurs de sympathie, de crainte, d'envie, d'admiration ou de haine, et c'est fini pour jamais !
Mardi 9 janvier 83.
Si je pouvais m'expliquer, je dirais que je suis désespérée de la mort de Gambetta. — J'ai pleuré sur le petit prince comme on pleure sur un mélodrame ; c'était tragique, c'était surtout touchant, cet enfant tué à l'étranger, si loin !.. mais ce que je pleure à présent, je ne pourrais bien le dire que si j'avais l'honneur d'être Française et le bonheur d'être homme.
Mardi 16 janvier 83.
Émile Bastien nous mène à Ville d'Avray, dans la maison de Gambetta, où son frère travaille.
Tant qu'on n'a pas vu de ses yeux, on ne croit pas à un intérieur aussi misérable, — car modeste exprimerait mal ce que c'est. La cuisine seule est convenable dans cette espèce de maison de jardinier.
La salle à manger est si petite et si basse qu'on se demande comment le cercueil y a tenu, et comment ses fameux amis ont pu l'entourer.
Le salon est un peu plus grand, mais pauvre et dénué de tout confort. Un mauvais escalier conduit à la chambre à coucher, qui me remplit d'étonnement et d'indignation. Comment ! C'est dans cette misérable cage dont je touche le plafond, avec la main littéralement, qu'on a laissé pendant six semaines un malade de la constitution de Gambetta, et en hiver, avec les fenêtres fermées. Un homme gros, asthmatique, blessé !

Il est mort aussi de cette chambre. — Un méchant papier de deux sous, un lit noir, deux secrétaires, des glaces rapiécées entre les fenêtres, et des rideaux de vieille et misérable laine rouge. — Un pauvre étudiant ne serait pas autrement logé.
Cet homme, qu'on a tant pleuré, n'a jamais été aimé ! Entouré de Juifs, d'actionnaires, de spéculateurs, d'exploiteurs, il n'avait personne qui l'aimait pour lui ou même pour sa gloire.
Mais il ne fallait pas le laisser une heure dans cette boîte malsaine et misérable !
Comment ! Mais les dangers d'un trajet d'ure heure peuvent-ils se comparer aux dangers de rester sans air, dans cette horrible petite chambre ! Mais sur un matelas à bras d'homme, on l'aurait transporté sans la moindre secousse !
Ville-d'Avray ou plutôt les Jardies qu'on nous dépeignait dans les journaux comme une petite maison à la Barras! Cet homme qu'on disait si occupé de ses aises et de son luxe ! Mais c'est une infamie !
Bastien-Lepage travaille au pied du lit. On n'a touché à rien, les draps froissés sur l'édredon qui figure le corps, les fleurs sur les draps. Dans les gravures on ne se rend pas compte des proportions de la pièce où le lit occupe une place énorme. La distance entre le lit et la fenêtre ne permet pas de se reculer du tout, aussi le lit est-il coupé dans le tableau, on n'en voit pas les pieds. Le tableau est la vérité même. La tête rejetée en arrière, vue de trois quarts, a cette expression de néant après les souffrances, de sérénité encore vivante, et déjà d'au delà. On croit le voir en réalité. Le corps étendu, étalé, anéanti, dont la vie vient de partir, est saisissant.
C'est une émotion qui vous prend aux jambes et qui casse les reins.
Bastien est un homme bien heureux ! — Je suis un peu gênée en sa présence. Quoique avec un physique de jeune homme de vingt-cinq ans, il a cette sérénité bienveillante et sans pose qu'on voit aux grands hommes, — Victor Hugo, par exemple. Je finirai par le trouver beau ; dans tous les cas, il possède ce charme infini des gens qui ont une valeur, une force et qui le savent, sans fatuité et sans sottise.
Je le regarde travailler, pendant qu'il cause avec Dina et que les autres sont dans la chambre à côté.
Sur le mur, on voit la trace de la balle qui a tué Gambetta. Il nous la montre, et alors le calme de cette chambre, les fleurs fanées, le soleil par la fenêtre, enfin cela me fait pleurer... Seulement il a le dos tourné, tout à sa peinture ; aussi, pour ne pas perdre le bénéfice de cette sensibilité, je lui tends brusquement la main et sors vite, avec la figure couverte de larmes. — J'espère qu'il l'aura remarqué. — C'est bête... oui bête d'avouer qu'on pense toujours à l'effet.
Lundi 22 janvier 83.
Depuis deux mois je vais deux fois par semaine chez le docteur indiqué par M. Duplay, qui, ainsi que vous vous le rappelez, n'avait pas le temps de me surveiller lui-même. Le traitement qui devait certainement donner de bons résultats n'en a pas donné. Je ne suis pas mieux, mais on espère que cela n’augmentera pas. « Et si ça n'augmente pas, vous devez vous estimer heureuse ! » C'est dur.
Mercredi 24 janvier 83.
Après une journée écrasante de peinture, nous allons chez Étincelle, où il y a M.Bocher, l’homme d'affaires des Orléans, et deux autres dont un grand, fort, presque un Cassagnac, gâté par un pince-nez. J'ai écouté en silence pendant vingt-cinq minutes dire des horreurs de la Révolution, des crimes de la France depuis 89, etc.
Il aurait été trop facile de répondre, surtout depuis que je ne m'endors chaque soir qu'après deux chapitres de la Révolution de Michelet. — Lorsque le vieux Bocher s'en va, je commets la faute, probablement, de dire que j'ai des opinions abominables.
Comment, républicaine ?...
Le moyen de se dire républicaine dans ce salon Louis XVI pur, et Étincelle trônant sur un fauteuil de laque blanche, en robe de velours bleu de roi à paniers ? Avec sa tête drôle et charmante, cette femme est très agréable.
Je m'en tire en disant que les mobiles, les intentions, la foi, sont admirables..., que l'élan le plus généreux, etc. Enfin... que tous les partis ont commis des crimes... pour avoir pour excuse le bonheur de tous en perspective... qu'il est naturel que, dans le principe, on tâtonne, on se trompe, cruellement parfois... Enfin, timidement, mais en termes assez précis, une modeste apologie de la Révolution..., appuyant sur le côté sentimental ; et enfin Étincelle console maman en lui disant que ce qu'il y a de généreux et d'héroïque en tout ceci devait forcément trouver un écho dans mon cœur jeune, etc., etc. En attendant, le monsieur à pince-nez restait toujours en lançant de temps en temps un mot, une phrase dans le style Cassagnac, et, comme nous partions, il a dit combien il avait regretté de n'avoir pu se rendre à notre soirée (il a eu une invitation par Saint-Amand). Échange de vives politesses avec, maman et une belle phrase à moi, avec qui il est honoré, flatté et enchanté d'avoir fait connaissance. Je réponds, par une inclination de tête.
Jeudi 22 février 83.
La tête du plus petit des garçon est entièrement peinte.
Je joue du Chopin au piano et du Rossini sur la harpe, toute seule dans l'atelier. Il fait un beau clair de lune ; l'a grande fenêtre laisse voir le ciel très clair, bleu, magnifique. Je pense à mes saintes femmes et je suis si enthousiasmée de la façon dont se présente le tableau que j'ai une peur folle qu'un autre le fasse avant... Ça trouble le calme profond de la soirée.
Il y a des jouissances en dehors de tout ; je suis très heureuse ce soir, je viens de lire Hamlet en anglais et je suis bercée par la musique d'Ambroise Thomas.
Il y a des drames éternellement émouvants, des types immortels... Ophélie... — Pâle et blonde. — Ça prend au cœur. — Ophélie ! On a envie d'éprouver un amour malheureux. Non, Ophélie, les fleurs et la mort... C'est beau !
Il doit y avoir des formules pour des rêveries comme celle de ce soir, c'est-à-dire que toutes les poésies qui passent par la tête ne devraient pas se perdre, mais se fondre en une œuvre... Est-ce que ce journal serait ?... Non, il est trop long. Ah ! si Dieu permettait que je fisse mon tableau, le vrai, le grand. Cette année, ce ne sera encore qu'une sorte d'étude..... Inspirée de Bastien ?
Mon Dieu, oui ; sa peinture ressemble tellement à la nature que si on la copie fidèlement, on est condamné à lui ressembler.
Les têtes sont vivantes, ce n'est pas de la belle peinture comme Carolus, mais de la peinture ; en somme, c'est de la chair, c'est la peau humaine, ça vit, ça respire. Il n'y a ni adresse, ni touche : c'est la mature même, et c'est sublime.
Samedi 24 février 83.
Vous savez que je suis continuellement préoccupée de Bastien-Lepage ; je me suis habituée à prononcer ce nom, et j'évite de le prononcer devant du monde, comme si j'étais coupable. Et quand j'en parle, c'est avec une tendre familiarité qui me paraît naturelle., vu son talent, mais qu'on pourrait mal interpréter.
Quel dommage, mon Dieu, qu'il ne puisse pas venir comme son frère !
Et qu'en ferais-je ? Mais un ami ! Comment! vous ne comprenez pas l'amitié ? Ah ! Moi, j'adorerais mes amis célèbres, non seulement par vanité, mais par goût, à cause de leurs qualités, de leur esprit, de leur talent, de leur génie ; c'est une race à part ; passé un certain juste milieu banal, on se retrouve dans une atmosphère plus pure, un cercle d'élus où l'on peut se prendre par la main et danser une ronde en l'honneur..... Qu'est-ce que je dis ? C'est que vraiment Bastien a une tête charmante.
J'ai bien peur que ma peinture ressemble à la sienne... Je copie la nature très sincèrement, je sais, mais je pense à sa peinture... Du reste, un artiste doué, qui sera sincèrement épris de la nature et qui voudra la copier, ressemblera toujours à Bastien.
Si ça marche toujours bien... j'aurai fini dans quatre ou cinq jours. Oui, mais...

Dimanche 25 février 83.
Ce doit être horrible, car je crois avoir fait quelque chose de bien. Un instant, j'ai été contente de moi et j'en ai une peur qui me poursuit encore. Maintenant si ce n'est pas très bien, ce sera doublement douloureux.
Mardi 27 février 83.
Enfin, c'est une série de jours gais ; je chante, je cause, je ris, et Bastien-Lepage revient comme un refrain. Ni sa personne, ni son physique, à peine son talent. Rien que le nom... pourtant je suis prise de peur... Si mon tableau allait lui ressembler ? Il a peint dernièrement un tas de garçons et de fillettes. — Le célèbre Pas-mèche entre autres, qu'est-ce qu'on peut voir de plus beau ?
Eh bien, moi, ce sont deux gamins qui marchent le long d'un trottoir en se tenant par la main : l'aîné a sept ans et regarde dans le vague, devant lui, une feuille entre les lèvres ; le petit regarde le public, une main dans la poche de son pantalon de gamin de quatre ans. Je ne sais que penser, car j'ai encore été contente de moi ce soir. C'est vraiment épouvantable !
Mais ce soir, ce soir, c'est une heure de joie immense. Quoi ? me direz-vous : — Saint-Marceaux ou Bastien sont arrivés ? — Non, mais j'ai fait l'esquisse de ma statue.
Vous lisez bien. Je veux, sitôt après le 15 mars, faire une statue. J'ai dans ma vie ébauché deux ensembles et deux ou trois bustes, tout cela abandonné à mi-chemin... parce que, travaillant seule et sans direction, je ne puis m’attacher qu'à une chose qui m'intéresse, où je mets de ma vie, de mon âme, enfin quelque chose, — pas une simple étude d'atelier.
Concevoir une figure et avoir le désir immense de l'exécuter, voilà.
Ce sera mauvais. Qu'est-ce que ça fait ? Je suis née sculpteur, j’aime la forme à l'adoration ; jamais la couleur ne peut donner autant de puissance que la forme, quoique je sois aussi folle de la couleur. Mais la forme ! Un beau mouvement, une belle attitude ; vous en faites le tour, la silhouette change en gardant la même signification.
Bonheur ! Volupté !
Ma figure est une femme debout qui pleure, la tête dans ses mains. Vous savez, ce mouvement d'épaules, quand on pleure.
Je voulais m'agenouiller devant. Je disais mille folies. L'esquisse est haute de 30 cent., mais ce sera grandeur nature. Ce sera un défi au bon sens... Tiens, pourquoi ?
Enfin j'ai déchiré une belle chemise de batiste pour envelopper cette petite statuette frêle. J'aime mieux cette terre que ma peau.
Et puis je n'ai pas de bons yeux ; si je n'y vois plus assez pour peindre, je modèlerai.
C'est si beau ce linge blanc et mouillé recouvrant et drapant avec de beaux plis ce corps souple, que je vois, comme il devrait être. Je l'ai enveloppé avec respect ; c'est fin, c'est délicat, c'est noble !
Mercredi 28 février 83.
Le tableau sera fini demain, j'y aurai mis dix-neuf jours. Si je n'avais refait l'un des gamins, ce serait déjà fini, en quinze jours. Mais il paraissait trop âgé.
Samedi 3 mars 83.
Tony est venu voir le tableau. Il en est très content. Une des têtes est très bien.
« Vous n'avez jamais rien fait d'aussi bien ; c'est souple et d'un joli ton. A la bonne heure, c'est vraiment bien. Bravo ! mademoiselle. » Et comme cela pendant longtemps. Enfin c'est très bien. Je ne peux pas y croire. Reste à faire les vêlements et je veux aussi refaire la tête du petit qui n'est pas mal, mais pas si bien que l'autre. C'est qu'il avait l'air de trouver cela vraiment bien. Et pourtant je ne suis pas contente, ça ne m'a pas rendue gaie. Un autre jour, j’aurais sauté toute la journée.
Alors pourquoi ne suis-je pas enchantée ? Car jamais il ne m'en a dit autant. Ce n'est pas que je le soupçons de flatterie. Oh ! non. J'aurais pu faire encore mieux, il me semble du moins, et je vais tâcher d'y arriver dans la deuxième figure.
Il est content, c'est évident ; je voudrais savoir ce qu'il en dit aux autres.
Est-ce seulement relativement très bien, très bien pour moi, ou est-ce vraiment bien ? Moi, je vois au-delà, plus loin, mieux, je voudrais refaire... Je puis faire mieux... Alors ?
Mercredi 14 mars 83.
Julian est enfin venu voir le tableau, je ne le lui demandais pas ; il y a eu seulement échange de lettres pleines de chicanes de part et d'autre. Mais il se sent coupable, et je triomphe modestement.
Il le trouve très bien.
Je le retiens à déjeuner, — comme M. Grévy.

Jeudi 15 mars 83.
Voilà. C'est fini ! A trois heures je travaillais encore, mais tout le monde est arrivé et il a fallu tout laisser. — Madame et Mademoiselle Canrobert, Alice, Bojidar, Alexis, la Princesse, Abbema, Madame Kanchine ! Et Tony R.-F. est venu dans la matinée. Toute cette société va chez Bastien voir le tableau : l'Amour au Village. — Dans un verger une jeune fille de dos, la tête baissée, une fleur à la main ; elle s'appuie à une haie ; de ce côté de la haie, un jeune homme vu de face, les yeux baissés et regardant ses doigts qu'il tourmente. C'est d'une poésie pénétrante et d'un sentiment exquis.
Pour ce qui est de l'exécution, il n'y en a pas ; c'est la nature même. Il y a un petit portrait de Madame Drouet, — le vieil ange gardien de Victor Hugo — qui est un miracle de vérité, de sentiment, de ressemblance ; aucune de ces peintures ne se ressemble, même de loin ; ce sont des êtres vivants qui passent sous vos yeux. Ce n'est pas un peintre, c'est un poète, c'est un psychologue, c'est un métaphysicien, c'est un créateur.
Son portrait à lui, qui est là dans un coin, est un chef-d'œuvre. Et il n'a pas encore tout donné ; c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus ou mieux que ce qu'il a fait ; mais nous l'attendons à un grand tableau où il atteindra de telles hauteurs que personne n'osera plus nier son génie.
La fillette vue de dos avec ses deux nattes courtes et sa fleur à la main est un poème.
Jamais personne n'est entré plus avant dans la réalité de la vie que Bastien. Rien n'est plus élevé, plus admirablement humain. Les dimensions naturelles contribuent encore à rendre plus saisissante la vérité de ses tableaux. Qui me citerez-vous ? Les Italiens ? Les faiseurs de sujets religieux et naturellement conventionnels ? Il y en a de sublimes, mais forcément routiniers et puis... cela ne vous prend pas au cœur, à l'âme, à l'esprit. Les Espagnols ? Brillants et charmants. Les Français, brillants, dramatiques, ou académiques.
Millet, Breton sont des poètes sans doute. Mais Bastien a tout réuni. Il est le roi de tous, non seulement par son exécution miraculeuse, mais par la profondeur d'intensité de sentiment. On ne peut pousser plus loin l'observation, et le génie de l'observation est presque tout le génie humain, a dit Balzac. J’écris assise par terre, au moment de me coucher ; il a fallu que je raconte tout ça.
Jeudi 22 mars 83.
Hier, j'ai appelé deux praticiens qui m'ont construit la carcasse de la statue en grand, d'après la petite que j'ai faite en terre. Et aujourd'hui je l'ai dessinée et lui ai donné le mouvement voulu... Je suis très empoignée. Les saintes femmes en peinture, que je tâcherai de faire cet été ; et en sculpture, ma grande préoccupation c'est Ariadne. En attendant, je fais cette femme, qui est en somme la figure debout, la figure de l'autre Marie du tableau ; seulement en sculpture, sans vêtements et en prenant une jeune fille, cela ferait une adorable Nausicaa. Elle a laissé tomber sa tête dans ses mains et pleure. Il y a dans la pose un abandon si vrai, un désespoir si complet, si jeune, si sincère, si triste que je suis très empoignée.
Nausicaa, fille du roi des Phéaciens, est une des plus charmantes figures de l'antiquité. Figure de second plan, mais figure attractive, touchante, intéressante.
Je suis absolument de l'avis d'Ouïda, qui voudrait étrangler la vieille Pénélope et marier Ulysse avec cette idéale jeune tille, appuyée à la colonne de marbre rose du palais de son père et s'éprenant de cet intrigant d'Ulysse, au récit de ses aventures. Aucune parole n'est échangée entre eux ; il s'en va, ce bourgeois, retrouver son pays et ses affaires. Et Nausicaa reste sur le rivage à regarder s'éloigner la grande voile blanche, et lorsque tout, à l'horizon bleu, est désert, elle laisse tomber sa tête dans ses mains, et, les doigts sur la figure, dans les cheveux, sans souci de sa beauté, les épaules soulevées et le sein écrasé par ses bras, elle pleure.
Dimanche 25 mars 83.
Depuis hier deux heures je suis dans des transes qu'on comprendra lorsque j'aurai dit pourquoi.
Villevieille vient me voir et demande si j'ai des nouvelles du Salon. — Mais non. — Comment ! vous ne savez rien ? — Rien. — Mais vous avez passé. — Je n'en savais rien. — Sans doute, puisqu'on en est à la lettre C. — Et voilà tout. J'écris avec peine, les mains me tremblent, je me sens comme désorganisée, en morceaux, en loques.
Puis arrive Alice qui dit : « Vous êtes reçue ! »
— Reçue comment ? Sans numéro ?
— On n'en sait rien encore.
Je ne doutais pas de mon admission.
Et avec ça, maman, ma tante, tout le monde est dans une inquiétude qui m'agace au suprême degré. J'ai fait de grands efforts pour être comme à l'ordinaire et recevoir le monde.
M. Laporte est venu, mais je m'habillais.
J'ai envoyé quarante dépêches et, cinq minutes après, j'ai reçu un mot de Julian, que je copie textuellement :
« 0 naïveté, ô sublime ignorance. Je vais enfin vous dissiper.
« Reçue avec n° 3 au moins, car je connais quelqu'un qui voulait un n° 2 pour vous. Et maintenant vainqueur. Salut et félicitations. »
Ce n'est pas une joie, mais c'est la tranquillité.
Je ne crois pas que le n° 1 lui-même pourrait me faire plaisir, après ces vingt-quatre heures d'humiliantes inquiétudes. On dit que la joie est plus vive après les souffrances. Pas chez moi. Les difficultés, les inquiétudes, les souffrances me gâtent tout.
Mardi 27 mars 83.
Je viens de chercher dans l'Odyssée. Homère ne donne pas la scène que j'ai imaginée. Il est vrai qu'elle doit venir comme la conclusion logique et inévitable des faits précédents ; mais enfin il ne la donne pas. Mais le discours, plein de louange et d'admiration d'Ulysse, en abordant Nausicaa a dû inévitablement monter la tête à celle-ci ; elle s'en explique du reste à ses compagnes.
Elle le prend pour un dieu, et il lui fait la même politesse... Enfin, c'est comme ça.
Je relirai encore les paroles d'Ulysse. Lorsqu'il apparaît nu et souillé aux jeunes Phéniciennes, elles s'enfuient toutes ; Nausicaa reste seule.
« C'est Minerve qui lui donne ce courage ». Ce vieux viveur, ce vieil intrigant, fort beau du reste, a besoin de vêtements et de protection, et il compare Nausicaa à Diane. Donc elle doit être grande, élégante et svelte. — Et ses yeux, dit-il, n'ont jamais vu une mortelle semblable. — Il la compare ensuite à une tige de palmier qui l'a rendu muet de surprise, à Délos, près l'autel d'Apollon, dans un voyage qu'il y fit, suivi d'un peuple nombreux, et ce voyage a été pour lui la source des plus grands malheurs.
Ainsi en quelques mots il lui prodigue les plus belles flatteries et se présente lui-même sous un jour poétique, majestueux et digne du plus vif intérêt par ses malheurs ; il semble persécuté par les dieux.
Pour moi, il est impossible que cette jeune fille, que son esprit et sa beauté rendent l'égale des immortelles, ne soit pas saisie d'un sentiment extraordinaire, surtout dans les dispositions où l'avait mise le rêve précurseur.
Vendredi 30 mars 83.
Aujourd'hui, j'ai travaillé jusqu 'à six heures ; à six heures, comme il fait encore jour, j'ai ouvert la porte du balcon pour entendre sonner l'église et respirer l'air du printemps en jouant de la harpe.
Je suis calme, j'ai bien travaillé, puis je me suis lavée, mise en blanc, j'ai fait de la musique et maintenant j'écris ; tranquille, satisfaite, jouissant de cet intérieur arrangé par moi, où j'ai tout sous la main ; ce serait si beau de vivre de cette vie... en attendant les grandeurs ! et même si elles venaient, les grandeurs, je leur sacrifierais deux mois par an, et les autres dix mois je resterais enfermée et travaillant... C'est le seul moyen, du reste, de se procurer les deux mois en question. Ce qui me tourmente, c'est qu'il faudra que je me marie. Alors, il n'y aurait plus aucune de ces basses inquiétudes de vanité, auxquelles je n'échappe pas.
Pourquoi ne se marie-t-elle pas ? — On me donne vingt-cinq ans, et cela m'enrage — tandis qu'une fois mariée... Oui, mais avec qui ? Si j'étais comme avant, bien portante... Mais maintenant il faut que ce soit un homme bon et délicat. Il faut qu'il m'aime, car je ne suis pas assez riche pour en épouser un qui me laisse tout à fait tranquille.
Dans tout cela je ne fais pas la part de mon cœur à moi. On ne peut pas tout prévoir, et puis ça dépend... Et puis ça n'arrivera peut-être jamais ?... Je viens de recevoir la lettre suivante :
« Palais des Champs-Élysées. Association des artistes français pour les expositions annuelles des Beaux-Arts.
« Mademoiselle,
« Je vous écris sur la table même de la salle du jury, pour vous dire que la tête au pastel a eu un véritable succès au jury. Je vous en adresse tous mes compliments. Je n'ai pas besoin de vous dire que vos peintures ont été très bien accueillies.
« Cette année, c'est un vrai succès pour vous, et j'en suis bien heureux.
« Respectueuses amitiés.
« Tony Robert-Fleury. »
Eh bien ? Ah! Ah ! Et puis ?... La lettre elle-même va être épinglée ici ; seulement il faudra que je la montre pendant quelques jours. Vous me croyez folle de joie ? Je suis très calme. Je ne mérite sans doute pas d'éprouver une grande joie, puisqu'une si heureuse nouvelle me trouve dans une disposition d'esprit telle que je trouve tout cela ordinaire. Et puisque c'est à moi qu'on écrit cela, cela perd toute sa valeur. Si je savais une lettre pareille à Breslau ou à une autre, j'en serais excessivement troublée. Ce n'est pas que je n'estime que ce que je n'ai pas, mais c'est par une excessive modestie. Je n'ai pas la foi ; si je croyais cela à la lettre, je serais trop contente ; aussi suis-je réservée comme quelqu'un qui craint que « ça n'arrive pas, parce que c'est trop beau » ... Je crains de me réjouir trop tôt... et pour pas grand'chose, en somme...
Samedi 31 mars 83.
Mais j'ai été chez Julian ce matin me faire répéter les belles choses. Il parait que Bouguereau lui a dit : — Vous avez une Russe qui a envoyé quelque chose qui n'est pas mal, pas mal. — Et vous savez, ajoute Julian, que, dans la bouche de Bouguereau, c'est énorme, quand il ne s'agit pas de ses élèves. — Enfin, il paraît que j'aurai quelque chose comme une mention.
Dimanche 1er avril 83.
Je vais au Louvre ce matin avec Brisbane (Alice). Ce n'est pas qu'elle soit très intéressante, comme eût été Breslau par exemple ; il n'y a pas échange d'idées ; mais elle est bonne enfant, assez intelligente ; elle m'écoute et je pense tout haut. C'est un exercice. Je parle de ce qui me préoccupe et de ce que je désirerais. — De Bastien, naturellement, qui a pris une place énorme dans mes conversations avec Julian et Alice. — J'aime sa peinture extraordinairement, et je vous paraîtrai bien aveuglée si je vous dis que ces vieilles toiles enfumées du Louvre me font penser avec plaisir aux peintures vivantes entourées d'air, aux yeux parlants, aux bouches qui vont s'ouvrir.
Enfin, c'est l'impression de ce matin; je ne la donne pas pour définitive.
Je tousse et, sans que je me voie maigrir, il me semble que je suis malade. Seulement, je ne veux pas y penser. Mais pourquoi alors ai-je un aspect si florissant, non seulement de couleur, mais de dimensions ?
Je cherche la cause de ma tristesse et je ne trouve rien, si ce n'est que je ne fais pas grand'chose depuis quinze jours.
La statue se détraque et se fend ; tout cela m'a fait perdre un temps infini.
Demain, à une heure, je recommence à travailler, sans cela je ne me retrouve pas.
Ce qui me vexe un peu, c'est que ce pastel soit si bien et que les peintures soient simplement bien. Eh bien, je me sens en état de peindre aussi bien que ça, à présent... et vous verrez !...
Je ne suis pas triste, j'ai simplement la fièvre et de la peine à respirer. C'est le poumon droit qui... progresse.
Eh ! folle que vous êtes ! vous vous voyez pour ainsi dire brûler, et vous ne faites rien ? Des vésicatoires ? Des taches jaunes pendant un an ou deux ?
Mais, qu'est-ce que deux ans auprès de la vie, de la beauté, du travail ?
Ah ! voilà. Je n'en ai même pas grand besoin de cette épaule, et on peut si bien s'arranger...
Eh bien alors ? Et bien alors... on croit toujours que ça passera comme ça...
Mardi 3 avril 83.
Il fait très beau. Je me sens une force, je crois que je puis faire de belle peinture. Je le sens, j'en suis sûre.
Le soleil, le printemps, le grand air : voilà la plus belle raison. L'été, il faut fuir la chaleur, et l'hiver le froid ; l'été, il n'y a de beau que les matins et les soirs ; mais à présent c'est un paradis, et si l'on n'en profite pas pour peindre en plein air, l'on est bien coupable.
Ainsi demain...
Je sens en moi la puissance de rendre ce qui me frappe. Je sens une force nouvelle, une confiance en moi qui triple les facultés. Je vais entreprendre demain un tableau qui me charme ; puis, plus tard, en automne, pour le mauvais temps, un autre très intéressant aussi. Il me semble que maintenant chaque coup va porter, et j'en éprouve un enivrement incomparable.
Journée rose, Mercredi 4 avril 83.
Six gamins groupés, les têtes près les unes des autres, jusqu'à mi-corps seulement. L'aîné a une douzaine d'années et le petit six. Le plus grand, vu presque de dos, tient un nid, et les autres regardent avec des attitudes variées et justes.
La sixième est une gamine de quatre ans, vue de dos, la tête levée et les bras croisés. Ça a l'air commun, d'après la description, mais, en réalité, toutes ces têtes ensemble forment quelque chose d'excessivement intéressant.
Dimanche 15 avril 83.
Ma maladie me plonge dans une prostration qui me rend insensible. Julian m'écrit que le tableau n'est pas encore accroché ; que Tony R.-F. ne peut pas PROMETTRE (sic) la cimaise ; mais comme je ne suis pas encore accrochée... ce qui pourra être fait sera fait. Que Tony R.-F. espère fortement (sic) une petite récompense, englobant peinture (sic) et pastel. Je n'espérais rien de semblable, il y a seulement deux mois, et je reste insensible comme s'il n'était pas question de moi. Cette mention, qui devait me faire évanouir, maintenant qu'on me dit: « c’est probable, c'est certain, » j'en suis surprise comme si je n'y avais jamais cru. Et en même temps, il me semble que je ne m'évanouirais pas du tout. La vie est logique et nous prépare aux événements ; c’est ce que je regrette. Je voudrais un coup de foudre la médaille tombant du ciel sans crier gare et me plongeant dans un océan de félicité. Oui, cela me laisserait calme à présent, et j'en serais étourdie comme...
Tu n'y croyais donc pas, quand tu y comptais ?
Mercredi 18 avril 83.
Savez-vous ce que je fais ? Je fais un concours chez Julian. Une figure de femme vêtue, avec les mains. C'est très laid, mais, comme les ateliers des hommes le feront aussi, ce concours, il y a l'impossible espoir de battre des hommes, et me voilà partie.
Songez donc, il y en a qui ont monté en loge ! Ce sera jugé dans quatre semaines, car les quatre ateliers vont faire la même figure, chacun à son tour.
Si j'ai une mention cette année, j'aurai marché plus vite que Breslau, qui, avant d'aller chez Julian, avait travaillé sérieusement. Enfin...
Je viens de jouer du piano. Cela a commencé par les deux divines marches de Chopin et de Beethoven, et puis j'ai joué au hasard je ne sais quoi, et des choses si ravissantes que je m'écoute encore. Est-ce drôle ! je ne saurais en rattraper une seule note maintenant, et si je voulais improviser je ne pourrais pas. Il faut l'heure, la minute, je ne sais quoi. Et maintenant il me passe par la tête des mélodies divines. Si j'avais de la voix, je chanterais des choses ravissantes, inconnues, dramatiques... Pourquoi ?... La vie est trop courte. On n'a le temps de rien faire ! Je voudrais sculpter sans cesser de peindre. Ce n'est pas de la sculpture que j'ai envie de faire. Mais je vois de belles choses, et je sens le besoin impérieux de rendre ce que je vois.
J'ai appris à peindre, mais je n'ai pas peint parce que j'avais envie de faire tel ou tel tableau. Tandis qu'ici je vais manier de la terre pour donner un corps à mes visions.
Dimanche 22 avril 83.
Il n'y a eu que deux pastels reçus avec n° 1 : celui de Breslau et le mien. Le tableau de Breslau n'est pas sur la. cimaise, mais son portrait de la fille de l'administrateur du Figaro est sur la cimaise. Mon tableau n'est pas sur la cimaise non plus, mais Tony Robert-Fleury assure qu'on le voit bien et que le tableau qui est dessous n'est pas grand. La tête d'Irma est sur la cimaise et dans un angle, par conséquent place d'honneur. Enfin il dit que j'ai une bonne exposition.
Comme presque tous les soirs il y a du monde à dîner, j'écoute et me dis que voilà des gens qui ne font rien et qui passent leur vie à dire des niaiseries ou des potins. Sont-ils plus heureux que moi ?... Leurs tracas sont autres et ils souffrent autant. Et ils ne jouissent pas autant que moi de tout. Une quantité ile choses leur échappent : des riens, des subtilités, des reflets qui sont pour moi un champ d'observations et une source de plaisirs inconnus du vulgaire, mais aussi je suis peut-être plus sujette que beaucoup à ces contemplations des grandeurs de la nature, autant que des mille détails de Paris. Un passant, une expression d'yeux d'enfant ou de femme, une annonce, que sais-je ? Quand je vais au Louvre, traverser la cour, monter l'escalier par le sillon tracé par les millions de pieds qui l'ont foulé ; ouvrir cette porte, — et les gens que l'on y rencontre, on leur prête des histoires, on les suit dans leur être intime, on se représente leur vie en un instant ; — puis d'autres pensées, d'autres impressions, et tout cela s'enchaîne et tout cela est divers. Il y a sujet à... Est-ce que je sais ? Et si, depuis que j'entends parfois moins bien, je suis moins que tout le monde, il y a peut-être des compensations.
Oh ! non. Tout le monde le sait, et c'est la première chose que l'on doit dire en me nommant : « Elle est un peu sourde, vous savez ? » Je ne sais comment je puis l'écrire... Est-ce qu'on peut s'habituer à une telle misère ? Que cela arrive à un homme âgé, à une vieille femme, à un malheureux ! mais à un être jeune, vivant, vibrant, enragé de vie ! ! !
Vendredi 27 avril 83.
Tony R.-F. est venu me voir hier et il est resté une heure. On a parlé de mon grand tableau et le susdit Tony R.- F. manifeste des craintes sérieuses.
Il m'encourage beaucoup à faire les six gamins. C'est très difficile, mais enfin je n'ai qu'à copier. — On n'a toujours qu'à copier ! — Copier ? c'est facile à dire, copier sans parti pris d'artiste, sans une idée intérieure, copier est bête. Mais il faut copier avec l'âme comme avec les yeux. Je ne dis pas tout cela à Tony R.-F. Il le comprendrait, mais il y ajouterait des idées d’interprétation classique que je répudie avec violence. Enfin, il dit que..., dans un tableau de cet ordre-là, il faut savoir des choses dont je ne me doute pas. Exemple : les draperies... Quesaco ?
— Eh bien, Monsieur, je ferai mes draperies, puisque draperies il y a, comme je fais des vêtements modernes.
— Ce sera affreux.
— Et pourquoi ? Est-ce que les gens que je vais peindre n'étaient pas vivants et modernes ?
— Oui, mais il y a des choses, en art, qu'il faut savoir. Vous ne pouvez pas faire des draperies (!!!!) comme cela viendra, il faudra arranger.
— Est-ce que je n'arrange pas, moi, artiste, des vêtements de 1883 à mon idée ? Est-ce que je les copie sans choisir ? Est-ce que le choix n'est pas une des puissances de l'artiste ?
— C'est égal, vous ne trouverez pas dans la nature votre tableau tout fait.
Je ne réplique pas, cela me mènerait à lui dire des sottises. Mais ici…. je ne trouverai pas mon tableau tout fait dans la nature. Ah ! par exemple. Qu'est-ce que ça signifie ?
Mais mon tableau est dans ma tête. Et la nature me fournira les moyens de l'exécuter...
Il est évident qu'il doit présider à tout ceci un certain sentiment... Si je le possède, ce sentiment, tout ira bien, mais si je ne le possède pas, ce ne sont pas les études de draperies qui me le donneront.
Il me faut un paysage à peu près comme celui que je rêve, et il n'est pas compliqué.
Et il me faut deux femmes, que j'ai trouvées : l'une, la pâle, est étonnante ; l'autre est aussi bien.
Et puis ? Et puis il faut une installation quelque part à la campagne, et du beau temps pour faire mes figures. Et le paysage se fera d'après des études rapportées de là-bas.
Et alors ? La difficulté, c'est que je ne le ferai pas cette année.
Je ne pourrai y aller qu'en novembre, et, à moins de le faire entièrement là-bas, il faudra attendre l'été pour l'exécuter.
Maintenant, il y a chez moi une de ces convictions profondes, enthousiastes, immenses, que ce doit être beau ! Et il y a aussi la certitude que les forces se décuplent quand on travaille avec amour.
Il me semble même qu'un certain élan peut suppléer à presque tout. Je vous en donnerai des preuves. Exemple : voilà six ou sept ans que je ne joue plus du piano ; mais là, plus du tout, quelques mesures en passant ; je suis restée des mois sans y toucher, pour jouer tout à coup cinq ou six heures par jour une fois par an. Dans ces conditions-là, les doigts n'existent plus ; aussi je ne puis rien jouer devant du monde, et la moindre demoiselle me battrait.
Eh bien, que j'entende un chef-d'œuvre, comme la marche de Chopin par exemple, ou celle de Beethoven, que je sois saisie, possédée du désir de la jouer, et, en quelques jours, en deux ou trois jours, et en ne jouant pas plus d'une heure par jour, j'arrive à la jouer tout à fait bien, aussi bien que n'importe qui, que Dusautois, qui est premier prix du Conservatoire et qui pratique.
Samedi 28 avril (Pâques russes). — Dimanche 29 avril 83.
Le vernissage demain. Mon tableau n'est pas sur la cimaise et ma robe est laide, et...
Allons, c'est fou et indigne de moi ! La vérité la voici : j'ai à faire mes six gamins, grandeur naturelle, en pied, au coin d'une rue, auprès d'un réverbère. Je serai interrompue pendant un mois par la Russie, je reviendrai ensuite et les finirai ; ça me mènera probablement jusqu'en octobre. En octobre, je pars pour Jérusalem et j'y resterai. Ça dépendra ; s'il y a moyen d'y faire le tableau, j'y resterai trois ou quatre mois ; sinon, j'y resterai un mois et reviendrai en novembre-décembre, avec des études, pour repartir dans le Midi où je pourrai peindre mes figures en plein air en me servant des paysages rapportés. En janvier, cela m'amènera à Paris, où je ferai le tableau d'intérieur, moins grand que nature, dont l'idée a été rapportée du Mont-Dore : l'enfant de chœur.
Je pousserai en même temps la statue à laquelle je pourrai travailler tout le temps à Paris, c'est-à-dire juillet, août, septembre et janvier, février, mars. Pourtant je ne pense pas que l'enfant de chœur se fasse, si je fais les saintes femmes, et vice versa.
On a raison de dire que je m'éparpille, que je me dépense et m'énerve pour des riens, et que c'est bien dommage. Comment, il dépend de moi d'être forte et je ne le puis !
Allons donc, voyons !
Il faut essayer. Je veux me concentrer.
Lundi 30 avril 83.
J'ai le bonheur de causer avec Bastien-Lepage.
Il m'a expliqué son Ophélie. Diable !
Ce n'est pas un artiste de talent ordinaire. Il comprend cela d'une façon absolument générale ; ce qu'il m'en a dit est puisé dans les profondeurs les plus intimes de l'âme. C'est vraiment beau de comprendre ainsi l'art, de sentir comme il sent. Il ne la voit pas en folle seulement ; c'est une misérable d'amour, c'est l'immense désenchantement, l'amertume, le désespoir, la fin de tout, — la misérable d'amour, avec un trait le folie. C'est la figure la plus touchante, la plus triste, la plus désespérée...
J'en suis folle. C'est beau, le génie ! Ce petit homme laid apparaît plus beau et plus attrayant qu'un ange. On a envie de passer sa vie à l'entendre et à le suivre dans ses sublimes travaux. Enfin, il parle si simplement. Il a répondu à je ne sais quoi qu'on lui disait : « Je trouve tant de poésie dans la nature » — avec un accent de sincérité si franche que j'en reste tout enveloppée d'un charme inexprimable.
J'exagère, je sens que j'exagère. Enfin, il y a de ça.
Donc nous sortons ensemble et il y a avant de sortir un beau moment lorsque nous nous trouvons : Carolus, Tony R.- F., Jules Bastien, Émile Bastien, Carrier-Belleuse, Edelfelt et Saint-Marceaux enfin.
Mardi 1er mai 83.
Et le Salon ? Eh bien, il est plus nauvais que d'habitude.
Dagnan n'a pas exposé ; Sargent est médiocre ; Gervex ordinaire ; Henner est ravissant. C’est une femme nue qui lit. Éclairage artificiel et le tout baigné d’une sorte de vapeur, mais d'un ton si précieusement adorable qu'on se sent tout enveloppé de cette merveilleuse vapeur magique. Jules Bastien l'admire énormément Un tableau de Cazin que j'aime moins que ses paysage de sentiment, c'est Judith qui sort de la ville pour aller chez Holopherne. Je n'ai pas assez regardé pour subir « le charme qui doit s'en dégager » ; mais ce qui frappe, c'est que l'aspect de Judith n'excuse pas l'entraînement d'Holopherne.
Le tableau de Bastien-Lepage ne m'enlève pas complètement. Les deux figures sont irréprochables. Sa fillette vue de dos, la tête dont on ne voit que la joue, et cette main qui tourmente une fleur, tout cela est d'une poésie, d'un sentiment, d'une observation poussée au suprême degré.
Ce dos est un poème. La main qu'on voit à peine est un chef-d'œuvre. On sent ce qu'il a voulu exprimer. La petite baisse un peu la tête et ne sait que faire de ses pieds qui ont une pose d'un embarras charmant. Le jeune homme est très bien aussi. Mais la jeune fille est la grâce, la jeunesse, la poésie même. C'est vrai, c'est juste, c'est senti, c'est fin, c'est délicat.
Maintenant il y a un paysage tout à fait désagréable. Outre qu'on aurait pu choisir un endroit moins vert, il aurait fallu aussi l'exécuter de façon à ce qu'il ne vienne pas en avant. Ça manque d'air. Pourquoi ? On dit que le fond est trop empâté. Enfin, c'est lourd.
Et Breslau ? Breslau, c'est bien, mais on se sent troublée. C'est encore de la bonne peinture, mais ce tableau ne dit rien et il est d'un ton joli, mais commun. Ce sont des gens qui prennent du thé auprès de l'âtre. Intérieur bourgeois, sans caractère. Une brune, une blonde, un jeune homme. Ils ont l'air très grave. Ça manque d'intimité. J'aurais cru que ce serait plus ramassé et plus intime. Ça n'exprime rien. Elle, qui parle tant de sentiment, ne me paraît pas douée de ce côté-là... Son portrait est bon, mais voilà tout.
Et moi ?
Eh bien, la tête d'Irma est agréable et d'une peindre assez franche. Mais c'est une chose sans prétention.
Et le tableau m'a paru sombre, et quoique fait en plein air, il n'en a pas l'air. Le mur n'a pas l'air d'un mur, c'est un ciel, une toile peinte, tout ce qu'on veut. Les tètes sont bien. Mais ce fond est désastreux. Pourtant cela mériterait une meilleure place ; surtout quand voit des choses tellement inférieures sur la cimaise. Tout le monde est d'accord pour dire que les têtes, celle de l'aîné surtout, sont très bien. Il est probable que j'aurais pu faire mieux le reste, puisque c’est relativement facile, mais je n'ai pas eu le temps.
En revoyant mon tableau accroché là, j'ai appris plus qu'en six mois d'atelier. Le Salon est un grand enseignement... Je ne l'ai jamais si bien compris.
Mercredi 2 mai 83.
Je devais aller à l’Opéra, mais à quoi bon ? C'est-à-dire j'ai pensé un instant y aller pour qu'en m'y montrant jolie, cela vienne aux oreilles de Bastien. Et pourquoi faire ? Je ne sais pas. Enfin, est-ce bête ! Est-ce fou, que je plaise à des gens à qui je ne tiens pas du tout et qu'en revanche ?...
Il faut faire attention, d'autant plus que ce serait vraiment pour le roi de Prusse, car enfin je ne lui en veux pas sérieusement à ce grand artiste. L 'épouserais-je ? Non. Eh bien, alors ?
Enfin, pourquoi toujours fouiller jusqu'à je ne sais où ? J'ai une envie folle de plaire à ce grand homme et voilà tout. Et à Saint-Marceaux aussi. Auquel davantage ? N'importe auquel. Un d'eux me suffirait. C est un intérêt... dans la vie. Ma figure en est changée, je suis bien plus jolie, la peau est tendue, fraîche, veloutée, les yeux éveillés et brillants. Enfin, c'est curieux. Que doit faire le véritable amour, si de telles niaiserie produisent cet effet ?
Vendredi 4 mai 83.
Enfin, la question n'est pas là. Jules Bastien a dîné ici ce soir ; je n'ai posé ni à l'enfant, ni en folle, je n'ai été ni sotte, ni laide. Il a été simple, gai, charmant, nous avons fait des charges. Pas un instant de gêne. Il est très intelligent ; du reste, je n'admets pas de spécialités pour le génie ; un homme de génie peut être et doit être tout ce qu'il veut.
Et il est gai, je craignais de le voir insensible à la, plaisanterie qui, pour être fine, doit rester entre l'esprit et la blague. Enfin, il a, comme la jument de Roland, toutes les qualités... Excepté qu'il est mort… ou peu s'en faut. Est-ce bête ?
Dimanche 6 mai 83.
On fait un tapage énorme de la grande toile du jeune Rochegrosse.
On arrache à Andromaque son fils Astyanax pour le précipiter du haut des remparts.
C'est de l'antique original et moderne.
Il ne suit personne et ne s'inspire de personne. La couleur et la peinture sont d'une vigueur sans pareille. Il n'y a personne à l'heure qu'il est qui pourrait faire cela. Ajoutez à cela qu'il est le beau-fils de M. Th. de Banville ; voilà pour la presse.
Enfin, nonobstant ce détail, c'est un tempérament prodigieux. Il n'a que vingt-quatre ans, et c'est sa deuxième exposition.
Voilà comment il faudrait être, — composition, dessin, couleur sont d'une fougue incomparable.
C'est bien le talent de son nom. Écoutez : Rochegrosse, Georges Rochegrossse. C'est un roulement de tonnerre.
Et puis l'idyllique Bastien-Lepage. Georges Rochegrosse débute comme un torrent ; il est possible que plus tard son talent prendra une forme plus resserrée et qu'il recherchera la quintessence sentimentale, la psychologie, comme Bastien-Lepage.
Et moi ?...Que dit mon nom ? Marie Bashkirtseff... J'en changerai, car il sonne comme quelque chose de bizarre, de tourmenté, non qu'il ne promette un certain éclat ; il a même une certaine allure, de la fierté, du bruit, mais c'est saccadé et tracassé. — Tony Robert-Fleury, n'est-ce pas froid comme une épitaphe. Et Bonnat ? C'est correct, c'est vigoureux, mais court et sans éclat. Manet sonne comme un être incomplet, un élève qui promet beaucoup à cinquante ans. Breslau est sonore, calme, puissant. Saint-Marceaux, c'est, comme Bashkirtseff, très nerveux, mais moins tourmenté. Henner est mystérieux et calme, avec je ne sais quoi de gracieux comme l'antique…
Carolus-Duran est un déguisement. Dagnan est subtil, enveloppé, fin, doux et fort, mais sans beaucoup d'au delà. — Sargent me fait penser à sa peinture, du faux Velazquez, du faux Carolus, moins que Velazquez et tout de même bien.
Lundi 7 mai 83.
Je recommence entièrement les gamins ; je les fais en pied, une toile plus grande : c'est plus amusant.
Mardi 8 mai 83.
Je vis dans mon art, descendant pour dîner et ne causant avec personne.
Je me sens dans une phase nouvelle.
Tout paraît petit et sans intérêt, tout, en dehors de ce qu'on fait. La vie pourrait être belle, prise ainsi.
Mercredi 9 mai 83.
Ce soir, c'est un monde à part, et qui choquerait beaucoup notre société habituelle, mais qui m'amuse excessivement.
J. Bastien ne se dépense pas, lui qui prêche tellement l'économie de l'esprit, des forces et de tout pour concentrer tout sur un même point. Eh bien ! je crois que, chez moi, il y a une telle exubérance de tout que si je ne me dépensais pas, je ne pourrais y tenir. Sans doute si la conversation ou le rire vous épuisent, vous avez raison de vous abstenir, mais... Pourtant, il doit avoir raison.
On monte à l'atelier et, naturellement, ma grande toile est retournée contre Je mur, et je me bats presque avec Bastien pour l'empêcher de la voir, car il s'était fourré entre la toile et le mur.
J'exagère Saint-Marceaux, et J. Bastien dit qu'il en est jaloux et qu'il va le
Il l'a répété plusieurs fois et l'autre jour aussi ; — eh bien, que ce soit une plaisanterie, ça me ravit.
Il faut qu'il croie que Saint-Marceaux est adoré plus que lui, artistiquement, bien entendu. Je lui demande toujours: — Non, l'aimez-vous, n'est-ce pas que vous l'aimez ?
— Oui, beaucoup.
— L'aimez-vous autant que je l'aime ?
— Ah ! non, je ne suis pas une femme, moi ; je l'aime, mais...
— Mais ce n'est pas comme femme que je l'aime !
— Mais si, il se mêle un peu de ça à votre admiration.
— Mais non, je vous jure.
— Mais si, c'est inconscient !
— Ah ! pouvez-vous penser !...
— Oui, et j'en suis jaloux, je ne suis pas un beau brun moi...
— Il ressemble à Shakespeare.
— Vous voyez...
Le vrai Bastien va me détester ! Pourquoi ? Je ne sais pas, j'en ai peur. — Nous sommes hostiles l'un à l'autre, il y a des petites choses inexplicables qu'on sent. Nous ne sommes pas en sympathie ensemble, et je suis arrêtée pour dire devant lui des choses qui me feraient... peut-être aimer un peu.
Nous pensons identiquement sur les arts, et je n'ose pas parler devant lui. Est-ce parce que je sens qu'il ne m'aime pas ?
Enfin, il y a quelque chose...
Samedi 12 mai 83.
Je passe la matinée à l'atelier à causer avec ces dames et j'attrape un instant Julian pour le prier de venir voir les gamins.
Vous comprenez, je ne veux pas de conseils, mais seulement l'impression du public ; or, Julian représente la majorité bien pensante.
Il est arrivé à dîner, il a fallu faire apporter la toile de l'asile ; il a vu les deux. D'abord les gamins. Ils sont six, il y en a un grand presque de dos qui montre dans sa main je ne sais quoi aux autres cinq, groupés autour de lui. On voit la rue assez loin et, au loin, deux ou trois petites filles qui s'en vont. Il me fait carrément supprimer le réverbère qui était dans le coin à gauche, il a raison. Pour le reste, il trouve que c'est original, amusant et que c'est un succès presque certain, bien mieux que les deux gamins du Salon, surtout le côté canaille du gamin principal qui commence à devenir grand, un de ceux que les petits appellent les grands.
Enfin Julian a été ce soir parfait, sérieux, délicat, bon. Il ne m'a ni taquinée, ni blaguée. Je le lui fais remarquer et il me dit qu'il est selon ce que je lui montre — et que je suis joliment en train de remonter sur ma bête.
Nous avons causé des saintes femmes. Je lui explique comment je comprends cela. Nous nous sommes joliment moqués des draperies de T. R.-F. Est-ce que ces femmes peuvent avoir de belles draperies cachemire bleu ou marron ? Elles suivaient Jésus depuis des mois, c'étaient les révolutionnaires, les Louise Michel, les réprouvées de ces temps-là ; elles étaient en dehors de l'élégance et de la mode.
Et pendant les jours qu'a duré le grand drame, et le jugement et le supplice, est-ce qu'elles pouvaient être autrement qu'en haillons ou à peu près ? Julian dit que ce pourra être sublime ou un four. — Et que je prenne garde à Madeleine, car j'y voudrais mettre un monde et que... dans cet ordre-là, les plus grands artistes ont essuyé des défaites.
Tant pis, je suis partie ! Mon tableau est là ! Il est tout fait. Je le vois, je le sens. Rien au monde n'y changerait rien, aucun voyage, aucune nature, aucun conseil. L'effet ébauché plaît à Julian. Mais ce n'est pas encore ce que je veux. Je sais à quelle heure il faut que ça se passe, à l'heure où les contours se brouillent ; le calme contraste avec ce qui vient de se passer. — Et, au loin, des formes humaines qui s'en vont après avoir enseveli le Christ ; les deux femmes seules sont restées plongées dans la stupeur. — Madeleine, de profil, le coude sur le genou droit et le menton dans la nain, avec son œil qui ne voit rien, attaché à l'entrée du sépulcre, le genou gauche touche la terre et le bras gauche pend.
L'autre Marie est debout, un peu en arrière ; la tête dans les mains et les épaules soulevées ; on ne voit que les mains, et la pose doit révéler une explosion de larmes, de lassitude, de détente, de désespoir ; la tête tombée dans ses deux mains et le corps où on sent l’abandon, l'évanouissement de toutes les forces. Tout est fini. — Julian trouve que ce mouvement est très beau, qu'elle ne s'occupe pas du public, qu'elle est là pour elle, livrée à sa misère.
La femme assise sera la plus difficile. Il doit y avoir là de la stupeur, de l'ahurissement, du désespoir, de la prostration et de la révolte. Et c'est cette révolte qui est la chose délicate à rendre. Un monde, un monde !
Et c'est moi qui entreprends cela ? Eh bien, oui, c'est moi, et ça ne dépend que de moi, et c'est impossible de ne pas le faire, si Dieu veut. Ah ! il doit savoir que je le crains et que je tombe à genoux pour le supplier de me permettre de travailler. Je ne mérite pas de faveurs ni de secours, mais seulement qu’Il me laisse faire.
Mais ça pourra être un four, un four aux yeux du public ; ce n'en sera pas moins une belle chose.
:Et j'aurai mes gamins pour me consoler.
Ce serait trop beau !
Mon tableau du Salon ne m'intéresse pas. Je l'ai fait faute de mieux et n'ayant pas assez de temps.
Mardi 15 mai 83.
Mais il ne s'agit pas de ça. De quoi alors ?... De ce qu'il fait beau, que la lune est belle que le ciel est beau, que les étoiles font penser à un tableau de Cazin et qu'il n'y a que l'Art. Et que je suis tranquille de n'avoir plus à partir, de pouvoir finir le gamins, et puis le pêcheur, et puis le garçon qui lit sur un banc, et puis faire une trentaine de couchers de soleil...
Mercredi 16 mai 83.
Il fait si chaud qu'on ne vit que le soir. Je monte chez moi, bien heureuse de tout cet étage tranquille, avec l'infini du ciel.
Seulement, le printemps ne pousse pas au sentiment mais aux enfantillages.
On entend le sifflet du chemin de fer et la cloche de l'église de la rue Brémontier... C'est très poétique..
Par ces belles soirées, on devrait faire des parties de campagne, sur l'eau, au diable, avec du monde ; quel monde ?...
Je pense à tout ce Paris des Champs-Élysées et du Bois, qui vit... pendant que je suis là, en Amérique. Fais-je bien, fais-je mal de jeter ma jeunesse en pâture à des ambitions qui me... Enfin vais-je recueillir les intérêts du capital employé ?
Le sifflet est très harmonieux, la nuit. Un tas de gens reviennent de la campagne, fatigués, rêveurs, heureux, pochards, éreintés.
Toujours le sifflet...
Quand je serai célèbre... et ce sera peut-être dans un an... Je suis très patiente, comme si j'étais sûre...
Le sifflet, toujours... et on dit que quand on entend le sifflet comme ça, c'est que le temps est à l'orage, et voilà que ça me fait penser à ce que dit Domingue, de l'orage qui va éclater dans Paul et Virginie.
Bien difficile de lire Balzac dans ces dispositions d'esprit ; mais je ne lirai rien d'autre, pour ne pas me monter la tête.
Encore la cloche et le sifflet.
Vendredi 18 mai 83.
Désirer beaucoup l'amitié de Bastien-Lepage, c'est donner à ce sentiment trop d'importance, le dénaturer pour ainsi dire et se mettre vis-vis de soi-même dans une situation fausse et disproportionnée. Cette amitié m’aurait été très agréable, comme celle d'un Cazin, d'un Saint-Marceaux ; mais je suis vexée d'avoir pensé à sa vie privée, et, en somme, il n'est pas assez glorieux pour cela. Ce n'est pas un artiste-dieu, comme vient de l'être Wagner ; ce n'est que dans ces conditions que l'idée d'une grande admiration serait admissible.
Ce que je cherche, c'est de me faire un salon intéressant, et chaque fois que cet espoir commence à se réaliser, arrive quelque détraquement : voilà maman partie, papa mourant, est-ce que je sais ?
J'avais le projet d'avoir un dîner chaque semaine, suivi d'une réception pour les gens du monde, le jeudi, par exemple, et, le samedi, autre dîner d'artistes, les principales célébrités paraîtraient aussi aux soirées du jeudi, ayant dîné le samedi précédent...
Et puis, tout à l'eau... Mais je recommencerai l'année prochaine, calme comme si j'étais forte, patiente comme si j'étais éternelle, et persévérante comme si j'étais encouragée.
Maintenant, que Dieu reste neutre, et je lui en serai reconnaissante comme d'un bienfait.
Vendredi 18 mai 83.
Je vais peindre un panneau décoratif : Printemps. Une femme appuyée à un arbre, les yeux clos et souriant comme dans un beau rêve. Et tout autour un paysage délicat, des verts tendres, des roses pâles, des pommiers et des pêchers en fleurs, des pousses nouvelles, tout ce qui rend le printemps d'une couleur enchanteresse.
On ne l'a jamais fait avec sincérité. On a fait dernièrement des paysages printaniers, mais on y a fourré des vieux ou des blanchisseuses ou des lépreux. Moi, je veux un parti pris de tons « enchanteurs ».
On a fait mille printemps, mais dans des paysages de carton, de chic ; il n'y a que Bastien qui aurait pu penser comme moi, et il ne l'a pas encore fait. — Il faut que cette femme ait l'air d'entendre toutes les harmonies des tons, des parfums et du chant des oiseaux. Il faut qu'il y ait là du soleil. — Bastien n'a peint que du plein air gris, à l'ombre.
Je veux là du soleil et je le ferai à Nice dans un verger, et, si je trouve un verger très poétique, ma femme sera nue.
On devra entendre le murmure du ruisseau qui passe à ses pieds,:comme à Grenade, entre des touffes de violettes, et, çà et là, des taches de soleil.
Je demande au printemps des tons qui chantent et vont à l’âme ; j'exige des verts tendres, ravissants et des roses pâles, enchanteurs, et non pas des blafarderies jaunâtres.
Une orgie de notes douces ; il faut que ce soit. d'une couleur ravissante, avec des taches de soleil qui viennent çà et là donner de la vie et un certain commencement de mystère aux ombres.
Comprenez-vous ?
Mais Bastien fait ou va faire un enterrement de jeune fille ; or, s'il est intelligent, il va lui donner pour décor un paysage comme celui que je rêve. — J'espère qu'il n’aura pas tant d'esprit et qu'il nous servira un paysage d'un vert infâme...; pourtant je serais chagrinée s'il ne faisait pas de ce sujet un tableau sublime.
Et je souhaite qu'il ait eu mes idées, tout en souhaitant qu'il ne les ait pas... Moi, je vois son enterrement de jeune fille dans un sentier fleuri, avec des arbres fruitiers en fleurs ou des roses qu'on effeuille, et des têtes grossières de paysans comme repoussoirs; toute la poésie résidera dans le cercueil et dans la nature.
Je ne lui parlerai de rien.
Dimanche 20 mai 83.
Maman est arrivée dans la nuit du jeudi à vendredi; nous avons eu une dépêche samedi, où elle dit que la santé de mon père est déplorable. Aujourd'hui, son valet de chambre écrit que son état est désespéré.
On dit qu'il souffre beaucoup, je suis contente que maman soit arrivée à temps.
C'est demain que l'on ferme le Salon, pour trois jours, pour voter les récompenses. Jeudi, réouverture.
J'ai rêvé qu'on avait mis sur mon lit un cercueil et l'on disait qu'il y avait une jeune fille dedans. Et il resplendissait comme du phosphore, la nuit...
Mardi 22 mai 83.
Je travaille jusqu'à sept heures et demie. Mais à chaque bruit, à chaque coup de sonnette, à chaque aboiement de Coco, mon âme s'en va dans les talons. Ce que cette expression est juste ! Elle existe aussi en russe. — Il est neuf heures du soir et pas de nouvelles. — Voilà des émotions ! Si je n'ai rien, ce sera bien embêtant. — On l'a tellement dit d’avance à l'atelier, et Julian, et Lefebvre, et Tony, entre eux, tous ensemble, que c'est impossible que je ne l'aie pas. — Alors ce n'est vraiment pas gentil, on aurait pu me le télégraphier, on n'apprend jamais assez tôt une bonne nouvelle...
Si... si j'avais quelque chose, je le saurais déjà. Alors ?
J'en ai un peu mal à la tête.
Ce n'est pourtant pas que ce soit si important, mais on l'a annoncé... et puis l'incertitude est odieuse en toute chose.
Et le cœur qui bat, qui bat... Misérable vie ! Tout et le reste et rien... et pourquoi ? Pour aboutir à la mort !
Mme X... s'est éteinte après de cruelles souffrances, au milieu de sa famille en larmes ; M. Z... est décédé subitement en son château de... ; rien ne faisait prévoir une fin aussi prématurée...; ou encore : Mme Y... a été enlevée à la tendresse des siens, elle était âgée de quatre-vingt-dix-neuf ans...
Et nul n'y échappe !... Et chacun finit ainsi.
Finir ! Finir, ne plus être, voilà l'horreur. Avoir assez de génie pour vivre toujours... Ou écrire des bêtises avec une main fiévreuse, parce que l'annonce d'une misérable mention se fait attendre.
On vient apporter une lettre, mon cœur s'arrête. Elle est de Doucet, au sujet d'un corsage.
Je vais reprendre un peu de sirop d'opium, être calme. On dirait, à voir cette agitation, que je viens de rêver à mes saintes femmes. Il est ébauché, le tableau ; quand j'y travaille ou y pense, je suis dans un état pareil à celui de ce soir.
Impossible de s'occuper à quoi que ce soit !...
Neuf heures un quart. — Impossible que le prudent Julian se soit avancé à ce point et que ça n'arrive pas !... Et d'un autre côté, ce silence ?...
Cela vous prend aux jambes, comme une flamme qui enveloppe tout le corps et brûle les joues... J'ai fait de mauvais rêves...
Il n'est que neuf heures vingt-cinq.
Julian aurait dû venir ; il serait venu, il l'a su vers six heures, il serait venu dîner. Alors, rien ?
Je me suis crue refusée et ce n'était pas admissible pourtant. Mais ici, c'est très admissible.
Je viens de guetter les voitures, elles passent... Oh ! c'est trop tard à présent.
Il n'y a pas de médaille d'honneur pour la peinture. Et pour la sculpture, c'est Dalou qui l'a.
Qu'est-ce que ça me fait ?
L'aurais-je donnée à Bastien la médaille d'honneur ? Non. Il peut faire mieux que cet Amour au village ; par conséquent il ne la mérite pas. — On aurait pu la lui donner pour sa sublime Jeanne d'Arc, dont le paysage me déplaisait il y a trois ans.
Je voudrais la revoir.
Jeudi 24 mai 83.
Je l'ai ! Et me voilà rassurée et tranquille, je ne dis pas heureuse. Je pourrais dire contente...
Je l'apprends par les journaux. Ces Messieurs ne se sont pas donné la peine d'écrire un mot.
Écoutez l'histoire : — Je crois assez au : « Rien n'arrive guère, ni comme on le craint, ni comme on l'espère. »
Je cherchais comment cela allait arriver. Je l'aurais ou je ne l'aurais pas ; je connais l'effet produit, puisque, avant-hier et hier soir, je pensais ne pas l'avoir. Et si je l'ai, eh bien ce sera agréable, je me figurerai parfaitement comment cela... serait. Qu'est-ce qui va donc survenir ? D'où viendra la surprise ? — L'avoir sans l'avoir, et ne pas l'avoir tout en l'ayant.
A neuf heures et demie, nous allons au Salon et rencontrons à notre porte Bojidar rayonnant, avec son père qui vient me féliciter. — Nous emmenons le jeune homme. — Et j'arrive dans ma salle et je vois mon tableau, changé de place, remonté plus haut, au-dessus d’une grande toile représentant des tulipes, d'une couleur aveuglante, et signée d'un artiste de neuvième: classe. Alors cette prévision que l'écriteau : Mention honorable serait attaché à Irma devient possible, j'y; cours. Point.
Je vais enfin jusqu'à l'odieux pastel et je l'y trouve.
Je ne fais qu'un bond jusque chez Julian, et je suis là pendant plus d'une demi-heure sans pouvoir trop parler. — J'aurais pleuré. Il paraît très étonné,. Comment ! mais depuis l'ouverture du Salon, depuis qu'on avait vu mes toiles, il n'était plus question du pastel, et puis il était sûr que je serais déplacée et sur la cimaise...
Enfin, la récompense, quand même accordée dans une autre section, — semble protéger contre une ascension de cette espèce ! Il me paraît plein de cœur en écrivant des dépêches pressantes et persuasives à Cot, Lefebvre et Tony R.-F. Mais il est bien tard.
Mention pour le pastel, c'est idiot ; mais passe encore ! Mais remonter mon tableau ! Ça me fait pleurer toute seule dans ma chambre en l'écrivant.
La mention, au pastel, c'est un camouflet, une stupidité, un chagrin ; mais aller déplacer le tableau...
J'en prends Dieu et tous les honnêtes gens à témoin : l’année dernière, on a donné des deuxièmes médailles à des choses qui étaient loin de me valoir. Et cette année aussi du reste. Tout le monde vous dira que c'est vrai. On me trouve bien bonne de m'indigner.
Je ne puis admettre tant de mauvaise foi, tant de tripotages !
Je ne comprends pas cette cuisine artistico-électorale.
C'est infâme. Quand donc serai-je aussi canaille que les autres pour ne plus m'indigner ?
Enfin je veux bien que le vrai talent perce tout seul. D'accord. Mais il est nécessaire qu'on soit mis à flot pour commencer.
Bastien-Lepage lui-même a été soutenu dans les commencements par son maître M. Cabanel.
Lorsqu'un élève promet, son maître doit lui tenir un instant la tête hors de l'eau. S'il se maintient c'est qu'il est quelqu'un ; sinon, tant pis. Oh ! j'arriverai.
Seulement c'est un retard et pas par ma faute.
Ne pas user de certains avantages me révolte comme une injustice !
Bojidar et Dina ont été réclamer auprès de l'administration, en vain bien entendu. — Et Bojidar a chipé le fameux écriteau et m'a apporté ce morceau de carton avec les mots : Mention honorable. Je l'ai immédiatement attaché à la queue de Coco qui n'osait pas bouger, plein d'épouvante. — En somme, je suis désolée, vexée, malheureuse. Le tableau en haut c'est un déchirement. Mais mon désespoir a été, pour ceux qui m'entouraient, un spectacle amusant ; je suis toujours en spectacle et quand je voudrais pleurer je dis des drôleries ; il ne faut pas fatiguer les gens, il faut toujours être une distraction, une nouveauté... On dirait que je le suis, parce que je le veux...
Vendredi 1er juin 83.
Les gosses qui posent m'exaspèrent à la folie !
J'ai l'autorisation des parents de taper dessus, et aujourd'hui j'en ai empoigné un et je l'ai flanqué par terre comme un paquet, — absolument enragée.
Et puis ?... Et puis rien.
Mercredi 6 juin 83.
Je suis terrassée par les oreilles. (Voilà une belle image.) Vous comprendrez mes souffrances, quand je vous dirai que les jours où j'entends bien sont comme des événements heureux. Saisissez-vous l'horreur d'une telle préoccupation !
Et des nerfs surexcités à un point absolument extraordinaire ! — Mon travail en souffre, je peins tout en étant dévorée d'appréhensions chimériques. Je m'imagine des quantités d'horreurs ; l'imagination court, court, court, je subis toutes les infamies, j'invente des opprobres, craignant de les voir arriver.
Je reste à peindre et je pense à ce qu'on peut bien dire de moi, et j'invente de telles horreurs qu'il m'arrive de me lever en sursaut et d'aller à l'autre bout du jardin comme une folle en poussant des exclamations indignées.
Ah ! ça doit produire de la belle peinture ! Il faudrait prendre des douches. Et ce soir je vais écrire à maman pour qu’elle songe à l'ambassade, ou j'en deviendrai folle ; c'est commencé.

Dimanche 10 juin 83.
Comme, le dimanche, on ne risque de rencontrer personne, je vais au Salon, le matin.
Il y a vraiment des récompenses abominablement injustes.
Il y a toujours foule devant le jeune tableau du jeune Rochegrosse. C'est très puissant, c'est incontestable, mais ça me laisse froide. Mais qu'est-ce qui ne me laisse pas froide ?
Il faut, pour être émue, que je me batte les flancs, et alors, à force de travail, j'arrive à une grande exaltation... factice.
Pourtant Jeanne d'Arc... Oui, c'est vrai, et puis ? Et quelques autres choses aussi.
Au Louvre ? Des portraits, car les grandes machines anciennes... mais les portraits et les délicieuses choses de l'école française.
Et à la dernière exposition des portraits du siècle, ceux de Lawrence et deux ou trois de Bastien : son frère, André Theuriet, Sarah. Et puis... Et puis, qui vous dit que je sois artiste-peintre ?
Poussée dans une autre voie, j'y serais arrivée au même point à force d'intelligence et de volonté, sauf les mathématiques.
Mais la musique me passionne et je composerais facilement. Alors, pourquoi la peinture ? Et quoi à la place ? C'est misérable, de pareilles pensées.
Je veux faire un grand tableau, grand de dimension.
Et je cherche un sujet... J'en ai un antique : Ulysse racontant ses aventures au roi des Phéaciens, Alcinoüs. Alcinoüs et la reine sont sur leur trône, entourés de princes, de jeunes gens et de leur maison. Cela se passe dans une galerie à colonnes de marbre rose. Nausicaa, appuyée à une de ces colonnes, un peu en arrière de ses parents, écoute le héros. C’est après le festin et le chant du poète Démodocus, qui est tout au fond et regarde dehors, avec son luth appuyé sur les genoux, indifférent comme un chanteur qu'on n’écoute plus. Dans tout cela, il y a des attitudes, les groupe» la composition enfin.
Ce n'est pas cela qui m'embarrasse, et ça sera bien mais l'exécuter, voilà le terrible.
Je ne sais rien, rien, rien ! meubles, costumes, accessoires ; et puis, pour fabriquer une grande machine comme ça, il faut des recherches... Et il faut savoir ce que Tony Robert-Fleury appelle les qualités ou le.., quoi ?
Lundi 11 juin 83.
Mon père est mort.
On a reçu la dépêche ce matin à dix heures, c'est-à-dire à l'instant. Ma tante et Dina, en bas, disaient qu'il fallait que maman revînt à la minute, sans attendre l'enterrement. Je suis montée ici très émue, mais ne pleurant pas. Seulement, lorsque Rosalie est venue me montrer l'arrangement d'une robe, je lui ai dit : « Ce n'est pas la peine, Monsieur est mort, » et je me suis mise à pleurer irrésistiblement.
Ai-je eu des torts envers lui ? Je ne crois pas. J'ai toujours tâché d'être convenable... Mais, dans un moment pareil, on se croit toujours coupable de quelque chose... Il fallait partir avec maman...
Il n'avait que cinquante ans. Tant souffrir !... et n'avoir, en somme, fait de mal à personne. Très aimé chez lui, parfaitement honorable, probe, ennemi de tout tripotage et très bon garçon.
Mercredi 13 juin 83.
Je m'imagine que si j'avais le malheur de perdre maman, eh bien, j'aurais mille reproches et mille remords, car j'ai été très grossière et très violente... pour le bon motif, je sais bien, mais c’est égal, je me reprocherais tous ces excès de parole...
Du reste, maman... il y aurait là un chagrin immense ; rien que d'y penser me fait pleurer ; j'ai beau lui reconnaître des défauts.
Elle est vertueuse, mais elle ne comprend rien et n'a pas confiance en moi... Elle croit toujours que tout va s'arranger et qu'il vaut mieux « ne pas faire d'histoires ».
Je crois que la mort qui me ferait le plus de peine ce serait encore celle de ma tante, qui s’est dévouée toute sa vie pour tout le monde et qui n'a jamais, pas une seule minute, vécu pour elle, sauf les heures passées à la roulette de Bade ou de Monaco.
Il n'y a que maman qui soit gentille avec elle ; moi, je ne l'ai pas embrassée depuis un mois, et ne lui dis que des choses indifférentes ou des reproches sur un tas de bêtises. Ce n'est pas par méchanceté, mais c'est que je suis aussi très malheureuse, et que toutes ces discussions sur nos affaires avec maman et ma tante m'ont habituée à un ton bref, dur, cassant. Si je me mettais à dire des choses tendres ou seulement douces, je pleurerais comme une bête. Enfin, sans être tendre, je pourrais être plus aimable, sourire et causer quelquefois ; ça la rendrait si heureuse et ne me coûterait rien ; mais ce serait un tel changement dans mes manières, que je n'ose pas, par une sorte de fausse honte.
Et pourtant cette pauvre femme, dont l'histoire s’écrit en un mot « dévouement » m'attendrit, et je voudrais être gentille... et si elle venait à mourir, en voilà une qui me laisserait des remords !
Tenez, grand-papa, il m'impatientait quelquefois par des manies de vieillard, mais il faut respecter la vieillesse. Il m'est arrivé de lui répondre de travers, et, lorsqu'il a été paralysé, j'en ai eu tant de remords que je venais très souvent près de lui pour effacer, atténuer, expier.
Et puis, grand-papa m'aimait beaucoup, et voila qu'en pensant à lui je pleure.
Vendredi 15 juin 83.
Les Canrobert m'écrivent une lettre charmante ; du reste, tout le monde est très sympathique.
Ce matin, espérant ne rencontrer personne, je me risque à la salle Petit ; exposition des cent chefs-d'œuvre au profit de quelque chose : — Decamps, Delacroix, Fortuny, Rembrandt, Rousseau, Millet, Meissonier, le seul vivant, et d'autres. Et d'abord, je fais mes excuses à Meissonier, que je connaissais mal, et qui n'avait que des choses inférieures à la dernière exposition des portraits. Oui, ce sont des merveilles à la lettre.
Mais ce qui m'a poussée à sortir mes voiles de crêpe, c'est l'envie de voir Millet que je ne connaissais pas du tout et dont on m'assourdissait. — Bastien n'en est que le faible imitateur, disait-on. — Enfin j'en étais agacée. J'ai vu et je retournerai voir... Bastien en est l'imitateur si l'on veut, parce que ce sont des paysans et parce que tous deux sont de grands artistes, et que tous les véritables chefs-d'œuvre ont un air de famille.
Les paysages de Cazin se rapprochent bien plus de Millet que ceux de Bastien. Chez Millet, dans les six toiles que je vois là, ce qui est beau c'est l'ensemble, l'harmonie, l'air, la fluidité. Ce sont de petites figures vues d'une façon sommaire, très large et très juste. Et ce qui rend Bastien d'une force sans égale aujourd'hui, c'est l'exécution méticuleuse, forte, vivante, extraordinaire de ses figures humaines ; l'imitation parfaite de la nature, enfin la vie. Son Soir au village, qui n'est qu'une impression de petite dimension, égale Millet certainement ; il n'y a là que deux petites figures perdues dans le crépuscule. Mais le souvenir de son Amour au village me déchire les yeux. Quelle faute que ce fond ! Comment ne le voit-il pas ? Oui, dans ces grands tableaux il manque de ce qui rend Millet extraordinaire dans les petits... l'air, l'harmonie... Il faut, quoi qu'on dise, que la figure domine !
Le Père Jacques est supérieur à l'Amour au village comme effet ; Les foins aussi. Le Père Jacques était plein de poésie ; la fillette cueillant des fleurs est une figure ravissante et le vieux faisait bien... Je sais bien qu'il est plus difficile de donner à un grand tableau. cette... enveloppe, ce fondu si doux et si ferme qui caractérise Millet... Mais il faudrait y arriver. Dans un petit tableau, beaucoup de choses peuvent s'escamoter. Je parle de petits tableaux où l'expression domine (et pas des méticuleux Meissonier), comme Cazin par exemple qui est le fils de Millet ; on peut souvent donner ce rien et ce tout qui s'étend à tout et qui se trouve précisément sur aucun point, appelé charme, avec quelques coups de pinceau heureux..., tandis que, dans un grand tableau, tout cela change... et devient terriblement difficile ; car le sentiment doit s'appuyer sur la science, et c'est souvent comme l'amour et l'argent...
Samedi 16 juin 83.
Alors, je retire aux peintures de Bastien la qualification de « chefs-d'œuvre ». Pourquoi ? Parce que son Amour au village m'horripile ou parce que je n'ai pas le courage de mon opinion ? On n'ose déifier que les morts ; si Millet était vivant, qu'en dirait-on ? Et puis on voit là six toiles de Millet seulement ; est-ce que nous ne trouverons pas six toiles équivalentes rue Legendre ? Pas mèche, 1 ; Jeanne d'Arc, 2 ; Le portrait du frère, 3 ; Le Soir au village, 4 ; Les foins, 5. Je ne connais pas tout, et il n'est pas encore mort. Bastien est moins le fils de Millet que Cazin, qui lui ressemble beaucoup, en plus... jeune... Bastien est original et est lui. On procède toujours un peu de quelqu'un, mais la personnalité se dégage ensuite. Du reste, la poésie, la force, le charme sont toujours les mêmes, et si c'est imiter que de les chercher, alors ce serait désespérant. On ressent une vive impression devant un Millet, on la retrouve devant un Bastien... Qu'est-ce que ça prouve ?
Les superficiels disent imitation. Ils ont tort ; deux acteurs différents peuvent vous émouvoir de la même façon, parce que les sentiments véritables, humains, intenses sont toujours les mêmes.
Il y a une dizaine de lignes tout à fait gracieuses d'Étincelle sur moi. Je suis un peintre remarquable, une belle jeune fille et une élève de Bastien-Lepage. Attrape !
J'ai vu le buste de E. Renan chez Saint-Marceaux, et hier j'ai vu passer Renan en fiacre. Je l'ai reconnu tout de suite.
Voilà de la ressemblance au moins !
Lundi 18 juin 83.
Attention ! C'est un petit événement : j'ai accordé pour ce matin onze heures une audience au correspondant du Nouveau Temps (de Saint-Pétersbourg) qui me l'avait demandée par lettre. C'est un très grand journal et ce M. B... y envoie, entre autres, des études sur nos peintres à Paris, et, comme « vous occupez parmi ceux-là une place notable » vous me permettrez, j'espère, etc.
Ah ! ah ! Avant de descendre je le laisse quelques minutes avec ma tante qui prépare mon entrée, en parlant de ma jeunesse et de toute sorte de choses pour nous poser. Il regarde toutes les toiles et prend des notes ; — quand j'ai commencé ? Où ? à quel âge et comment ? et des détails et des enfin ?... Je suis une artiste dont le correspondant d'un grand journal va faire une étude.
C'est un commencement, et c'est la mention qui me vaut cela, et... Pourvu que l'article soit bon ; je ne sais pas exactement si les notes sont bien prises, car je n'entendais pas tout, et c'est même bien embêtant.
C'est ma tante et Dina qui ont tout dit... quoi ? J'attends cet article avec angoisse... et il faudra attendra une quinzaine.
On a surtout appuyé sur ma jeunesse.
Jeudi 21 juin 83.
C'est demain la distribution des récompenses, on m'a envoyé la liste des récompensés... et mon nom là-dedans (section de peinture)... ça fait bien... mais j'hésite à y aller, ça ne vaut pas la peine, et puis si...
Est-ce que je sais ? des peur d'on ne sait quoi.

Vendredi 22 juin 83.
Bojidar est là dès neuf heures. C'est un être très curieux. Le trait principal de ce caractère de Slave, fantasque, insouciant, c'est l'amour de l'improvisation. Du reste, quand il est ami, toute cette imagination sert à glorifier les amis, il s'attache passionnément aux gens pendant un certain temps.
Ces pauvres artistes ! Il y en avait de très impressionnés, des hommes de quarante-cinq ans tout pâles, tout émus, avec des redingotes ou des habits mal faits, qui allaient chercher leur médaille et serrer la main de Jules Ferry, ministre.
Un brave sculpteur ayant emporté- sa petite boîte s'est mis à l'ouvrir, sitôt à sa place et à eu un beau sourire heureux, involontaire, comme le sourire d'un enfant.
Moi, j'ai été un peu émue aussi en regardant les autres, et il m'a semblé un instant que ce serait chose effrayante que de se lever et de s'approcher de cette table.
Ma tante et Dina étaient assises derrière moi sur une banquette, car les récompensés ont droit à des chaises.
Eh bien ! la voilà passée cette journée de la récompense ! Je ne la voyais pas comme ça.
Oh ! l'année prochaine, attraper une médaille !…. Et que tout arrive enfin comme dans un rêve !... Être applaudie, triompher !
Ce serait trop beau et impossible comme tel, si je n'étais si malheureuse... Et quand vous aurez une deuxième médaille, vous voudrez avoir la grande sans doute.
Et puis la croix ? — Pourquoi non ? — Et après ? — Et après, jouir du fruit de son travail, de ses peines, travailler toujours, se soutenir autant que possible à la hauteur, et essayer d'être heureux, aimer quelqu’un.
Oui ! Nous verrons après, rien ne presse. Il ne sera ni plus laid ni plus vieux dans cinq ans qu'aujourd'hui. Et si je me mariais comme cela aujourd'hui, je le regretterais peut-être... Mais enfin il faut bien me marier ; j'ai vingt-deux ans. Et on m'en donne davantage ; non pas que je paraisse vieille, mais à treize ans, à Nice, on m'en donnait dix-sept et je les paraissais.
Enfin... me marier avec quelqu'un qui m'aimera vraiment ; sans cela je serais la plus malheureuse des femmes. Mais il faudra encore que ce quelqu'un me convienne, au moins !
Être célèbre, très célèbre, illustre ! cela arrangera tout... Non... il ne faut pas compter sur la rencontre d'un être idéal qui me respectera, m'aimera et sera un bon parti.
Les femmes célèbres effrayent les gens ordinaires, et les génies sont rares.
24 juin 83.
Je pense aux bêtises que j'écrivais de Pietro. Comme quand je disais que j'y pensais tous les soirs, que je l'attendais et que, s'il était arrivé à Nice à l'improviste, je me serais jetée dans ses bras. Et on a cru que j'en étais amoureuse ; ceux qui liront le croiront.
Et jamais, jamais, jamais ça n'a été; non, jamais !
Mais quand on s'ennuie, le soir, en été, on pense souvent qu'on serait heureux d'avoir des raisons pour se jeter dans les bras d'un monsieur amoureux... Ça m'est arrivé cent fois en imagination. Mais alors j'avais un nom à écrire, un être véritable que je pouvais nommer Pietro. Va pour Pietro !
Allons donc ! Il y avait la fantaisie d'être nièce du grand Cardinal, qui pouvait, devenir pape..., mais...
Non, je n'ai jamais été amoureuse et je ne le serai plus maintenant ; il faut qu'un homme soit si supérieur pour me plaire à présent, je suis si exigeante, il faudrait que ce fût... Et être simplement amoureuse d'un charmant garçon quelconque, non ça ne se pourra plus jamais.
Jeudi 28 juin 83.
Il me semble par moment que cet interminable journal contient des trésors de pensées, de sentiments, d'originalité. J'emmagasine depuis des années et je prends des notes à part dans un cahier.. C'est un besoin sans arrière-pensée, comme le besoin de respirer. Mais avant tout, il faudrait me donner la paix, en me mariant pour ne plus avoir ce souci-là. M'adonner alors tout entière au travail...
Mardi 3 juillet 83.
Le tableau ne va pas, je suis dans le chagrin. Rien qui console ! ! !
Enfin voici l'article du Nouveau Temps. Il est très bien et me gêne un peu, parce qu'il y est dit que je n'ai que dix-neuf ans, et que j'en ai plus, et que l'on m'en donne encore davantage.
Mais l'effet en Russie sera très grand.
Jeudi 12 juillet 83.
Les Canrobert à déjeuner, et puis nous allons à l'exposition de la rue de Sèze. Mon Dieu, ce que je veux, c'est d'avoir du talent. Mon Dieu, il me semble qu'il n'y a plus rien que ça.
Toilette, coquetterie, rien n'existe ; je m'arrange bien, parce que c'est encore de l'art et je ne pourrais pas être fagotée, mais autrement...
Cette préoccupation constante me rend laide ; je m'enterre, je m'enferme, et qu'est-ce que ça me rapportera ?
Tout ça est superbe à raconter après l'éclosion du génie, mais comme ça ! Je ne trouve pas Benvenuto Cellini aussi fort que moi en brûlant son mobilier ; je jette dans les flammes bien plus, et bien mieux. Et qu'est-ce qui m'en reviendra ? Lui, il savait ce que ce serait, et moi !...
Si je me débarrassais bientôt de ce tableau des gamins, je m'en irais à la campagne, une vraie campagne, avec de grands horizons, des landes, pas de montagnes ; de beaux couchers de soleil, des terrains gris, des herbes et des fleurs sauvages, roses, et de l'espace, de l'espace. Et peindre un grand tableau avec un ciel fini... des herbes et des fleurs sauvages.
Vendredi 13 juillet 83.
Serais-je romanesque, dans le sens ridicule du mot ? Ou bien serais-je vraiment au-dessus du commun, car mes sentiments ne s'accorent qu'avec ce qu'il y a de plus élevé et de plus pur dans la littérature, et Balzac avoue que les écrivains s'en parent comme d'un fard... Alors ?...
Enfin... et l'amour ?
Qu'est-ce que c'est ? Je ne l'ai jamais éprouvé, car ces entraînements passagers, vaniteux ne comptent pas. J'ai préféré des gens parce qu'il faut un objet à mon imagination ; ils étaient donc préférés parce que c'était un besoin de ma « grande âme » et non pas parce qu'ils s'imposaient.
Voilà toute la différence. Elle est énorme.
Sans transition, passons à l'art. Je ne vois pas où je vais en peinture. Je suis Bastien-Lepage, et c’est déplorable.
On reste toujours en arrière.
On n'est jamais grand, tant qu'on n'a pas découvert une voie nouvelle, sa propre nature, le moyen de rendre des impressions particulières.
Mon art n'existe pas.
Je l'entrevois un peu dans les Saintes femmes... Et encore ? En sculpture, c'est différent. Mais en peinture !...
Dans les Saintes femmes, je n'imite personne et je crois à un grand effet, car je veux mettre une grande sincérité dans l'exécution matérielle et puis toute l'émotion que j'éprouve à ce sujet.
Les gamins font penser à Bastien-Lepage, bien que j'aie pris le sujet dans la rue et que ce soit un sujet très commun, très vrai, très journalier. Et, du reste, ce peintre me cause toujours je ne sais quel malaise.
Samedi 14 juillet 83.
Nous allons faire un tour en voiture pour voir la ville pavoisée. Ça m'amuse.
Et puis je continue le recueillement d'hier.
Avez-vous lu l'Amour de Stendhal ?
Je le lis à présent.
Je n'ai jamais aimé de ma vie ou je n'ai jamais cessé d'être amoureuse d'un être imaginaire. Voyons ?
Lisez ce livre. C'est encore plus délicat que Balzac, c'est plus véritable, c'est plus harmonieux et plus poétique.
Et cela exprime divinement ce que tout le monde a senti, même moi. Seulement, moi, j'ai toujours été trop analyste.
Je n'ai été vraiment amoureuse qu'à Nice, étant enfant, et encore par ignorance.
Et puis un entraînement maladif pour cette horreur de Pietro.
Je me souviens, le soir, à Naples, toute seule au balcon, écoutant une sérénade, de moments vraiment délicieux ; se sentir transportée et en extase sans objet et sans autre cause que ce pays, le soir et la musique.
Je n'ai jamais retrouvé ces impressions à Paris, ni ailleurs qu'en Italie.
Si je ne craignais les on-dit, je me marierais tout de suite avec X... ; je serais libre et tranquille en attendant de rencontrer l'être suprême. Et, d'un autre côté, épouser un monsieur comme tout le monde et qui, n'ayant rien à se reprocher, me rendra malheureuse ou m'ennuiera !...
Lundi 16 juillet 83.
La cristallisation me préoccupe vivement et je suis convaincue qu'il y a un livre à faire sur les cristallisations innocentes qui n'aboutissent pas.
Moi, par exemple, chez qui l'amour complet ne serait possible que dans le mariage, ou toute autre jeune fille, ou même une femme mariée, à principes, nous ne sommes pas exemptes pour cela des chocs qui déterminent les cristallisations ; ces cristallisations n'aboutissent pas, et permettez-moi de dire ici que je n'aime pas le mot cristallisation ; mais il évite, comme dit Stendhal, une longue phrase explicative ; je l'emploie donc. — La cristallisation commence. Si « l'objet » a toutes les perfections, nous nous y laissons aller et nous arrivons à l'amour, c'est-à-dire que nous aimons ; l'essentiel c'est d'aimer et non de pratiquer la chose que M. Alexandre Dumas fils appelle « amour ». Si l'objet n'a pas toutes les perfections, si nous lui découvrons un défaut, des défauts, soit une laideur, soit un ridicule, soit un manque d'esprit, la chose s'arrête à mi-chemin. Je crois aussi que l'on peut s'arrêter à volonté.
Mardi 17 juillet 83.
Toujours préoccupée des cristallisations sans objet, hélas !
Et de la sculpture ? La peinture va un peu mieux.
Oh ! avoir du talent ! ! Effacer cette misérable mention ! Exposer les gamins, les saintes femmes dans un cadre tout noir et au bas le texte... « Et ayant roulé une grande pierre à l'ouverture du sépulcre, il s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient demeurées là en face du sépulcre.» Et une statue, Nausicaa ou Ariadne ; les esquisses sont toutes arrêtées, l'Ariadne fera blaguer. On dira que c’est moi, abandonnée par qui ? Et Nausicaa ? j'aime les deux.
Trois choses. Deux tableaux et une statue. Je le désire tellement que je crains les plus affreux malheurs.
L'amour ne peut pas m'absorber entièrement ; ce sera un accessoire, le couronnement de l'édifice, un superflu aimable. — Enfin, nous verrons bien.
Dimanche 22 juillet 83.
Hier soir, je me suis brûlé la poitrine, au-dessus du sein droit, à l'endroit où le poumon est malade. Je me suis enfin décidée, ce sera une tache jaune pendant trois ou quatre mois ; mais au moins je ne mourrai pas poitrinaire.
Mercredi 25 juillet 83.
M. X... nous apporte les deux bustes achetés cent francs pièce. Nous le gardons à dîner.
Il a l'air très mal à l'aise, tout en affectant un certain aplomb ; j'ai souffert pour lui, m'imaginant qu'il devait être très gêné. On dit qu'il est pauvre, tout ça me fait de la peine, et je suis honteuse d'avoir payé deux œuvres d'art le prix d'un chapeau. Au lieu de me rendre plus aimable, ces sentiments m'ont fait manquer de cordialité en apparence, et j'en suis fâchée. Ce pauvre garçon a ôté son paletot au salon et l'a mis sur un divan. Il ne cause pas ; nous avons fait de la musique, cela a produit une certaine détente ; il a dû ne savoir comment se tenir. Je ne lui vois pas beaucoup d'esprit ; pourtant avec le talent qu'il a, il doit être intelligent ; mais nous n avons pas su le mettre à son aise ; du reste, c'est une nature sauvage ; il doit être très fier et très malheureux. Dans tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est pauvre et que je lui ai acheté deux bustes pour deux cents francs, et cela me fait honte. Je voudrais lui envoyer cent francs encore, car j'ai un capital de cent cinquante francs, mais je ne sais comment.
Jeudi 26 juillet 83.
Le temps toujours incertain suspend mon tableau, et je démolis tous mes ensembles en terre, sauf un, qui n'est même pas en place encore ; et alors, naturellement, voilà Saint-Marceaux qui arrive... Attention aux battements du cœur, cristallisation, etc. Je mets, ôte et remets deux robes, le fais attendre longtemps et le reçois enfin, mal arrangée et rouge.
Il est très amusant, toujours indigné contre l'école moderne, les naturalistes et les documents humains. — Il faut chercher quelque chose qui est l'art et qu'on ne peut pas expliquer...
Je comprends bien, mais... Il n'a vu que ce pauvre ensemble, et m'a dit de continuer comme ça, voilà tout. C'est déconcertant ; le bonhomme couché que C. m'a conseillé de faire mouler pour le conserver étant chez le mouleur, il n'a pu le voir. Je n'ai eu aucun compliment, sauf pour cet éternel portrait de Dina que l'on trouve si bien... Il est charmant Saint-Marceaux, original, spirituel, nerveux, presque saccadé, et il ne se gêne pas pour taper sur tout ; c'est mieux que cette hypocrisie qui fait que l'on donne du talent à tout le monde. Il a vu mes gamins et dit qu'il est facile de faire choses canailles, des paysans, des gavroches, des charges en somme ; mais faites donc des choses jolies, fines et qui aient du caractère, voilà la difficulté.
Et surtout mettez-y le je ne sais quoi, ce qu'on ne peut expliquer, ce qui est l'art en somme et ce que nous ne trouvons qu'en nous. — Est-ce que je n'ai pas dit ça ? A bas les vils copistes, les photographes, les naturalistes !
Et allez donc !
Enfin, ce qui m'a laissé une impression pénible, c'est que je n'étais ni jolie, ni vive, ni spirituelle...
Vendredi 3 août 83.
Bastien-Lepage est désespérant. Quand on étudie la nature de près, quand on veut l'imiter absolument, il est impossible de ne pas pense tout le temps à cet immense artiste.
Il possède tous les secrets de l'épiderme ; ce que font les autres est de la peinture ; lui, c'est la nature même . On parle de réalistes ; mais les réalistes ne savent pas ce que c'est que la réalité : ils sont grossiers et croient être vrais. Le réalisme ne consiste pas dans la représentation d'une chose vulgaire, mais dans le rendu qu doit être parfait.
Je ne veux pas que ce soit de la peinture, je veux que ce soit de la peau et que ça vive !
Quand on s'est donné un mal de chien toute la journée, on en est à se reprocher cruellement d'avoir travaillé mal et d'avoir produit une chose sèche et peinte.
Et le souvenir de ce monstre de Damvillers vous écrase. C'est large, c'est simple et c'est vrai, et tous les détails de la nature y sont ! Ah ! misère !
Dimanche 5 août 83.
On dit que j'ai eu un roman avec C. et que c'est pour cela que je ne me marie pas, car on ne comprend pas autrement pourquoi, ayant une belle dot, je ne suis encore ni comtesse ni marquise.
Les sots ! Heureusement que vous, poignée d'êtres d'élite, gens supérieurs, vous chers bien-aimés confidents qui me lisez, vous savez à quoi vous en tenir. Mais quand vous me lirez, tous ceux dont je parle seront probablement morts, et C. emportera dans la tombe la douce conviction d'avoir été aimé d'une jeune et belle étrangère qui, éprise de ce chevalier, etc. Le sot ! Les autres le croiront aussi ; les sots ! Mais vous savez bien que non. Ce serait peut-être poétique de refuser des petits marquis par amour ; mais hélas, moi, je les refuse par raison.
Mardi 7 août 83.
Je deviens toute rouge en pensant que, dans une semaine, il y aura cinq mois que j'ai fini le tableau du Salon. Qu'ai-je fait en cinq mois ? Rien encore. De la sculpture, il est vrai, mais ça ne compte pas. Les gamins ne sont pas finis.
Je suis bien malheureuse... sérieusement. N. N. a dîné ici et m'a débité son catalogue du musée du Louvre en indiquant presque chaque tableau à sa place. Il a étudié ça pour entrer dans mes bonnes grâces. Il croit que c'est possible et que je puis l'épouser. Il faut qu'il me suppose aux abois pour se mettre cela en tète. C'est peut-être parce que je n'entends pas bien qu'il me croit déchue ?
Après son départ, j'ai failli m'évanouir de douleur. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me frappe toujours ? Qu'est-ce qu'il croit, ce Putiphar moderne ? S'il n'est pas convaincu que je n'aimerai jamais que l’art, que pense-t-il ? Pourtant un mariage d'amour, c’est introuvable !
Alors qu'est-ce qui gronde, qu'est-ce qui s'impatiente ? qu'est-ce qui fait que la vie ordinaire me semble misérable ? C'est une force réelle qui est en moi, c'est quelque chose que ma pauvre littérature ne sait pas dire.
L'idée d'un tableau ou d'une statue me tient éveillée des nuits entières ; jamais la pensée d'un joli monsieur m'en a fait autant.
J'ai été au Louvre ce matin pour voir Raphaël, à la suite d'une lecture du Stendhal. Eh bien ! quoi que je fasse, d'après ce que je vois ici, je ne puis l'aimer. J'aime encore mieux la naïveté des primitifs.
Raphaël est roué et faux.
Divin, divin !... divin, est-il divin ?
Le caractère du divin est de nous ravir et de transporter nos pensées en des régions célestes.
Raphaël me fatigue.
Qui donc est divin alors ? Je n'en sais rien. Pourquoi Stendhal dit-il que Raphaël peint les âmes ? Dans lequel de ses tableaux ?
Voilà une admiration qu'il me faudra travailler.
A la bonne heure, les primitifs, naïfs et admirables artistes dont est presque déjà le précieux Pérugin ! Mais que peuvent me faire ces grandes machines absurdes pleines de science et de correction, ou même les amas de chair de Rubens ? Mais ça m'ennuie ! Que voulez-vous que je fasse des noces de Cana ou des Vierges de Raphaël ? Ce n'est pas divin cela ! Cette Vierge est ordinaire; et cet enfant ? Au tait, il faudrait revoir ce qu'il y a en Italie. Le souvenir que j'en ai -gardé n'est pas favorable... La Vierge à la chaise est un type de jolie femme de chambre italienne bien délicate. Je vois plus de divinité dans Michel-Ange. Raphaël Sanzio. Écoutez ce nom précieux.
Je ne voudrais représenter que des choses qui empoignent, émeuvent, laissent palpiter ou rêver, enfin quelque chose qui accroche le cœur comme les simples petites toiles de Cazin ; la dimension importe peu, mais si en grand on arrivait à cet effet... ce serait superbe. Mais combien y en a-t-il qui comprennent Cazin ?
Samedi 11 août 83.
Je lis les histoires de la peinture de Stendhal, cet homme intelligent est toujours d'accord avec moi. Pourtant il me semble qu'il cherche trop de malice et d'invention.
Il m'a causé une surprise pénible en disant qu'en peignant la douleur, on devrait se renseigner dans la physiologie.
Comment ?
Mais si je ne sens pas l'expression tragique, quelle est la physiologie qui pourra me la faire sentir ?... Les muscles ! Ah ! Seigneur !
Un peintre qui peindra la douleur physiologiquement et non pas parce qu'il l'a sentie, comprise, vue (au figuré même), ne sera qu'un froid et plat artiste. C'est comme si on disait à quelqu'un de s'affliger selon certaines règles.
Sentir d'abord et raisonner ensuite, si l'on veut. Il est impossible que l'analyse ne vienne confirmer l'impression. Mais ce serait recherche de curiosité pure.
Libre à vous de décomposer les larmes pour apprendre logiquement et scientifiquement de quelle couleur il faut les peindre ! Moi, je préfère les voir briller et les peindre comme je les vois, sans même savoir pourquoi elles sont ainsi et non pas autrement.
Dimanche 12 août 83.
Cette idée que Bastien-Lepage va venir m'énerve à ce point que je n'ai pu rien faire. Il est vraiment ridicule d'être aussi impressionnable.
Le Pope a dîné avec nous... Nous avons causé à table ; Bastien-Lepage est excessivement intelligent, mais moins brillant que Saint-Marceaux.
Je n'ai montré aucune peinture, rien, rien, rien. Je n'ai rien dit, c'est-à-dire que je n'ai pas brillé, et lorsque Bastien-Lepage commençait une conversation intéressante, je n'ai pas su répondre, ni même suivre ses phrases serrées, quintessenciées comme sa peinture ; si ç'avait été avec Julian, j'aurais donné la réplique, car c'est le genre de conversation qui me convient le plus... Il est intelligent, il comprend tout, il est même instruit, je craignais une certaine ignorance...
Enfin, lorsqu'il disait des choses auxquelles j'aurais dû répondre de façon à dévoiler mes belles qualités d'esprit ou de cœur, je le laissais parler et restais sotte.
Je ne peux même pas écrire ; c'est un jour comme ça, je suis désorganisée...
Envie de rester seule, toute seule pour se rendre compte de l'impression qui est intéressante et considérable ; dix minutes après qu'il était là, j'avais mentalement capitulé et accepté son influence.
Je n'ai rien dit de ce qu'il fallait. Il est toujours dieu et se croit tel. Je l'ai encore fortifié dans cette croyance. Il est petit, et il est laid pour le vulgaire ; mais pour moi et pour les gens de mes régions, cette tête est charmante. Qu'est-ce qu'il pense de moi ? J'ai été gauche, riant trop souvent... Il se dit jaloux de Saint-Marceaux... Joli triomphe !
Jeudi 16 août 83.
« Grand malheur » serait peut-être exagéré ; mais ce qui arrive peut être, à juste titre, considéré, même par les gens raisonnables, comme un coup de massue bien appliqué...
Et bête... comme tous mes malheurs.
J'allais envoyer mon tableau à la triennale le 20 août, dernier délai ; et ce n'est pas le 20, c'est le 16, aujourd'hui, qu'expire ce délai.
J'ai des picotements dans le nez, mal au dos, et les mains désobéissantes.
On doit être ainsi après avoir été battu.
Après quoi, je vais me cacher aux cabinets pour pleurer toutes mes misères ; — le seul et peu héroïque endroit où je ne serai pas soupçonnée.
Si je m'enfermais dans ma chambre, on devinerait pourquoi, après un coup pareil. C'est, je crois, la première fois que je me cache pour pleurer à fond, les veux fermés, la bouche grimaçante comme un enfant ou un sauvage...
Et puis après ? Après, je vais rester à l'atelier jusqu'à ce que les yeux deviennent ordinaires.
J'ai pleuré une fois dans les bras de maman, et cette douleur partagée a été une si cruelle humiliation pendant des mois que je ne pleurerai plus de chagrin devant personne. On peut pleurer devant n'importe qui, de colère ou pour la mort de Gambetta ; mais étaler sa faiblesse, sa pauvreté, sa misère, son humiliation, jamais ! Si ça soulage dans le moment, on s'en repent toujours comme d'une confidence.
Tout en pleurant où vous savez, j'ai trouvé le regard de ma Madeleine, — qui ne regardera pas le sépulcre, mais ne regardera rien, comme moi tout à l'heure. Les yeux bien ouverts, quand on vient de pleurer.
Enfin, enfin, enfin !
Dieu est injuste, et, s'il n'existe pas, à qui m'en prendre ? Il me punit d'avoir douté. Il fait tout pour me faire douter et, quand je doute, il me tape dessus, et quand je persiste à croire et à prier, il me frappe encore plus fort, pour m'enseigner la patience.
Vendredi 17 août 83.
On ne croit pas à ma timidité ; elle s'explique pourtant par un excès d'orgueil.
J'ai horreur, terreur et désespoir de demander, il faut qu'on offre. Dans un moment de coup de tête, je me décide à demander, ça ne réussit jamais, c'est presque toujours trop tard et à côté.
Je deviens blême et rouge plusieurs fois avant d'oser dire que j'ai l'intention d'exposer ou de faire un tableau ; il me semble que l'on se moque de moi, que je ne sais rien, que je suis prétentieuse et ridicule.
Quand on regarde (on, un artiste bien entendu) ma peinture, je m'en vais dans la troisième chambre, tellement j'ai peur d'un mot ou d'un regard. Du reste, Robert-Fleury ne se doute pas que je sois aussi peu sûre de moi. Comme je parle avec jactance, il croit que je m'estime et m'accorde un grand talent. Par conséquent, il n'a pas même besoin de m'encourager, et si je lui disais mes hésitations et mes peurs, il rirait ; je lui en ai parlé une fois et il l'a pris comme une charge. Voilà la formidable erreur à laquelle je prête. Bastien-Lepage sait, je crois, que j'ai affreusement peur de lui et il se croit Dieu.
Lundi 20 août 83.
Je chante, la lune entre par la grande fenêtre de l'atelier, il fait beau. On doit pouvoir être heureux. Oui, si l'on a la chance d'être amoureux. Amoureux de qui ?
Mardi 21 août 83.
Non, je ne mourrai que vers 40 ans, comme Mlle Collignon ; vers 35 ans, je serai bien malade et, à 36 ou 37 ans, en un hiver au lit, tout sera dit. Et mon testament ! Il se bornera à demander une statue et une peinture, de Saint-Marceaux et de Jules Bastien-Lepage ; — dans une chapelle à Paris, entourée de fleurs, dans un endroit apparent; et, à chaque anniversaire, on y fera chanter des messes de Verdi et de Pergolèse et d'autres musiques, à chaque anniversaire et à perpétuité, par les plus célèbres chanteurs.
En outre, je fonderai un prix pour des artistes, hommes ou femmes.
Au lieu de m'occuper de ça, je veux vivre. Mais je n'ai aucun génie et il vaut encore mieux mourir.
Lundi 27 août 83.
J'ai donné mon Pêcheur à la ligne à la loterie d'Ischia ; les lots sont exposés rue de Sèze, chez Petit. Il fait bien, mon pêcheur, et l'eau est bien ; je n'aurais jamais cru ça. Ah ! le cadre ! Ah ! le milieu ! Nous sommes bien fous. A quoi bon faire de l'art, la foule n'y comprend rien. Tu aimes donc la foule, toi ? Oui ; c'est-à-dire que je voudrais d'une renommée comprise de tous pour avoir encore plus d'admiration.
Mercredi 29 août 83.
Je tousse tout le temps malgré la chaleur ; et cette après-midi, pendant le repos du modèle, m'étant à moitié endormie sur le divan, je me suis vue couchée et un grand cierge allumé à côté de moi.
Ça serait le dénouement de toutes ces misères.
Mourir ? J'en ai très peur.
Et je ne veux pas. Ce serait affreux. Je ne sais comment font les heureux ; mais moi, je suis bien à plaindre depuis que je n'attends plus rien de Dieu. Quand ce suprême refuge manque, on n'a plus qu'à mourir. Sans Dieu, il ne peut y avoir ni poésie, ni tendresse, ni génie, ni amour, ni ambition.
Les passions nous jettent dans des incertitudes, des aspirations, des désirs, des violences de pensée. On a besoin d'un au delà, d'un Dieu à qui reporter ses enthousiasmes et ses prières, un Dieu à qui tout demander et qui peut tout, à qui on peut tout dire. Je voudrais bien que tous les hommes remarquables se confessent et disent si, quand ils ont été bien amoureux, bien ambitieux ou bien malheureux, ils n'ont pas eu recours à Dieu.
Les natures vulgaires, même très intelligentes et très savantes, peuvent s'en passer. Mais ceux qui ont l'étincelle, même s'ils sont aussi savants que toute la science et même s'ils doutent par raison, ceux-là croient par passion, au moins par moments.
Je ne suis pas bien savante, mais toutes mes réflexions tendent à ceci : le Dieu qu'on nous enseigne est une invention. Le Dieu de la religion ou des religions, celui-là, n'en parlons plus.
Mais le Dieu des hommes de génie, le Dieu des philosophes, le Dieu des gens simplement intelligents, comme nous, ce Dieu-là est injuste, s'il ne nous entend pas, ou s'il est méchant, je ne vois pas ce qu'il a à faire.
Mais s'il n'existait pas, pourquoi ce besoin de l'adorer partout, chez tous les peuples et dans tous les temps ? Est-il possible que rien ne réponde à ces aspirations, qui sont innées chez tous les hommes, à cet instinct qui nous porte à chercher l'Être suprême, le grand maître, Dieu ?
Samedi 8 septembre 83.
Une bonne journée, j'ai fini le portrait de Louis.
Nous sommes allés à Versailles et le soir, après la visite au maréchal, Claire et moi allons nous étendre par terre au salon, comme tous les soirs. Des conversations sur les arts, comme tous les soirs toujours, mais ce soir surtout il y a plus d'intimité vraie, et puis surtout c'est que je pense à mon tableau. Ce sera... quelque chose rempli de poésie... tranquille, calme, simple, profond.
Ce ne sont pas les termes magnifiques qui manquent. Enfin, nous verrons.
Mon nouveau tableau serait grand... simple, calme.
Jeudi 13 septembre 83.
Je lis dans Stendhal que les peines paraissent moins amères lorsqu'on les idéalise c'est excessivement juste. Comment idéaliser les miennes ? C'est impossible ! Elles sont si amères, si plates, si affreuses que je ne puis en parler, même ici, sans me blesser horriblement. Comment dire que parfois j'entends mal ? Eh bien ! Que la volonté de Dieu soit faite ! Cette phrase me vient machinalement et je la pense presque. Car je vais mourir, tout naturellement, sans violence, tout en me soignant.
J'aime autant ça, car je suis inquiète pour mes yeux et je suis restée quinze jours sans travailler et sans voire, et ça ne va pas mieux. Je sens des battements et des choses vagues passant dans l'air.
C'est peut-être parce que depuis quinze jours j'ai une bronchite qui mettrait au lit n'importe qui, et avec laquelle je me promène comme si je n’avais rien.
J'ai travaillé au portrait de Dina avec une disposition l'esprit si tragique que ça me fera encore des cheveux blancs.
Samedi 15 septembre 83.
Ce matin, je vais voir les Bastien au Salon. Comment dire ? C’est le beau du beau. Il y a trois portraits qui, au dire de Julian qui ce soir dîne avec nous, sont désespérants. Oui, désespérants. Jamais on n'a fait rien de tel. C’est la vie même, c'est l'âme. Et c'est d'une facture qu'on ne peut comparer à rien, car c'est la nature même. On est insensé de peindre après cela.
Il a un petit tableau intitulé Les blés mûrs. Un homme vu de dos les fauche. Ce tableau est bien.
Il y a deux tableaux grandeur nature : Les Foins et Les Ramasseuses de pommes de terre.
Quelle couleur ! quel dessin ! quelle peinture ! C'est une richesse de tons qu'on ne trouve que dans la nature même. Et ces personnages vivent !
Les tons s'enchaînent avec une simplicité divine et le regard les suit avec un ravissement réel.
Je suis entrée dans la salle sans savoir que c'était là, et je me suis arrêtée net en observant Les Foins, comme on s'arrêterait devant une fenêtre ouverte à l'improviste sur la campagne.
On ne lui rend pas justice. Il est à cent lignes au-dessus de tous. Rien ne peut se comparer à lui.
*
* *
Je suis malade à fond. Et je m'applique un immense vésicatoire sur la poitrine. Après cela, doutez de mon courage et de mon désir de vivre. Personne ne le sait du reste, sauf Rosalie ; je me promène dans l'atelier, lis, cause et chante avec presque une belle voix. Comme souvent le dimanche je ne fais rien, ça n'étonne personne.Mardi 18 septembre 83.
Il paraît que la presse russe, en s'occupant de moi, a fait que tout le monde s'en est occupé un peu, et entre autres la grande Duchesse Catherine. Maman est liée avec son grand chambellan et sa famille, et on a sérieusement parlé de ma nomination au poste de demoiselle d'honneur.
Mais il faut être présenté à la grande Duchesse. Enfin, tout a été dit sur ce sujet ; mais maman a eu tort de laisser tout marcher sans elle et de revenir ici.
Et puis... ma belle âme demande une âme sœur. Je n'aurai jamais d'amie. Claire dit que je ne puis avoir d'amie jeune fille parce que je n'ai pas de petits secrets et de petites histoires de jeune fille.
— Vous êtes trop bien, vous n'avez rien à cacher.
Mercredi 26 septembre 83.
Maintenant que les froissements sont oubliés, je ne me rappelle que ce que mon père avait de bien, d'original, de spirituel. Il était primesautier et semblait léger et baroque au vulgaire. Un peu de sécheresse et de ruse peut-être... mais qui est sans défaut, et moi-même ?... Enfin, je m'accuse et je le pleure.
Si j'étais partie alors... Ce serait par convenance, car le sentiment n'y était pas...
Ç'aurait-il été méritoire tout de même ? Je ne crois pas.
Je n'ai pas eu ce sentiment et Dieu m'en punira ; mais est-ce ma faute ? Et puis l'attendrissement de ce soir me sera-t-il compté ?
Sommes-nous responsable de nos bons ou mauvais sentiments véritables ?
Il faut faire son devoir, dites-vous. Il n'était pas question de devoir. Nous parlons sentiment, et puisqu'alors je n'ai pas éprouvé le besoin de partir, comment serais-je jugée par Dieu ?
Oui, je regrette de n'avoir pas ressenti plus tôt l'élan de ce soir. Et il est mort et c'est irréparable. Et qu'est-ce que ça m'aurait coûté d'aller faire mon devoir, car c'était mon devoir, d'aller vers mon père mourant ? Je ne l'ai pas compris et je ne me sens pas tout à fait irréprochable; je n'ai pas fait mon devoir, il fallait le faire. C'est un regret éternel. Oui, je n'ai pas bien agi et je m'en repens, et j'en ai honte devant moi-même, ce qui est très pénible. Je ne voudrais pas m'excuser, mais ne croyez-vous pas que maman aurait dû me le dire alors ? Ah ! bien oui ! Elle a eu peur de me fatiguer, et puis des raisonnements : « Marie avec sa mère : ça les ferait rester six mois là-bas ! et si Marie reste ici, sa mère sera plus vite revenue. »
Voilà les raisonnements de la famille. Hélas ! on subit toujours quelque influence, sans le savoir.
Lundi 1er octobre 83.
Notre grand écrivain Tourgueneff, mort il y a quinze jours, est expédié aujourd'hui en Russie. Grande cérémonie d'adieux à la gare. Discours de M. Renan, de M. About et de Vyrouboff, un Russe qui a parlé français très bien et a ému plus que les autres. About a parlé assez bas et j'ai peu entendu, et Renan, que je vois à travers le buste de Saint-Marceaux, a été très bien, et le dernier adieu a vibré. Bogoliouboff a aussi prononcé un discours. En somme, je suis fière de voir honorer un Russe par ces horribles orgueilleux de Français.
Je les aime, mais je les méprise.
Ils ont laissé mourir Napoléon à Sainte-Hélène. Ça, c'est un crime immense, monstrueux, abominable ; c'est, une honte éternelle...
Chez d'autres... pourtant... on a bien assassiné César. Enfin, ils ont conspué Lamartine qui, dans l'antiquité, aurait eu des autels, comme dit si justement Dumas fils.
Et puis, encore un grief personnel : ils méconnaissent le talent de Bastien-Lepage. — Nous avons été au Salon, après Tourgueneff, et je ne puis voir cette peinture sans des explosions d'enthousiasme, explosions intérieures, car on croirait que j'en suis amoureuse.
Meissonier ! Mais Meissonier n'est qu'un prestidigitateur !
Il fait des choses microscopiques, de façon à vous causer des étonnements si grands qu'ils touchent presque à l'émotion... Mais dès qu'il sort de ce format minuscule, dès que ses tètes ont plus d'un centimètre, cela .devient dur et ordinaire ; mais on n'ose pas le dire et l'on admire, bien que toutes ses toiles de ce Salon soient seulement bonnes et correctes.
Mais est-ce de l'art ?
Des gens en costume qui jouent du clavecin ou qui montent à cheval et...
Enfin beaucoup de genristes en font autant.
Ce que j'ai vu d'étonnant et de beau de lui, c'est d'abord les Joueurs de boules sur la route d'Antibes. C'est une scène prise sur le vif, bien qu'en costumes anciens, et c'est plein d'air et de soleil, et c'est si petit et tellement fait qu'on reste consterné.
Puis lui-même et son père, à cheval sur la même route, je crois. Puis le Graveur à l'eau-forte. — Le mouvement et l'expression sont saisis et sont vrais. Cet homme qui pense, qui travaille, qui est peut-être empoigné, nous touche et nous intéresse, et les détails sont miraculeux. — Il y a aussi un cavalier Louis XIII qui regarde par la fenêtre ; même format et encore un mouvement juste, une action humaine, naturelle, simple, une parcelle de vie enfin.
Pour le reste, je le classe dans les rangs des bons tableaux de genre bien soignés et qui, sans les chefs d'œuvre que j'ai cités, ne suffiraient pas à la gloire de Meissonier.
Ses portraits, lorsque la tête a seulement deux centimètres, sont en carton ; et plus c'est grand, plus c'est mauvais.
Je salue et passe, il ne me touchera jamais. Mais regardez les portraits de Bastien-Lepage!La majorité crierait très fort si je disais qu’ils sont de beaucoup supérieurs à ceux de Meissonier. Et pourtant c'est une vérité incontestable.
Mais tous les envieux se servent d'un vieux tableau reconnu comme d'une massue pour taper sur ceux qui leur semblent dangereux. Rien ne peut se comparer aux portraits de Bastien-Lepage. Contestez ses tableaux... passe encore, vous pouvez ne pas les comprendre ; — mais ses portraits ! Depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, on n'a rien fait de. mieux.
Samedi 6 octobre 83.
Ce bon, ce brave, cet excellent Robert-Fleury vient voir mon tableau. Bon, brave, excellent ! Cela vous fait prévoir qu'il ne m'a pas éreintée. Les premiers mots ont été : C'est d'un très bon aspect.
Je l'ai interrompu aussitôt.
— Non, Monsieur, je vous en prie, si vous me ménagez, je ne veux pas. Cet horrible Julian dit qu'on me ménage, que je ne sais rien, que...
— Mais, je vous demande pardon, Mademoiselle, je vous ai toujours traitée comme une élève tout à fait sérieuse, comme quelqu'un qui travaille tout à fait sérieusement.
— M. Julian dit que je ne sais rien... que.
— Et vous vous laissez prendre à ses taquineries ?
Et ce charmant homme rit de très bon cœur de ma naïveté...
Enfin voici ce qu 'il dit du tableau : — Il est très bien ; il y a des morceaux excessivement bien (je cite les mots mêmes) des morceaux comme je n’en ferai peut-être jamais de meilleurs. Le gavroche de droite et celui du premier plan qui tourne le dos sont tout à fait bien. — Mais le fond a besoin d'être éclairci, à droite, et cela fera gagner énormément, paraît-il, à mes figures que je ne dois plus toucher, sauf deux yeux à faire un peu moins noirs.
C'est un travail de deux heures.
Je devrais être folle de joie, mais je ne le suis pas, parce que je ne partage pas l'opinion de mon excellent maître. Je puis faire mieux... Ce que j'ai fait n'est donc pas bien ? pas assez... je vois mieux, je devrais faire comme je vois.
Que dira le public ? Est-ce une chose qui sera remarquée ? Comment savoir ? Il trouve que c'est bien. Ne l'envoyez pas à Nice, gardez-le pour Paris. — Il dit que c'est bien, les bien sont relatifs, et d'un bien relatif je n'en veux pas. C'est bien pour un autre, mais pour moi, mais pour tout le monde ? Est-ce fort ? Il trouve le petit bonhomme de dos parfaitement dessiné, on sent, dit-il, ses petites jambes à travers le pantalon, il est campé et tout...
Il croit peut-être que j'ai pensé aux malices anatomiques.
J'ai copié la nature sans songer à rien ; du reste, il me semble que le talent est inconscient.
Samedi 6 octobre 83.
J'ai lu un roman de notre illustre Tourgueneff, tout d'une traite et en français, pour me rendre compte de l'impression des étrangers.
C'était un grand écrivain, un esprit très subtil et un analyste très fin ; un poète, un Bastien-Lepage. Les paysages sont aussi beaux et il décrit les moindres sentiments comme les peint Bastien-Lepage.
Quel sublime artiste !
Millet ! Eh bien, il est aussi poétique que Millet ; je dis cette phrase inepte pour les imbéciles qui ne comprendraient pas autrement.
Tout ce qui est grand, poétique, beau, subtil, vrai! en musique, en littérature, en tout, me ramène à ce peintre merveilleux, à ce poète. Il prend des sujets considérés comme vulgaires par les gens du monde et il en extrait la poésie la plus pénétrante.
Quoi de plus ordinaire qu'une petite fille qui garde une vache ou une femme qui travaille aux champs ?
Ça a-t-il été fait ?
Mais personne ne l'a fait comme lui. Il a bien raison ; oui, trois cents pages en une toile. Mais nous sommes peut-être quinze qui le comprenons.
Tourgueneff a aussi peint les paysans, le pauvre paysan russe, et avec quelle vérité, quelle naïveté, quelle sincérité ! Et c'est attendrissant, et c'est poétique, et c'est grand.
Malheureusement, à l'étranger cela ne peut être compris, et ce sont ces études de la société qui le font surtout connaître.
Mardi 9 octobre 83.
Le portrait de Bojidar me paraît.. bien ; Julian dit que c'est peut-être un grand succès, que c'est très original, très neuf et que ça paraîtra comme un Manet savant.
A moi, cela me paraît amusant. Il est accoudé au balcon, le corps presque de face et la tête de profil se détachant sur le ciel ; on voit le chantier, les maisons, les toits, la rue, un fiacre ; c'est très ressemblant pour tous, mais je voudrais encore quelque chose de plus dans le masque. Le crâne et le corps sont très justes, même pour moi.
Il y a des capucines au balcon. Il en chiffonne une entre ses doigts, tout en regardant dans la rue ; mais je remplacerai la fleur par la cigarette ; l'autre main est dans sa poche. C'est grandeur nature et à mi-corps. Il y a la main encore à faire.
Mais, vers cinq heures et demie, je surprends un effet du ciel un peu rouge avec le croissant ; juste, juste, juste ce qu'il faut pour mes Saintes femmes ; j'en ai fait une pochade à l'instant. On ne pourra faire ce tableau que de chic, impossible de faire poser un ciel pareil ; j'ai très envie de m'y mettre tout de suite, maintenant je le ferai en trois semaines. Essayons toujours... Il ne fera pas plus mauvais à Concarneau en novembre qu'en octobre, et puis... Il faut faire ce qui attire et dans le moment propice, le moment psychologique.
J'ai mon ciel et j'irai dans le Midi pour le terrain, les plantes. J'ai le modèle ici. Il faudra aller dans le Midi, quand, voyons ? Quand j'aurai fait les figures et le ciel, — dans quinze jours, et, une fois là, peut-être trouverai-je quelques tableaux à faire, car je ne suis pas sûre des Saintes femmes. Ça peut réussir et ça peut traîner sept ans.
Mais ce ciel... Oh ! si c'était en petit... Mais non, je veux grandeur nature, ce sera plus empoignant.
Attendre encore ? Peut-être, car j'ai bien fait d'avoir attendu ; il y a quelques mois encore j'en aurais gâché l'exécution ; je voulais le peindre par morceau et je ne comprenais pas assez le fondu qu'il faut lui donner. Et puis, je voudrais être connue d'abord et n’envoyer ce tableau qu'avec un nom connu, sans ça il risque de passer. Qui consulter ? Qui sera franc ? Qui verra juste ?
Ce sera encore toi, mon unique amie, tu seras franche au moins et tu m'aimes. Oui, je m'aime, moi seule.
Oui, il faut achever les gamins. Avoir un autre tableau à envoyer avec. Exposer Bojidar dans une exposition d'hiver, au Cercle et un portrait de Dina aussi.
Et avoir une statue. Voilà le rêve. Il est possible.
Lundi 15 octobre 83.
Nous allons au Salon, les Gavini, maman et moi. Enfin aujourd'hui M. Gavini est convenu avec moi que les portraits de Bastien-Lepage sont supérieurs à ceux de Meissonier: Ça m'a coûté six mois de discussion, mais je suis très contente.
Qu'est-ce que ça peut bien me faire l'opinion, sur la peinture, d'un homme du monde ? C'est un petit triomphe intime, on aime à faire prévaloir ses idées ; chez les apôtres, ça a tourné en passion, et il y en a encore maintenant ; et quand on est jeune, on est plein de feu, on veut faire partager ses enthousiasmes ; un jour, je m'en ficherai, je me fiche déjà de certaines choses.
Et Bastien-Lepage y gagnera des gens du monde qui le méprisent passablement à l'heure qu'il est. Moi, je voudrais être utile et agréable à tout le monde, jouer le rôle de providence, sauver, improviser des bonheurs, et même, ô étonnement ! sans désirer par trop qu'on sache que c'est moi. Mais je suis un ange !
Lundi 22 octobre 83.
Je voudrais bien que ma phtisie fût imaginaire.
Il paraît qu'à une certaine époque il a été de mode d’être poitrinaire, et chacun s'efforçait de le paraître et croyait l'être. Ah ! si ça pouvait être l'imagination seule ! Je veux vivre, moi, quand même et malgré tout, je n'ai pas de chagrin d'amour, je n'ai ni manie, ni sensiblerie, ni rien. Je voudrais être célèbre et jouir de ce qu'il y a de bon sur la terre... c'est si simple.
Dimanche 28 octobre 83.
Je deviens enragée de n’avoir rien en train, je me dis : Allons à Fontainebleau et puis : Pourquoi faire ? je pourrais trouver tout près un endroit boisé où je pourrais aller tous les matins en fiacre, ou bien pourquoi ne pas peindre le brouillard sur la Seine ? Ou bien..., enfin je ne vois rien nettement et ne sais pas ce que je veux.
Et pourquoi ne pas aller à Arcachon, qui ressemble à l'Orient et où je pourrai faire les Saintes femmes ? Et en même temps autant d'études qu'ailleurs ? — Et la sculpture ? Si je voyage, ma statue ne se fera pas.
Pour rompre ces... indécisions, je vais peindre le brouillard sur la Seine en bateau. Ca me fait du bien.
Je me lève à une heure du matin pour dire que j'ai enfin envie de peindre quelque chose ! C'était de n'avoir envie de rien que je souffrais.
C'est comme une flamme qui monte, qui monte ; c'est comme la vue soudaine de celui qu'on préfère, une émotion, une chaleur, une joie.
J'en rougis toute seule.
J'ai envie de peindre la forêt avec ses feuilles flamboyantes, ses tons merveilleux d'octobre ! Et là dedans une ou deux figures. Dans le Père Jacques de Bastien-Lepage la forêt était, à ce qu'il m'en souvient, trop avancée ; c'était dépouillé et un peu gris. Je voudrais faire rouge, or, vert...
Pourtant ce ne sera pas encore là le tableau où je serai moi. Il n'y a que les Saintes femmes qui me montreront... et je n'ose pas les aborder, positivement je n'ose pas.
Allons dormir.
Jeudi 1er novembre 83.
Je vais travailler à la Grande-Jatte. Une allée d'arbres aux tons dorés, toile moyenne. — Bojidar est venu avec moi, heureusement, car je n'ai pas pensé que c'est fête et, en arrivant là, nous avons trouvé des tas de canotiers, et Rosalie aurait peut-être été insuffisante comme porte-respect. Du reste, pour me permettre de venir et d'aller et de peindre dans cette île si distinguée, je m'habille comme une vieille Allemande ; deux ou trois tricots de laine pour me déformer la taille, un pardessus acheté pour vingt-sept francs et sur la tête un gros châle noir tricoté. Des chaussons aux pieds.
Vendredi 2 novembre 83.
C'est bien beau ce que j'ai à faire... Aujourd'hui, il n'y avait pas un chat ; dans la semaine, c'est un désert, surtout en cette saison ; enfin, pourvu que je ne tombe pas malade !
J'ai bien envie d'un tableau... après lequel je ne peindrai plus dehors cet hiver ; cela pourrait être fait en un mois, novembre, sur l'eau. C'est très simple et très beau. Je me couvrirai bien et il n'y aura que les yeux de découverts.
Lundi 5 novembre 83.
Les feuilles sont tombées et je ne sais comment finir mon tableau. Je n'ai pas de chance. La chance ! Quelle chose formidable ! Puissance inexplicable et effrayante.
Ce tableau en bateau, la toile est là et je ne sais plus s'il faut le faire...
Oh ! oui, mais vite, vite, vite ! en quinze jours et le montrer à Robert-Fleury et à Julian stupéfaits.
Si je faisais ça, je ressusciterais. Je souffre de n'avoir pas fait grand chose cet été, c'est un remords affreux. Je voudrais mieux définir cet état particulier. — Je me sens affaiblie, c’est comme un grand calme. Je suppose que ceux qu'on vient de saigner éprouvent quelque chose de semblable.
J'en prends mon parti... jusqu'au mois de mai... Pourquoi cela changerait-il au mois de mai ? Enfin, que sait-on ?
Cela me fait songer à tout ce que je puis avoir de bon, de bien, de remarquable, et je m'en console doucement.
Cela m'a fait causer à dîner avec ma famille, causer gentiment comme une personne naturelle et d'un air très calme, très gentil, comme le premier jour où j'ai relevé mes cheveux sur le front.
Enfin, je ressens un grand calme, je travaillerai avec calme, il me semble que tous mes mouvements vont être tranquilles, que je regarderai l'univers avec une douce condescendance.
Je suis calme comme si j'étais ou parce que je suis forte. Et patiente comme si j'étais certaine de l'avenir... Qui sait ? Vraiment je me sens investie d'une sorte de dignité, j'ai confiance. Je suis une force. Alors... quoi ? Ce n'est pourtant pas de l'amour ? Non. Mais en dehors, je ne vois rien qui m'intéresse... C est ce qu'il faut, mademoiselle, occupez-vous donc de votre art.
Jeudi 8 novembre 83.
Je lis dans un journal qu'à l'ouverture d'une exposition industrielle, rue de Sèze, hier, il y avait beaucoup de monde, nos grands-ducs. Je devais y aller et j'ai laissé passer le jour.
Non, ne luttons plus, je n'ai pas de chance. Et cela me fait chanter en m'accompagnant de la harpe. Si j'avais été complètement heureuse, je ne pourrais peut-être pas travailler. On dit que les grands artistes ont tous mangé de la vache enragée ; ma vache enragée à moi, ce sont toutes ces misères qui me ramènent toujours au pied de l'art, ma seule raison pour vivre.
Oh ! devenir célèbre !
Lorsque je me vois célèbre en imagination, c'est comme un éclair, comme le contact d'une pile électrique ; je me lève en sursaut et me mets à. marcher par la chambre.
On dira que si l'on m'avait mariée à dix-sept ans, je serais comme tout le monde. Grave erreur. Pour qu'on eût pu me marier comme tout le monde, il aurait fallu que je fusse une autre.
Croyez-vous que j'aie jamais aimé ? Je ne crois pas.
Ces toquades passagères ont l'apparence de l'amour, mais ça ne doit pas être ça.
*
* *
Je continue à ressentir cette grande faiblesse... comme les cordes détendues d'un instrument, pourquoi ? Julian dit que j'ai l'air d'un paysage d'automne, une allée abandonnée, remplie de brumes et de désolation d'hiver... « Juste ce que je viens de faire, cher monsieur. »
Il dit parfois juste, le père Julian.
— Montrez-vous votre tableau au grand homme ?
— J'aimerais mieux sauter d'un cinquième.
— Eh bien, c est la preuve que vous sentez que c’est insuffisant et que vous pouvez aller au delà.
Très juste.
Samedi 10 novembre 83.
Je voudrais attribuer une légère fièvre causée par le vent d'hier (sur la Seine) à des causes morales...
Je travaille à la maison ; sculpture.
Ma pauvre enfant, tout te pousse au pied de l'art, ne méconnais pas ces divers indices, vas-y.
La gloire seule donne ce que tu veux, et l'on dit que tu peux l'atteindre.
Dimanche 11 novembre 83.
J'ai dîné ce soir à Jouy ; je crois que j'aime vraiment ces gens-là. Ils sont intelligents et gentils. Je trouve presque du plaisir à les voir, ce n'est pas une corvée comme les autres.
Changement de décor subit, tout est riant, calme et beau. Je sais ce que je veux faire, et tout va.
Lundi 12 novembre 83.
Drumont, de la Liberté, vient nous voir.
Il déteste le genre que je fais, mais m'adresse de grands compliments, tout en me demandant avec stupeur comment il se peut que moi, entourée d’élégance et de raffinements, j'aime le laid. Il trouve mes gamins laids.
— Pourquoi ne les avez-vous pas choisis jolis, ce serait aussi bien ?
— Je les ai choisis expressifs, si j'ose m'exprimer ainsi. Du reste, dans les gamins qui courent les rues, on ne voit pas tant que ça d'astres de beautés ; il faudrait pour cela aller aux Champs-Élysées et peindre les pauvres petits bébés enrubannés et flanqués de gouvernantes !
Où est le mouvement ? où est la liberté sauvage, primitive ? où est l'expression vraie, alors ? Dans les enfants bien élevés, il y a déjà de la pose.
Et puis... Enfin, j'ai raison.
Samedi 17 novembre 83.
La campagne fait très vivement sentir la beauté des tableaux.
Les Parisiens ne peuvent l'adorer, mais s'ils se donnaient seulement la peine de regarder la campagne si grande, si simple, si belle, si poétique ; chaque brin d'herbe, les arbres, la terre, les regards des femmes qui passent, les attitudes des enfants, la démarche des vieillards, la couleur de leurs vêtements s'harmonisant avec le paysage…
Jeudi 22 novembre 83.
L'Illustration universelle (de Russie) publie sur la première page le dessin de mon tableau (Jean et Jacques).
C'est le plus grand journal illustré russe, et me voila comme chez moi.
Et ça ne me cause pas de joie. Pourquoi ? Cela m'est agréable, mais ce n'est pas de la joie.
Pourquoi ? Parce que ce n'est pas assez pour mon ambition. Si j'avais eu une mention, il y a deux ans je me serais évanouie. Si l'on m'avait, l'année dernière, donné une médaille, j'aurais pleuré dans le gilet de Julian... Mais maintenant...
Les événements sont logiques, hélas ! Tout s'enchaîne et se suit, tout se prépare petit à petit. Une troisième médaille, l année prochaine, me semblera naturelle. Si je n'ai rien, je serai révoltée.
On n’éprouve une joie très vive que lorsque l'événement est inattendu, lorsque c'est en quelque sorte une surprise.
Une deuxième médaille au prochain Salon me rendrait bien heureuse parce que je n'y compte pas. Et puis, ce n’est pas une médaille qui compte, c'est le plus ou moins de succès qui l'accompagne.
Vendredi 23 novembre. — Samedi 24 novembre 83.
. — Il vient d'arriver quelque chose d'étonnant et qui me fait grand plaisir. Mon Pêcheur à la ligne, que j'avais donné à la loterie d'Ischia, se trouve à l'hôtel Drouot, faisant partie d'une collection de tableaux divers ; le mari d'une des femmes de chambre est venu dire avec effarement qu'une toile signée Bashkirtseff était à l'hôtel des Ventes et se vendait ce soir. Maman et Dina y sont allées et ont assisté à l'adjudication au prix de 130 francs. Ça ne vous fait pas d'effet, 130 francs, et à moi ça en a fait un grand. Il n'y avait pas de cadre, rien qu'une baguette de 20 francs, par conséquent ma peinture s'est vendue 110 francs à l'hôtel Drouot. Ces dames essaient de me faire croire que c'est 230, mais j'ai bien vu que le 2 avait été un 1 sur le catalogue. Dina a dit à la princesse et aux autres 430 francs. 0 vérité ! Enfin les 130 sont vrais. Ces dames n'en reviennent pas, Dina dit qu'elle croyait que tout le monde la regardait et maman avait détourné la tête avec terreur. Enfin je ne crois pas encore, tellement ça me parait beau.Mercredi 28 novembre 83.
J'ai fait le portrait de Dina, une harmonie blanche, c'est superbe.
La jeune fille d'hier, en feuilletant mes albums, m'a fait retrouver un vieux croquis : le meurtre de César. Ça m'a empoignée. J'avais à noter quelques tons vers quatre heures, dehors ; car, depuis trois jours, il y a des aurores boréales qui font flamber Paris... Ça c'est fait en fiacre ; je peignais et le fiacre marchait... je ne cherchais que les tons... Donc, ça fait, je rentre et saute sur Suétone et Plutarque. Montesquieu adore le récit du meurtre dans Plutarque. Quel académicien ! C'est arrangé, éloquent, tandis que dans Suétone ça fait frémir, c'est un procès-verbal qui fait froid dans le dos. Quel prestige étonnant ont donc les grands hommes, pour qu'au bout de plusieurs siècles, leurs vies et leurs morts nous fassent frémir et pleurer. J'ai pleuré Gambetta. Chaque fois que je relis l'histoire, je pleure Napoléon, Alexandre et César. Mais Alexandre est mort mal, tandis que César !...
Je ferai ce tableau pour moi, à cause des sentiments, et pour la foule parce que ce sont des Romains, qu'il y a de l'anatomie, du sang, et que je suis une femme, et que les femmes n'ont rien fait de classique en grand, et que je veux employer mes facultés de composition et de dessin... et parce que ce sera très beau.
Ce qui m'ennuie, c'est que ça se passe dans le Sénat, pas dehors ; c'est une difficulté de moins... et je les voudrais toutes... Lorsque je sens que je m'attaque aux choses les plus difficiles, je deviens subitement très froide, très décidée ; je me ramasse, me concentre, et arrive beaucoup mieux que dans les travaux à la portée de mes inférieurs.
Il n'est pas besoin d'aller à Rome pour faire le tableau et je le commencerai sitôt que... Pourtant, au mois de mars et avril, le printemps donne des tons bien jolis dehors, et j'avais l'intention d'aller faire des arbres en fleurs à Argenteuil... Il y a tant à faire dans la vie, et la vie est si courte ! Je ne sais pas mème si j'aurai le temps d'exécuter ce qui est déjà conçu...
Les Saintes femmes... — Le grand bas-relief ! Printemps. — J. César. — Ariane. — On se sent pris de vertige. On voudrait tout, tout de suite... Et tout se fera lentement... à sa place, avec des retards et des froideurs et des désenchantements... La vie est logique, tout s'enchaîne. Et lorsque Brutus poursuivi des fantômes se tue, je me surprend à m'écrier : C'est bien fait, canaille, c'est bien fait, ignoble scélérat !
Triompher en grand ! ne pensez pas que je songe à l'année prochaine, ni même à l'autre... mais plus tard... Ce serait tout de même si affolant, que je ne veux pas y penser...
Samedi 1er décembre 83.
Est-ce que je ne fais pas un métier de dupe ? Qui me rendra mes plus belles années dépensées... peut-être en vain !
Mais il y a une bonne réponse à ces doutes du moi vulgaire, c'est que je n'avais rien de mieux à faire vraiment ; partout ailleurs, et vivant comme les autres, j'aurais eu trop à souffrir... Et puis, je n'aurais pas atteint ce développement moral qui me rend d'une supériorité bien gênante... pour moi. Stendhal au moins avait connu un ou deux êtres capables de le comprendre ; tandis que moi, c'est effrayant; tout le monde est plat, et ceux que je prenais pour des gens d'esprit me paraissent stupides. Est-ce que je serais devenue ce qu'on appelle un être incompris ? Non,. mais enfin... Il me semble pourtant que j'ai bien raison d'être étonnée et mécontente, quand on pense de moi des choses dont je suis incapable et qui atteindraient ma dignité, ma délicatesse, mon élégance même...
Voyez-vous, quelqu'un qui me comprendrait tout à fait, devant qui je pourrais tout dire ?... Qui comprendrait tout et dans les discours de qui je reconnaîtrais mes pensées ?... Et bien, ma petite, ce serait de l'amour.
Peut-être bien; mais, sans aller si loin, des gens qui vous jugeraient seulement d'une façon intelligente, et avec qui on pourrait causer, ce serait déjà bien agréable... et je n'en connais pas. Le seul était Julian, et voilà que je le trouve de plus en plus fermé... Il est agaçant même quand il commence ces interminables taquineries qui frappent à côté, surtout dans les questions d'art ; il ne comprend pas que je vois clair et que je veux arriver ; il me croit entichée de moi...
Enfin... en somme, il est encore mon confident par intervalles. Pour ce qui, est d'une parité absolue de sentiments, ça n'existe pas, à moins d'être amoureux ; alors c'est l'amour qui fait des miracles... Pourtant,est-ce que ça n'est pas au contraire cette parité absolue qui fait naître l'amour ? — L'âme-sœur. — Moi, je crois que cette image, dont on a abusé, est bien juste. Eh bien, où est-elle cette âme ? Quelqu'un dont on ne verrait pas même le bout de l'oreille...
Il faudrait que pas un mot, pas un regard ne fussent en désaccord avec l'idée que je... m’en fais... Ce n'est pas que je demande la perfection introuvable et un être qui n'aurait rien d'humain ; mais je demande que ses travers me paraissent des travers intéressants et ne le démolissent pas à mes yeux ; qu'il soit conforme au rêve, non pas le rêve banal des divinités impossibles, mais enfin que tout en lui me plaise... et que je ne découvre pas tout à coup quelque coin stupide, ou plat, ou insuffisant, ou niais, ou mesquin, ou faux, ou intéressé ; rien qu'une de ces taches, et même toute petite, suffit pour tout détruire.
Dimanche 2 décembre 83.
En somme, mon cœur est absolument vide, vide, vide... Mais il me faut des rêveries pour m'amuser... Pourtant, j'ai éprouvé presque toutes ces choses dont parle Stendhal, à propos de l'amour vrai qu'il nomme amour-passion. Toutes; ces mille folies de l'imagination, tous les enfantillages, dont il parle... Ainsi, il m'est arrivé de voir avec bonheur des gens assommants, parce qu'ils avaient ce jour-là approché de l'objet.
Du reste, je crois qu'un être, femme ou homme, travaillant toujours et préoccupé d'idées de gloire, n'aime pas comme ceux qui n'ont que cela à faire.
Sans doute, Balzac et Jules (pas César) l'ont dit ; la somme d'énergie est une ; si on la dépense toute à droite, il n'en reste plus pour à gauche, ou bien les efforts sont moindres étant deux au lieu d'un.
« Lorsque vous envoyez cinq cent mille hommes sur le Rhin, ils ne peuvent en même temps être devant Paris. »
Il est donc probable que mes sentiments... tendres glissent sur moi en raison de cette théorie.
Lundi 3 décembre 83.
Voyons, je suis intelligente, je me donne de l'esprit, de la pénétration... enfin toutes les qualités cérébrales, et je suis juste. Eh bien ! dans ces conditions, pourquoi ne pas se juger soi-même ?.. Ça doit pouvoir se faire, puisque je vois clair, voyons ?
Suis-je vraiment quelqu'un, ou vais-je vraiment être quelqu'un en art ? Qu'est-ce que je pense de moi ?
Ça, c'est des questions terribles... parce que je pense du mal de moi par rapport à l'idéal auquel je voudrais atteindre ; mais, d'un autre côté, en comparaison des autres...
On ne peut pas se juger, et puis... dès que ce n'est pas du génie... et je n'ai encore rien fait qui puisse me faire définitivement juger, même par moi.
Ainsi je suis désespérée devant ce que je fais ; chaque fois que c'est fini, je veux tout recommencer, je trouve tout mauvais, parce que je compare toujours avec ce que je voudrais que cela fût... Mais ce qui entoure console, on voit des gens qui font pis et qu'on admire... alors ? Et puis ça dépend des moments. En somme, au fond, je ne pense pas grand'chose de moi-artiste, j’aime mieux le dire (dans l'espoir de me tromper). D 'abord, si je me croyais du génie, je ne me plaindrais jamais de rien... Mais ce mot génie est si formidable que je ris en l'écrivant à propos de moi, même pour dire que j'en manque !... Si je m'en croyais, je serais folle.
Enfin. Eh bien ! je ne crois pas que j'en aie, mais j'espère que le monde m'en croira...
Lundi 10 décembre 83.
Matin, sculpture. Après-midi, je peins le corsage et le bouquet de la tête qui rit. C'est une petite gueuse moitié danseuse, moitié modèle, et elle rit drôlement. C'est fini. Au gaz : — un dessin, femme qui lit près d'un piano ouvert. Fini. Si c'était comme çà tous les jours, ce serait charmant.
Mais cinquante inconnus font ce que je fais et ne se plaignent pas que le génie les étouffe. Et si ton génie t'étouffe, c'est que tu n'en as pas ; celui qui en a a la force de le supporter.
Le mot génie c'est comme amour, j'ai eu de la peine à l’écrire pour la première fois ; mais une fois écrit, je l'ai employé tous les jours et à propos de tout ; c'est comme pour toutes les choses qui vous paraissent d'abord énormes, effrayantes, inabordables ; une fois qu'on y touche, on s'en donne comme pour se rattraper des hésitations et des frayeurs. Cette spirituelle observation ne me paraît pas bien claire, mais il faut que je dépense mon fluide ; j'ai travaillé jusqu'à sept heures du soir, il m 'en reste encore, il va s'écouler par la plume.
Je maigris. Enfin... Que Dieu me soit indulgent !
Mardi 11 décembre 83.
Matin, rien ! Après-midi, ébauché une tète de gamine de cinq ans, de profil et qui rit. J'ai l intention de faire cinq ou six têtes toutes riant. Ça commence par une tête de huit mois, puis la fillette de cette après-midi. Puis Armandine (la danseuse de Japhet), de face, en chapeau et pèlerine loutre, avec un bouquet de violettes sur l'épaule. Puis je mettrai un gommeux, en habit et suçant sa canne, puis une jeune fille innocente, et enfin un vieux et une vieille. Tout ça encadré ensemble.
« Rire est le propre de l'homme. » Ces rires très différents pourraient donner quelque chose de drôle. Et je le ferai, comme Armandine, très vite; ce serait pour une petite exposition.
Dimanche 23 décembre 83.
Les vrais artistes ne peuvent pas être heureux ; d'abord, ils savent, eux, que la grande masse ne les comprend pas ; ils savent qu'ils travaillent pour une centaine d'individus et que les autres suivent leur mauvais goût ou le Figaro. L'ignorance en matière artistique, dans toutes les classes, est effrayante.
Ceux qui en parlent bien respectent ce qu'ils ont lu ou entendu dire par les gens dits compétents.
Enfin... je crois aussi qu'il y a des jours où l'on sent par trop naïvement toutes ces niaiseries, il y a des jours où une conversation inepte est particulièrement insupportable, où les niaiseries vous font souffrir, où entendre pendant deux heures échanger des âneries qui n'ont même pas le mérite de la gaieté ou du vernis mondain vous cause un vrai chagrin.
Remarquez que je ne suis pas de ces âmes d'élite qui pleurent quand elles sont forcées d'écouter les banalités des salons, les petits potins, les compliments d'usage, les considérations sur le temps ou l'opéra italien. Je ne suis pas assez sotte pour exiger des causeries intéressantes partout, et tout ce qui est banalité mondaine, gaie parfois, plus souvent terne, me laisse calme ; c'est un mal que je supporte quelquefois, même avec plaisir ; mais la vraie niaiserie, la vraie stupidité, le manque de...; enfin, la banalité mondaine, en même temps qu'absence d'esprit.
Ça c'est la mort à petit feu.
Samedi 29 décembre 83.
0 misère ! il y a des journées noires, tristes, désespérées ; tous ces cancans, ce que cela fait dire, croire, inventer...
Mais je n'ai jamais rien fait d'immoral ! El quand je: pense ! !
Ah ! mes amis, perdez tout, mais gardez les apparences !
Enfin, ces infimes misères me rendent profondément malheureuse.
Si on ose dire des bêtises, on a raison tout en ayant infâmement tort.
Et voilà des choses méprisables, petites, infimes, dont je suis innocente et qui ne peuvent pas se rattraper. 0 misère !
Il y a des jours tristes, désespérés, noirs. On me couvre de calomnies...
Et je n'ai rien fait, ni à moi, ni aux autres. Claire et Villevieille travaillent, et je pleure en écrivant à l'autre bout de la bibliothèque.
Il y a des jours où l'on dégage de la clarté, d'autres où l'on est comme une lanterne éteinte : je suis éteinte.
Lundi 31 décembre 83.
La maréchale et Claire dînaient hier chez la princesse Mathilde, et Claire me raconte que Lefebvre lui a dit qu'il connaît mon talent, très réel, que je suis une personne assez extraordinaire, que je vais tous les soirs dans le monde et que, du reste, je suis surveillée, dirigée par des peintres illustres (d'un air fin).
Claire, en le regardant dans les yeux : — Quel peintre illustre, Julian ? — Lefebvre ? — Non, Bastien-Lepage. — Claire : Mais vous vous trompez absolument, Monsieur, elle sort très peu et travaille tout le temps. Quant à Bastien-Lepage, elle le voit dans le salon de sa mère, et il ne monte jamais à l’atelier.
C'est un amour que cette petite fille, et elle a dit la vérité ; car vous savez bien, ô mon Dieu, que ce diable de Jules ne m'aide en rien. C'est que Lefebvre avait l'air de le croire !
Il est deux heures ; c'est la nouvelle année, à minuit juste, au théâtre, et, montre en main, j'ai fait un souhait en un seul mot ; un mot qui est beau, sonore, magnifique, enivrant, écrit ou prononcé :
La gloire !
1884
Mercredi 2 janvier 84.
Ma tante Hélène, la sœur de mon père, est morte il y a huit jours. Paul nous avait télégraphié cette nouvelle.
Autre dépêche aujourd'hui : mon oncle Alexandre vient de mourir d'une attaque d'apoplexie. C'est saisissant. Et ce pauvre homme qui adorait sa famille, sa femme qu'il avait fini par aimer à la folie. N'ayant lu Balzac ni aucun romancier peut-être, il ne connaissait pas de phrases toutes faites ; seulement j'ai retenu des choses qu'il disait et qui font que cette mort me fait de la peine. On avait voulu lui faire croire que sa femme accueillait les hommages d'un voisin, et je me souviens de lui avoir entendu dire : Eh bien ! quand même cette infamie serait vraie ! Est-ce que ma femme, que j'ai épousée à quinze ans, n'est pas ma chair, mon sang, mon âme ? est-ce que nous ne sommes pas un ! Si j'avais failli, moi, est-ce que je ne me pardonnerais pas ? Comment pourrais-je ne pas pardonner à ma femme ; mais c'est comme si, pour me punir moi-même, je me crevais les yeux ou me coupais un bras !
Et puis il répétait toujours à mon dernier voyage en Russie : « Tu ne sais pas, ma petite Marie, et je ne sais pas m'expliquer, mais toi si fine, tu me comprendras... Avant, j'avais tant de préoccupations, tant de tourments, une telle soif d'acquérir, de devenir riche que je ne pensais pas comme il le fallait à ma femme ; mais maintenant, tout est arrangé, je n'ai plus les préoccupations sèches et absorbantes d'alors ; maintenant! il n'y a que du bonheur et la continuelle préoccupation des moindres souhaits de ma femme, cette pauvre chère Nadine adorée ; oui, maintenant tout est différent, ce serait trop long à dire, mais tout est différent... »
Il laisse trois enfants, Étienne qui a seize ans, Julie qui en a quinze et Alexandre qui a huit ou dix mois.
Et sa pauvre femme qui a trente-trois ans !
Vendredi 4 janvier 84.
Oui, je suis poitrinaire et ça marche.
Je suis malade, personne n'en sait rien, mais j'ai la fièvre tous les soirs, et tout va mal et ça m'ennuie d'en parler ! !
Samedi 5 janvier 84.
Ouverture de l'exposition Manet à l'École des Beaux-Arts !
J'y vais avec maman.
Il n'y a pas un an que Manet est mort. Je ne connaissais pas grand'chose de lui. L'ensemble de cette exposition est saisissant.
C'est incohérent, enfantin et grandiose !
Il y a des choses folles, mais il y a des morceaux superbes. Avec un peu plus ce serait un des grands génies de la peinture. C'est presque' toujours laid, souvent difforme, mais c'est toujours vivant. Il y a là des impressions splendides.
Et dans les choses les plus mauvaises on sent un je ne sais quoi qui fait qu'on regarde sans dégoût ni lassitude. Il y a là un tel aplomb, une si formidable confiance unie à une ignorance non moins formidable... C'est comme l'enfance d'un génie. Et puis des emprunts presque entiers à Titien (la femme ébauchée et le nègre), à Vélazquez, à Courbet, à Goya. Mais tous ces peintres se volent les uns les autres. Et Molière donc ! Il a pris des pages entières mot pour mot ; j'ai lu, je sais.
Mardi 8 janvier 84.
Dina pose bien, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle ne sent pas la pose et change tout en ne bougeant pas ; j'aimerais dix fois mieux une femme remuant beaucoup, mais retrouvant par moment la pose juste... Ou bien...; enfin, peu importe la raison, ça ne va pas, voilà...
Et comme je ne cède pas à la déveine, c'est une lutte terrible qui me brise ; la rage arrive à ce point qu'on paraît extraordinairement calme et que les mouvements sont d'une lenteur de malade, tandis qu'on a une envie folle de casser et de déchirer tout.
Lundi 14 janvier 84.
Il me semble que j'ai fait un voyage à Damvillers. Émile Bastien nous a tout raconté : le projet de tableau, le genre de vie... Il ne perpètre rien dans l'ombre, il n'a pas défendu de parler ; il n'a pas... S'il ne nous a pas invitées à voir les études de Concarneau, c'est qu'il n'invite jamais personne ; il penserait même que ce serait prétentieux d'inviter pour voir quelques études faites n'importe comment à Concarneau, où il était allé se reposer, et qu'enfin la façon très bienveillante dont il était reçu chez nous supprimait d'office ces cérémonies ; il aurait été enchanté si nous étions venues, etc. Et que même pour ses grands tableaux il n'invite jamais personne ; il dit seulement à son humble frère de prévenir quelques amis...
Mais voilà qui est plus sérieux ; lorsque le frère lui a parlé de mon tableau, il lui a dit : — Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à Paris, j'aurais été voir cela.
— Je ne lui avais rien dit à Paris parce que, s'il était venu, vous lui auriez tout caché comme d'habitude ; il ne sait rien de ce que vous faites, sauf votre salon. Vous retournez vos toiles ; enfin, savez-vous qu'il ne voudra plus jamais voir votre peinture si vous faites cela ?..
— Il voudra si je veux, si je lui demande des conseils.
— Il sera toujours ravi de vous en donner.
— Mais je ne suis pas son élève, hélas !..
— Et pourquoi ? Il ne demanderait pas mieux, il serait très flatté si vous le consultiez et il vous donnerait des conseils désintéressés et, enfin, des conseils de bon sens. Car il a un jugement très juste, sans parti pris... et il serait heureux d'avoir une élève intéressante... Croyez-moi, il serait très flatté et très content.
Mercredi 16 janvier 84.
L'architecte me l'a dit : parmi de nombreux projets de tableaux de son frère, il y a les Bergers à Bethléem.
Depuis deux jours ma tête a travaillé et j'en ai eu cette après-midi une vision très nette. — Oui, les bergers à Bethléem. — Sujet sublime et qu'il rendra plus sublime encore.
Oui, j'en ai eu une vision si nette et mon impression est telle que je ne peux là comparer qu'à celle de ces bergers ; un enthousiasme saint et une adoration complète.
Oui, pendant deux ou trois heures, j'ai été amoureuse folle par admiration. C'est que vous ne pouvez pas comprendre ça.
Sentez-vous tout ce qu'il y mettra de mystère, de tendresse, de simplicité grandiose ? On peut se le figurer quand on connaît son œuvre et en établissant des filiations mystérieuses et fantastiques entre Jeanne d'Arc et le Soir au village, dont l'effet se reproduira en quelque sorte dans les bergers; non, mais vous ne me trouvez pas ravissante de prendre feu pour des tableaux que je n'ai pas vus et qui n'existent pas encore ? Mettons que je suis ridicule pour la majorité, deux ou trois rêveurs seront avec moi et, au besoin, je m'en passerai.
Jeanne d'Arc ne fut pas comprise en France, on s'agenouilla devant en Amérique. Jeanne d'Arc est un chef-d'œuvre de facture et de sentiment.
Il fallait entendre Paris en parler. C'était une honte !
Mais enfin, est-ce possible que le succès aille aux Phèdre et aux Aurore ? Du reste... Est-ce que le public a aimé Millet, Rousseau, Corot ! Il les a aimés quand ils furent à la mode.
Ce qui est honteux pour notre époque, c'est la mauvaise foi des gens éclairés, qui font semblant de croire que cet art n'est ni sérieux ni élevé, et qui encensent « ceux qui suivent les traditions des maîtres ». Est-il besoin d'insister et d'expliquer la stupidité de ces raisonnements ? Qu'est-ce qui est donc l'art élevé, si ce n'est l'art qui, tout en peignant la chair, les cheveux, les vêtements, les arbres, en perfection, de façon à nous faire toucher pour ainsi dire, peint en même temps des âmes, des esprits, des existences ? Jeanne d'Arc n'est pas d'un art élevé parce qu'il nous la montre paysanne, chez elle, et non pas avec des mains blanches et avec une armure.
Non, son Amour au village est inférieur à Jeanne d'Arc, et les critiques idiots ou perfides le louent pour l'enfermer dans une spécialité, furieux que cet homme, qui a peint des paysans, s'avise de peindre autre chose, une paysanne historique comme Jeanne d'Arc.
Pharisiens hypocrites !
Car enfin nous tous, n'importe qui, nous peindrons la chair, mais nous n'avons pas l'au delà, le souffle divin... ce qu'il a enfin. Qui donc, excepté lui ? Mais personne. Dans les yeux de ses portraits, je vois la vie des personnages, il me semble que je les connais. J'ai essayé de me donner cette impression devant d'autres toiles, et je n'ai pas pu.
Pouvez-vous préférer l'exécution de Jeanne Gray ou un Bajazet quelconque à l'œil limpide et vivant d'une petite fille qui passe ?
Ce qu'il a, cet artiste incomparable, on ne le trouve que dans les tableaux religieux italiens, lorsque les artistes peignaient et croyaient.
Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de vous trouver à la campagne le soir, seul, sous un ciel très pur et de vous sentir troublé, envahi par un sentiment mystérieux, par des aspirations vers l'infini ; de vous sentir comme dans l'attente de quelque grand événement, de quelque chose de surnaturel ? et n'avez-vous jamais eu des rêveries qui vous transportaient dans des mondes inconnus ?...
Sinon... vous ne comprendrez jamais et je vous conseille d'acheter une Aurore de Bouguereau ou un tableau historique de Cabanel.
Tout ça, cher ange, pour dire que tu adores le génie du petit Bastien ?
Oui.
Alors, c'est fait, là-dessus va te coucher. Amen.
Dimanche 20 janvier 84.
C'est triste, mais je n'ai pas d'amie, je n'aime personne et personne ne m'aime.
Si je n'ai pas d'amie, c'est que (je le sens bien) malgré moi je laisse par trop voir de quelle hauteur « je contemple la foule ».
Personne n'aime à être humilié. Je pourrais me consoler en pensant que les natures vraiment supérieures n'ont jamais été aimées. On les entoure, on se chauffe à leurs rayons ; au fond, on les exècre et, sitôt qu'on peut, on les diffame. A l'heure qu'il est, il est question d'une statue à Balzac, et les journaux publient des souvenirs et des renseignements recueillis chez les amis du grand homme. C'est à vomir de dégoût, des amis pareils.
C'est à qui divulguera un vilain trait, un ridicule, une bassesse.
J'aime mieux les ennemis, on les croit moins.
Samedi 23 février 84.
La Maréchale et Claire sont arrivées vers une heure pour recevoir Madeleine Lemaire, qui vient voir le tableau. Cette dame est une célèbre aquarelliste et femme du monde aussi, mais elle vend ses tableaux très chers. Elle n'a dit que des choses flatteuses, naturellement.
Et je suis de mauvaise humeur, enragée. C’est probablement parce que je mourrai bientôt ; mais toute ma vie me revient dès les commencements avec les détails, des choses bêtes et qui me font pleurer ; je n'ai jamais été souvent au bal comme les autres ; trois, quatre bals par an ; je pouvais y aller souvent depuis deux ans, lorsque ça ne pouvait plus m'amuser.
Et c'est la grande artiste qui regrette ça ? Ma foi oui... Et maintenant ? Maintenant, il y a autre chose que le bal, ce sont les réunions où l'on rencontre tout ce qui pense, écrit, peint, travaille, chante, tout ce qui constitue la vie d’êtres intelligents.
Les plus philosophes et les plus raisonnables ne font pas fi de se rencontrer, une fois par semaine ou deux fois par mois, avec des gens qui sont la fleur de l'intelligence de Paris... Je donne ces explications parce que je ne sais pas, je vais mourir. J'ai toujours été malheureuse en tout ! A force de travail, j'arrive à avoir des relations dans le vrai monde, et encore c'est une humiliation.
On est trop malheureux pour ne pas espérer qu'il y a un Dieu qui peut vous prendre en pitié... ; mais si ce Dieu existait, laisserait-il faire ce qui se fait, et moi qu'ai-je fait pour être si malheureuse ?
Ce n'est pas la lecture de la Bible qui peut faire croire. Ce n'est qu'un document historique où tout ce qui touche à Dieu est enfantin.
On ne peut croire qu'à un Dieu... abstrait, philosophique, un grand mystère, la terre, le ciel, tout. Pan.
Mais alors c'est un Dieu qui ne peut rien pour nous. Ce Dieu, on l'admire et on se l'imagine en regardant les étoiles et en pensant aux questions scientifiques — spiritualistes, à la Renan... Mais un Dieu. qui voit tout, qui s'occupe de tout, à qui on peut tout demander... Ce Dieu-là, je voudrais bien y croire. Mais s'il existait, laisserait-il faire ?
Mardi 11 mars 84.
Il pleut. Ce n'est pas seulement cela... mais je vais mal... Tout ça est si injuste. Le ciel m'accable...
Enfin, je suis encore en un âge où l'on trouve de l'ivresse même à mourir.
II me semble que personne n'aime autant tout que moi : arts, musique, peinture, livres, monde, robes, luxe, bruit, calme, rire, tristesse, mélancolie, blague, amour, froid, soleil ; toutes les saisons, tous les états atmosphériques, les plaines calmes de la Russie et les montagnes autour de Naples ; la neige en hiver, les pluies d'automne, le printemps et ses folies, les tranquilles journées d'été et les belles nuits avec des étoiles brillantes... j'adore et j'admire tout. Tout se présente à moi sous des aspects intéressants ou sublimes ; je voudrais tout voir, tout avoir, tout embrasser, me confondre avec tout et mourir, puisqu'il le faut, dans deux ans ou dans trente ans ; mourir avec extase pour expérimenter ce dernier mystère, cette fin de tout ou ce commencement divin.
Cet amour universel n'est pas une sensation de poitrinaire ; j'ai toujours été ainsi et je me souviens qu'il y a dix ans juste j'écrivais (1874), après avoir énuméré les charmes des saisons diverses : « En vain je voudrais choisir, toutes les saisons sont belles, toute l 'année, toute la vie.
« Il faut tout ! Le reste ne suffit pas.
« Il faut la nature, devant elle tout est misérable.
« Enfin tout dans la vie me plaît, je trouve tout agréable et, tout en demandant le bonheur, je me trouve heureuse d'être misérable. Mon corps pleure et crie, mais quelque chose qui est au-dessus de moi se réjouit de vivre, quand même ! »
Ce brave et bon T. Robert-Fleury dîne ici ce soir; il dit que mes gamins ont beaucoup gagné et qu'en somme, c'est sérieusement bien et que ça comptera au Salon.
J'oublie de dire que mes gamins sont intitulés : Un meeting.
Mercredi 12 mars 84.
Le portrait de Dina ne sera pas fini, je n'enverrai donc que le Meeting.
Ce soir, réunion intime chez Mme Hochon : beaucoup d'artistes et quelques dames, comme la duchesse d'Uzès, la comtesse Cornet, la Maréchale, nous. En fait de peintres, Cabanel, Jalabert, Siebert, G. Ferrier, Boulanger, etc. On fait de la musique et Salvayre joue et chante des morceaux de son Henri III. Tous ces gens ont été aimables pour moi, Cabanel aussi.
Samedi 15 mars 84.
Abbema est venue voir mon tableau ce matin.
Il semblait que ce 15 ne viendrait jamais..... Il fait un temps radieux et je vais dès lundi ou mardi travailler à la campagne. Je ne veux plus admirer Bastien-Lepage ; je le connais à peine, c'est une nature... fermée ; et puis il vaut mieux travailler à son propre talent que de se dépenser en admiration.
Dimanche 16 mars 84.
On a envoyé les tableaux.
Je rentre à six heures et demie dans un état de fatigue et d'éreintement si complet que ça en est délicieux... Vous ne croyez pas que c'est délicieux, c'est que, pour moi, toute sensation complète, poussée à l'extrême limite, même une sensation de douleur, est une jouissance.
Lorsque je me suis abîmé le doigt, la douleur fut si vive pendant une demi-heure que j'en ai joui.
Ainsi la fatigue complète de ce soir, le corps n'offrant plus aucune résistance à l'air, détendu par un bain, puis étendu au lit, les bras et les jambes lourdes, la tête pleine de choses incohérentes, nuageuses... je me suis endormie en disant par ci, par là, tout haut des mots pris aux choses qui me passaient confusément par la tête... Cabanel, vernissage... le Maréchal, Breslau,... peinture, Algérie, cimaise,... Wolff !
Mercredi 19 mars 84.
J'ai trouvé un verger à Sèvres et ne rentre que vers huit heures, très fatiguée. Il y a du monde à dîner.
Hier a eu lieu le ballottage au Cercle des artistes russes. Je suis élue à l'unanimité.
Claire a vu un monsieur qui a été voir Bastien-Lepage et qui l'a trouvé très malade ; le lendemain, ce monsieur a rencontré le médecin qui a dit : cet homme est très malade, mais je ne crois pas au rhumatisme, il est malade de là (en se tapant l'estomac). Alors il est vraiment malade ?... il est parti depuis trois ou quatre jours pour Blidah, accompagné de sa mère.
Samedi 22 mars 84.
Pas encore commencé à Sèvres, mais c'est trouvé.
Julian écrit : « Vous êtes reçue avec numéro 3 au moins. »
Qu'est-ce que ça signifie au moins ?
Dieu merci, je n'ai pas douté d'être reçue !
Lundi 24 mars 84.
Depuis quelques jours, il y a je ne sais quoi de brouillant autour de moi... qui m'isole de l'univers et qui me fait voir la réalité au fond de moi-même. Aussi... Non, tout est trop triste pour que je me plaigne... c'est un abêtissement lourd... Je viens de relire un livre que j'avais peu admiré il y a quelques années et qui est admirable Madame Bovary.
La forme littéraire, le style... oui...; en somme, ce n’est que de l'exécution.
Mais il n'est pas question de cela; au milieu de ces vapeurs qui m'entourent je vois plus claires les réalités... des réalités si dures, si amères que je vais pleurer en les écrivant. Mais je ne pourrai même pas les écrire. Et puis, à quoi bon ? A quoi bon tout ? Passer six ans à travailler dix heures par jour pour arriver à quoi ? Un commencement de talent et une maladie mortelle. J'ai été chez mon médecin aujourd'hui et j'ai causé si gentiment qu'il m'a dit : « Je vois que vous êtes toujours gaie. »
Si je persiste à espérer que « la gloire » va me payer de tout, il faudra vivre, et pour vivre il faudra me soigner...
Voilà des visions, des réalités affreuses.
On ne croit jamais... jusqu'à ce que... Je me rappelle, étant toute petite et voyageant pour la première fois en chemin de fer, et pour la première fois en contact avec des étrangers, je m'étais installée, occupant deux places avec toutes sortes d'objets, lorsque deux voyageurs entrèrent. — Ces places sont prises, dis-je avec aplomb. — C'est bon, répondit le monsieur, je vais appeler le conducteur.
Je crus à une menace, comme en famille, à un de ces mensonges comme à la maison, et rien ne peut peindre le froid étrange qui me saisit lorsque le conducteur débarrassa la place que le voyageur occupa aussitôt. Ce fut la première réalité.
Depuis longtemps je me menace de maladie sans y croire... Enfin !... Je n'aurais pas eu le temps de vous raconter toutes ces misères, mais j'attendais mon modèle et, ne faisant rien, il faut bien geindre.
Et le vent de mars avec un ciel gris et lourd...
J'ai commencé hier un assez grand tableau dans le vieux verger de Sèvres, une jeune fille assise sous un pommier en fleurs, un sentier qui s'en va au loin, et partout des branches d'arbres fruitiers en fleurs, de l'herbe très fraîche, des violettes et de petites fleurs jaunes. La femme est assise et rêve les yeux fermés et la tête appuyée dans la main gauche, le coude sur le genou.
Ça doit être très simple et on doit sentir les effluves du printemps qui font rêver la femme.
Il faut du soleil entre les branches. Ça a deux mètres de large et un peu plus en hauteur.
Alors, je ne suis reçue qu'avec le numéro 3, et je puis n'être pas sur la cimaise, pas même cela ?
Alors c'est un découragement profond et sans espoir ; ce n'est de la faute de personne, puisque je n'ai pas de talent... Oui, voilà qui m'a vraiment montré que si je n'espérais pas en mon art, je mourrais à l'instant. Et si cette espérance venait à manquer comme ce soir... oui il ne resterait que la mort sans phrase.
Jeudi 27 mars 84.
Très préoccupée de mes travaux. Pourquoi n'ai-je pas encore donné en peinture l'équivalent du pastel fait il y a près de deux ans ?
Lundi 31 mars 84.
Presque rien fait, mon tableau sera mal placé et je n'aurai pas de médaille.
Puis je me suis mise dans un bain très chaud pendant plus d'une heure et j'ai craché du sang.
C'est bête, direz-vous ; c'est possible, mais je n'ai plus de sagesse, je suis découragée et à moitié folle de mes luttes contre tout.
Enfin... que dire, que faire, si cela continue j'en ai pour dix-huit mois, mais si j'étais un peu tranquille je pourrais vivre vingt ans encore.
Oui, ce 3 est difficile à avaler. Zilbardt, Breslau .ont des numéros 2. Alors moi ? Il y a quarante jurés et j'ai eu, paraît-il, tant de voix pour 2 qu'on a cru que je l'avais. Supposons que j'aie eu 15 voix, et 25 contre. Ces 25... le jury est composé de quinze ou vingt hommes connus et de vingt intrigants inconnus et faisant des peintures atroces. Ceci est de notoriété publique. Enfin, c'est ainsi. Et c'est un coup formidable. Voyons, je suis pourtant lucide et je me vois; non, il n'y a rien à dire... Il commence à me sembler que si mon tableau avait été très bon...
Ah ! jamais, jamais, jamais ! ! je n'ai touché le fond du désespoir comme aujourd'hui. Tant qu'on coule en bas, ce n'est pas encore la mort, mais toucher de ses pieds le fond noir et visqueux... se dire : ce n'est ni les circonstances, ni ma famille, ni le monde, c'est mon manque de talent. Ah ! c'est trop horrible, car il n'y a pas d'appel, pas de puissance humaine ni divine. Je ne vois plus la possibilité de travailler, tout semble fini.
Alors voilà une sensation complète ? De l'embêtement à fond ? Oui. Eh bien ! d'après tes théories, cela doit être une jouissance. — Attrape !
Cela m'est égal ; je vais prendre du bromure, ça me fera dormir, et puis Dieu est grand et il m'arrive toujours quelque petite consolation après de profondes misères.
Et dire que je ne puis même pas raconter tout cela, échanger des idées, me consoler en causant... Rien, personne, personne !...
Bienheureux les simples d'esprit, bienheureux ceux qui croient en un bon Dieu auquel on peut en appeler ! En appeler de quoi, de ce que je n'ai pas de talent ?
Vous voyez bien. C'est le fond. Ce doit être une jouissance.
C'en serait une si mes misères avaient des spectateurs...
Les douleurs des gens, devenus célèbres ensuite, sont racontées par leurs amis, car on a des amis, des gens avec lesquels on cause. Je n'en ai pas. Et quand je me lamenterais ! Quand je dirais : Non, je ne peindrai plus ! Et puis après ? Ça n'est une perte pour personne, je n'ai pas de talent.
Alors toutes ces choses qu'il faut enfermer en soi et qui ne font rien à personne... Le voilà, le pire des tourments, le plus humiliant. Car on sait, on sent, on croit soi-même qu'on n'est rien.
Si cela durait, on n'y pourrait survivre.
Mardi 1er avril 84.
Cela dure, mais comme il faut bien trouver des biais, je trouve celui-là. Et si je me trompe ? Mais, à force de pleurer, j'ai les yeux troubles.
On me dit : oh ! vous savez, le numéro ne signifie pas grand'chose, ça se passe n'importe comment.
Oui, mais la place ??
Mercredi 2 avril 84.
J'ai été chez Petit (exposition de la rue de Sèze). Je suis restée une heure devant les incomparables toiles de Bastien-Lepage et de Cazin.
Après, je vais chez Robert-Fleury et, d'un air très gai, en curieuse : — Voyons, Monsieur, comment cela s'est-il passé au jury ? — Mais très bien, lorsque votre tableau a passé, ils ont dit, — ni un, ni deux d’entre eux, mais tout un groupe : — « Tiens, c'est bon ça, un numéro 2 ! »
— Oh ! Monsieur, est-ce possible ?
— Mais oui, croyez bien que je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, c'est ainsi. Alors on a voté, et si ce jour-là le président n'avait pas été un ahuri, vous auriez le numéro 2. Votre tableau a été trouvé bon, on l'a accueilli avec sympathie.
— Et j'ai le numéro 3.
— Oui, mais c'est dû à une sorte de malheur, de la guigne uniquement, vous deviez avoir 2.
— Mais que lui reproche-t-on, au tableau ?
— Rien.
— Comment rien, il n'est donc pas mauvais ?
— Il est bon.
— Mais alors ?
— Alors c'est un malheur et voilà tout, alors si vous trouviez un membre du jury pour demander qu'on le mette sur la cimaise, il y serait, car il est bon.
— Mais vous ?
— Moi je suis membre du bureau, chargé spécialement de faire respecter l'ordre des numéros ; mais qu'un de nous le demande, croyez bien que je ne dirai rien contre.
Et puis chez Julian, qui rit un peu des conseils de Robert-Fleury et qui dit que je puis être presque tranquille, et qu'il sera bien étonné si je ne suis pas sur la cimaise, et que... Du reste, Robert-Fleury m'a dit qu'en son âme et conscience, je mérite 2, et que je l'ai moralement. Moralement ! ! ! Et que, du reste, ce ne serait que juste.
Ah ! Non ! demander comme une faveur ce qui m'est dû, c'est trop !
Vendredi 4 avril 84.
L’exposition de Bastien-Lepage est brillante, sans doute; mais ce sont presque toutes des choses anciennes. Il y a : 1° portrait de Mme Drouet, de l'année dernière ; 2° un autre portrait de 1882 ; 3° un paysage avec deux blanchisseuses et un pommier en fleurs, de 1882 aussi ; 4° son concours de prix de Rome (il n'a eu que le second prix de Rome) de 1875 ; et alors de l'été dernier il y a une esquisse faite à Concarneau; ça fait cinq. La mare de Damvillers, 6. Les Blés ou les Faucheurs; on ne voit qu'un petit faucheur de dos.
Un vieux gueux portant du bois dans une forêt, ça fait huit. La mare de Damvillers, les faucheurs et le gueux sont en plein soleil, et, lorsqu'on m'aura montré beaucoup de paysagistes de cette-valeur, je serai bien étonnée. C'est qu'un grand artiste ne peut pas avoir de spécialité.
Je sais que j'ai vu chez Bastien-Lepage une Andromède qui, quoique petite, est une étude de nu comme personne ne peut en faire. Précision, caractère, noblesse de forme, élégance du mouvement, finesse de ton, tout y était. Et une exécution précieuse et large en même temps ; enfin, comme la nature, de la chair et de la peau enfin ! Lorsqu'il a voulu faire un effet de crépuscule, il a fait le Soir au village, qui est un chef-d'œuvre pur. Cette note poétique à la Millet était dépassée peut-être... Je dis à la Millet pour faire comprendre ; car Bastien est. lui-même, et si Millet a peint des soirs et des lunes, il en reste encore pour d'autres, Dieu merci.
Ce Soir au village est d'un effet magique ; comment ne l'ai-je pas acheté ?
Il a donné aussi des vues de Londres, avec la Tamise où l'on voit positivement couler l'eau, cette eau lourde, épaisse, qui coule en tournant pour ainsi dire. Enfin, ses petits portraits sont des plus beaux, aussi beaux que tous les petits portraits des maîtres anciens. Et le portrait grandeur nature de sa mère est d'une exécution qui n'en est pas, car c'est la nature même, de loin comme de près. Enfin Jeanne d Arc est une inspiration de génie.
Il a trente-cinq ans. Raphaël est mort à trente-sept ans, ayant fait davantage. Mais Raphaël a été, dès l'âge de douze ans, bercé sur les genoux des duchesses et des cardinaux qui l'ont fait travailler chez le grand Pérugin, et Raphaël, âgé de quinze ans, faisait des copies de son maître à s'y tromper, et, dès quinze ans, était sacré grand artiste. Ensuite ces grandes toiles qui nous étonnent par le temps qu'elles représentent, aussi bien que par leurs qualités, dans ces toiles, le gros ouvrage était fait par des élèves, et, dans plusieurs de ces tableaux, il n'y a de Raphaël que le carton.
Et Bastien-Lepage, dans les premiers temps, pour subsister à Paris, faisait le triage des lettres à la poste, de trois à sept heures du matin. Il a exposé en 1869 pour la première fois, je crois.
Enfin, il n'a eu ni duchesses, ni cardinaux, ni Pérugin. Mais déjà au village il avait tous les prix pour le dessin. Je crois que c'est à quinze ou seize ans seulement qu'il vint à Paris.
C’est encore mieux que moi, moi vivant toujours dans un milieu peu artistique, prenant quelques leçons dans mon enfance, comme tous les enfants, puis une quinzaine de leçons de une heure chacune dans l'espace de trois ou quatre ans, puis enfin toujours dans ce milieu... Ça me fait six ans et quelques mois ; mais il y a des voyages et une grande maladie. Enfin... Et où en suis-je ?
En suis-je au 1874 de Bastien ? Cette question est une insanité.
Si je disais devant du monde, et même devant des artistes, ce que j'écris de Bastien, on dirait que je suis tout à fait folle ; — les uns avec conviction, les autres par principe et pour ne pas admettre la supériorité d'un jeune.
Samedi 5 avril 84.
Voici des projets :
Je finirai d'abord le tableau de Sèvres. Puis j'entreprends la statue sérieusement le matin et une étude de nu l'après-midi — l'esquisse est faite d'aujourd'hui. Ça me mènera jusqu'au mois de juillet. En juillet je commence le Soir qui représente un grand chemin sans arbre ; une plaine, le chemin se confond avec le ciel où le soleil se couche.
Sur le chemin un chariot attelé de deux bœufs... et rempli de foin sur lequel un vieux est couché sur le ventre, le menton dans les mains. Le profil se détache en noir sur le coucher du soleil. Les bœufs sont conduits par un gamin.
Ce doit être simple, grandiose, poétique, etc., etc.
Ayant fini ça et deux ou trois petites choses qui sont en train, je partirai pour Jérusalem où je passerai l'hiver pour mon tableau et ma santé.
Et au mois de mai prochain, Bastien me proclamera grande artiste.
Je raconte ça, car c'est intéressant de voir ce qui advient de nos projets.
Dimanche 6 avril 84.
Ce soir ma tante est partie pour la Russie.
Samedi 12 avril 84.
Julian écrit que le tableau est sur la cimaise.
Mercredi 16 avril 84.
Je vais tous les jours à Sèvres, ce tableau m'empoigne. Le pommier est en fleurs ; tout autour les feuilles d'un vert clair poussent et le soleil joue sur cette belle verdure du printemps. Dans l'herbe, des violettes, des fleurs jaunes qui éclatent comme de petits soleils. L'air est embaumé et la fille qui rêve au pied de l'arbre, « alanguie et grisée », comme dit André Theuriet. Si on rendait bien cet effet de sève de printemps, de soleil, ce serait beau.
Mardi 29 avril 84.
C'est demain le vernissage, demain à la première heure je verrai le Figaro et le Gaulois. Que diront-ils ? Rien ? Du bien ? Du mal ?
Mercredi 30 avril 84.
Le désastre n'est pas complet, car le Gaulois parle de moi très bien. J'ai une notice à part. C'est très chic, c'est Fourcaud, le Wolff du Gaulois, et le Gaulois paraissant avec un plan du Salon le même jour que le Figaro, a une importance égale à ce qu'il me semble ou à peu près.
Le Voltaire, qui publie un numéro dans le même genre, me traite comme le Gaulois. Ça ce sont des pièces capitales.
Le Journal des Arts qui, lui aussi, publie un compte rendu à vol d'oiseau, me cite. L'Intransigeant, dans un numéro du même genre, me traite aussi bien. Les autres journaux feront leur compte rendu au fur et à mesure. Il n'y a que le Figaro, le Gaulois et le Voltaire qui font ces choses le matin même du vernissage.
Suis-je contente ? C'est une simple question. Ni trop, ni trop peu...
Il y en a juste assez pour que je ne sois pas désolée, voilà tout.
J'en viens, du Salon !. Nous n'y sommes allées qu'à midi et n'en sommes parties qu'à 5 heures, une heure avant la fin. — J'ai la migraine.
Nous restons longtemps sur la banquette devant le tableau.
On le regarde beaucoup et je riais en pensant que tous ces gens-là n'iraient jamais chercher l'auteur dans la jeune fille élégante, assise là et montrant de si petits pieds, si bien chaussés.
Ah ! c'est autrement mieux que l'année dernière, tout ça !
Est-ce un succès ? dans le sens véritable, sérieux, bien entendu ? Ma foi presque.
Breslau a exposé deux portraits, je n'en ai vu qu'un, qui m'a étonnée beaucoup. C'est une imitation de Manet, cela me déplaît. Ce n'est plus fort comme avant. Eh bien, c'est peut-être affreux ce que je vais dire, mais ça ne me chagrine pas. Je n'en suis pas non plus contente, non ; il y a place pour tout le monde. Pourtant j'avoue que j'aime mieux que ce soit comme ça.
Bastien-Lepage n'a que son petit tableau de l'année dernière : La Forge.
C'est un vieux forgeron dans l'obscurité de sa forge. C'est aussi bien que les petites toiles les plus noires des Musées.
Il ne va pas encore assez bien pour travailler. Ce pauvre architecte a l'air triste et dit qu'il va se ficher à l'eau.
Moi aussi je suis triste et je crois que, malgré ma peinture, ma sculpture, ma littérature, ma musique oui, malgré tout cela, je crois que je m'ennuie.
Samedi 3 mai 84.
Emile Bastien-Lepage arrive à onze heures et demie, je descends tout étonnée !
Il a une foule de bonnes choses à me dire. J'ai un vrai grand succès.
« Non pas relativement à vous ou aux camarades d'atelier, mais pour tout le monde. — J'ai vu hier Ollendorff, qui m'a dit que si c'était l'œuvre d'un Français, l'Etat l'aurait achetée. « Ah ça ! c'est un homme très fort que M. Bashkirtseff. » (Le tableau est signé M. Bashkirtseff.) Alors je lui ai dit que vous êtes une jeune fille et j'ai ajouté « jolie ». Non ! ! il n'en revenait pas. Et tout le monde m'en parle comme d'un grand succès. »
Ah ! ! je commence à le croire un peu. Par crainte de croire trop, je ne me permets de ressentir quelques satisfactions qu'avec des réserves dont vous ne vous faites pas une idée.
Enfin, je serai la dernière, à croire qu'on croit en moi. Mais il paraît que. c'est bien.
— Un vrai et très grand succès d'artiste, dit Emile Bastien.
Alors, comme Jules Bastien en 1874 ou 75 ? Ah ! Seigneur. Eh bien, je ne suis pas encore inondée de joie, parce que j'y crois à peine.
Il faudrait être inondée de joie. Cet excellent ami me demande de signer une autorisation pour Charles Baude, le graveur, l'ami intime de son frère.
Ce Baude va photographier et graver mon tableau pour le Monde illustré, ça c'est.bien.
Il m'a dit aussi que Friant (qui a du talent) est enthousiasmé de mon tableau.
Des gens que je ne connais pas parlent, s'occupent de moi, me jugent. Quel bonheur ! ! Ah ! c'est à ne pas y croire, tout en l'ayant désiré et attendu tant !
J'ai bien fait d'avoir attendu pour autoriser à photographier. On m'a écrit avant-hier pour me le demander, je ne sais qui. J'aime mieux que ce soit Baude, celui que Bastien-Lepage appelle Charlot, et auquel il écrit des lettres de huit pages.
Je vais descendre au salon de maman pour recevoir les félicitations de tous les imbéciles qui croient que je fais de la peinture de femme du monde, et qui adressent les mêmes compliments à Alice et aux autres petites sottes.
Là !
C'est, je crois, Rosalie qui sent le plus vivement mon succès. Elle est folle de joie, me parle avec des attendrissements de vieille nourrice et va raconter des choses à droite et à gauche comme une portière. Pour elle, il est arrivé quelque chose, un événement s'est accompli.
Lundi 5 mai 84.
Mourir, c'est un mot qu'on dit et qu'on écrit facilement ; mais penser, croire qu'on va mourir bientôt ? Est-ce que je le crois ? Non, mais je le crains.
Il n'y a pas à se le dissimuler, je suis poitrinaire. Le poumon droit est assez abîmé et le gauche commence à s'abîmer un peu depuis un an. — Les deux côtés. — Enfin, avec une autre structure, je serais presque maigre. Il est évident que je suis plus ronde que la plupart des jeunes filles, mais je ne suis pas comme avant. Il y a un an encore j'étais superbe, sans graisse et sans embonpoint ; maintenant les bras ne sont plus fermes, et en haut, vers les épaules on sent l'os au lieu de voir une épaule toute ronde et d'une belle forme. Je me regarde tous les matins en me baignant. Les hanches sont encore belles, mais on commence à voir les muscles du genou. Les jambes sont bien. Enfin, je suis atteinte sans retour. Mais, misérable créature, soigne-toi ! Mais, je me soigne et à fond. Je me suis brûlé les deux côtés de la poitrine, je ne pourrai plus me décolleter pendant quatre mois. Et il faudra recommencer ces brûlures, de temps en temps, pour que je dorme. Il n'est pas question de guérir, j'ai l'air de pousser au noir ; mais non, c'est seulement vrai. Mais à part les brûlures, il y a tant de choses ! Je les fais. Huile de foie de morue, arsenic, lait de chèvre. On m'a acheté une chèvre.
Enfin je me prolongerai, mais je suis perdue.
Aussi j'ai été trop tracassée. J'en meurs, c'est logique, mais c'est horrible.
Il y a tant de choses intéressantes dans la vie ! Les lectures seules.
On vient de m'apporter Zola complet, Renan complet et des volumes de Taine ; je préfère la Révolution de Taine à celle de Michelet. Michelet est nuageux et cotonneux et, malgré son parti pris du sublime, j'aime mieux la Révolution, après avoir lu Taine, que Michelet, bien que Taine ait voulu la montrer en laid, à ce qu'on dit.
Et la peinture ?
Voilà où on voudrait croire à un bon Dieu qui vient et arrange tout !
Mardi 6 mai 84.
La littérature me fera perdre la tête. Je lis Zola, entier. C'est un géant.
Chers Français, c'en est encore un que vous faites semblant de méconnaître !
Mercredi 7 mai 84.
Je reçois de Dusseldorff la demande de graver et de publier mon tableau et aussi d'autres tableaux de moi, si je le juge convenable. C'est amusant. Mais moi, vous savez, je ne crois pas que c'est arrivé. En somme, oui, c'est un succès, on me l’assure ; on ne le disait pas l'année dernière ; l'année dernière, il y a eu un petit succès d'artiste pour le pastel, mais cette année..... Seulement, ce n'est pas un coup de foudre. Non. Et si ce soir on m'annonce dans un salon, il ne se produira pas de mouvement, à moins que ce salon ne soit rempli de peintres. Pour que... un... succès arrive jusqu'à mon cœur et me rende heureuse, il faudrait cela.
Oui, il faut qu'à l'annonce de mon nom, les conversations s'arrêtent et toutes les têtes se retournent.
Depuis l'ouverture du Salon, il n'y a pas un journal qui ne parle de mon tableau ; oui, mais ce n'est pas encore ça ! Il y a ce matin un premier Paris d'Etincelle : Les mondaines — peintres. C'est très chic ! — Je viens immédiatement après Claire et j'ai autant de lignes qu'elle ! — Je suis un Greuze, je suis blonde avec le front volontaire d'un être qui sera quelqu'un, j'ai les yeux profonds. Je suis très élégante, j'ai du talent et je fais du bon réalisme, dans le genre de Bastien-Lepage. Là ! Ce n'est pas tout, j'ai le sourire et la grâce attirante d'un enfant ! ! ! — Et je ne suis pas transportée ? — Eh bien ! pas du tout.
Jeudi 8 mai 84.
Je travaille un peu chez moi.
Comment se fait-il que Wolff n'ait rien dit de mon tableau ? Il ne l'a pas vu, ça c'est encore possible ; en faisant la salle 17, il aura eu des distractions. Ce n'est pas que je ne sois pas digne d'occuper cet homme illustre, car il s'occupe de gens... moindres que moi...
Alors ? C'est du guignon comme le numéro 3 ? Je ne crois pas au guignon pour moi. Ce serait trop commode et on a l'air bête ; je crois à mon peu de mérite.
Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est vrai.
Vendredi 9 mai 84.
Je lis et j'adore Zola. Ses critiques et ses études sont des choses tout à fait admirables, et j'en suis amoureuse folle. Pour plaire à pareil homme on ferait tout ! Et vous me croyez capable d'amour comme tout le monde. Ah ! Seigneur.
Eh bien, Bastien-Lepage, je l'ai aimé comme j'aime Zola que je n'ai jamais vu, qui a quarante-quatre ans, une femme et du ventre. Je vous demande si les hommes du monde, ces hommes qu'on épouse ne sont pas atrocement ridicules ? Qu'est-ce que je pourrais bien dire à un gentleman pareil toute la journée ?
Emile Bastien dîne ici, et m'annonce pour jeudi matin sa visite avec M. Hayem, un amateur assez connu.
Il a des Delacroix, des Corot, des Bastien-Lepage et il a la spécialité de découvrir les futurs grands peintres.
Le lendemain du jour où le portrait du grand-père Bastien-Lepage fut exposé, Hayem arrivait dans son atelier et lui commandait le portrait de son père à lui. Il parait qu'il a un flair étonnant. Émile Bastien l'a rencontré aujourd'hui devant mon tableau.
— Comment trouvez-vous ça ?
— Je trouve ça très bien, connaissez-vous l'artiste ? Est-il jeune ? etc., etc.
Ce Hayem. m'a suivie depuis l'année dernière où il a remarqué le pastel et cette année le tableau...
Bref, ils viendront jeudi. Il désire m'acheter quelque chose.
Lundi 12 mai 84.
Après des journées glaciales, nous avons 28 et 29 degrés depuis trois jours.
C'est accablant. Je termine une étude de petite fille, au jardin, dans l'espoir de la visite de l'amateur.
J'ai oublié de dire que nous avons rencontré Hecht dans l'escalier des Italiens, il est dans l'enthousiasme de mon tableau.
C’est égal, ce n’est pas encore ça. Mais lorsque Bastien-Lepage a exposé le portrait du grand-père ce n’était pas ça non plus. Sans doute, mais c'est égal... Comme je dois mourir vite, je voudrais...
Tout porte à croire que Bastien-Lepage a un cancer à l'estomac. Alors il est donc flambé ? On se trompe peut-être. Le pauvre enfant ne peut pas dormir. C'est insensé ! Et son concierge jouit probablement d'une belle santé. C'est insensé !
Jeudi 15 mai 84.
A dix heures du matin. E. Bastien est arrivé avec M. Hayem.
Est-ce drôle ? Ça ne me parait pas possible. Je suis artiste et j'ai du talent. Et c'est sérieux. Et voila un homme comme ce M. Hayem qui vient chez moi, qui s'intéresse à ce que j'ai fait ; est-ce possible ?
Emile Bastien en est tout heureux, il m'a dit l'autre jour : « Il me semble que c'est moi. » Ce brave garçon est très malheureux. Je crois que son frère ne s'en tirera pas…
15 mai 84.
Et toute l'après-midi je me promène dans mes appartements assez contente, avec de petits frissons dans la nuque à la pensée de la médaille.
La médaille c'est pour le gros public ; en somme je préfère un succès comme le mien, sans médaille, à certaine médaille.
Samedi 17 mai 84.
Je suis rentrée du Bois, où j’étais allée avec les demoiselles Staritzky, de passage ici, et j'ai trouvé Bagnisky qui me dit que chez le peintre Bogoluboff on parlait du Salon, et que quelqu'un a dit à quelqu'un que mon tableau ressemble aux tableaux de Bastien-Lepage.
En somme, je suis flattée du bruit que fait mon tableau. On m'envie, on me calomnie, je suis quelqu'un. Il m'est donc bien permis de poser un peu si tel est mon plaisir.
Mais non, je dis d'un ton navré : — « Croyez-vousi que ce n'est pas horrible et n'y a-t-il pas de quoi être abattue ? je passe six années, les six plus belles années de ma vie à travailler comme un forçat ; ne voyant personne et ne jouissant de rien de la vie ! au bout de six ans je fais quelque chose de bien et on ose dire qu'on m'a aidée ! la récompense de tant de peine se change en une calomnie affreuse ! ! !
C'est sur une peau d'ours que je dis cela, les bras inertes, sincère et poseuse en même temps. Alors ma mère le prend à la lettre et cela me met au désespoir.
Voilà maman : supposez qu'on donne la médaille d'honneur à X..., naturellement je m'écrie que c'est une indignité, une honte, que j'en suis révoltée, furieuse, etc. — Maman : — Mais non, mais non, ne t'agite pas ainsi ! Ah ! mon Dieu, mais on ne la lui a pas donnée ! Ce n'est pas vrai ! Il ne l'a pas ! Et si on la lui a donnée c'est exprès ; on connaît ton caractère, on sait que tu vas enrager. Et on l'a fait exprès et toi tu te laisses prendre comme une petite sotte, voyons !...
Ce n'est même pas une charge, c'est seulement prématuré, attendez que X... ait sa médaille d'honneur et vous verrez !
Autre exemple. Le roman du pitoyable Y*** qui est à la mode maintenant, atteint — je ne sais combien d'éditions. Naturellement je bondis : — Comment, voilà la pâture de la majorité, voilà ce qu'on préfère ? 0 tempora ! 0 mores ! Voulez-vous parier que maman recommence la tirade X... ou à peu près ! — C'est déjà arrivé pour plusieurs choses. Elle a peur que je me casse, que je meure du moindre choc et, dans son immense naïveté, veut me préserver par des moyens qui finiront par me donner un accès de fièvre chaude.
Arrive X. Y. ou Z. et il dit : — Vous savez, le bal de Larochefoucauld était superbe.
Je m'assombris.
Maman le voit et cinq minutes plus tard, elle raconte devant moi, comme par hasard, quelque chose qui doit déconsidérer ce bal dans mon esprit ; à moins qu'elle n'entreprenne de prouver que le bal n'a pas eu lieu du tout.
C'est arrivé. — Des inventions et des défaites enfantines, et moi j'écume de voir qu'on croit que je peux gober ça ! ! !
mardi 20 mai 84.
A dix heures au Salon avec M. H.. Il dit que mon tableau est si bien qu'on croit que je me suis fait aider.
C'est atroce.
Il ose dire aussi que Bastien n'a jamais su composer un tableau, qu'il peint des portraits et que ses tableaux sont des portraits, et qu'il ne peut pas faire du nu. — Ce juif est étonnant.
Il parle de la médaille et va s'occuper de ça, il connaît tous les membres du jury, etc., etc.
En sortant de là, nous allons chez Robert-Fleury. D'un air agité, je lui raconte qu'on m'accuse de ne pas avoir fait mon tableau.
Il n'en a pas entendu parler ; il dit que ça n'existe pas dans le jury et que si on le disait, il serait là. Il nous croit beaucoup plus émus que je ne le suis en réalité, et nous l'emmenons déjeuner chez nous pour qu'il nous calme et prodigue des consolations. — Comment peut-on ainsi s'émouvoir de tout ? On repousse ces saletés du pied.
— Je voudrais qu'on le dise dans le jury devant moi, s'écrie-t-il, je serais foudroyant. Si quelqu'un s'avisait de le dire, je l'anéantirais ; ah ! mais là, carrément.
— Ah ! merci, monsieur.
— Mais non, il n'y a là aucune question d'amitié c'est simplement parce que c'est la vérité et que je le sais mieux que personne.
Il nous répète encore ces bonnes choses et aussi que j'ai des chances pour l'avoir, cette médaille, — on ne sait jamais ; — mais j'ai, paraît-il, beaucoup de chances.
Samedi 24 mai 84.
Il y a juste un an, c'était fait. Mais, cette année, le Salon ne rouvre que mardi. Ca fait que ce jour correspond au 21 mai de l'an passé. Aujourd'hui on a voté les premières et les deuxièmes médailles. Demain les troisièmes.
Il fait chaud et je suis fatiguée. La France illustrée demande l'autorisation de reproduire le tableau. Et un nommé Lecadre aussi. Je signe, je signe : Reproduisez !
Mais enfin on donnera des médailles à des choses moins bonnes que mon tableau ! c'est évident. Oh ! je suis bien tranquille, le vrai talent se fait jour quand même ; seulement c'est un retard et c'est embêtant. Je préfère n'y pas compter. La mention était promise pour sûr ; la médaille est problématique, mais ce sera injuste ! !
Evidemment.
Dimanche 25 mai 84.
Qu'est-ce que je fais depuis le 1er mai ? Rien. Et pourquoi ? Ah misère !
Je reviens de Sèvres. Ah ! c'est affreux. Le paysage a tellement changé qu'on ne peut y toucher. Ce n*est plus le printemps. Et puis mes fleurs de pommiers isont devenues jaunes (sur le tableau) ; j'y avais fourré de l'huile, mais aussi je suis idiote, j'ai raccommodé ça ; nous verrons. Mais il faut le finir ce tableau ; avec le Salon, les journaux, la pluie, H.... et toutes ces bêtises j'ai perdu vingt-cinq jours ; c'est insensé mais c'est fini.
Ma médaille se vote aujourd'hui, il est quatre heures. Il vient de pleuvoir à torrents. L’année dernière j’étais sûre de l'avoir et j'étais tracassée du retard de nouvelles positives. Cette année, ce n’est pas sûr, je suis beaucoup plus calme ; il y a un an je devais l'avoir, mais je redoutais l'imprévu et ça me tourmentait fort. L'avoir tout en ne l'ayant pas, l'avoir pour le pastel me désespérait. A présent que je comprends combien ce pastel est beau, ça me fait plaisir.
Cette année, c'est oui ou non, c'est très net. Si c’est oui, je le saurai ce soir vers huit heures. Je vais donc m'asseoir à la turque dans le grand fauteuil qui est sous la fenêtre et regarder par cette fenêtre, accoudée au dossier du susdit fauteuil. Et ça pendant quatre heures !
Il est cinq heures vingt. Ce n'est pas que je sois beaucoup plus ennuyée que lorsque je reste à ne rien faire sans rien attendre.
Et puis cette huile qui a ranci mes fleurs. Quand j'ai vu ça, j'en ai eu le front en eau. Espérons que ça ne se verra pas trop... Dans deux heures, je saurai. Vous croyez peut-être que je suis très tourmentée. Non, je vous le dis, pas beaucoup plus que lorsqu'il m'arrive de passer une après-midi à ne rien faire, seule, énervée.
Dans tous les cas les journaux de demain m'apprendront le résultat.
Je suis écrasée d'attente, brûlée et en eau avec un petit mal de tête.
Oh ! je ne l'aurai pas ; et c'est à cause de l'émotion de maman que ça m'embête. Je ne veux pas qu'on force la porte de mes affaires et qu'on partage mes sentiments. J'en souffre comme d'une impudeur. Que je sois en feu, ou en eau, ou en n'importe quoi, les autres doivent me laisser la paix. Et maman va s'imaginer que je souffre et ça m'exaspère.
Il fait lourd et du brouillard ! J'ai la gorge serrées jusque dans les mâchoires et les oreilles.
Sept heures trente cinq. On m'appelle pour dîner. C'est fini.
Lundi 26 mai 84.
Ça va mieux. Au lieu de cette attente lourde, je suis dans l'indignation. Or c'est un sentiment en dehors ou plutôt rafraîchissant. On a voté hier vingt-six troisièmes médailles, il en reste six à voter. M..., a sa médaille pour le portrait de Julian.
Comment expliquer cette aventure? Car enfin on a récompensé des choses relativement mauvaises.
L'injustice ? Je n'aime pas beaucoup cette raison, elle sied trop aux nullités.
On peut aimer plus ou moins ma peinture, mais il est un fait qui s'impose, c'est que voilà sept enfants groupés et grandeur nature avec un fond qui est bien aussi quelque chose. Tous ceux dont l'opinion compte trouvent cela très bien ou bien ; il y en a qui disent que je n'ai pas pu faire ça toute seule. Jusqu'au vieux Robert-Fleury qui, sans savoir de qui est le tableau, le trouve très bien.
Et Boulanger qui dit à des tiers qu'il n'estime pas ce genre, mais que c'est fort tout de même et très intéressant.
Et puis ?...
On a médaillé des nullités insignes ! ! Je sais bien que c'est la règle. Mais d'un autre côté il n'y a pas d’artiste de talent qui n'ait pas eu ses médailles. De sorte qu'il y a des barbouilleurs pourvus de médailles, mais il n'y a pas de talent qui n'en soit pas pourvu. Alors ? Alors ? Et moi aussi j'ai des yeux. C'est une composition, mon tableau.
Mettez que je les aie habillés, ces gamins, en costume moyen âge et exécutés dans un atelier (ce qui est bien plus facile que dehors), avec un fond de tapisserie.
Mais me voilà avec un tableau historique qui serait fort apprécié en Russie.
Que croire ?
Voici encore une demande de reproduction, Baschet, le grand éditeur.
C'est la cinquième que je signe. Et puis ?
Mardi 27 mai 84.
C'est fini. Je n'ai rien.
Mais c'est affreusement vexant ; j'espérais jusqu'à ce matin. Et si vous saviez les choses auxquelles on a donné des médailles ! ! !
Pourquoi ça ne me décourage-t-il pas ? Je suis très sonnée. — Si mon tableau est bien, pourquoi n'est-il pas récompensé ?
Tripotages.. dira-t-on.
C'est égal, puisque c'est bien, comment se fait-il donc qu'on ne le récompense pas ? Je ne veux pas poser pour une loyale enfant, qui ignore qu'il existe des intrigues; pourtant il me semble qu'étant donnée une bonne chose...
Alors c'est donc que c'est mauvais ? Non plus.
J'ai des yeux même pour moi,... et puis les autres ! Et les quarante journaux !
Jeudi 29 mai 84.
Ayant eu la fièvre toute la nuit, je suis d'une irritation furieuse, enfin, un état d'énervement à devenir fou. Ce n'est pas tout à fait la médaille mais la nuit sans sommeil.
Je suis trop malheureuse, je veux croire en Dieu. N'est-ce pas naturel de chercher quelque puissance miraculeuse, lorsque tout est misère et malheur et qu'il n'y a pas de salut ! On essaie de croire à une force au dessus de tout, qu'on n'a qu'à invoquer... Cette opération ne présente ni fatigue, ni froissement, ni humiliation, ni ennui. On prie. Les médecins sont impuissants ; on demande un miracle, qui ne vient pas, mais pendant l'instant où on le demande on est consolée. C'est bien peu. Dieu ne peut être que juste et s'il est juste comment-se fait-il ?... Une seconde de réflexion et on n'y croit plus, hélas ! Pourquoi vivre ? A quoi bon traîner une telle misère ? La mort présente au moins cet avantage d'apprendre ce que c'est que cette fameuse autre vie. A moins qu'il n'y ait rien ; c'est ce qu'on sait, enfin, quand on meurt.
Vendredi 30 mai 84.
Je trouve que je suis bien bête de ne pas m'occuper sérieusement de la seule chose qui en vaille la peine. De la seule chose qui donne tous les bonheurs ; qui fasse oublier toutes les misères : l'amour, oui, l'amour, naturellement. Deux êtres qui s'aiment ont l'illusion de leur perfection absolue morale et physique, morale surtout. Un être qui vous aime est juste, bon, loyal, généreux et prêt à accomplit les actions héroïques avec simplicité.
Deux êtres qui s'aiment ont l'illusion d'un univers admirable et parfait, tel que l'ont rêvé des philosophes comme Aristote et moi ; et voilà, je crois, ce qui est la grande attraction de l'amour.
En parenté, en amitié, dans le monde, partout, on découvre le bout de l'oreille des saletés humaines : là, c'est un éclair de cupidité, là, de sottise ; là, d'envie, de bassesse, d'injustice, d'infamie ; enfin l'ami le meilleur a ses pensées cachées, et, comme dit Maupassant, l'homme est toujours seul, car il lui est impossible de pénétrer dans les pensées intimes du meilleur ami qui est en face de lui et le regarde et lui fait ses confidences sincères.
Eh bien ! l'amour accomplit le miracle du mélange des âmes... On s'illusionne, qu'importe ? Ce qu'on croit être existe ! C'est moi qui vous le dis. L'amour fait paraître le monde tel qu'il devrait être. — Si j'étais Dieu...
Eh bien ! Alors ?
Samedi 31 mai 84.
Villevieille vient me dire qu'on ne m'a pas donné la médaille parce que j'ai fait du tapage pour la mention l'année dernière et que j'ai traité tout haut le Jury d'idiot... C'est vrai que j'ai dit ça...
Ma peinture n'est peut-être pas très large et très franche, mais, si elle l'était, le Meeting serait un chef-d'œuvre. Faut-il des chefs-d'œuvre pour de petites troisièmes médailles ? La gravure de Baude a paru avec un article où on dit que le public est désappointé de me voir sans médaille... Ma peinture est sèche ? ! Mais on dit la même chose de Bastien.
Y a-t-il sur la terre des gens capables de dire que le portrait de M... est plus que mon tableau ?
M. Bastien-Lepage a eu huit voix pour sa Jeanne d'Arc. M. M... a eu une médaille. Et l'immense M... vient d'avoir vingt-huit voix, juste vingt de plus que moi ! II n'y a ni conscience, ni justice. — Enfin que faut-il croire ? Je suis absolument déroutée.
Je suis descendue quand H.... est arrivé, pour montrer à ce juif que je ne suis pas abattue.
Je me suis montrée si contente et si militante, parlant de photographes, graveurs, acheteurs, etc., que ce fils d'Israël se décide enfin à dire qu'il voudrait bien faire des affaires avec moi... Quoique je n'aie pas eu de médaille... Enfin !... — Je vous achèterai le Pastel (Armandine) et la tête de bébé qui rit. Deux ! C'est à Dina qu'il s'adresse pour qu'elle lui arrange cette affaire. — Mais nous le renvoyons à Emile Bastien qui traitera la question d'argent. Je suis très contente.
Dimanche 1er juin 84.
Avec tout ça je ne fais rien depuis un mois! Si, je lis Sully-Prudhomme depuis hier matin. J'en ai là deux volumes et je trouve que c'est très bien...
Je m'inquiète peu de vers, je ne m'en inquiète que lorsqu'ils sont mauvais et que cela gêne ; autrement il n'y a pour moi que l'idée exprimée. — Il leur plaît de rimer, qu'ils riment ! Mais que je ne m'en aperçoive pas. Donc les idées très subtiles de Sully-Prudhomme me plaisent infiniment. Et il y a chez lui un côté très élevé, presque abstrait, très fin, très quintessencié, qui s'accorde parfaitement avec ma façon de sentir.
Je viens de lire, tantôt couchée sur le divan, tantôt me promenant sur mon balcon, la préface du livre de Lucrèce et le livre lui-même. De natura rerum. Ceux qui savent ce que c'est, m'en sauront gré...
Il faut une grande tension d'esprit pour comprendre tout. Ce doit être une lecture difficile, même pour ceux qui ont l'habitude de manier ce sujet. J'ai tout compris, ça échappait par moments, mais j'y revenais et me forçais de ressaisir... Je devrais respecter beaucoup Sully-Prudhomme d'écrire des choses que je saisis avec tant de peine.
Le maniement de ces idées lui est familier comme à moi le maniement des couleurs...
Il devrait donc aussi avoir une sainte vénération pour moi, parce qu'avec quelques couleurs boueuses, comme a dit l'antipathique Th. Gautier, je fais des visages qui expriment des sentiments humains et des tableaux où on voit la nature, les arbres, l'air, les lointains. — Il doit se croire mille fois supérieur à un peintre, en fouillant inutilement dans le mécanisme de la pensée humaine. Qu'est-ce qu'il apprend à lui et aux autres ?
Comment l'esprit fonctionne ? En donnant à tous ces mouvements intellectuels, rapides, insaisissables, des noms... Moi, pauvre ignorante, je pense que cette subtile philosophie n'apprendra rien à personne ; c'est une recherche, un amusement délicat et difficile, mais pourquoi ? Est-ce en apprenant à donner des noms à toutes ces choses abstraites et merveilleuses que se formeront les génies qui écriront de beaux livres ? Ou les hommes extraordinaires qui penseront, à la tête de l'univers ?
Et puis l'homme, dit-il, ne peut connaître de l’objet que ce par quoi il est en communication avec lui, etc. La plupart de ceux qui me liront n'y entendront rien, pourtant, je citerai encore ceci : « notre science ne peut donc excéder la connaissance de nos catégories appliquée à nos perceptions ». Bon, évidemment nous ne pouvons comprendre plus que nous ne pouvons comprendre. C'est clair.
Si j'avais eu une éducation raisonnable, je serais très remarquable. J'ai tout appris moi-même, j'ai fait moi-même le plan de mes études à Nice avec les professeurs du' lycée qui n'en revenaient pas. Moitié par intuition, moitié par ce que je lisais. J'ai voulu savoir telle et telle chose. Puis j'ai lu le grec et le latin et les classiques français et anglais et les modernes et tout.
Mais c'est un chaos, bien que je tâche de régler tout ça par amour de l'harmonie en tout.
Qu'est-ce que ce nom, Sully-Prudhomme ? J'ai' acheté ses livres il y a six mois et, ayant essayé de les lire, je les ai rejetés comme des vers agréables ; aujourd'hui j'y découvre des choses dignes de me captiver et je lis tout d'un trait, poussée à cela par la visite de François Coppée. Mais Coppée n'en a pas parlé, ni personne ; alors quel rapport et pourquoi ?
Il est évident qu'avec de très grands efforts je pourrais analyser philosophiquement ce travail intellectuel. Mais pourquoi ? Cela changera-t-il ce que j'ai pensé ?
Jeudi 5 juin 84.
Prater est mort. Il a grandi avec moi, on me l'a acheté à Vienne en 1870 ; il avait trois semaines et se fourrait toujours derrière les malles, dans les papiers des achats que nous faisions.
Il a été mon chien dévoué et fidèle, pleurant quand j’étais sortie et attendant des heures assis à la fenêtre. Puis à Rome je me suis toquée d'un autre chien et Prater fut recueilli par maman, toujours très jaloux de moi avec son poil jaune de lion et ses yeux admirables. Quand je pense à mon manque de cœur !...
Le nouveau chien s'appellait Pincio et on me l'a volé à Paris. Au lieu de revenir à Prater qui ne se consolait pas, j'ai eu la stupidité d'avoir Coco Ier puis le Coco actuel. C’est lâche, c'est ignoble. Depuis quatre ans ces deux bêtes s'entre-dévoraient et on avait fini par enfermer Prater dans une chambre en haut où il vivait comme un prisonnier, pendant que Coco se promenait sur la table et sur la tête des gens. Il est mort de vieillesse. Depuis hier j'ai passé deux heures avec lui, il se traînait vers moi et posait sa tête sur mes genoux.
Ah ! je suis une jolie misérable avec mes sentiments tendres. Ah ! méprisable caractère, je pleure en écrivant et je pense que les traces de ces larmes vont me faire une réputation de bon cœur auprès de ceux qui me liront. Je voulais toujours réadopter la malheureuse bête, et ça s'est toujours borné à un morceau de sucre et à une caresse en passant.
Il fallait voir sa queue alors, cette pauvre queue coupée qui remuait, remuait, faisant comme un rond, tellement elle tournait vite.
Il n'est pas encore mort le malheureux ; je l'ai cru parce que je ne le voyais plus dans sa chambre, il s'était fourré dernière une malle ou un bain, comme à Vienne, et j'ai pensé qu'on l'avait emporté n'osant pas m'en parler... Mais ce sera pour ce soir ou demain...
T. Robert-Fleury m'a trouvée pleurant, je lui avais écrit pour lui demander quelque chose à propos des reproductions du tableau, et il est venu. Il paraît que j'ai manqué signer un petit papier avec lequel on aurait pu empêcher de reproduire mon tableau par d'autres et me faire un procès. Vous comprenez, je suis très fière de toutes ces demandes d'autorisation, et je serais fière même d'un procès.
Vendredi 6 juin 84.
Cette soirée à l’Ambassade me préoccupe beaucoup et j'ai peur que quelque chose en fasse rater l'effet. Je ne puis jamais croire à quoi que ce soit de bon... Ça se présente bien, mais il arrivera quelque chose, quelque empêchement. Il y a si longtemps que je crie pour tout cela.
Nous avons été au Salon. Moi, pour voir le tableau médaillé. Et comme nous rencontrons T. Robert-Fleury, je lui demande devant des deuxièmes médailles, ce qu'il me dirait si je lui apportais des tableaux faits comme cela.
— Et d'abord j'espère que vous vous garderez bien de faire de la peinture pareille, me répondit-il sérieusement.
— Et la deuxième médaille alors ?
—Eh bien! mais c'est un garçon qui expose depuis très longtemps, et alors... vous comprenez.
Quel amas de médiocrités ! Comme c'est attristant !
Les médailles ne sont même pas atroces, ce sont pour la plupart des choses platement médiocres ou mauvaises. Le reste... En somme cette année est très mauvaise.
Samedi 7 juin 84.
On se prépare à la solennité de ce soir en silence.
Voici ma robe. En mousseline de soie blanche ; le corsage formé de deux draperies croisées, est noué sur les épaules par les bouts de ces mêmes draperies. La manche est courte et formée également d'un bout de mousseline nouée. Une très large ceinture de satin blanc à bouts flottants derrière. La jupe est faite d'une draperie de gauche à droite qui tombe jusqu'aux pieds. Derrière, il y a deux lés de mousseline double froncés, l’un tombant droit jusqu'à terre, l'autre plus court. Rien dans les cheveux. Des souliers blancs unis. L'ensemble est ravissant. Il faut avec cela une coiffure à la Psyché. Je crois que la robe est excessivement gracieuse. La draperie du devant est un rêve. C'est si simple et si délicat que je devrais bien être jolie. Maman aura une robe de damas noir couverte de jais, une traîne très longue et des diamants.
Dimanche 8 juin 84.
J'étais aussi bien que je puis l'être et que je l'ai jamais été. La robe faisait un effet ravissant. — Et la figure refleurie comme à Nice ou à Rome.
Les gens qui me voient tous les jours en sont restés la bouche ouverte.
Nous sommes arrivées un peu tard, madame Fridericks n'était pas auprès de l'ambassadrice avec laquelle maman échange quelques mots. Je suis très tranquille et très à mon aise... Pas mal de connaissances, madame d'A…. que je rencontre chez les Gavini, et qui ne me saluait pas, me salue très gracieusement. Je prends le bras de Gavini qui fait bien avec ses cordons et ses plaques ; il me présente Menabrea, le ministre d'Italie, nous causons art. Puis M. de Lesseps me raconte une longue histoire de nourrices et d'enfants et d'actions de Suez. Nous restons avec lui assez longtemps. Chevreau me donnait le bras.
Pour ce qui est des autres, chargés d'affaires, attachés au secrétaire, je les abandonne pour les vieillards couverts de plaques.
Un peu plus tard, ayant dûment sacrifié à la gloriole, je cause avec tout ce qu'il y avait là de peintres ; ils se sont fait présenter, très curieux de moi. Mais j'étais si jolie et si bien mise qu'ils seront convaincus que je ne fais pas mes tableaux toute seule. Ce sont Cheremetieff; Lehmann, un homme âgé très sympathique, certain talent, et enfin Edelfeldt, du talent. — Beau garçon assez vulgaire, Finlandais russe. En somme, c'était très bien. Voyez-vous, le principal c'est d'être jolie. Tout est là.
Mardi 10 juin 84.
Mon Dieu que c'est donc intéressant la rue ! Les physionomies des gens, les particularités de chacun, les plongeons que l'on fait dans les âmes inconnues.
Faire vivre tout ça ou plutôt saisir la vie de chacun ! On fait un combat de gladiateurs romains qu'on n’a jamais vus, avec des modèles parisiens. — Pourquoi ne pas faire des lutteurs de Paris avec la plèbe de Paris ? Dans cinq ou six siècles ce sera antique et les imbéciles d'alors le vénéreront.
Samedi 14 juin 84.
Beaucoup de monde au jour de maman. Je suis d'une élégance ! Robe Louis XVI très pur en taffetas gris avec un gilet de mousseline de soie blanche.
J'ai été à Sèvres, mais vite revenue, j'avais emmené un modèle bien. Eh ! un modèle n'est pas une vraie fille de la campagne et je reprendrai encore notre laveuse de vaisselle. Cette Armandine ne peut pas faire l'affaire ; ça se sent si bien qu'elle a dansé à l'Eden-Théâtre.
Enfin, moi qui prétends peindre le moral des gens, j'en aurais fait une petite coureuse habillée en paysanne. Il me faut une vraie grande bête de fille qui rêve accablée de chaleur et dont aura raison le premier paysan venu. Donc cette Armandine est d'une bêtise idéale, je la fais causer.
Quand la stupidité n'irrite pas, elle amuse ; on écoute ça avec une bienveillante curiosité et puis j'entrevois des mœurs !... et je complète ces aperçus avec mon intuition que je qualifierai de remarquable, si vous le permettez.
Lundi 16 juin 84.
Ce soir nous allons voir Macbeth (traduction Richepin) avec Sarah Bernhardt. Les Gavini sont avec nous.
Je vais si rarement au théâtre que cela m'amuse. Mais les déclamations des acteurs blessent mon sens artistique. Comme ce serait beau si ces gens parlaient naturellement. Oh ! la déclamation !
Marais (Macbeth) est bon par moment, mais il lui échappe des intonations si fausses et si théâtrales que ça fait pitié. Sarah, elle, est toujours admirable, bien que la voix d'or soit devenue une voix ordinaire.
Mardi 17 juin 84.
Ce que mon tableau m'embête ! ! et il y a encore les mains à faire ! — Ça ne m'intéresse plus ce pommier en fleurs et ces violettes ! Et cette paysanne assoupie ! Ce serait bien assez grand avec une toile d'un mètre. Et je fais grandeur nature ! C'est raté ! Et trois mois à l'eau !…
Mercredi 18 juin 84.
A Sèvres toujours. Ce qui est agaçant, c'est que j'ai la fièvre tous les jours. Pas moyen d'engraisser... Pourtant je prends six ou sept verres de lait de chèvre par jour.
Vendredi 20 juin 84.
L'architecte m'écrit d'Alger. Ma lettre à moi se terminait par nos trois têtes avec chacune une médaille au cou. Jules, la médaille d'honneur ; moi, une première médaille, et l'architecte une deuxième pour l'année prochaine. Je lui ai aussi envoyé la photographie du Meeting. Et il me dit qu’il a montré tout à son frère, lequel a été très heureux d'avoir une idée du tableau dont on lui a tant parlé et qu'il le trouve très bien, et qu'il s'est écrié :
Sont-ils bêtes de ne pas avoir donné de médaille à ce tableau que je trouve tout à fait bien ! Il aurait bien voulu pouvoir m'écrire, mais cela lui est impossible, il souffre toujours beaucoup, mais malgré ses souffrances, il est décidé à revenir d'aujourd'hui en huit. Il charge l'architecte de m'envoyer son amitié et de me remercier pour la broderie.
Il y a un an ça m'aurait transportée. Il voudrait pouvoir m'écrire ! Je n'en jouis que... rétrospectivement, car, à l'heure qu'il est, ça m'est à peu près indifférent.
Au bas de la lettre il y a ma tête avec la médaille d'honneur pour 1886.
Il aura été touché de la façon délicate dont je consolais son frère dans ma lettre ; la lettre commençait sérieusement, contenait des « paroles fortifiantes » et finissait en plaisanteries, ce qui est mon genre le plus habituel.
Mercredi 25 juin 84.
Relisez mes cahiers de 1875, 1876 et 1877. Je me plains là de je ne sais quoi ; ce sont des aspirations vers quelque chose d'indéfini. Je restais meurtrie et découragée tous les soirs, me dépensant à chercher quoi faire avec fureur et désespoir. Aller en Italie ? rester à Paris ? me marier ? Peindre ? que devenir ? En allant en Italie je ne serais pas à Paris, et c'était une soif d'être partout ! ! Ce qu'il y avait là de force ! ! !
Homme, j'aurais conquis l'Europe. Jeune fille, je me dissipais en excès de langage et en niaiseries excentriques. Misère !
Il y a des moments où on se croit naïvement apte à tout : « Si j'avais le temps je sculpterais, j'écrirais, je serais musicienne ! »
C'est un feu qui vous dévore. Et la mort est au bout, inévitable, — que je me consume en vains désirs ou non.
Mais si je ne suis rien, si je ne dois rien être, pourquoi ces rêves de gloire depuis que je pense ? Pourquoi ces aspirations folles vers les grandeurs que je me représentais d'abord comme des richesses, des titres ?
Pourquoi dès que j'ai pu avoir deux pensées l'une à la suite d'une autre, dès l'âge de quatre ans, le désir des choses glorieuses, grandes, confuses, mais immenses ? Tout ce que j'ai été dans ma tête d'enfant !... D'abord j'ai été danseuse, danseuse célèbre que Pétersbourg adore. Tous les soirs je me faisais mettre une robe décolletée, des fleurs sur la tête et je dansais dans le salon, très grave, pendant que toute la maison me regardait. Puis j'ai été la première chanteuse du monde. Je jouais de la harpe en chantant et on me portait en triomphe, je ne sais où ni qui. Puis j'électrisais les masses par ma parole. L'empereur de Russie m'épousait pour se maintenir sur son trône, je vivais en communion directe avec mon peuple, je lui adressais des discours expliquant ma politique, et souveraine et peuple s'attendrissaient aux larmes.
Et j'ai aimé. L'homme aimé m'a trahie et, s'il ne m'a pas trahie, il est mort d'un accident quelconque, d'une chute de cheval pour la plupart du temps, juste à l'instant où je sentais que je l'aimais moins. Alors j'en aimais un autre, mais tout ça s'arrangeait toujours très bien, très moralement, puisqu'ils mouraient ou me trahissaient. Je me consolais des morts, mais quand j'étais trahie, c'était un dégoût et un désespoir sans fin et ma mort.
Enfin en tout, dans toutes les branches, de tous les sentiments et de toutes les satisfactions humaines j'ai rêvé plus grand que nature ; si ça ne se réalise pas il vaut mieux mourir.
Pourquoi mon tableau n'a-t-il pas eu de médaille ?
La médaille !... C'est qu'ils ont dû penser (beaucoup d'entre eux) que je m'étais fait aider. Il est déjà arrivé qu'on a donné des médailles aux femmes qui s'étaient fait faire leur tableau et, une fois la médaille donnée, on est admis de droit l’année suivante, et on peut envoyer les plus plates horreurs.
Et moi, jeune, élégante et citée dans les journaux ! Tous ces gens sont les mêmes... Breslau par exemple ; elle a dit à mon modèle que j'aurais bien plus de talent si j'allais moins au bal. Tous ces gens-là s'imaginent que je vais tous les soirs dans le monde. Comme les apparences sont trompeuses ! Seulement supposer que le tableau n'est pas de moi ; c'est trop grave, on ne l'a pas dit, plût au ciel ! Tony Robert-Fleury m'a dit qu'il a été étonné du résultat, car chaque fois qu'il parlait de moi à ses collègues du jury, on lui répondait : c'est très bien, c'est une chose très intéressante.
— Que voulez-vous qu'on pense quand on dit ça ? demande Robert-Fleury.
Alors c'est ce doute...
Vendredi 27 juin 84.
Au moment où nous allons partir pour faire un tour au Bois, voilà l'architecte qui s'amène près de la voiture. Ils sont arrivés ce matin et il vient nous dire que Jules va un peu mieux, qu'il a bien fait sa traversée, mais que malheureusement il ne peut pas sortir. Il aurait eu tant de plaisir à me dire le succès que mon tableau a eu auprès de tous ceux à qui il a montré la photographie en Algérie.
— Alors nous irons le voir demain, dit maman.
— Vous ne pouvez pas lui faire un plus grand plaisir, il a dit que votre tableau... mais non il vous le dira lui-même; ce sera mieux.
Samedi 28 juin 84.
Nous allons donc rue Legendre. D'abord il se lève pour nous recevoir et fait quelques pas dans la chambre ; il m'a paru comme honteux de se montrer si changé.
Très changé, oh ! très changé, mais ce n'est pas de l'estomac qu'il est malade ; je ne suis pas un médecin, mais il n'a pas la tète à ça.
Enfin je le trouve si changé que je lui dis seulement :
— Eh bien! vous voilà revenu ? — Il n'est pas répugnant, et si gentil tout de suite, si amical, si bienveillant pour ma peinture, me répétant toujours de ne pas me soucier des médailles, le succès suffit.
Je le fais rire de sa maladie en lui disant qu'elle était nécessaire et lui fait du bien puisqu'il commençait à bedonner. — L'architecte semblait ravi de voir son malade si gai et si gentil. Et encouragée je deviens bavarde. Il me fait des compliments sur ma robe et jusque sur le manche de mon ombrelle. Il m'a fait asseoir à ses pieds sur la chaise longue... De pauvres jambes maigres !... les yeux grandis et très clairs, les cheveux ébouriffés.
Mais il est très intéressant et, puisqu'il le demande, j'irai encore le voir.
L'architecte, qui nous accompagne jusqu'en bas, me le demande aussi. « Cela fait tant de plaisir à Jules et il est si heureux de vous voir, il dit que vous avez beaucoup de talent, je vous jure ! »
J'insiste sur l'accueil qui m'est fait parce que j’en suis très contente.
Mais c'est un sentiment maternel, très calme, très tendre et dont je suis fière comme d'une force. Il en réchappera,... c'est sûr.
Lundi 30 juin 84.
Il a fallu me tenir à quatre pour ne pas crever ma toile à coups de couteau. Il n y a pas un coin fait comme je le voudrais.
Et encore une main à faire ! mais cette main faite, il y a tant à refaire ! ! ! Ah misère, damnation !
Et trois mois, trois mois.
Non ! ! !
Je me suis amusée à faire une corbeille de fraises comme on n'en voit pas. J'en ai cueilli moi-même, avec les tiges, de vraies grappes, il y en avait même de vertes par amour de la couleur.
Et des feuilles !... Enfin des fraises merveilleuses, cueillies par un artiste avec toute sorte de délicatesse et de coquetterie, comme lorsqu'on fait une chose inaccoutumée.
Et avec ça une branche entière de groseilles rouges.
J'ai traversé comme ça les rues de Sèvres et j'ai tenu le panier sur mes genoux en tramway, en ayant bien soin de le tenir un peu en l'air pour que le vent passe dessous et que ma chaleur ne fane pas les fraises dont pas une n'avait une tache ou une meurtrissure.
Rosalie riait : — Si quelqu'un de la maison vous voyait, mademoiselle !
Est-il possible !
— Mais c'est à cause de sa peinture qui le mérite, — pas de sa figure qui ne mérite rien. Mais sa peinture mérite tous les égards... — Alors c'est son tableau qui mangera les fraises ?
Mardi 1er juillet 84.
Encore l'odieux Sèvres !
Mais je rentre de bonne heure, cinq heures. — C'est à peu près fini.
Mais je suis d'une tristesse mortelle, je vais mal en tout.
Il faudrait quelque puissant dérivatif. Et moi qui ne crois pas en Dieu, je compte sur ce Dieu.
Après des journées de misère atroce, il m'est toujours arrivé quelque chose pour me reprendre à la vie.
Mon Dieu, pourquoi me permettez-vous de raisonner ? je voudrais tellement croire sans conditions.
J'y crois ou je n'y crois pas ; quand je raisonne je ne peux y croire. Mais dans des moments de misère ou de joie, tout au fond, la première pensée est pour ce Dieu qui est si dur pour moi.
Mercredi 2 juillet 84.
Nous avons été voir Jules Bastien, dans son atelier cette fois. Il me semble vraiment qu'il va mieux. Sa mère était là. Elle est bien mieux que son portrait, c'est une femme de soixante ans qui en paraît quarante-cinq ou cinquante. Les cheveux sont d'un assez joli blond et presque pas de cheveux blancs, un bon sourire, enfin une femme très sympathique et qui se tient bien avec sa robe noire et blanche ; elle fait de très jolies broderies avec des dessins qu’elle invente elle-même.
Bastien-Lepage a les deux dents du haut écartées comme moi.
Jeudi 3 juillet 84.
Ce matin à sept heures j'étais chez Potain. Il m'a examinée assez légèrement et m'envoie aux Eaux-Bonnes. Après on verra. Mais j'ai là la lettre qu'il écrit à son collègue des eaux, je l'ai décachetée.
Il y est dit qu'il y a une excavation au sommet droit, que je suis la malade la plus indisciplinée et la plus imprudente du monde.
Après, comme il n'était pas huit heures, je vais chez le petit Docteur de la rue de l'Echiquier. Ça m'a l’air d'un garçon sérieux, car il paraît désagréablement surpris de mon état et insiste très fort pour que j’aille chez un prince de la science : Bouchard ou Grancher, etc.
Comme je refuse, il dit qu'il ira avec moi, pourvu que j'y aille. Alors je consens.
Potain prétend que j'ai été bien plus malade et que ça s'est amélioré d'une façon inespérée, que maintenant c'est revenu, mais que ça s'arrangera.
Et il est si optimiste que je dois être bien bas.
Le petit B..., lui, n'est pas de cet avis ; il dit que j'ai été plus malade, mais que cette maladie était aiguë ; on a craint qu'elle ne me fît aller très vite ; ce n'est pas arrivé, voilà l'amélioration inespérée. Tandis que maintenant c'est une aggravation de maladie chronique... Bref, il veut absolument me mener chez ce Grancher.
J'irai.
Poitrinaire, va !
Ça et le reste.... et tout. Ce n'est pas drôle.
Et rien de bon pour me consoler un peu !
Vendredi 4 juillet 84.
Il est ici le tableau de Sèvres, à l'atelier. — On peut l'appeler l'Avril. — Ça m'est égal, mais cet Avril me paraît si mauvais ! ! !
Le fond est d'un vert intense et sale en même temps.
La femme n’est pas du tout ce que je voulais, du tout.
Je l'ai baclée comme ça, mais ce n'est pas le sentiment que je voulais, du tout. — Enfin, c'est plus de trois mois à l'eau !
Samedi 5 juillet 84.
J'ai une charmante robe de toile grise, le corsage fait comme une blouse d'atelier sans aucun ornement, sauf des dentelles au cou et aux manches. Un chapeau idéal avec un gros nœud de dentelles ancien et coquet. J'avais donc très envie d’aller rue Legendre, me trouvant très bien ; seulement c’est trop souvent, pourquoi ? Il faut y aller simplement en camarade, en admiratrice, en bon enfant, puisqu'il est très malade.
Nous y allons donc. La mère est enchantée, me tape sur l'épaule, parle de mes beaux cheveux... L'architecte est toujours abruti, il a l'air anéanti depuis son monument, et le grand peintre va mieux.
Il mange son bouillon et son œuf devant nous ; sa mère court, apporte tout ça pour que le domestique n'entre pas ; c'est elle qui le sert. Du reste il trouve ça très naturel et accepte nos services avec sang-froid, ne s'étonne de rien. En parlant de sa mine quelqu'un dit qu'il devrait se faire couper les cheveux, et maman raconte qu'elle coupait les cheveux à son fils quand il était enfant et à son père quand il était malade : Voulez-vous que je vous les coupe, je porte bonheur.
On rit, mais il y consent tout de suite, sa mère court chercher un peignoir et maman procède à l'opération, s'en tirant a son honneur.
Je voulais aussi donner un coup de ciseaux ; mais cet animal dit que je ferais des bêtises et je me venge en le comparant à Samson et Dalila ! Mon prochain tableau.
Il daigne rire.
Enhardi, son frère propose de tailler aussi la barbe et s'en acquitte religieusement, avec lenteur, les mains un peu tremblantes.
Ça lui change la physionomie et il n'a plus cet air malade et changé, la mère pousse de petits cris de joie : — Je l'entrevois enfin, mon garçon, mon cher petit garçon, mon cher enfant ! !
Quelle brave femme ! si simple, si bonne et pleine d'adoration pour son grand homme de fils.
Ce sont de braves gens.
Lundi 14 juillet 84.
J'ai commencé le traitement qui doit me guérir. Et j'en suis toute calme.
Jusqu'à ma peinture qui se présente mieux.
Un bon public sur le boulevard des Batignolles et même avenue Wagram !
Avez-vous regardé ça ? Avec la rue et les gens qu passent.
Tout ce que contient un banc, quel roman ! quel drame ! Le déclassé avec un bras appuyé au dossier et l'autre sur le genou ; le regard fuyant. — La femme et l'enfant sur les genoux ; la femme du peuple qui trime. — Le garçon épicier très gai qui s'est assis, lisant un petit journal. L'ouvrier endormi, le philosophe ou le désespéré qui fume. Aussi je vois peut-être trop de choses... Pourtant, regardez bien vers cinq, six heures du soir...
Ça y est, ça y est, ça y est !
Il me semble que j'ai trouvé.
Oui, oui, oui, je ne le ferai peut-être pas, mais l'esprit est en repos. J'en danse sur un pied.
Il y a des moments si différents !
Tantôt on ne voit vraiment rien dans la vie, et tantôt... Je me reprends à aimer tout ! tout ce qui m'entoure !
C'est comme un flot de vie qui entre !
Il n'y a pourtant pas de quoi se réjouir.
Ah ! tant pis, je trouverai un côté gai et adorable même dans mon trépas ; j'étais faite pour être très heureuse, mais...
Pourquoi, dans ton œuvre céleste,
Tant d'éléments si peu d'accord ?...
Mardi 15 juillet 84.
Je reviens à un projet ancien et qui me prend tout entière, chaque fois que je vois les bonnes gens des bancs publics. Ce pourrait être une étude grandiose. Il faut toujours mieux peindre des scènes où les personnages ne bougent pas. Entendons-nous, je ne suis pas contre le mouvement, mais dans des scènes violentes il ne peut y avoir d'illusion et de jouissance pour un public raffiné. On est péniblement (et sans s'en rendre compte même) impressionné par ce bras levé pour frapper et qui ne frappe pas, par ces jambes qui courent et qui restent à la même place. Il y a des situations très mouvementées et où pourtant on peut se figurer une immobilité de quelques instants, ce qui suffit.
Il vaut toujours mieux saisir l'instant qui suit un grand mouvement ou une violence quelconque, que celui qui le précède. La Jeanne d’Arc de Bastien-Lepage a entendu des voix, elle a marché précipitamment en avant, renversant son rouet et s'est arrêtée tout à coup adossée à un arbre. Mais voyez des scènes aux bras levés où les gens agissent, c'est peut-être très fort, mais il n'y a jamais jouissance complète.
La distribution des drapeaux par l'Empereur, qui est à Versailles.
Chacun se précipite, les bras sont levés et pourtant c'est très bien, car ces bras attendaient et on est saisi, remué, emporté soi-même par l'émotion de ces hommes, on partage leur impatience. L'élan et le mouvement sont prodigieux, justement parce qu’on peut se figurer un instant d'arrêt, pendant lequel on peut regarder en paix cette scène comme une chose véritable et non un tableau.
Mais rien ne peut égaler la grandeur des sujets au repos, soit en sculpture, soit en peinture.
Un homme médiocre peut exécuter une toile tourmentée assez bien, mais il ne fera jamais rien d'un sujet au repos.
Voyez les toiles de Millet et comparez-les à toutes les violences imaginables.
Voyez le Moïse de Michel-Ange. Il est immobile, mais il est vivant. Son Penseur ne remue pas, ne parle pas mais c'est parce qu'il ne le veut pas ; c'est un homme vivant qui est absorbé pas ses pensées.
Le Pas-mèche de Bastien-Lepage vous regarde et vous écoute, mais il va parler, car il est vivant. Dans ses Foins, l'homme couché sur le dos, la figure couverte de son chapeau, dort ; mais il vit. La femme assis, rêve et ne bouge pas, mais on sent qu'elle est vivant.
Un sujet au repos peut seul donner des jouissance complètes, il laisse le temps de s'absorber en lui, de le pénétrer, de le voir vivre.
Les imbéciles et les ignorants pensent que c'est plus facile à faire. Ah ! Misère !
*
* *
Si je meurs jamais, ce sera d'indignation devant la bêtise humaine qui est infinie, comme dit Flaubert.
Il y a trente ans qu'on écrit des choses admirables, en Russie.
En lisant La Paix et la Guerre, du comte Tolstoï j'ai été frappée au point de m'écrier : — Mais c'est comme Zola !
Il est vrai, on consacre une étude dans la Revue des Deux-Mondes à notre Tolstoï aujourd'hui et mon cœur de Russe en bondit d'allégresse. Cette étude est de M. de Vogüé, qui a été secrétaire d'ambassade en Russie, qui en a étudié la littérature et les mœurs, et qui a publié déjà plusieurs articles remarquablement justes et profonds sur mon grand et admirable pays.
Et toi misérable ! Tu vis en France, tu aimes mieux être une étrangère que de rester chez toi !
Puisque tu aimes ta belle, ta grande, ta sublime Russie, vas-y et travaille pour elle.
Moi je travaille aussi à la gloire de mon pays... si jamais j'ai un grand talent comme Tolstoï !
Mais si je n'avais pas ma peinture, j'irais ! Parole d'honneur, j'irais ! Mais mon travail absorbe mes facultés et le reste devient un intermède, un amusement.
Lundi 21 juillet 84.
Je me suis promenée plus de quatre heures, cherchant le coin que je prendrai pour fond dans mon tableau. C'est la rue, c'est même le boulevard extérieur, mais il faut encore choisir.
Il est évident qu'un banc public sur le boulevard extérieur a bien autrement de caractère qu'un banc des Champs-Elysées où il ne s'assied que des concierges, des grooms, des nourrices et des gommeux.
Là plus d'étude, plus d'âme, plus de drame. Des mannequins, à moins de cas particuliers.
Mais quelle poésie que le déclassé au bord de ce banc. Là l'homme est vrai, là c'est du Shakespeare.
Et me voilà prise d'inquiétude folle devant ce trésor découvert, si ça allait m'échapper ! Si j’allais ne pouvoir le faire ou si le temps, si...
Ecoutez, si je n'ai pas de talent c'est que le ciel se moque de moi, car il m'inflige toutes les tortures des artistes de génie... Hélas !
Mercredi 23 juillet 84.
Et mon tableau qui est esquissé, les modèles trouvés. Je cours depuis cinq heures du matin à la Villette et aux Batignolles ; Rosalie aborde les gens que je lui désigne.
Allez, ce n'est pas facile ni commode.
Vendredi 1er août 84.
Quand je vous servirai des phrases attendries, ne vous y laissez pas trop prendre.
Des deux moi qui cherchent à vivre, l'un dit à l'autre :
— Mais, éprouve donc quelque chose, sapristi ! Et l'autre qui essaie de s'attendrir est toujours dominé par le premier, par le moi-spectateur qui est là en observation et absorbe l'autre.
Et ce sera toujours comme ça ?
Et l'amour ?
Eh bien, vous savez, il me semble que c'est impossible, quand on voit la nature humaine au microscope. Les autres sont bien heureux, ils ne voient que ce qu'il faut.
Voulez-vous savoir ? Eh bien, je ne suis ni peintre, ni sculpteur, ni musicien, ni femme, ni fille, ni amie. Tout chez moi se réduit à des sujets d'observation, de réflexions et d'analyses.
Un regard, une figure, un son, une joie, une douleur sont immédiatement pesés, examinés, vérifiés, classés, notés. Et quand j'ai dit ou écrit, je suis satisfaite.
Samedi 2 août 84.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Cinq jours. J'ai fini mon tableau. Nous avons commencé le même jour, avec Claire, et le même sujet, une toile de 1m,40 sur 1m, 15 ; comme vous voyez, c'est considérable. La Bièvre chantée par Hugo, une ferme au fond, au bord de l'eau une jeune fille assise et parlant à un gamin debout de l'autre côté de la rivière.
Et si ce que j'ai fait est très bien ? Ce n'est pas possible, il y a du reste comme sentiment dans les figures des choses trop banales, mais j'ai voulu aller vite. C'est que c'est si drôle ! — On se dit : Mais voilà un coin qui est joliment bien venu... puis, et celui-là ne vaut rien. — Puis encore : C'est que c'est très bien, un vrai joli tableau ! — Claire n'a pas fini son tableau, elle le finira d'après le mien.
Je voudrais chanter ce que j'admire par-dessus tout !
J'admire les gens qui osent faire des observations.
J'admire les gens qui voient que je travaille et qui me poussent le coude pour rire, sans aucune arrière-pensée méchante ou seulement malicieuse.
Moi, quand je vois coudre Angélique, j'éprouve une espèce de respect et du reste jamais l'idée ne me viendrait de m'amuser ainsi.
Comment oser ?... enfin, c'est incompréhensible.
Mais qu'il y a donc de choses, bon Dieu, qui me choquent !
Presque tous les vrais artistes, tous ceux qui travaillent sont comme moi.
J'admire aussi les gens qui mangent par bons gros morceaux des côtelettes de mouton composées de graisse et de sang.
J'admire les heureux qui avalent avec plaisir les framboises sans se soucier des petits vers presque inévitables que l'on y trouve toujours.
Moi je les retourne toutes, de sorte que la peine est plus grande que le plaisir.
J'admire encore ceux qui peuvent manger toutes sortes de choses hachées, farcies et dont la composition échappe.
J'admire..... ou plutôt j'envie les natures simples, saines et habituelles... enfin.
Jeudi 7 août 84. — Vendredi 8 août. — Samedi 9 août.
Ces dames ont été porter une petite glacière rue Legendre. Il avait envie d'en avoir une qu'on pourrait mettre près du lit.
Pourvu qu'il ne pense pas qu'on le comble pour carotter un tableau !
Mon tableau à moi est ébauché en couleur. Mais je ne suis pas vaillante.
Il faut que je me repose souvent en me couchant, et quand je me relève, chaque fois la tête me tourne et pendant quelques secondes je n'y vois plus. Enfin c'est à un tel point que j'ai quitté ma toile vers cinq heures pour aller au Bois dans les allées désertes.
Lundi 11 août 84.
Je suis sortie à cinq heures du matin pour faire une esquisse, mais il y avait déjà du monde et je suis obligée de m'en aller furieuse. Ils étaient vingt autour du fiacre, fermé pourtant.
L'après-midi, je parcours de nouveau les rues, rien ne tient plus !
Je vais au Bois.
Mardi 12 août 84.
En somme, mes amis, tout ça signifie que je suis malade. Je me traîne et je lutte ; mais ce matin, j'ai bien cru être sur le point de capituler, c'est-à-dire me coucher et ne plus rien faire. Alors tout de suite, il est revenu un peu de force et j'ai encore été chercher des choses pour mon tableau. Ma faiblesse et ma préoccupation m'éloignent du monde réel ; jamais je ne l'ai compris avec une telle lucidité, lucidité au delà de ce que je puis donner d'ordinaire.
Tout cela apparaît en détail et avec une clarté attristante.
Moi, étrangère, ignorante et trop jeune en somme, j'épluche les phrases mal tournées des plus grands écrivains et les inventions bêtes des plus célèbres poètes. Quant aux journaux, je ne peux en lire trois lignes sans me révolter. Non seulement parce que c'est un français de cuisinière, mais à cause des idées... il n'y a rien de vrai ! Tout est convenu ou payé !
Pas de bonne foi, pas de sincérité nulle part !
Et quand on voit des hommes honorables qui, pour obéir à l'esprit de parti, disent des mensonges ou des bêtises qu'ils ne peuvent penser !
C'est à vomir.
Nous sommes rentrées pour dîner en sortant de chez Bastien, toujours couché, mais le visage tranquille et les yeux clairs. Il a des yeux gris dont la beauté ravissante échappe naturellement au vulgaire.
Me comprenez-vous bien ? Des yeux qui ont vu Jeanne d'Arc. —- Nous en parlons.
Il se plaint de n'avoir pas été assez compris... Et je lui dis qu'il a été compris de tous ceux qui ne sont pas des brutes, et que Jeanne d'Arc est une œuvre dont on pense des choses qu'il est impossible de lui dire en face.
Samedi 16 août 84.
Voilà le premier jour que j'ai travaillé pour de vrai en fiacre, et je suis si courbaturée qu'en rentrant je me fais doucher le dos, etc.
Mais comme on se sent bien. L'architecte a installé ma toile ce matin. Son frère va mieux, il a été au Bois. On l'a descendu et monté dans un fauteuil. C’est Félix qui l'a raconté en venant prendre du lait, à quatre heures.
Depuis une semaine il prend du lait de chèvre, de notre chèvre ; jugez de la joie de ces dames. Mais ce n'est pas tout, il daigne être si familier qu'il en envoie chercher lorsqu'il en a envie. Ça c'est beau.
Enfin nous allons donc le perdre puisqu'il va mieux. Oui, le bon temps a l'air de toucher à sa fin. On ne pourra aller voir un homme qui sort.
Mais ne nous exagérons rien.
Il a été au Bois, mais porté dans un fauteuil, puis il s'est couché.
Ça ne veut pas dire qu'il sort.
Mardi 19 août 84.
Je suis tellement patraque que j'ai à peine la force de mettre une robe de toile sans corset pour sortir et aller chez Bastien. Sa mère nous reçoit par des reproches. Trois jours ! trois jours sans venir ! mais c'est horrible. Et, sitôt dans la chambre, c'est Emile qui s'écrie : — Comment, c'est donc fini ! Eh quoi, plus d'amitié ? — Eh bien, vous me lâchez donc ? dit-il alors lui-même. Ah ! ce n'est pas bien.
Ma coquetterie voudrait que je répète ici tout ce qu'il nous dit d'aimables reproches et d'assurances que jamais, jamais nous ne pouvons venir trop souvent.
Jeudi 21 août 84.
Je flâne tout le jour et ne travaille que de cinq à sept heures en voiture.
Je fais faire une photographie du coin que je peins, pour avoir les lignes du trottoir bien exactes.
L'opération a eu lieu ce matin à sept heures. Dès six heures l'architecte était là ; alors nous sommes partis, moi, Rosalie, l'architecte, Coco et le photographe.
Ce n'est pas que la présence du frère soit utile, mais c'est plus gai ; j'aime bien avoir un petit état-major autour de moi.
Vendredi 22 août 84.
C'est fini, il est condamné !
Baude, qui passe la soirée ici avec l'architecte, le dit à maman.
Baude est son grand ami ; il lui a écrit une longue lettre d'Algérie.
Celle que j'ai lue.
Alors, c'est fini.
Est-ce possible ?
Mais je ne me rends pas encore compte de l'effet que produit sur moi cette nouvelle abominable.
C'est un sentiment nouveau : voir un homme condamné à mort.
Mardi 26 août 84.
Toutes les choses confuses qui papillotaient et qui me remplissaient le cerveau sont maintenant groupées et arrêtées sur ce point noir.
C'est un cas qui se présente pour la première fois, c'est du nouveau, un homme... un homme, un grand artiste et... enfin, ce que vous savez...
Condamné à mort.
Mais c'est sérieux ça !
Et je vais penser d'avance, tous les jours, qu'il va mourir ? Mais c'est épouvantable !
Je suis déjà ramassée sur moi-même, la tête dans les épaules et j'attends le coup.
Ça n'a-t-il pas été ainsi toute ma vie ?
Quand le coup vient, je l'attends de pied ferme.
Puis je le raisonne, je me révolte et je m'attendris, quand tout est fini.
Je ne peux pas coller deux mots ensemble.
Mais ne croyez pas que je suis désolée, je suis seulement profondément absorbée et je me demande ce que ça va être.
Samedi 30 août 84.
Choses sérieuses. Je ne fais rien... Depuis que le tableau de Sèvres est fini, je n'ai rien fait. Rien, sauf deux misérables panneaux.
Je dors des heures entières en plein jour... J'ai bien fait ma petite étude en fiacre, mais cela fait rire.
Le tableau est installé, tout est là, il n'y a que moi qui manque.
Si je disais tout ! Les craintes affreuses...
Voici septembre, le mauvais temps n'est pas loin.
Le moindre refroidissement peut me flanquer au lit pour deux mois, puis la convalescence...
Et le tableau ! ! Ainsi j'aurais tout sacrifié et...
Ah ! voici le moment de croire en Dieu et de le prier...
Oui, c'est la peur de tomber malade ; au point où j'en suis, je puis en finir en six semaines avec une pleurésie quelconque.
C'est ainsi que je partirai, du reste.
Comme je travaillerai quand même au tableau... et qu'il fera froid... Et si ce n'est pas en travaillant, ce sera en me promenant ; ceux qui ne font pas de peinture et qui meurent tout de même... Enfin !
La voilà donc, la fin de toutes mes misères ! tant d'aspirations, tant de désirs, de projets, tant de... pour mourir à vingt-quatre ans, au seuil de tout !
Je l'avais prévu, Dieu ne pouvant, sans se montrer partial, me donner ce qui est nécessaire à ma vie, me fera mourir. — Il y a des années... tant d'années ! si peu ; — et rien !
Mercredi 2 septembre 84.
Je fais le dessin pour le Figaro, mais avec des interruptions d'une heure, des repos... une fièvre atroce. Je n'en peux plus. Je n'ai jamais été si malade ; mais comme je ne le dis pas, je sors et je travaille. A quoi bon dire ? Je suis malade, ça suffit. Est-ce que d'en bavarder peut faire du bien ? Mais sortir ?
C'est une maladie qui le permet dans le moment où on se sent mieux.
Jeudi 11 septembre 84.
J'ai commencé mardi une étude d'enfant nu, ça peut faire un sujet, si c'est bien.
L'architecte est venu hier, son frère se demande pourquoi nous lui manquons depuis si longtemps. Nous allons donc au Bois ce soir, mais tard, il faisait son petit tour habituel ; je me suis installée à sa place ; vous voyez d'ici la surprise de tous les trois de nous trouver là. Il me tend les deux mains et, au retour, il vient dans notre voiture tandis que ma tante revient avec sa mère. C'est, du reste, une bonne habitude.
Samedi 13 septembre 84.
Nous sommes des amis, il nous aime; il m'estime, il m'aime, je l'intéresse. Il a dit hier que j'ai bien tort de me tourmenter, que je devrais... m'estimer très heureuse... Pas une femme, dit-il, n'a eu le succès que j'ai eu et en si peu d'années de travail.
— Vous êtes connue enfin, on dit Mlle Bashkirtseff, tout le monde vous connaît. Enfin un succès véritable ! Mais voilà, on voudrait deux Salons par an ; arriver, arriver plus vite !
C'est naturel, du reste, on est ambitieux, j'ai passé par là... etc.
Et aujourd'hui, il a dit :
— On me voit en voiture avec vous, il est heureux que je sois malade, sans cela on m'accuserait d'avoir fait votre tableau.
— On l'a déjà dit, ajoute l'architecte.
— Pas dans la presse !
— Oh ! Non.
Mercredi 17 septembre 84.
Il se passe peu de jours sans que je sois tourmentée par le souvenir de mon père. J'aurais dû partir et le soigner jusqu'à la fin. Il n'a rien dit, parce qu'il était comme moi, mais il a dû sentir cruellement mon absence. Comment n'ai-je pas ?...
C'est depuis que Bastien-Lepage est ici et que nous allons si souvent chez lui avec mille prévenances, gâteries, tendresses...
N'est-ce pas vraiment très mal ?
Maman, c'est différent, séparée pendant plusieurs années, remise depuis cinq ans ; mais moi, la fille ?
Alors Dieu me punira. Mon Dieu, si on va au fond des choses..., on ne doit rien à ses parents s'ils ne vous ont pas prodigué des soins dès votre entrée dans le monde.
Mais ça n'empêche pas... et puis je n'ai pas le temps de développer cette question. — Bastien-Lepage me donne des remords. — La punition de Dieu. Mais si je ne crois pas en Dieu ? Je n'en sais rien et quand même... J'ai ma conscience et ma conscience me reproche ce que j'ai fait.
Et puis on ne peut pas dire : Je ne crois pas en Dieu. Ça dépend de ce qu'on entend par Dieu. Si le Dieu que nous aimons et que nous désirons existait, le monde serait autre.
Il n'y a pas de Dieu qui écoute ma prière du soir, et je prie tous les soirs en dépit de la raison.
Si le ciel est désert, nous n'offensons personne ;
Si quelqu'un nous entend, qu'il nous prenne en pitié
Et pourtant comment croire ?...
Bastien-Lepage va très mal, nous le trouvons au Bois, faisant des grimaces de douleur... Il y a tous les Charcot ; c'est pour amener un de ces jours le docteur lui-même comme par hasard. Ils s'en vont et Bastien nous dit que c'est abominable de l'abandonner ainsi depuis deux jours.
Jeudi 18 septembre 84.
J'ai vu Julian ! Il me manquait. Mais il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus que nous n'avons pas grand'chose à nous dire. Il me trouve l'air arrivé, tranquille ; il n'y a que l'art, le reste ne mérite pas qu'on s'y arrête.
Il y a toute une famille auprès de Bastien-Lepage, la mère et les filles, elles restent-là jusqu'à la fin, mais ça a l'air de bonnes femmes très bavardes.
Ce monstre de Bastien-Lepage veut me soigner, il veut qu'en un mois je sois guérie de ma toux ; il me boutonne ma jacquette et s'inquiète toujours si je suis bien couverte.
Une fois qu'on a eu couché Bastien-Lepage, tout le monde est venu s'asseoir autour du lit à gauche comme toujours ; moi, je suis allée me mettre à droite; alors il a tourné le dos aux autres, s'est bien installé et s'est mis à causer très doucement d'art.
Oui, certainement il a de l'amitié pour moi et même une amitié égoïste. Comme je lui disais qu'à partir de demain, j'allais travailler, il me répond :
— Oh ! pas encore ! Il ne faut pas me lâcher...
Vendredi 19 septembre 84.
Il va plus mal. Nous ne savions que faire : partir ou rester, devant cet homme criant de douleur, puis nous souriant..
S'en aller, c'est faire croire qu'il est très mal ; et rester comme à un spectacle pendant qu'il se tord de douleur !...
Je suis affreuse, j'en parle sans délicatesse, il me semble qu'on pourrait trouver des mots plus..., c'est-à-dire moins... Pauvre enfant !
Mercredi 1er octobre 84.
Tant de dégoût et tant de tristesse.
A quoi bon écrire ?
Ma tante est partie pour la Russie lundi ; elle arrivera à une heure du matin.
Bastien-Lepage va de mal en pis.
Et je ne peux pas travailler.
Mon tableau ne sera pas fait.
Voilà, voilà, voilà !
Il s'en va et il souffre beaucoup. Quand on est là, on se détache de la terre ; il plane déjà au-dessus de nous; il y a des jours où je me sens ainsi. On voit les gens, ils vous parlent, on répond, mais on n'est plus à la terre; — une indifférence tranquille, pas douloureuse, un peu comme un rêve à l'opium. Enfin, il meurt. Je n'y vais que par habitude ; c'est son ombre, moi aussi je suis ombre à demi ; à quoi bon ?
Il ne sent pas particulièrement ma présence, je suis inutile ; je n'ai pas le don ranimer ses yeux. Il est content de me voir. C'est tout.
Oui, il meurt, et cela m'est égal ; je ne me rends pas compte, c'est quelque chose qui s'en va.
Tout est fini, du reste.
Tout est fini.
On m'enterrera en 1885.
Jeudi 9 octobre 84.
Vous voyez. Je ne fais rien. J'ai la fièvre tout le temps. Mes médecins sont deux jolis imbéciles. J'ai appelé Potain et me suis remise entre ses pattes. Il m'a guérie une fois. Il est bon, attentionné, honnête. Enfin, il paraît que ma maigreur et le reste ne viennent pas de la poitrine ; c'est une chose accidentelle que j'ai attrapée et dont je ne parlais pas, espérant toujours que ça passerait tout seul et ne m'occupant que de mes poumons qui ne sont pas plus malades qu'avant.
Je n'ai pas besoin de vous embêter avec mes maladies. Ce qu'il y a, c'est que je ne peux rien faire ! ! !
Rien !
Hier, j'ai commencé à m'habiller pour aller au Bois et j'ai été deux fois prête d'y renoncer, sans force.
Mais j'y suis arrivée tout de même.
Mme Bastien-Lepage est à Damvillers depuis lundi pour les vendanges, et bien qu'il y ait des dames autour de lui, il est content de nous voir.
Dimanche 12 octobre 84.
Je n'ai pas pu sortir. Je suis tout à fait malade, quoique pas couchée.
Le médecin vient tous les deux jours, depuis la visite de Potain qui m'envoie son sous-Potain.
Oh ! mon Dieu, mon Dieu, et mon tableau, mon tableau, mon tableau !
Julian est venu me voir. On a donc dit que je suis malade.
Hélas ! comment le cacher ? Et comment aller chez Bastien-Lepage ?
Jeudi 16 octobre 84.
J'ai des fièvres terribles qui m'épuisent. Je passe toute la journée au salon, changeant de fauteuil et de canapé.
Dina me lit des romans. Potain est venu hier, il viendra encore demain. Cet homme n'a plus besoin d'argent, et s'il vient plusieurs fois c'est qu'il s'intéresse un peu à moi.
Je ne peux pas sortir du tout, mais ce pauvre Bastien-Lepage sort ; alors il se fait porter ici, s'installe dans un fauteuil, les jambes allongées sur des coussins ; moi, tout près dans un autre fauteuil et comme ça jusqu'à six heures.
Je suis habillée d'un fouillis de dentelle, de peluche, tout ça est blanc, mais de blancs divers ; l'œil de Bastien-Lepage s'en dilate de plaisir :
— Oh ! si je pouvais peindre ! Dit-il.
Et moi !
Fini, le tableau de cette année !
Samedi 18 octobre 84.
Bastien-Lepage vient presque chaque jour. Sa mère est de retour et ils sont venus tous les trois.
Potain est venu hier, je ne vais pas mieux.
Dimanche 19 octobre 84.
Tony et Julian à dîner.
Lundi 20 octobre 84.
Malgré un temps magnifique, Bastien-Lepage vient ici au lieu d'aller au Bois. Il ne peut presque plus marcher ; son frère le soutient sous chaque bras, il le porte presque.
Et une fois dans le fauteuil le pauvre enfant est exténué. Misère de nous ! Et que de concierges se portent bien ! Émile est un frère admirable. C'est lui qui descend et monte Jules sur ses épaules jusqu'à leur troisième étage. Moi, j'ai dans Dina un dévouement pareil. — Depuis deux jours mon lit est au salon ; mais comme il est très grand et divisé par des paravents, des poufs et le piano, on ne s'en aperçoit pas. Il m'est trop difficile de monter l'escalier.
(Le journal s'arrête là. — Marie Bashkirtseff est morte onze jours après, le 31 octobre 1884.)
(Jules Bastien-Lepage est mort le 10 décembre.)
FIN DU TOME SECOND.

"Marie rises a bit, releases a soft sigh, the sigh of tiny children when waking, and two thick tears roll down her cheek....then her head falls again into the pillow."
C'est ainsi que Bojidar décrivit les derniers instants de Marie.
(Marie se redressa un peu, elle poussa un léger soupir, le soupir du tout jeune enfant qui s'éveille, et deux grosses larmes coulèrent sur ses joues ..... puis sa tête retomba dans l'oreiller.)
Les obsèques eurent lieu dans l'église de la rue Daru (Paris) le 6 novembre.
 |

|
Le mausolée ci-dessus est au cimetière de Passy (11è division).
Cette chapelle, classée "Monument historique", fut réalisée par l'architecte Emile Bastien-Lepage. Les colonnes de marbre qui encadrent l'autel supportent les bustes de ses parents. Vous reconnaissez la toile inachevée Les Saintes Femmes au Tombeau. Une messe y fut célébrée le 31 octobre 1985.
La crypte renferme deux tombeaux, dans l'un se trouvent les corps de Marie et de sa tante Nadine, dans l'autre les cendres de sa mère († 1920) et celles de sa nièce Marie Pavlovna Bashkirtseff, fille de Paul ? (François Mitterand est venu s'y recueillir quelques semaines avant sa mort.)

