


ANNEXES
| Retour | Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun, Volume 2 | Table des matières |
Table des matières du Volume 2.
Retour au Volume 1. ; Vers le Volume 3.
SOUVENIRS
DE
MADAME LOUISE-ELISABETH
VIGEE-LEBRUN,
DE L'ACADEMIE ROYALE DE FRANCE
DE ROME ET D'ARCADIE, DE PARME ET DE BOLOGNE,
DE SAINT-PETERSBOURG, DE BERLIN, DE GENEVE
ET AVIGNON.
En écrivant mes Souvenirs, je me rappellerai
le temps passé, qui doublera pour ainsi
dire mon existence.
J.-J. Rousseau.
TOME SECOND
AVANT-PROPOS
DE L'AUTEUR
La mort de la bonne et aimable princesse Kourakin, que le choléra vint enlever à Pétersbourg en 1831, m'avait fait renoncer pendant longtemps à toute idée de continuer mes Souvenirs, pour lesquels cependant j'avais déjà rassemblé les matériaux nécessaires. Les instances de mes amis m'ayant fait consentir l'an dernier à reprendre ce travail, le lecteur ne sera pas surpris de voir mon second volume écrit dans une autre forme que le premier, puisque je n'ai point eu le bonheur d'achever le récit de ma vie pour celle qui me l'avait fait entreprendre.
CHAPITRE PREMIER.
Turin, Porporati, le Corrége. Parme, M. de Flavigni, les Églises, l'Infante de Parme. Modène. Bologne. Florence.
Après avoir traversé Chambéry, j'arrivai à Turin extrêmement fatiguée de corps et d'esprit, car une pluie battante m'avait empêchée, pendant toute la route, de
descendre pour marcher un peu, et je ne connais rien de plus ennuyeux que les voiturins qui cheminent constamment au pas. Enfin, mon conducteur me déposa dans une
très mauvaise auberge. Il était neuf heures du soir ; nous mourions de faim ; mais comme il ne se trouvait rien à manger dans la maison, ma fille, sa gouvernante
et moi, nous fûmes obligées de nous coucher sans souper.
Le lendemain de très bonne heure, je fis prévenir de mon arrivée le célèbre Porporati,
(nb) Celui dont on connaît de si belles gravures, entre autres une faite d'après le tableau de Santerre, qui représente la chaste Suzanne entre les deux vieillards. Le burin éminemment classique de Porporati, comme celui de M. Desnoyers, sera toujours apprécié par les vrais connaisseurs.
que j'avais beaucoup vu pendant son séjour à Paris. Il était alors professeur à Turin, et il vint aussitôt me faire une visite. Me trouvant si mal dans mon
auberge, il me pria avec instance de venir loger chez lui, ce que je n'osai d'abord accepter ; mais il insista sur cette offre avec une vivacité si franche, que
je n'hésitai plus, et faisant porter mes paquets, je le suivis aussitôt avec mon enfant. Je fus reçue par sa fille, âgée de dix-huit ans, qui logeait avec lui, et
qui se joignit à son père pour avoir de moi tous les soins imaginables pendant les cinq ou six jours que je passai dans leur maison.
Étant pressée de continuer ma route vers Rome, je ne voulus voir personne à Turin. Je me contentai de visiter la ville et de faire quelques excursions dans les
beaux sites qui l'environnent. La ville est fort belle ; toutes les rues sont parfaitement alignées et les maisons bâties régulièrement. Elle est dominée par une
montagne appelée la Superga, lieu de sépulture, destinée aux rois de Sardaigne.
Porporati me conduisit d'abord au musée royal, où j'admirai une collection de superbes tableaux des diverses écoles, entre autres celui de la
femme hydropique de Gérard Dow,
(nb) Ce tableau a été acheté par la France ; il est resté depuis au musée du Louvre.
qu'on peut appeler un chef-d'oeuvre dans son genre, et plusieurs tableaux admirables de Vandick, parmi lesquels je dois citer celui qui représente une famille
de bourguemestres, dont les figures sont d'un pied et demi de hauteur. Il est certain que Vandick a pris plaisir à faire ce tableau si remarquable ; car, non
seulement les têtes et les mains, mais les draperies, les moindres accessoires, tout est fini et tout est parfait, tant pour le coloris que pour l'exécution.
Vandick, au reste, tenait la plus grande place dans ce musée du roi, où je trouvai peu de tableaux des maîtres d'Italie.
Porporati voulut aussi me mener au spectacle. Nous allâmes au grand théâtre, et là, j'aperçus aux premières loges le duc de Bourbon et le duc d'Enghien que je
n'avais point vus depuis bien longtemps. Le père alors paraissait encore si jeune, qu'on l'aurait cru le frère de son fils.
La musique me fit grand plaisir, et comme je demandais à Porporati si sa ville renfermait beaucoup d'amateurs des arts, il secoua la tête et me dit : «Ils n'en
ont aucune idée, et voici ce qui vient de m'arriver ici : un très grand personnage, ayant entendu dire que j'étais graveur, est venu dernièrement chez moi pour me
faire graver son cachet.»
Cette petite anecdote suffit, je l'avoue, pour me donner une mince opinion des habitants de Turin sous le rapport des arts.
Je quittai mes aimables hôtes pour aller à Parme. À peine étais-je arrivée dans cette dernière ville, que je reçus la visite du comte de Flavigny, qui y
séjournait alors comme ministre de Louis XVI. M. de Flavigny avait soixante ans au moins ; je ne l'avais jamais rencontré en France ; mais son extrême bonté et la
grâce qu'il mit à m'obliger en tout me le firent bientôt connaître et apprécier. Sa femme aussi combla de soins ma fille et moi, et leur société me fut de la plus
agréable ressource dans une ville où je ne connaissais personne.
M. de Flavigny me fit voir tout ce que Parme offrait de remarquable. Après avoir été contempler le magnifique tableau du Corrége, la Créche
ou la Nativité
(nb) Nous l'avons eu au Musée.
je visitai les églises, dont les ouvrages de ce grand peintre sont aussi le plus admirable ornement. Je ne pus voir tant de tableaux divins sans croire à
l'inspiration que l'artiste chrétien puise dans sa croyance : la fable a sans doute de charmantes fictions ; mais la poésie du christianisme me semble bien plus
belle.
Je montai tout au haut de l'église Saint-Jean ; là, je m'établis dans le cintre pour admirer de près une coupole où le Corrége a peint plusieurs anges dans une
gloire, entourés de nuages légers. Ces anges sont réellement célestes ; leurs physionomies, toutes variées, ont un charme impossible à décrire. Mais, ce qui m'a
le plus surpris, c'est que les figures sont d'un fini tel, qu'en les regardant de près, on croit voir un tableau de chevalet sans que cela nuise en rien à l'effet
de cette coupole, vue du bas de l'église.
On peut admirer aussi dans l'église de Saint-Antoine, en entrant à gauche, une autre figure de ce grand peintre, la plus gracieuse que je connaisse, et d'une
couleur inimitable.
J'ai remarqué dans la bibliothèque de Parme un buste antique d'Adrien, très bien conservé, quoiqu'il ait été doré. Un petit Hercule en bronze d'un travail fort
précieux, un petit Bacchus charmant, beaucoup de médaillons antiques, etc., etc. ; mais le Corrége !... le Corrége est la grande gloire de Parme.
M. le comte de Flavigny me présenta à l'infante (soeur de Marie-Antoinette), qui était beaucoup plus âgée que notre reine, dont elle n'avait ni la beauté ni la
grâce. Elle portait le grand deuil de son frère l'empereur Joseph II, et ses appartements étaient tout tendus de noir ; en sorte qu'elle m'apparut comme une
ombre, d'autant plus qu'elle était fort maigre et d'une extrême pâleur.
Cette princesse montait tous les jours à cheval. Sa façon de vivre comme ses manières étaient celles d'un homme. En tout, elle ne m'a point charmée, quoiqu'elle
m'ait reçue parfaitement bien.
Je ne séjournai que peu de jours à Parme ; la saison avançait, et j'avais les montagnes de Bologne à traverser. J'étais donc très pressée de me mettre en route ;
mais l'excellent M. de Flavigny me fit retarder mon départ de deux jours, parce qu'il attendait un ami auquel il désirait me confier, ne voulant pas que je
traversasse les montagnes seule avec ma fille et la gouvernante. Cet ami (M. le vicomte de Lespignière) arriva, et je fus remise à ses soins. Son voiturin suivait
le mien, en sorte que je voyageai avec la plus grande sécurité jusqu'à Rome.
Je m'arrêtai très peu à Modène, jolie petite ville, qui me parut fort agréable à habiter. Les rues sont bordées de longs portiques qui mettent les piétons à
l'abri de la pluie et du soleil. Le palais a un aspect grandiose et élégant. Il renferme plusieurs beaux tableaux, un de Raphaël et plusieurs de Jules Romain, la
Femme adultère du Titien, etc., etc. On y voit aussi quantité de curiosités remarquables et des dessins des plus grands maîtres italiens ; quelques statues
antiques, un grand nombre de belles médailles, ainsi que des camées en agate très précieux.
La bibliothèque est fort belle ; elle contient, m'a-t-on dit, trente mille volumes, beaucoup d'éditions très rares et des manuscrits.
Le théâtre rappelle les amphithéâtres des anciens. Les remparts sont la promenade habituelle ; mais les campagnes qui bordent les grands chemins sont charmantes,
riches et bien cultivées.
Après avoir traversé les montagnes qui ont bien quelque chose d'effrayant, car le chemin est très étroit et très escarpé, et bordé de précipices, ce qui m'engagea
à en faire une partie à pied, nous arrivâmes à Bologne. Mon désir était de passer au moins une semaine dans cette ville pour y admirer les chefs-d'oeuvre de son
école, regardée généralement comme une des premières de l'Italie, et pour visiter tant de magnifiques palais dont elle est ornée. Tandis que, dans cette
intention, je me pressais de défaire mes paquets, - Hélas ! madame, me dit l'aubergiste, vous prenez une peine inutile ; car, étant Française, vous ne pouvez
passer qu'une nuit ici.
Me voilà au désespoir, d'autant plus que dans le moment même, je vis entrer un grand homme noir, costumé tout-à-fait comme Bartholo, ce qui me le fit reconnaître
aussitôt pour un messager du gouvernement papal. Ses habits, son visage pâle et sérieux, lui donnaient un aspect qui me fit tout-à-fait peur. Il tenait à la main
un papier, que je pris naturellement pour l'ordre de quitter la ville dans les vingt-quatre heures. - Je sais ce que vous venez m'apprendre, signor, lui dis-je
d'un air assez chagrin. - Je viens vous apporter la permission de rester ici tant qu'il vous plaira, madame, répondit-il.
On juge de la joie que me donna une aussi bonne nouvelle, et de mon empressement à profiter de cette faveur.
(nb) Il faut croire que de Turin on instruisait le gouvernement papal du nom de tous les voyageurs français qui traversaient les États romains.
Je me rendis aussitôt à l'église de Sainte-Agnès, où se trouve placé le tableau du martyre de cette sainte, peint par le Dominicain. La jeunesse, la candeur
est si bien exprimée sur le beau visage de sainte Agnès, celui du bourreau qui la frappe d'un poignard forme un si cruel contraste avec cette nature toute divine,
que la vue de cette admirable tableau me saisit d'une pieuse admiration.
Je m'étais agenouillée devant le chef-d'oeuvre, et les sons de l'orgue me faisaient entendre l'ouverture d'Iphigénie parfaitement bien
exécutée. Le rapprochement involontaire que je fis entre la jeune victime des païens et la jeune victime chrétienne, le souvenir du temps si calme et si heureux
où j'avais entendu cette même musique, et la triste pensée des maux qui pesaient alors sur ma malheureuse patrie, tout oppressa mon coeur au point que je me mis à
pleurer amèrement et à prier Dieu pour la France. Heureusement j'étais seule dans l'église, et je pus y rester longtemps, livrée aux émotions si vives qui
s'étaient emparées de mon âme.
En sortant, j'allai visiter plusieurs des palais qui renferment les chefs-d'oeuvre des grands maîtres de l'école de Bologne, plus féconde qu'aucune autre école
italienne. Il faudrait des volumes pour décrire les beautés dont le Guide, le Guerchin, les Carraches, le Dominicain, ont orné ces pompeuses habitations. Dans
l'un de ces palais, le custode me suivait, s'obstinant à me nommer l'auteur de chaque tableau. Cela m'impatientait beaucoup, et je lui dis doucement qu'il prenait
une peine inutile ; que je connaissais tous ces maîtres. Il se contenta donc de continuer seulement à m'accompagner ; mais comme il m'entendait m'extasier devant
les plus beaux ouvrages en nommant le peintre, il me quitta pour aller dire à mon domestique : - Qui donc est cette dame ? j'ai conduit de bien grandes
princesses, mais je n'en ai jamais vue qui s'y connaisse aussi bien qu'elle.
Le palais Caprara renferme, dans sa première galerie, des trophées militaires indiens et turcs, dont plusieurs sont la dépouille de généraux vaincus par la
famille Caprara. Le portrait du plus célèbre guerrier de ce nom est au bout de la galerie, qui, je crois, est unique dans son genre.
On voit, dans la seconde galerie, une tête de prophète et la Sibylle de Cumes du Guerchin, dans son meilleur temps ; une Ascension du Dominicain, quelques têtes
de Carlo Dolce et du Titien ; une Sainte Famille du Carrache, et deux petits ronds de l'Albane, d'une grande finesse.
Le palais Bonfigliola possède un beau Saint Jérôme de l'Espagolet, une Sibylle du Guide, appuyée sur sa main, tenant son papyrus ; et plusieurs autres
chefs-d'oeuvre.
Le palais Zampieri : Henri IV et Gabrielle de Rubens ; dans la salle d'Annibal Carrache, la Déposition du Christ, effet de nuit, superbe tableau. Le portrait de
Louis Carrache, peint par lui-même. Un plafond du Guerchin représentant Hercule qui étouffe Antée, et le Départ d'Agar, beau tableau, plein d'expression. C'est
dans ce palais que l'on voit le chef-d'oeuvre du Guide, saint Pierre et saint Paul causant ensemble. Ce tableau réunit toutes les perfections ; les moindres
détails y sont d'une telle vérité, que ces deux figures font illusion au point qu'on croit les entendre parler. C'est bien certainement ce que le Guide a fait de
plus beau.
Trois jours après mon arrivée (le 3 novembre 1789), j'avais été reçue membre de l'Académie et de l'Institut de Bologne. M. Bequetti, qui en était le directeur,
vint m'apporter lui-même mes lettres de réception.
Je me consolais d'abandonner tant de chefs-d'oeuvre par l'idée de tous ceux que j'allais trouver à Florence. Après avoir traversé les Apennins et les montagnes
arides de Radico Fani, nous parcourûmes un pays plein de belles cultures, qui est la limite de la Toscane. À droite du chemin, on me
montra un petit volcan, qui s'enflamme à l'approche d'une lumière, et que l'on nomme Fuoco di Lagno. Plus loin, le chemin s'étant élevé,
je découvris Florence, située au fond d'une large vallée, ce qui d'abord me parut triste ; car j'aime beaucoup que l'on bâtisse sur les hauteurs ; mais sitôt que
j'entrai dans la ville, je fus surprise et charmée de sa beauté.
Après m'être installée dans l'hôtel qu'on m'avait indiqué, je débutai par aller, avec ma fille et le vicomte de Lespignière, me promener sur une montagne des
environs, d'où l'on découvre une vue magnifique, et sur laquelle se trouvent beaucoup de cyprès. Ma fille, en les regardant, me dit : «Ces arbres-là invitent au
silence.» Je fus si surprise qu'un enfant de sept ans pût avoir une idée de ce genre, que je n'ai jamais oublié cela.
Malgré le désir extrême que j'avais d'arriver à Rome, il m'était impossible de ne pas séjourner un peu dans cette charmante ville. J'allai voir avant tout la
célèbre galerie que les Médicis ont enrichie avec tant de magnificence. En entrant par le vestibule, on aperçoit d'abord une quantité de tombeaux antiques;
(nb) Les Médicis ont élevé à Gioto, Florentin de naissance, un monument sur lequel est placé le portrait de ce peintre
et contre la porte, se trouve placée la fameuse statue du Gladiateur. De ce vestibule, on entre dans la galerie qui renferme tant de superbes statues. La Vénus
de Médicis, les deux Lutteurs, le Remouleur, un jeune Faune, le Satyre et le Bacchus de Jean de Bologne, et la belle scène de la Niobé. Ces principales figures
ornent la salle de la tribune, qui est aussi décorée par plusieurs beaux tableaux, dont trois sont de Raphaël, un d'André del Sarte, et d'autres de divers grands
maîtres. Dans une seconde salle, on voit en sculpture : Euphrosine couchée, Alexandre mourant ; en peinture : une Vénus du Titien, un très beau Vanderveft, de
superbes paysages de Salvator Rosa, et cent autres chefs-d'oeuvre que je ne cite point ; car il faudrait un volume pour entrer dans quelques détails sur toutes
les richesses que j'eus le bonheur d'admirer dans ce lieu de délices pour un artiste.
J'allai le lendemain au palais Pitti, où, dans la première salle, je distinguai surtout la Charité, peinte par le Guide, le portrait d'un philosophe par
Rembrandt, un tableau à la fois très fin et très vigoureux de Carlo Dolce, une sainte famille de Louis Carrache, et la vision d'Ézéchiel, admirable petit tableau
de Raphaël. On y remarque aussi le portrait d'une femme habillée en satin cramoisi, peint par le Titien avec autant de vigueur que de vérité.
La seconde salle renferme quatre beaux tableaux du vieux Palme ; et de Rubens, un grand tableau allégorique, une Sainte Famille, ainsi que son tableau des
Philosophes, qui est superbe ; le portrait d'un cardinal, peint par Vandick, dont la belle couleur et la grande vérité sont remarquables. C'est aussi dans cette
salle que l'on voit la Madone à la Seggiola, Léon X et Jules II, par Raphaël, trois chefs-d'oeuvre, si dignes de leur haute renommée.
On trouve dans la troisième salle un grand et beau tableau d'André del Sarte représentant la Vierge, Jésus et saint Jérôme ; Paul III, du Titien, admirable de
vérité ; un tableau allégorique, deux paysages, et la fameuse fête de village, par Rubens ; enfin, une Sainte Famille assise sur des ruines, magnifique tableau de
Raphaël.
Dans le jardin du palais Pitti, au-dessus d'un bassin qui a vingt pieds de diamètre, on voit une statue colossale de Neptune, et trois Fleuves qui versent de
l'eau en abondance ; toutes ces figures, d'une très belle composition, sont de Jean de Bologne.
Dès que je pus m'arracher à la jouissance de parcourir la galerie des Médicis et le palais Pitti ; j'allai voir les autres beautés que renferme Florence. D'abord,
les portes du baptistère de Guilberti, dont les sujets, en dix compartiments, sont d'une composition admirable. Ces sujets sont pris
dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le relief des figures, le style des draperies, les accessoires, arbres, fabriques, tout est d'une exécution si parfaite,
qu'on pourrait en faire des tableaux, car il n'y manque que la couleur ; aussi Michel-Ange les nommait-il les portes du paradis.
À l'église de Saint-Laurent, je m'arrêtai longtemps dans la chapelle des Médicis, dont plusieurs tombeaux ont été exécutés d'après les dessins de Michel-Ange. On
ne peut rien voir de plus beau que ces tombeaux. Quelques-uns sont en granit oriental, d'autres en granit égyptien. Dans des niches en marbre noir on a placé des
statues en bronze doré. C'est dans l'église Santa-Croce que se trouve le mausolée de Michel-Ange. Là, il faut se prosterner.
Je suis montée au cloître de l'Annonciate, peint par André del Sarte. Ces diverses compositions sont d'un style simple, qui convient au sujet, et qui tient même
de l'antique. Les figures pleines d'expression et de vérité sont d'une excellente couleur. Il est bien malheureux que l'on n'ait pas soigné ces chefs-d'oeuvre,
qui auraient suffi à la réputation de ce grand peintre. La Vierge, nommée la Madona del Sacco, est divine. On la prendrait pour une
vierge de Raphaël.
On sent bien que je ne pouvais quitter Florence sans aller au palais Altoviti pour voir le beau portrait que Raphaël a fait de lui-même. Ce portrait a été mis
sous verre afin de le conserver, et cette précaution a fait noircir les ombres, mais tous les clairs de la chair sont restés purs et d'une belle couleur. Les
traits du visage sont régulièrement beaux, les yeux charmants, et le regard est bien celui d'un observateur.
Je ne négligeai pas de visiter la bibliothèque des Médicis, qui possède les manuscrits les plus rares. Il s'y trouve d'anciens missels dont les marges à gauche
sont peintes dans la perfection ; ces sujets saints sont rendus en miniature avec des couleurs et un fini admirables.
Le jour que j'allai visiter la galerie où se trouvent les portraits des peintres modernes peints par eux-mêmes, on me fit l'honneur de me demander le mien pour la
ville de Florence, et je promis de l'envoyer quand je serais arrivée à Rome. Je remarquai avec un certain orgueil dans cette galerie celui d'Angelica Kaufmann,
une des gloires de notre sexe.
Tout le temps de mon séjour à Florence fut un temps d'enchantement. J'avais fait connaissance avec une dame française, la marquise de Venturi, qui me comblait
d'amitiés et d'obligeances. Les soirs, elle me menait promener sur les bords de l'Arno, où arrivent, à une certaine heure, une quantité de voitures élégantes et
de beau monde, dont la présence animait ce lieu charmant. Ces promenades et mes courses du matin à la galerie Médicis, aux églises et aux palais de la ville, me
faisaient passer mes journées d'une manière ravissante ; et si j'avais pu ne point penser à cette pauvre France, j'aurais été alors la plus heureuse des
créatures.
CHAPITRE II.
Rome. Saint-Pierre. Le Muséum. Drouais. Raphaël. Le Vatican. Le Colysée. Angelica Kaufmann. Le cardinal de Bernis. Usage romain. Mes déménagements.
Peu de jours après mon arrivée à Rome, j'écrivais à Robert le paysagiste la lettre suivante :
Rome, 1er décembre 1789.
J'ai quitté avec peine, mon ami, cette belle ville de Florence où j'ai vu très rapidement des chefs-d'oeuvre si remarquables, et que je me promets bien de
revoir avec plus de soin à mon retour de Rome.
Vous avez été témoin des gros soupirs que me faisaient pousser les récits de tous ceux qui avaient eu le bonheur de séjourner ici. Vous savez combien je désirais
visiter à mon tour cette belle patrie des arts. Je puis dire que j'avais pour Rome la maladie du pays. Mais, tant de portraits que je me trouvais engagée à faire
ne m'auraient pas permis de réaliser mon désir, si, pour notre malheur à tous, la révolution n'était pas venue me déterminer à quitter Paris, dont le charme était
détruit pour moi.
Vous savez, mon cher ami, qu'à quelque distance de Rome on découvre déjà le dôme de Saint-Pierre ? Il m'est impossible de vous dire la joie que j'éprouvai lorsque
je l'aperçus : je croyais rêver ce que j'avais souhaité si longtemps en vain. Enfin je me trouvai sur le Ponte Mole ; je vous avouerai même tout bas qu'il m'a
paru bien petit, et le Tibre si chanté, bien sale. J'arrive à la porte del Popolo, je traverse la rue du Cours, puis je m'arrête à l'Académie de France. Notre
directeur, M. Ménageot, vient à ma voiture ; je lui demande l'hospitalité jusqu'à ce que j'aie trouvé un logement, et voilà qu'il me donne aussitôt un petit
appartement où ma fille et sa gouvernante sont logées près de moi. De plus, il me prête dix louis pour que je puisse achever de payer mon voiturin ; car il faut
dire que je n'ai emporté avec moi que quatre-vingts louis, mon cher mari gardant tout pour lui, comme vous savez qu'il avait coutume de faire.
Le jour même de mon arrivée, M. Ménageot m'a menée avant tout à Saint-Pierre, dont l'immensité, d'après l'idée que l'on m'en avait donnée, ne m'a point frappée
d'abord. J'attribue cet effet à la grandeur si bien calculée de tous ses détails : par exemple, à l'aspect de ces deux bénitiers de jaune antique, en forme de
coquilles, que l'on voit en entrant, les enfants de quatre ou cinq ans qui les entourent ont six pieds de hauteur, et cette parfaite proportion diminue au premier
coup d'oeil la grandeur de l'église ; quoi qu'il en soit, je n'ai su qu'en la parcourant à quel point elle était vaste. Ayant dit à M. Ménageot que j'aurais
préféré la voir soutenue par des colonnes au lieu de ces énormes pilastres, il me répondit qu'on l'avait bâtie d'abord comme je le désirais, mais que les colonnes
ne paraissant pas assez solides, on les avait entourées ainsi ; il m'a fait voir en effet depuis un tableau où Saint-Pierre est représentée comme je voudrais
qu'elle fût.
J'ai monté aussi l'escalier qui conduit à la chapelle Sixtine, pour admirer la voûte peinte à fresque par Michel-Ange, et le tableau représentant le jugement
dernier. Malgré toutes les critiques qu'on a faites de celui-ci, il m'a semblé un chef-d'oeuvre du premier ordre, pour l'expression et la hardiesse des
raccourcis. Il y a vraiment du sublime dans la composition, dans l'exécution. Quant au désordre qui y règne, il est, selon moi, complètement justifié par le
sujet.
Le lendemain, je suis allée voir le Muséum. Il est bien vrai qu'on ne peut rien comparer sous le rapport des formes, du style et de l'exécution, à tant de
chefs-d'oeuvre antiques. C'est aux Grecs surtout qu'il appartenait de réunir dans une aussi haute perfection l'élégance des formes à la vérité. En voyant leurs
ouvrages, on ne peut douter qu'ils n'aient eu de bien admirables modèles, et que les hommes et les femmes de la Grèce n'aient réalisé jadis ce que nous appelons
le beau idéal. Je n'ai fait encore que parcourir le muséum, mais l'Apollon, le Gladiateur mourant, le groupe du Laocoon, ces beaux autels, ces magnifiques
candélabres, toutes ces beautés enfin qui me sont apparues, m'ont déjà laissé des souvenirs ineffaçables.
Au moment où j'allais partir pour cette course au muséum, j'ai reçu la visite des pensionnaires de l'Académie de peinture, au nombre desquels était Girodet. Ils
m'ont apporté la palette du jeune Drouais, et m'ont demandé en échange quelques brosses dont je me sois servie pour peindre. Je ne puis vous cacher, mon ami, à
quel point j'ai été sensible à cet hommage si distingué, à cette demande si flatteuse ; j'en garderai toujours une douce et reconnaissante pensée.
Combien je regrette de ne pas retrouver ici ce jeune Drouais, que la mort vient de nous enlever cruellement ! Je l'avais connu à Paris, il avait même dîné chez
moi avec ses camarades la veille du jour où tous sont partis pour Rome. Vous n'avez pas oublié sans doute son beau Marius ? pour moi, je le vois encore. La foule
se portait chez la mère du pauvre Drouais pour voir ce tableau, qui était exposé chez elle. Hélas ! la mort ne respecte rien ; n'a-t-elle pas frappé Raphaël avant
qu'il eût trente-huit ans ? n'a-t-elle pas enlevé ce génie au monde, quand il était dans toute sa force, dans toute son énergie ? car je vous avoue que j'entre en
fureur lorsque je songe qu'on a osé dire, qu'on a osé écrire que Raphaël était mort par suite d'excès, en un mot, de libertinage. Quoi ! ce talent si pur, si
suave, aurait été chercher ses inspirations dans les mauvais lieux ! De bonne foi, cela peut-il se croire ? Mais la preuve que rien n'est plus faux, c'est que
nous savons tous que Raphaël était amoureux, éperdument amoureux de cette belle boulangère sans laquelle il ne pouvait vivre, à qui il restait fidèle au point de
refuser pour elle les honneurs, les richesses et la main de la nièce du cardinal Bibiéna ; tellement que, lorsque enfin le pape se laissa fléchir et permit que la
Fornarina rentrât dans Rome, l'émotion de joie qu'il éprouva, le bonheur de revoir cette femme adorée, contribuèrent beaucoup à terminer ses jours. Un homme aussi
passionné, aussi constant, pouvait-il rechercher les voluptés grossières, se rouler dans la fange ? Non, ces choses ne sont pas compatibles ; non, Raphaël n'était
pas un libertin ; il ne faut que regarder ses têtes de Vierges pour être sûr du contraire.
Pardonnez-moi cette diatribe, mon ami : je sors du Vatican ; c'est là surtout que le divin maître a démontré toute la subtilité de son art. Les copies que l'on a
faites des chefs-d'oeuvre de Raphaël sont loin d'en donner une juste idée ; il faut les voir face à face pour admirer le dessin, l'expression, la composition de
chaque sujet : jusques aux draperies, tout y est parfait. J'ai même remarqué que, dans la plus grande partie de ces belles pages, la couleur avait la vérité du
Titien.
La galerie, les salles, et même ce corridor du Vatican où j'ai vu dans le fond la belle Cléopâtre mourante, tout cela est unique dans le monde. Combien ne
s'étonne-t-on pas de la variété des compositions de Raphaël en voyant cette école d'Athènes, ordonnée avec tant de sagesse, puis l'incendie de Borgo, composé dans
un genre si différent ? Mais ce qui surprend le plus, c'est que celui qui est mort si jeune ait laissé tant de chefs-d'oeuvre. Cela prouve avec évidence que la
fécondité est un attribut inhérent au génie.
Il est bien malheureux de voir que tant de belles productions soient altérées, non-seulement par le temps, mais aussi parce qu'on permet que de jeunes artistes
aillent prendre le trait au calque. Je me rappelle à ce sujet qu'un ancien directeur de l'Académie disait à ses élèves : Qu'avez-vous besoin de prendre le trait
des figures de Raphaël ? prenez la nature, morbleu ! ce sera la même chose ; allez sur la place del Popolo.»
Je me suis rendue au Colysée en mémoire de vous. Le côté d'où l'on peut le croire entier suffit pour faire estimer parfaitement sa grandeur, et cette ruine est
encore une des plus belles choses qu'on puisse voir ; le ton de ses pierres, les effets que la végétation y a semés partout, en font un monument admirable pour la
peinture. Je ne puis concevoir comment il a pu vous venir l'idée si hasardeuse de grimper jusqu'au faîte pour l'unique plaisir d'y planter une croix ? La raison
se refuse à le croire. Je dois vous dire, au reste, que cette croix est restée, et que votre adresse et votre courage sont devenus historiques, car on en parle
encore à Rome.
J'ai été voir Angelica Kaufmann, que j'avais un extrême désir de connaître. Je l'ai trouvée bien intéressante, à part son talent, par son esprit et ses
connaissances. C'est une femme qui peut avoir cinquante ans, très délicate, sa santé s'étant altérée par suite du malheur qu'elle avait eu d'épouser d'abord un
aventurier qui l'avait ruinée. Elle s'est remariée depuis à un architecte qui est pour elle un homme d'affaires. Elle a causé avec moi beaucoup et très bien,
pendant les deux soirées que j'ai passées chez elle. Sa conversation est douce ; elle a prodigieusement d'instruction, mais aucun enthousiasme, ce qui, vu mon peu
de savoir, ne m'électrisait pas.
Angelica possède quelques tableaux des plus grands maîtres, et j'ai vu chez elle plusieurs de ses ouvrages : ses esquisses m'ont fait plus de plaisir que ses
tableaux, parce qu'elles sont d'une couleur titianesque.
J'ai été dîner hier avec elle chez notre ambassadeur, le cardinal de Bernis, à qui j'avais fait une visite trois jours après mon arrivée. Il nous a placées toutes
deux à table à côté de lui. Il avait invité plusieurs étrangers et une partie du corps diplomatique, en sorte que nous étions une trentaine à cette table, dont le
cardinal a fait les honneurs parfaitement, tout en ne mangeant lui-même que deux petits plats de légumes. Mais voilà le plaisant : ce matin on me réveille à sept
heures en m'annonçant la famille du cardinal de Bernis. Je suis bien saisie, comme vous imaginez ! Je me lève, toute essoufflée, et je fais entrer. Cette famille
était cinq grands laquais en livrée qui venaient me demander la buona mano. On m'expliqua que c'était pour boire. Je les congédiai en
leur donnant deux écus romains. Vous concevez toutefois mon étonnement, n'étant pas instruite de cet usage.
Voilà, mon ami, une énorme lettre ; mais j'avais besoin de causer avec vous. Rappelez-moi à ce qui reste à Paris de mes amis et de mes connaissances. Comment va
notre cher abbé Delille ? Parlez-lui de moi, ainsi qu'à la marquise de Grollier, à Brongniart, à ma bonne amie madame de Verdun. Hélas ! quand vous reverrai-je
tous ! Adieu.
Comme je ne pouvais rester dans le très petit appartement que j'occupais à l'Académie de France, il me fallut chercher un logement. Je regrettais fort peu
celui que je quittais, attendu qu'il donnait sur une petite rue dans laquelle les voitures des étrangers remisaient à toute heure de nuit. Les chevaux, les
cochers, faisaient un train infernal ; en outre, il se trouvait une madone au coin de cette rue, et les Calabrois, dont sans doute elle était la sainte, venaient
chanter et jouer de la musette devant sa niche jusqu'au jour. À vrai dire, il m'était assez difficile de trouver à me loger, attendu l'extrême besoin que j'ai de
sommeil et le calme environnant qui m'est absolument nécessaire pour dormir. J'allai d'abord occuper un logement sur la place d'Espagne, chez Denis, le peintre de
paysage ; mais, toutes les nuits, les voitures ne cessaient point d'aller et de venir sur cette place, où logeait l'ambassadeur d'Espagne. De plus, une foule de
gens des diverses classes du peuple s'y réunissait, quand j'étais au lit, pour chanter en choeur des morceaux que les jeunes filles et les jeunes garçons
improvisaient d'une manière charmante, il est vrai, car la nation italienne semble avoir été créée pour faire de bonne musique ; mais ce concert habituel, qui
m'aurait enchantée le jour, me désolait la nuit. Il m'était impossible de reposer avant cinq heures du matin. Je quittai donc la place d'Espagne.
J'allai louer près de là, dans une rue fort tranquille, une petite maison qui me convenait parfaitement, où j'avais une charmante chambre à coucher, toute tendue
en vert, avantage dont je me félicitai beaucoup. J'avais visité toute la maison depuis le haut jusqu'en bas ; j'avais même examiné les cours des maisons voisines
sans rien apercevoir qui pût m'inquiéter. Je pensai donc ne pouvoir entendre d'autre bruit que le bruit bien léger d'une petite fontaine placée dans la cour, et
dans mon enchantement, je m'empresse de payer le premier mois d'avance, dix ou douze louis, je crois. Bien joyeuse, je me couche dans une quiétude parfaite ; à
deux heures du matin, voilà que j'entends un bruit infernal précisément derrière ma tête ; ce bruit était si violent, que la gouvernante de ma fille, qui couchait
deux chambres plus loin que la mienne, en avait été réveillée. Dès que je suis levée, je fais venir mon hôtesse pour lui demander la cause de cet horrible
vacarme, et j'apprends que c'est le bruit d'une pompe attachée à la muraille près de mon lit : les blanchisseuses, ne pouvant blanchir le linge pendant le jour,
attendu l'extrême chaleur, ne venaient à cette pompe que la nuit. On imagine si je m'empressai de quitter cette charmante petite maison.
Après avoir beaucoup cherché inutilement pour m'établir à ma fantaisie, on m'indiqua un petit palais dans lequel je pouvais louer un appartement ; n'ayant encore
rien trouvé qui pût me convenir, je pris le parti de m'y installer. J'avais là bien plus d'espace qu'il n'en fallait pour me loger commodément ; mais toutes ces
pièces étaient d'une saleté dégoûtante. Enfin, après en avoir fait nettoyer quelques-unes, je vais m'y établir. Dès la première nuit je pus juger des agréments de
cette habitation. Un froid, une humidité effroyables, m'auraient permis de dormir, qu'une troupe de rats énormes, qui couraient dans ma chambre, qui rongeaient
les boiseries et mes couleurs, m'en auraient empêchée. Quand je demandai le lendemain au gardien comment il se faisait que ce petit palais fût si froid et que les
rats y eussent établi leur domicile, il me répondit que depuis neuf ans on n'avait pu trouver à le louer : ce que je n'eus point de peine à croire. Malgré tous
ces inconvénients, cependant, je me vis forcée d'y rester six semaines.
Enfin, je trouvai une maison qui paraissait être entièrement à ma convenance. Je ne la louai néanmoins que sous la condition de l'essayer pendant une nuit, et à
peine m'étais-je mise au lit, que j'entendis sur ma tête un bruit tout-à-fait insurmontable ; c'était une quantité innombrable de vers qui grugeaient les solives.
Dès que j'eus fait ouvrir les volets, le bruit cessa ; mais il n'en fallut pas moins abandonner cette maison à mon grand regret, car je ne crois pas qu'il soit
possible de déménager plus souvent que je ne l'ai fait pendant mes différents séjours dans la ville du Capitole : aussi suis-je restée convaincue que la chose la
plus difficile à faire dans Rome, c'est de s'y loger.
CHAPITRE III.
Portraits que je fais en arrivant à Rome. Les palais. Les églises. La Semaine-Sainte. Le jour de Pâques. La bénédiction du Pape. La Girande. Le Carnaval. Madame Benti. Crescentini. Marchesi. Sa dernière représentation à Rome.
Aussitôt après mon arrivée à Rome, je fis mon portrait pour la galerie de Florence. Je me peignis la palette à la main, devant une toile sur laquelle je trace
la reine avec du crayon blanc. Puis, je peignis miss Pitt, la fille de lord Camelfort. Elle avait seize ans, était fort jolie : aussi la représentai-je en Hébé,
sur des nuages, tenant à la main une coupe, dans laquelle un aigle venait boire. J'ai peint cet aigle d'après nature, et j'ai pensé être dévorée par lui. Il
appartenait au cardinal de Bernis. Le maudit animal, qui avait l'habitude d'être toujours en plein air, enchaîné dans la cour, était si furieux de se trouver dans
ma chambre, qu'il voulait fondre sur moi, et j'avoue qu'il me fit grand'peur.
Je fis dans le même temps le portrait d'une Polonaise, la comtesse Potoska. Elle vint chez moi avec son mari, et dès qu'il nous eut quittées, elle me dit d'un
grand sang-froid : - C'est mon troisième mari ; mais je crois que je vais reprendre le premier, qui me convient mieux, quoiqu'il soit ivrogne. J'ai peint cette
Polonaise d'une manière très pittoresque : elle est appuyée sur un rocher couvert de mousse, et près d'elle s'échappent des cascades.
Je peignis ensuite mademoiselle Roland, alors la maîtresse de lord Welesley, qui a peu tardé à l'épouser. Puis, je fis mon portrait pour ma réception à l'Académie
de Rome ; une copie de celui que je destinais à Florence, que vint me demander lord Bristol ; le portrait de lord Bristol lui-même jusqu'aux genoux, et celui de
madame Silva, jeune Portugaise que j'ai retrouvée depuis à Naples, et dont je parlerai plus tard. En tout, j'ai prodigieusement travaillé à Rome pendant les trois
ans que j'ai passés en Italie. Non seulement je trouvais une grande jouissance à m'occuper de peinture, entourée comme je l'étais de tant de chefs-d'oeuvre ; mais
il fallait aussi me refaire une fortune, car je ne possédais pas cent francs de rente. Heureusement je n'eus qu'à choisir, parmi les plus grands personnages, les
portraits qu'il me plaisait de faire.
La satisfaction d'habiter Rome pouvait seule me consoler un peu du chagrin d'avoir quitté mon pays, ma famille, et tant d'amis que je chérissais. L'intérêt
qu'inspirent les beaux lieux est si vif pour tout le monde et si profitable à un artiste, qu'il suffit pour répandre quelque douceur sur la vie. Combien de fois,
voulant me distraire de pensées trop pénibles, j'ai été au soleil couchant revoir ce Colysée, dont l'imagination ne saurait agrandir l'espace ! Il est impossible,
quand on est là, de songer à autre chose qu'à ces effets si beaux, si divers ! Les arcades, éclairées d'un ton jaune rougeâtre, se détachent sur ce ciel
d'outre-mer que l'on ne voit nulle part aussi foncé qu'en Italie. L'intérieur ruiné de ce grand théâtre, qui est maintenant rempli de verdure, d'arbustes en
fleur, et de lierre qui court çà et là, ne doit encore sa conservation actuelle qu'à une douzaine de petites chapelles portant une croix, placées symétriquement
au milieu de l'enceinte. C'est là que des confréries viennent faire des stations, et d'autres entendre prêcher un capucin. Ainsi, ce qui fut jadis l'arène des
gladiateurs et des bêtes féroces, est devenu un lieu consacré à notre culte. Quelles réflexions ne font point naître de semblables métamorphoses ! Mais dans Rome,
peut-on faire un pas sans rêver à l'instabilité des choses humaines ; soit que l'on foule aux pieds ces marbres, ces débris de colonnes, ces fragments de
bas-reliefs qui faisaient l'ornement des temples, des palais, et qui, malgré leur vétusté, conservent encore le style et le faire délicat des Grecs ; soit qu'on
entre dans les églises et qu'on y trouve ces baignoires de marbre précieux, qui peut-être ont servi à Périclès ou à Lays, transformées en tabernacles ? Le
maître-autel de Sainte-Marie-Majeure est une urne antique de porphyre ; les colonnes de la plupart des églises sont celles des anciens temples. Tout offre un
mélange de sacré et de profane ; et ces superbes restes d'un temps qui n'est plus ajoutent prodigieusement à la magnificence des cérémonies religieuses, qui
d'ailleurs ont conservé toute la pompe de l'ancienne Rome.
Mon travail ne me privait point du plaisir journalier de parcourir Rome et ses environs. J'allais toujours seule visiter les palais qui renfermaient des
collections de tableaux et de statues, afin de n'être point distraite de ma jouissance par des entretiens ou des questions souvent insipides. Tous ces palais sont
ouverts aux étrangers, qui doivent beaucoup de reconnaissance aux grands seigneurs romains d'une telle obligeance.
Je me suis décidée à ne donner ici qu'un très léger aperçu de ces magnifiques habitations et des beautés qu'elles renferment, d'abord parce qu'il existe une
multitude d'ouvrages qui les décrivent en détail, ensuite parce que tant d'années se sont écoulées depuis mon voyage à Rome, que beaucoup de chefs-d'oeuvre ont
changé de place. J'apprends sans cesse aujourd'hui, par des gens arrivant d'Italie, que telle statue ou tel tableau n'est plus où je l'avais vu, et je ne veux
point induire en erreur les amis des arts.
Le palais Justinien renfermait alors une immense quantité de chefs-d'oeuvre qui depuis ont tous été vendus. J'y admirai l'Ombre de Samuel, un des plus beaux
tableaux de Gérard de la Note ; c'est un effet de nuit du genre habituel de ce maître ; plusieurs statues antiques, entre autres la fameuse Minerve devant
laquelle on a longtemps brûlé l'encens, ce qu'on reconnaît en voyant le bas de cette statue très enfumé.
Le palais Farnèse, Doria, Barbarini, étaient pleins aussi d'objets d'art qu'on ne se lassait pas d'aller revoir. Dans le dernier, qui est situé sur le
Mont-Quirinal et dont la cour renfermait alors un obélisque égyptien, la voûte du grand salon est peinte par Pierre de Cortone ; dans d'autres salles, on trouvait
la Mort de Germanicus, du Poussin, une Magdeleine, et un Enfant endormi de Guide, et plusieurs beaux portraits de ce peintre. En sculpture, un magnifique buste
d'Adrien, le Faune qui dort, et beaucoup d'autres statues et bas-reliefs antiques.
Le palais Colona est cité comme le plus beau de Rome ; toutefois, il est loin d'offrir le même intérêt que le palais Borghèse. Celui-ci est si riche en tableaux
des grands maîtres et en statues, qu'il peut, ainsi que la villa du même nom, passer pour un musée royal. C'est là que j'ai vu les plus beaux tableaux de Claude
Lorrain.
Si l'on s'en croyait, on passerait sa vie à Rome dans les palais dont je parle et dans les églises. Les églises renferment des trésors en peinture, en mausolées
admirables. En ce genre, les richesses qui ornent Saint-Pierre sont assez connues ; pourtant je veux dire un mot du mausolée de Ganganelli par Canova, qui est une
bien belle chose. C'est à San Pietro in vincoli que se trouve celui de Jules II par Michel-Ange. À Saint-Laurent hors des murs, on voit
des tombeaux antiques : l'un d'eux représente un mariage, et l'autre une vendange.L'église de Saint-Jean-de-Latran, qui est ornée de colonnes, renferme aussi
plusieurs tombeaux du même genre, dont l'un est en porphyre et d'une immense dimension ; le cloître, qui joint la sacristie, est rempli d'inscriptions antiques
écrites en diverses langues. C'est à Saint-Jean-de-Latran que le peuple monte à genoux les vingt-huit degrés qui précèdent le portail.
La plus belle des églises sous le rapport d'architecture est celle de Saint-Paul hors des murs, dont l'intérieur, de chaque côté, est orné de colonnes. On ne peut
douter que Saint-Paul n'ait été un temple, et c'est dans ce style que j'aurais désiré Saint-Pierre.
À Saint-André-de-la-Valle, la coupole et les quatre évangélistes sont peints par le Dominiquin. C'est à la Trinité-du-Mont, que se trouve la célèbre Descente de
Croix de Daniel de Volterra. Ce tableau, aussi admirable par la composition que par l'expression, est un des chefs-d'oeuvre les plus remarquables de Rome. Je l'ai
vu bien dégradé ; mais on m'assure qu'aujourd'hui il est parfaitement restauré. Je ne sais s'il faut dire que l'on voit dans l'église de la Victoire de
Sainte-Marie, la fameuse Sainte-Thérèse du Bernin, dont l'expression scandaleuse ne peut se décrire ; mais c'est à San Pietro in Montorio qu'on pouvait admirer
alors la Transfiguration de Raphaël.
On ne peut avoir une idée de l'effet imposant et grandiose que produit la religion catholique, quand on n'a point vu Rome pendant le carême. La semaine sainte
commence au dimanche des Rameaux, et se passe en cérémonies religieuses dont la pompe est vraiment admirable.
Le mercredi, je me portai avec la foule à la chapelle de Monte-Cavalo où se chante le Stabat Mater de Pergolèze, musique qu'on peut appeler céleste.
Le jeudi j'assistai à la messe qui se dit à Saint-Pierre avec la plus grande magnificence. Les cardinaux, revêtus de riches chasubles et tenant un cierge à la
main, se rendent dans la chapelle Pauline, qui est éclairée par mille cierges. Un grand nombre de soldats, qui portent des cuirasses et des casques de fer,
suivent le cortège, et le coup d'oeil de cette procession est superbe.
Le matin du vendredi-saint, j'allai à la chapelle Sixtine, entendre le fameux Miserere d'Allégri, chanté par des soprani sans aucun
instrument. C'était vraiment la musique des anges. Le soir, je me rendis à Saint-Pierre, les cent lampes de l'autel étaient éteintes. L'église ne se trouve plus
éclairée que par une croix illuminée, prodigieusement brillante. Cette croix a pour le moins vingt pieds de hauteur, et vous parait être suspendue d'une manière
magique. Nous vîmes entrer le pape, qui s'agenouilla ; il était suivi de tous les cardinaux qui l'imitèrent ; mais ce qui, je l'avoue, me surprit et me scandalisa
même, ce fut de voir, pendant la prière du saint Père, une quantité d'étranger se promener dans l'église avec la même liberté que s'ils étaient dans le jardin du
Palais-Royal.
Le jour de Pâques, j'eus soin de me trouver sur la place de Saint-Pierre, pour voir le pape donner la bénédiction. Rien n'est plus solennel. Cette place immense
est couverte dès le grand matin par des groupes de paysans et d'habitants de la ville voisine, tous en costumes différents, de couleurs fortes est variées ; on y
voit un grand nombre de pèlerins. Et pas un de ces groupes ne se divise. Les galeries de chaque côté de l'église étaient remplies de Romains et d'étrangers, puis
en avant, se trouvaient placées les troupes du pape et les troupes suisses, enseignes et drapeaux déployés. Le plus religieux silence régnait partout. Ce peuple
était aussi immobile que le superbe obélisque de granit oriental qui orne la place ; on n'entendait que le bruit de l'eau tombant des deux belles fontaines, se
perdre doucement dans l'immensité de la place.
À dix heures le pape arriva, tout habillé de blanc, et la tiare sur la tête. Il se plaça dans la tribune du milieu en dehors de l'église, sur un magnifique trône
cramoisi très élevé. Tous les cardinaux, vêtus de leur beau costume, l'entouraient. Il faut dire que le pape Pie VI était superbe. Son visage coloré n'offrait
aucune trace des fatigues de l'âge. Ses mains étaient très blanches et potelées. Il s'agenouilla pour lire sa prière ; après quoi, se levant, il donna trois
bénédictions en prononçant ces mots : urbi et orbi(à la ville et au monde). Alors comme frappés par un coup d'électricité, le peuple,
les étrangers, les troupes, tout se prosterna, tandis que le canon retentissait de toute part ; ce qui ajoute encore à la majesté de cette scène, dont il est, je
crois, impossible de ne pas se sentir attendri.
La bénédiction donnée, les cardinaux jettent de la tribune une grande quantité de papiers, que l'on m'a dit porter des indulgences. C'est à ce moment seulement
que les groupes dont j'ai parlé se rompent, se confondent ; qu'un millier de bras s'élèvent pour saisir un de ces papiers. Le mouvement, l'ardeur de cette foule
qui s'élance et se presse, est au-dessus de toute description. Lorsque le pape se retire, la musique des régiments joue des fanfares, et les troupes défilent
ensuite au son des tambours.
Le soir, le dôme de Saint-Pierre est illuminé, d'abord en verres de couleur, puis subitement en lumières blanches du plus grand éclat. On ne peut concevoir
comment ce changement s'opère avec tant de rapidité ; mais c'est un spectacle aussi beau qu'extraordinaire. Le soir aussi on tire un très beau feu d'artifice
au-dessus du château Saint-Ange. Des milliers de bombes et de ballons enflammés sont lancés dans l'air ; la girandole qui termine est ce qu'on peut voir de plus
magnifique en ce genre, et le reflet de ce beau feu dans le Tibre en double l'effet.
À Rome, où tout est resté grandiose, on n'illumine point avec de misérables lampions. On place devant chaque palais d'énormes candélabres d'où sortent de grands
feux dont les flammes s'élèvent et rendent, pour ainsi dire, le jour à toute la ville. Ce luxe de lumière frappe d'autant plus un étranger, que les rues de Rome
habituellement ne sont éclairées que par les lampes qui brûlent devant les madones.
La foule des étrangers est attirée à Rome bien plus pour la semaine sainte, que pour le carnaval, qui ne m'a pas semblé fort remarquable. Les masques
s'établissent sur des gradins, déguisés en arlequin, en polichinelle, etc., ainsi que nous les voyons à Paris sur les boulevards, si ce n'est qu'à Rome ils ne
bougent point. Je n'ai vu qu'un seul jeune homme qui courait les rues, costumé à la française. Il contrefaisait à s'y méprendre un élégant très maniéré que nous
avons tous reconnu.
Les voitures, les chars vont et reviennent remplis de personnes costumées richement. Les chevaux sont parés de plumes, de rubans, de grelots, et la livrée porte
des habits de scaramouche ou d'arlequin ; mais tout cela se passe le plus tranquillement du monde. Enfin, vers le soir, quelques coups de canon annoncent les
courses de chevaux, qui animent le reste du jour.
Une de mes jouissances, dès que je fus arrivée à Rome, fut celle d'entendre de la musique, et certes, les occasions ne manquaient pas. La célèbre Banti s'y trouva
pendant mon séjour. Quoiqu'elle eût chanté plusieurs fois à Paris, je ne l'avais jamais entendue, et j'eus cette jouissance à un concert qui se donna dans une
galerie immense. Je ne sais pourquoi je m'étais figuré qu'elle avait une taille prodigieusement grande. Elle était au contraire très petite et fort laide, ayant
une telle quantité de cheveux, que son chignon ressemblait à une crinière de cheval. Mais quelle voix ! il n'en a jamais existé de pareille pour la force et
l'étendue ; la salle, toute grande qu'elle était, ne pouvait la contenir. Le style de son chant, je me le rappelle, était absolument le même que celui du fameux
Pachiarotti, dont madame Grassini a été l'élève.
Cette admirable cantatrice était conformée d'une manière très particulière : elle avait la poitrine élevée et construite tout-à-fait comme un soufflet ; c'est ce
qu'elle nous fit voir après le concert, lorsque quelques dames et moi furent passées avec elle dans un cabinet ; et je pensai que cette étrange organisation
pouvait expliquer la force et l'agilité de sa voix.
Très peu de temps après mon arrivée, j'allai avec Angelica Kaufmann voir l'opéra de César, dans lequel Crescentini débutait. Son chant
et sa voix à cette époque avaient la même perfection : il jouait un rôle de femme, et il était affublé d'un grand panier comme on en portait à la cour de
Versailles, ce qui nous fit beaucoup rire. Il faut ajouter qu'alors Crescentini avait toute la fraîcheur de la jeunesse et qu'il jouait avec une grande
expression. Enfin, pour tout dire, il succédait à Marchesi, dont toutes les Romaines étaient folles, au point qu'à la dernière représentation qu'il donna, elles
lui parlaient tout haut de leurs regrets ; plusieurs même pleuraient amèrement, ce qui, pour bien du monde, devint un second spectacle.
CHAPITRE IV.
La place Saint-Pierre. Les poignards. La princesse Joseph de Monaco. La duchesse de Fleury ; son mot à Bonaparte. Bontés de Louis XVI pour moi. L'abbé Maury. Usage qui m'empêche de faire le portrait du pape. Les Cascatelles et Tasculum. La villa Conti, la villa Adriana. Monte Mario. Genesano. Némi. Son lac. Aventure.
Il n'existe pas une ville au monde dans laquelle on puisse passer le temps aussi délicieusement qu'à Rome, y fût-on privé de toutes les ressources qu'offre la
société. La promenade seule dans ces murs est une jouissance ; car on ne se lasse point de revoir ce Colysée, ce Capitole, ce Panthéon, cette place Saint-Pierre
avec sa colonnade, sa superbe pyramide, ses belles fontaines que le soleil éclaire d'une manière si magnifique, que souvent l'arc-en-ciel se joue sur celle qui
est à droite en entrant. Cette place est d'un effet surprenant au coucher du soleil et au clair de lune ; que ce fût ou non mon chemin, je me plaisais alors à la
traverser.
Ce qui m'a beaucoup étonnée à Rome, c'est de trouver le dimanche matin au Colysée une quantité de femmes des plus basses classes extraordinairement parées,
couvertes de bijoux, et portant aux oreilles d'énormes girandoles en diamants faux. C'est aussi dans cette toilette qu'elles se rendent à l'église, suivies d'un
domestique, qui, très souvent, n'est autre que leur mari ou leur amant, dont l'état est presque toujours celui de valet de place. Ces femmes ne font rien dans
leur ménage ; leur paresse est telle, qu'elles vivent misérables et deviennent pour la plupart des femmes publiques. On les voit à leurs fenêtres dans les rues de
Rome, coiffées avec des fleurs, des plumes, fardées de rouge et de blanc ; le haut de leur corsage, que l'on aperçoit, annonce une fort grande parure ; en sorte
qu'un amateur novice, qui veut faire connaissance avec elles, est tout surpris, quand il entre dans leurs chambres, de les trouver seulement vêtues d'un jupon
sale. Les plaisantes Romaines dont je parle n'en jouent pas moins les grandes dames, et quand le temps de se rendre aux villa arrive,
elles ferment avec soin leurs volets, pour faire croire qu'elles sont aussi parties pour la campagne.
On m'a assuré que toutes les femmes à Rome avaient sur elles un poignard ; je ne crois cependant pas que les grandes dames en portent ; mais il est certain que la
femme de Denis le peintre en paysage, chez qui j'ai logé, et qui était Romaine, m'a fait voir celui qu'elle portait constamment. Quant aux hommes du peuple, ils
ne marchent jamais sans en être munis, ce qui amène souvent des accidents bien graves. Trois jours après mon arrivée, par exemple, j'entendis le soir, dans la
rue, des cris suivis d'un grand tumulte. J'envoyai savoir ce qui se passait, et l'on revint me dire qu'un homme venait d'en tuer un autre avec son poignard. Comme
ces manières d'agir m'effrayaient beaucoup pour les étrangers, on m'assura que les étrangers n'avaient rien à craindre, qu'il ne s'agissait jamais que de
vengeance entre compatriotes. Dans le cas dont il est question notamment, il y avait dix ans que l'assassin et l'homme assassiné s'étaient pris de querelle : le
premier venait de reconnaître son adversaire, et l'avait frappé de son poignard ; ce qui prouve combien de temps un Italien peut conserver sa rancune.
À coup sûr, les moeurs de la classe élevée sont plus douces, car la haute société est à peu près la même dans toute l'Europe. Toutefois, j'en serais assez mauvais
juge ; car à l'exception des rapports relatifs à mon art, et des invitations qui m'étaient adressées pour des réunions nombreuses, j'ai eu peu de moyens de
connaître les grandes dames romaines. Il m'est arrivé ce qui arrive naturellement à tout exilé, c'est de rechercher à Rome, pour société intime, celle de mes
compatriotes. Pendant les années 1789 et 1790, cette ville était pleine d'émigrés français que je connaissais pour la plupart, ou avec lesquels je fis bientôt
connaissance. Au nombre de ces voyageurs, qui plus tôt ou plus tard venaient de quitter la France, je citerai le duc et la duchesse de Fitz-James avec leur fils,
que nous voyons jouir aujourd'hui d'une si belle célébrité, la famille des Polignac ; je m'abstins néanmoins de fréquenter ceux-ci, dans la crainte d'exciter la
calomnie ; car on n'aurait pas manqué de dire que je complotais avec eux, et je crus devoir éviter cela en considération des parents et des amis que j'avais
laissés en France. Nous vîmes arriver aussi la princesse Joseph Monaco, la duchesse de Fleury, et une foule d'autres personnes marquantes.
La princesse Joseph avait une charmante figure, beaucoup de douceur et d'amabilité. Pour son malheur, hélas ! elle ne resta pas à Rome. Elle voulut retourner à
Paris afin d'y soigner le peu de fortune qui restait à ses enfants, et s'y trouva à l'époque de la terreur. Arrêtée, condamnée à mort, on lui conseilla vainement
de se dire grosse ; son mari n'étant plus en France, elle n'y consentit pas et fut conduite à l'échafaud.
Ce qui désespère, quand on pense à cette aimable femme, c'est que le 9 thermidor approchait et qu'il ne lui fallait que gagner fort peu de temps.
Celle que je distinguai bientôt parmi toutes les dames françaises qui se trouvaient à Rome, était la charmante duchesse de Fleury, très jeune alors ; la nature
semblait s'être plu à la combler de tous ses dons. Son visage était enchanteur, son regard brûlant, sa taille celle qu'on donne à Vénus, et son esprit supérieur.
Nous nous sentîmes entraînées à nous rechercher mutuellement ; elle aimait les arts, et se passionnait comme moi pour les beautés de la nature ; enfin je trouvai
en elle une compagne telle que je l'avais souvent désirée.
Nous allions habituellement ensemble passer nos soirées chez le prince Camille de Rohan, qui était alors ambassadeur de Malte et grand commandeur de l'ordre ;
tous les soirs il réunissait chez lui les étrangers les plus distingués ; la conversation était très animée et très intéressante ; chacun y parlait de ce qu'il
avait vu dans la journée, et le goût, l'esprit de la duchesse de Fleury brillait par-dessus tout.
Cette femme si séduisante me semblait dès lors exposée aux dangers qui menacent tous les êtres doués d'une imagination vive et d'une âme ardente ; elle était
tellement susceptible de se passionner qu'en songeant combien elle était jeune, combien elle était belle, je tremblais pour le repos de sa vie ; je la voyais
souvent écrire au duc de Lauzun, qui était bel homme, plein d'esprit et très aimable, mais d'une grande immoralité, et je craignais pour elle cette liaison,
quoique je puisse penser qu'elle était fort innocente. Le duc de Lauzun était resté en France ; j'ignore s'il a pris une part active à la révolution ; ce qui est
certain, c'est qu'il a été guillotiné.
Quant à la duchesse de Fleury, elle est revenue à Paris avant moi. Les passions y étaient encore débordées. Tout en arrivant, elle fit divorce avec son mari, puis
étant devenue très amoureuse de M. de Montrond, homme à bonne fortune, jeune encore, et très spirituel, elle l'épousa. Tous deux quittèrent le monde pour aller
jouir de leur bonheur dans la solitude, mais, hélas ! la solitude tua l'amour et ils ne revinrent à Paris que pour divorcer. La dernière passion qu'elle prit
s'alluma pour un frère de Garat, qui, m'a-t-on dit, la traitait cruellement ; enfin elle ne retrouva la paix et du bonheur qu'à la restauration qui lui ramena son
père, le comte de Coigny, dans les bras duquel elle alla se jeter pour le soigner jusqu'à sa mort ; avant la rentrée des Bourbons, étant allée voir un jour
l'empereur Bonaparte, celui-ci lui dit brusquement : - Aimez-vous toujours les hommes ? - Oui, sire, quand ils sont polis, répondit-elle.
L'arrivée à Rome de tant de personnes qui apportaient des nouvelles de la France me faisait éprouver chaque jour des émotions, souvent bien tristes, et
quelquefois bien douces : on me raconta, par exemple, que peu de temps après mon départ, comme on suppliait le roi de se faire peindre, il avait répondu : «Non,
j'attendrai le retour de madame Lebrun, pour qu'elle fasse mon portrait en pendant à celui de la reine. Je veux qu'elle me peigne en pied, donnant l'ordre à M. de
La Pérouse d'aller faire le tour du monde.»
Rien ne m'est plus doux que de me rappeler combien Louis XVI m'a toujours témoigné de bonté, au point que je me suis beaucoup reproché d'avoir oublié de dire,
dans mon premier volume, qu'à l'époque où je fis le grand portrait de la reine avec ses enfants, M. d'Angevilliers vint chez moi et me dit que le roi voulait me
donner le cordon de Saint-Michel, qui ne s'accordait alors qu'aux artistes et aux gens de lettres de premier ordre ; comme dans ce temps aussi les plus odieuses
calomnies s'attachaient à ma personne, je craignis qu'une aussi haute distinction ne portât à son comble l'envie que j'excitais déjà, et, toute pénétrée que
j'étais de reconnaissance, je n'en priai pas moins M. d'Angevilliers de faire ses efforts pour que le roi perdît l'idée de m'accorder cette faveur.
Je retrouvai à Rome un de mes meilleurs et de mes anciens amis, M. Dagincour, qui, lorsqu'il habitait Paris, me prêtait les beaux dessins qu'il possédait pour les
copier. M. Dagincour était un grand enthousiaste des arts et surtout de la peinture ; j'étais fort jeune quand il quitta la France ; il me dit en partant : «Je ne
vous reverrai que dans trois ans,» et il s'en était écoulé quatorze depuis lors, sans qu'il pût se décider à quitter Rome, ne pouvant plus imaginer que l'on pût
vivre autre part. Aussi a-t-il fini ses jours dans cette ville, regretté de tous ceux qui l'avaient connu.
C'est aussi, je crois, pendant mon premier séjour à Rome, que je revis l'abbé Maury, qui n'était pas encore cardinal ; il vint chez moi pour me dire que le pape
voulait que je fisse son portrait ; je le désirais infiniment ; mais il fallait que je fusse voilée pour peindre le Saint-Père et la crainte de ne pouvoir ainsi
rien faire dont je fusse contente, m'obligea à refuser cet honneur. J'en eus bien du regret, car Pie VI était encore un des plus beaux hommes qu'on pût voir.
J'étais arrivée à Rome, où il pleut si rarement, précisément à l'époque des pluies d'automne, qui sont de vrais déluges. Il me fallut attendre le beau temps pour
visiter les environs. M. Ménageot alors me mena à Tivoli avec ma fille et Denis le peintre ; ce fut une charmante partie. Nous allâmes d'abord voir les
cascatelles, dont je fus si enchantée que ces messieurs ne pouvaient m'en arracher. Je les crayonnai aussitôt avec du pastel, désirant colorer l'arc-en-ciel qui
ornait ces belles chutes d'eaux. La montagne qui s'élève à gauche, couverte d'oliviers, complète le charme du point de vue.
Quand nous eûmes enfin quitté les cascades, Ménageot nous fit monter par un mauvais petit sentier à pic jusqu'au temple de la Sibylle, où nous dînâmes de bon
appétit ; puis après, j'allai me coucher sur le soubassement des colonnes du temple pour y faire la sieste. De là, j'entendais le bruit des cascades, qui me
berçait délicieusement ; car celui-là n'a rien d'aigre comme tant d'autres que je déteste. Sans parler du terrible bruit du tonnerre, il y en a d'insupportables,
pour moi, dont je pourrais tracer la forme d'après l'impression que j'en reçois : je connais des bruits ronds, des bruits pointus ; de même, il en est qui m'ont
toujours été agréables : celui des vagues de la mer, par exemple, est moelleux et porte à une douce rêverie ; enfin je serais capable, je crois, d'écrire un
traité sur les bruits, tant j'y ai, toute ma vie, attaché d'importance. Mais je reviens à Tivoli. Nous couchâmes à l'auberge, et de
grand matin nous retournâmes aux cascatelles, où je finis mon esquisse. Ensuite nous allâmes voir la grotte de Neptune, du haut de laquelle tombe une énorme
quantité d'eau, qui, après avoir bouillonné en cascades sur de grosses pierres noires, va former une large nappe blanche et limpide. De là, nous entrâmes dans ce
qu'on appelle l'antre de Neptune, qui n'est autre chose qu'un amas de rochers couverts de mousse, sur lesquels tombent des cascades qui rendent cette caverne très
pittoresque. Près de là, nous trouvâmes une nouvelle cascade que l'on aperçoit sous l'arche d'un pont : je la dessinai aussi ; car tous les artistes ont dû sentir
comme moi qu'il est impossible de marcher autour de Rome sans éprouver le besoin de prendre ses crayons ; je n'ai jamais pu faire un petit voyage, pas même une
promenade, sans rapporter quelques croquis. Toute place m'était bonne pour me poser, tout papier me convenait pour faire mon dessin. Je me souviens, par exemple,
que, pendant mon séjour à Rome, je reçus une lettre de M. de la Borde, qui renfermait fermait une lettre de change de dix-huit mille francs sur son banquier à
Rome, en paiement de deux tableaux que je lui avais vendus avant de quitter la France.
(nb) Ces deux tableaux étaient le portrait de Robert, sa palette à la main, et le mien tenant ma fille dans mes bras.
N'ayant point alors besoin d'argent, je remis à me faire payer plus tard de cette somme (en quoi l'on va voir que j'eus fort grand tort) : me trouvant un soir
sur la terrasse de la Trinité-du-Mont, je suis frappée de la beauté du soleil couchant ; et comme je n'avais point d'autre papier sur moi que la lettre de M. de
la Borde, chargée d'écriture, je prends la lettre de change qu'elle contenait et je trace derrière ce coucher du soleil. Trois ans après, comme je songeais à
rentrer en France, ce que je ne fis pourtant pas alors, je touchai chez un banquier de Turin dix mille francs à compte, qui même ne m'en valurent que huit mille,
tant le change sur Paris était mauvais à cette époque. Par suite, quand je fus de retour en France, M. Alexandre de la Borde ne voulant ou ne pouvant pas
acquitter les huit mille francs qui restaient à payer, nous rompîmes le marché, il me rendit mes tableaux, et je lui remis la lettre de change avec mon coucher du
soleil derrière.
M. Ménageot, qui nous faisait les honneurs de Rome, nous conduisit à la villa Aldobrandini, dont le parc est très beau et les jets d'eau superbes. Du cazin, qui
est fort élevé, on découvre une vue magnifique : d'un côté on aperçoit les anciens aqueducs qui traversent la campagne de Rome ; de l'autre la mer et la belle
ligne des Apennins et plus bas, Tusculum. Nous allâmes visiter cette ville détruite, qui était située sur une montagne. C'est un triste
spectacle que l'amas de pierres formé par ces maisons, par ces murailles renversées sans forme, çà et là, sur terre. Il n'est resté debout que l'enceinte où
Ciceron tenait son école. Le coeur se serre à la vue de ces grands désastres, qui font naître de si tristes pensées.
En quittant Tusculum, nous allâmes à Monte-Cavi. Nous trouvâmes à droite de cette montagne une forêt qu'il faut gravir pour aller voir
les restes informes d'un temple de Jupiter. Ce temple a, dit-on, été bâti par Tarquin-le-Superbe.
Nous allâmes aussi visiter la villa Conti, où j'ai vu les plus beaux arbres de toutes les espèces ; puis, la villa Palavicina, dont le cazin est superbe et les
appartements très beaux. Nous trouvâmes à peu de distance une chapelle dans laquelle étant entrés, nous vîmes une sainte Victoire très bien habillée et couchée
sur une châsse. Comme un rideau la couvrait, le petit garçon qui nous conduisait, en le tirant, fit remuer la sainte ; je crus que ma fille en mourrait de
frayeur. Enfin nous terminâmes cette tournée par une course à la villa Bracciano que je trouvai très belle.
Le souvenir qui me reste de toutes ces superbes villas, néanmoins, est loin de m'intéresser autant que celui de cette grande ruine qu'on appelle la villa Adriana.
Malgré les énormes débris qui couvrent le terrain sur lequel était bâti ce vaste palais antique, on peut encore juger de sa beauté. Il avait trois milles de
longueur ; ses murs seuls attestent son ancienne magnificence, et l'on prend une idée des merveilles qu'on a pu en tirer, en voyant cette quantité de statues
antiques qui ornent aujourd'hui la villa d'Este, le Capitole et plusieurs palais de Rome. «Adrien, dit M. de Lalande dans son Voyage
d'Italie, avait imité dans son palais tout ce que l'antiquité avait eu de plus célèbre. On y trouvait un lycée, une académie, le portique, le temple de
Thessalie, la piscine d'Athènes, etc., etc. On y avait construit un double portique très long et très élevé, qui garantissait du soleil à toutes les heures du
jour. Vingt-cinq niches, pratiquées dans les murs de la bibliothèque, avaient sans doute contenu des statues.»
On reconnaît dans ces ruines fameuses l'excellente distribution des appartements, qui sont extrêmement vastes. Les décorations extérieures et intérieures feront
toujours l'admiration des architectes, autant par leur style que par leur exécution. Nous sommes bien loin, hélas ! de cette élégance et de ce grandiose.
J'avais peine à quitter ce lieu de splendeur et de destruction. Ah ! combien ce qui reste fait rêver ! Combien le temps fait nos plus grandes choses petites !
Depuis que le monde existe, les merveilles du ciel sont les seules qui n'aient point changé. Ayons donc de l'orgueil, quand chaque pas que l'on fait dans les
environs de Rome nous révèle l'instabilité des choses humaines ; car on peut dire que là on foule aux pieds les chefs-d'oeuvre. Je me rappelle qu'un jour, me
promenant fort près de la ville avec la duchesse de Fleury, nous entrâmes dans une villa dont le jardin était presque en friche et qui nous paraissait désert. En
entrant dans une allée où l'herbe poussait, nous aperçûmes de loin plusieurs débris de vases et de statues mutilées. Ayant poussé plus loin, nous trouvâmes
quelques ouvriers qui démolissaient une petite maison dans laquelle ils avaient déjà trouvé ces restes d'antiquités, qu'ils brisaient en les jetant çà et là sans
aucune précaution ; madame de Fleury et moi, furieuses contre le propriétaire qui n'avait pas songé à faire surveiller ses manoeuvres, nous étions décidées à
l'aller trouver pour arrêter ce massacre ; mais on nous dit que la personne à qui appartenait le jardin était en voyage, et il nous fut impossible de savoir à qui
nous pouvions nous adresser pour obtenir que l'on fit avec soin des fouilles aussi intéressantes.
Un lieu que j'avais pris en grande affection, c'était la hauteur du Monte-Mario, sur laquelle est située la villa Mellini. On m'a dit qu'en creusant le chemin qui
y conduit, on avait trouvé des coquilles d'huîtres et une roue semblable à celles que l'on fait aujourd'hui. On voit encore sur ces chemins d'énormes troncs
d'arbres coupés ; ces arbres ont été ceux de la forêt sacrée qui conduisait au temple antique, à la place même où se trouve maintenant le cazin, qui est
abandonné. Arrivée sur les côtes du mont, j'aperçus la belle ligne des Apennins ; cette vue est si magnifique, cet air est si bon, je me trouvais si bien là,
qu'après y être venue d'abord avec M. Ménageot, j'y retournai plusieurs fois toute seule ; et pour que je pusse y rester plus longtemps, mon domestique, qui me
suivait, portait mon dîner dans un panier. Ce dîner était un poulet ; mais comme il y avait une espèce de ferme sur le plateau, j'y faisais demander des oeufs
frais. Je ne puis dire la jouissance que j'éprouvais à contempler ces lignes des Apennins jusqu'à l'heure où le soleil couchant les colorait des tons de
l'arc-en ciel ! Cette voûte céleste d'un bleu d'azur, cet air si pur, cette complète solitude, tout m'élevait l'âme ; j'adressais au ciel une prière pour la
France, pour mes amis, et Dieu sait quel mépris j'éprouvais alors pour les petitesses du monde ; car, ainsi que l'a dit le poète Lebrun :
«L'ame prend la hauteur des cieux qui l'environnent.»
M. Ménageot m'avait recommandé de ne jamais aller seule dans les chemins escarpés et solitaires, en sorte que mon domestique me suivait toujours ; mais je
voulais que ce fût de loin, d'autant plus qu'il avait des souliers qui faisaient un bruit insupportable. Pour cette raison, je lui dis un jour : «Germain,
éloignez-vous, je vous prie, vous m'empêchez de penser.» En sorte que, si j'allais me promener, le pauvre homme, qui n'avait rien de mieux à faire, s'amusait à
guetter toutes les personnes qui voulaient s'approcher de moi, et les accostait pour leur dire : «N'allez pas près de madame, cela l'empêche de penser,» ce que
plusieurs gens de mes connaissances me répétaient le soir.
Lorsque les chaleurs devinrent insupportables à Rome, je fis plusieurs excursions aux environs, désirant trouver une maison dans laquelle je pusse me loger avec
la duchesse de Fleury. J'allai d'abord à la Riccia, j'y fis une charmante promenade dans les bois, qui sont superbes et fort pittoresques. On y trouve une
quantité de beaux arbres très anciens et une jolie fontaine. Après avoir couru quelque temps, nous louâmes à Genesano une maison qui était justement ce qu'il nous
fallait. Cette maison avait appartenu à Carle Maratte ; on voyait sur les murailles d'une grande salle, diverses compositions tracées par lui, ce qui me la
rendait précieuse. Nous allâmes l'habiter en commun, la duchesse et moi, et nous faisions très bon ménage.
Dès que nous fûmes établies, les courses dans les environs commencèrent. Nous avions loué trois ânes ; car ma fille voulait toujours être de nos parties : nous
allâmes d'abord au lac d'Albano ; il est très spacieux, et l'on parcourt avec délices les hauteurs qui l'avoisinent. Cette promenade s'appelle la Galerie
d'Albano. Nous lui préférâmes bientôt néanmoins les bords du charmant lac de Némi, à gauche duquel on voit un temple de Diane, dont le soubassement est recouvert
par les eaux. Ce lac a quatre milles de circuit, il est comme encaissé dans un fond qu'entoure une si riche végétation, que les sentiers sont bordés de mille
fleurs odorantes. Sur la hauteur se montre la ville de Némi, surmontée d'une tour et d'un aqueduc. Nous vîmes un jour une procession sortir des rues de la ville,
et parcourir le chemin qui tourne la montagne ; je n'ai pas de souvenir plus pittoresque que celui-là. Une autre fois, nous entrâmes dans un cimetière où des
têtes de morts étaient rangées avec ordre : madame de Fleury ne pouvait quitter ces têtes ; quant à moi, je ne les regardais pas volontiers.
Les arbres qui entourent le lac de Némi sont énormes ; il y en a de si vieux, que leur tronc, leurs branches, sont desséchés et blanchis par le temps. Nous fîmes
la partie de venir les contempler au clair de lune, et ma fille voulut nous accompagner. On ne peut rien voir de plus charmant que l'effet produit par ces arbres,
portant des ombres sur les eaux du lac. Nous restâmes longtemps en admiration ; mais plus loin, comme nous suivions un sentier, ces mêmes arbres, ayant été
agités par le vent, prirent tout-à-fait l'aspect de grands spectres qui nous menaçaient ; ma pauvre enfant se mourait de peur ; elle me disait toute tremblante :
«Ils sont vivants, maman, je t'assure qu'ils sont vivants.»
En certaines circonstances, il faut l'avouer, ma compagne et moi n'étions pas beaucoup plus braves que ma fille, témoin l'aventure suivante : étant allées un jour
nous promener toutes deux dans les bois de la Riccia, nous prîmes, pour gagner un grand vallon situé près de là, un chemin dans lequel on voit à droite et à
gauche plusieurs tombeaux anciens garnis de lierre. Ce chemin est fort isolé. Tout à coup nous apercevons venir derrière nous un homme qui nous sembla avoir tout
l'air d'un brigand. Nous pressons le pas, cet homme nous poursuit ; dans la terreur que nous éprouvons, voulant faire croire que nos domestiques ne sont pas
éloignés, la duchesse appelle Francisco, moi, Germain ; mais l'ennemi approchait toujours, et, trop sûres que ceux que nous appelions ne viendraient pas, nous
nous mîmes à gravir la montagne en courant de toutes nos forces, pour regagner le grand chemin qui se trouve sur la hauteur. Je n'ai jamais su si celui qui nous
forçait à nous essouffler de la sorte était un brigand ou le plus honnête homme du monde.
CHAPITRE V.
Je pars pour Naples. Le mari de Mme Denis, nièce de Voltaire. Le comte et la comtesse Scawronski. Le chevalier Hamilton. Lady Hamilton. Son histoire, ses attitudes. L'hôtel de Maroc. Chiaja. L'Hercule Farnèse.
J'étais à Rome depuis huit mois à peu près, lorsque, voyant tous les étrangers partir pour Naples, il me prit grande envie de m'y rendre aussi. Je fis part de
mon projet au cardinal de Bernis qui, tout en l'approuvant, me conseilla beaucoup de ne point aller seule. Il me parla d'un M. D***, mari de la nièce de Voltaire,
madame Denis, qui se proposait de faire ce voyage et qui serait charmé de m'accompagner. M. D***, en effet vint chez moi, me répéter tout ce que m'avait dit le
cardinal, en me promettant d'avoir le plus grand soin de ma fille et de moi. Il ajouta, pour me tenter davantage, qu'il avait sous sa voiture une espèce de
marmite propre à cuire une volaille, ce qui nous serait très utile, attendu la mauvaise chère que l'on faisait dans les meilleures auberges de Terracine.
Tout cela me convenait à merveille, je partis avec ce monsieur. Sa voiture était fort grande ; ma fille et sa gouvernante en occupaient le devant ; et de plus, il
y avait une banquette dans le milieu. Un énorme valet de chambre vint s'y placer devant moi, de manière que son gros dos me touchait et m'infectait. Il est rare
que je parle en voiture, et la conversation se bornait entre nous tous à l'échange de quelques mots. Mais comme nous traversions les marais Pontins, j'aperçus au
bord des canaux un berger assis, dont les moutons paissaient dans une prairie tout émaillée de fleurs, au-delà de laquelle on voyait la mer et le cap Circée. -
Ceci ferait un charmant tableau, dis-je à mon compagnon de voyage : ce berger, ces moutons, la prairie, la mer ! - Ces moutons sont tout crottés, me répondit-il ;
c'est en Angleterre qu'il faut en voir. Plus loin sur le chemin de Terracine, à l'endroit où l'on traverse une petite rivière en bateau, je vis à gauche la ligne
des Apennins entourée de nuages superbes que le soleil couchant éclairait ; je ne pus m'empêcher d'exprimer tout haut mon admiration : - Ces nuages ne nous
promettent que de la pluie pour demain, dit mon homme.
Arrivés à Terracine, nous descendîmes à l'auberge pour souper et coucher. Ma fille n'avait jamais vu la mer qu'en peinture, elle ne revenait pas de son étonnement
: «Sais-tu bien, maman, s'écriait-elle, que c'est plus grand que nature !»
Nous demandâmes à souper ; je comptais beaucoup sur la poularde de M. D*** ; mais vraisemblablement elle avait été oubliée, car nous fûmes réduits à nous
contenter de deux mauvais petits plats, et nous nous remîmes en route le lendemain matin fort mal restaurés. Les chemins qui mènent à Naples sont charmants ;
outre de très beaux arbres qu'on y trouve semés çà et là, ils sont bordés des deux côtés de rosiers sauvages et de myrtes odoriférants. J'étais enchantée, quoique
mon compagnon préférât, disait-il, les coteaux de Bourgogne qui promettent de bon vin ; mais je ne l'écoutais plus ; j'étais décidée à ne point me laisser
refroidir par ce glaçon.
Enfin nous arrivâmes à Naples le lendemain, vers trois ou quatre heures. Je ne puis exprimer l'impression que j'éprouvai en entrant dans la ville. Ce soleil si
brillant, l'étendue de cette mer, ces îles que l'on aperçoit dans le lointain, ce Vésuve d'où s'élevait une forte colonne de fumée, et jusqu'à cette population si
animée, si bruyante, qui diffère tellement de celle de Rome qu'on penserait qu'il existe entre elles mille lieues de distance ; tout me ravissait ; le plaisir de
me séparer de mon ennuyeux compagnon de voyage entrait peut-être bien pour quelque chose dans ma satisfaction. Je nommais ce monsieur mon
éteignoir ; c'est un titre dont souvent depuis j'ai gratifié quelques autres personnes.
J'avais retenu l'hôtel de Maroc, situé à Chiaja, sur les bords de la pleine mer. Je voyais en face de moi l'île de Caprée, et cette situation me charmait. À peine
y étais-je arrivée, que le comte Scawronski, ambassadeur de Russie à Naples, dont l'hôtel touchait le mien, envoya un de ses coureurs pour s'informer de mes
nouvelles et me fit apporter aussitôt le dîner le plus recherché. Je fus d'autant plus sensible à cette aimable attention, que je serais morte de faim avant qu'on
eût chez moi le temps de songer à la cuisine. Dès le soir même, j'allai le remercier, et je fis alors connaissance avec sa charmante femme ; tous deux
m'engagèrent beaucoup à n'avoir point d'autre table que la leur, et quoiqu'il me fût impossible d'accepter entièrement cette offre, j'en ai profité souvent
pendant mon séjour à Naples, tant leur société m'était agréable.
Le comte Scawronski avait des traits nobles et réguliers ; il était fort pâle. Cette pâleur tenait à l'extrême faiblesse de sa santé, qui ne l'empêchait pas
cependant d'être parfaitement aimable et de causer avec autant de grâce que d'esprit. La comtesse était douce et jolie comme un ange ; le fameux Potemkin, son
oncle, l'avait comblée de richesses dont elle ne faisait aucun usage. Son bonheur était de vivre étendue sur un canapé, enveloppée d'une grande pelisse noire et
sans corset. Sa belle-mère faisait venir de Paris pour elle des caisses remplies des plus charmantes parures que faisait alors mademoiselle Bertin, marchande de
modes de la reine Marie-Antoinette. Je ne crois pas que la comtesse en ait jamais ouvert une seule, et quand sa belle-mère lui témoignait le désir de la voir
porter les charmantes robes, les charmantes coiffures que ces caisses renfermaient, elle répondait nonchalamment : À quoi bon ? pour qui ? pour quoi ? Elle me fit
la même réponse quand elle me montra son écrin, un des plus riches qu'on puisse voir : il contenait des diamants énormes que lui avait donnés Potemkin, et que je
n'ai jamais vus sur elle. Je me souviens qu'elle m'a conté que pour s'endormir, elle avait une esclave sous son lit, qui lui racontait tous les soirs la même
histoire. Le jour, elle restait constamment oisive ; elle n'avait aucune instruction, et sa conversation était des plus nulles ; en dépit de tout cela, grâce à sa
ravissante figure et à une douceur angélique, elle avait un charme invincible. Le comte Scawronski en était fort amoureux, et quand il eut succombé à ses longues
souffrances, la comtesse, que je retrouvai à Pétersbourg, se remaria au bailli de Litta, qui était retourné à Milan pour se faire relever de ses voeux, et revint
ensuite en Russie épouser cette belle nonchalante. Elle n'a jamais eu que deux filles de son premier mari, dont l'une a épousé le prince Bagration.
Ce voisinage à Naples me fut très agréable, et je passais la plupart de mes soirées à l'ambassade russe. Le comte et sa femme faisaient souvent une partie de
cartes avec l'abbé Bertrand, qui était alors consul de France à Naples. Cet abbé était bossu dans toute l'étendue du terme, et je ne sais par quelle fatalité, dès
que je me trouvais assise à côté de lui près de la table de jeu, l'air des bossus me revenait toujours en tête. J'avais toutes les peines du monde à m'en
distraire. Enfin, un soir ma préoccupation devint telle, que je fredonnai tout haut ce malheureux air ; je m'arrêtai aussitôt, et l'abbé se retournant vers moi,
me dit du ton le plus aimable : «Continuez, continuez, cela ne me blesse nullement.» Je ne puis concevoir comment pareille chose m'était arrivée : c'est un de ces
mouvements inexplicables.
Le comte de Scawronski m'avait fait promettre de faire le portrait de sa femme avant celui de toute autre personne ; je m'y engageai, en sorte que, deux jours
après mon arrivée, je commençai ce portrait où l'ambassadrice est peinte presque en pied, tenant en main et regardant un médaillon sur lequel était le portrait de
son mari. J'avais donné la première séance, quand je vis arriver chez moi le chevalier Hamilton, ambassadeur d'Angleterre à Naples, qui me demandait en grâce que
mon premier portrait fût celui d'une superbe femme qu'il me présenta ; c'était madame Hart, sa maîtresse, qui ne tarda pas à devenir lady Hamilton, et que sa
beauté a rendue célèbre. D'après la promesse faite à mes voisins, je ne voulus commencer ce portrait que lorsque celui de la comtesse Scawronski serait avancé. Je
fis en même temps un nouveau portrait de lord Bristol que je retrouvai à Naples, où l'on peut dire qu'il passait sa vie sur le Vésuve, car il y montait tous les
jours.
Je peignis madame Hart couchée au bord de la mer, tenant une coupe à la main. Sa belle figure était fort animée et contrastait complètement avec celle de la
comtesse ; elle avait une quantité énorme de beaux cheveux châtains qui pouvaient la couvrir entièrement, et en bacchante, ses cheveux épars, elle était
admirable.
Le chevalier Hamilton faisait faire ce portrait pour lui ; mais il faut savoir qu'il revendait très souvent ses tableaux lorsqu'il y trouvait un bénéfice ; aussi,
M. de Talleyrand, le fils aîné de notre ambassadeur à Naples, entendant dire un jour que le chevalier Hamilton protégeait les arts, répondit-il : «Dites plutôt
que les arts le protègent.» Le fait est qu'après avoir marchandé fort longtemps pour le portrait de sa maîtresse, il obtint que je le ferais pour cent louis et
qu'il l'a vendu à Londres trois cents guinées. Plus tard, lorsque j'ai peint encore lady Hamilton en sibylle pour le duc de Brissac, j'imaginai de copier la tête
et d'en faire présent au chevalier Hamilton, qui la vendit tout de même sans hésiter.
La vie de lady Hamilton est un roman : elle se nommait Emma Lyon ; sa mère, dit-on, était une pauvre servante, et l'on n'est pas d'accord sur le lieu de sa
naissance ; à treize ans, elle entra comme bonne d'enfant chez un honnête bourgeois à Hawarder ; mais, ennuyée de l'obscurité dans laquelle elle vivait, et se
flattant qu'à Londres elle pourrait se placer plus convenablement, elle s'y rendit. Le prince de Galles m'a dit l'avoir vue à cette époque, avec des sabots à la
porte d'une fruitière, et quoiqu'elle fût très pauvrement vêtue, sa charmante figure la faisait remarquer.
Un détaillant du marché Saint-Jean la reçut à son service, mais elle sortit bientôt de chez lui pour entrer comme femme de chambre chez une dame de bonne famille
et très honnête. Dans cette maison elle prit le goût des romans, puis le goût des spectacles. Elle étudiait les gestes, les inflexions de voix des acteurs, et les
rendait avec une facilité prodigieuse. Ce talent, qui ne plaisait et ne convenait nullement à sa maîtresse, la fit renvoyer.
Ce fut alors qu'ayant entendu parler d'une taverne où se rassemblaient tous les artistes, elle imagina d'aller y chercher de l'emploi. Sa beauté était dans tout
son éclat ; toutefois, elle était encore très sage. On raconte que sa première faiblesse eut pour motif de sauver un de ses parents nommé Galois, qui venait
d'être pressé sur la Tamise, et qui était matelot. Le capitaine, auquel elle s'adressa pour obtenir la délivrance de son parent, y mit
un prix qui lui livra la jeune fille. Devenu possesseur d'Emma, il lui donna des maîtres de toute espèce, puis il l'abandonna. Elle fit alors connaissance avec le
chevalier Feathersonhang, qui la trouva trop fière avec lui, et ne tarda pas à l'abandonner aussi.
Emma se voyant sans ressource, descendit bientôt au dernier degré d'avilissement. Un hasard étrange la tira de cet abîme. Le docteur Graham s'empara d'elle, pour
la montrer chez lui, couverte d'un léger voile, sous le nom de la déesse Higia (déesse de la santé) ; une quantité de curieux et
d'amateurs venaient en foule la voir ; les artistes surtout en étaient charmés. Quelque temps après cette exhibition, un peintre l'emmena chez lui comme modèle ;
il lui faisait prendre mille attitudes gracieuses qu'il fixait dans ses tableaux. C'est là qu'elle perfectionna ce talent d'un nouveau genre, qui l'a rendue
célèbre. Rien n'était plus curieux en effet que la faculté qu'avait acquise lady Hamilton de donner subitement à tous ses traits l'expression de la douleur ou de
la joie, et de se poser merveilleusement pour représenter des personnages divers. L'oeil animé, les cheveux épars, elle vous montrait une bacchante délicieuse,
puis tout à coup son visage exprimait la douleur, et l'on voyait une Madeleine repentante admirable. Le jour que le chevalier Hamilton me la présenta, il voulut
que je la visse en action ; je fus ravie ; mais elle était habillée comme tout le monde, ce qui me choquait. Je lui fis faire des robes comme celles que je
portais, pour peindre à mon aise, et qu'on appelle des blouses ; elle y ajouta des schals pour se draper, ce qu'elle entendait très bien ; dès lors, on aurait pu
copier ses différentes poses et ses différentes expressions pour faire toute une galerie de tableaux ; il en existe même un recueil, dessiné par Frédéric
Reinberg, qu'on a gravé.
Pour revenir au roman de sa vie, c'est tandis qu'elle était chez le peintre dont j'ai parlé, que lord Gréville
(nb) Lord Gréville était de l'antique famille des Warwick.
en devint si fort amoureux, qu'il allait l'épouser en 1789, quand il fut subitement dépouillé de ses places et ruiné. Il partit aussitôt pour Naples, dans
l'espoir d'obtenir des secours de son oncle, le chevalier Hamilton, et il emmena Emma afin qu'elle plaidât sa cause auprès de son grand parent. Le chevalier, en
effet, consentit à payer toutes les dettes de son neveu, mais à la condition qu'Emma lui resterait. (Je tiens ces détails de lord Gréville lui-même.) Emma devint
donc la maîtresse de lord Hamilton, jusqu'au printemps de 1791, qu'il se détermina à l'épouser en dépit des remontrances de sa famille. Il me dit, en partant pour
Londres : «Elle sera ma femme malgré eux ; après tout, c'est pour moi que je l'épouse.»
Ainsi, ce fut lady Hamilton qu'il ramena à Naples peu de temps après, devenue aussi grande dame qu'on puisse l'être. On a prétendu que la reine de Naples alors
s'était intimement liée avec elle. Il est certain que la reine la voyait ; mais on peut dire que c'était politiquement. Lady Hamilton étant très indiscrète, la
mettait au fait d'une foule de petits secrets diplomatiques, dont Sa Majesté tirait parti pour les affaires de son royaume.
Lady Hamilton n'avait point d'esprit, quoiqu'elle fût excessivement moqueuse et dénigrante, au point que ces défauts étaient les seuls mobiles de sa
conversation ; mais elle avait de l'astuce, qui l'a servie à se faire épouser. Elle manquait de tournure et s'habillait très mal, dès qu'il s'agissait de faire
une toilette vulgaire. Je me souviens que lorsque je fis mon premier portrait d'elle en sibylle : elle habitait à Caserte une maison que le chevalier Hamilton
avait louée ; je m'y rendais tous les jours, désirant avancer cet ouvrage. La duchesse de Fleury et la princesse Joseph de Monaco assistaient à la troisième
séance, qui fut la dernière. J'avais coiffé madame Hart (elle n'était pas encore mariée) avec un schall tourné autour de sa tête en forme de turban, dont un bout
tombait et faisait draperie. Cette coiffure l'embellissait au point que ces dames la trouvaient ravissante. Le chevalier nous ayant toutes invitées à dîner,
madame Hart passa dans ses appartements pour faire sa toilette, et lorsqu'elle vint nous retrouver au salon, cette toilette, qui était des plus communes, l'avait
tellement changée à son désavantage, que ces deux dames eurent toutes les peines du monde à la reconnaître.
Lorsque j'allai à Londres, en 1802, lady Hamilton venait de perdre son mari. Je me fis écrire chez elle, et elle vint aussitôt me voir dans le plus grand deuil.
Un immense voile noir l'entourait, et elle avait fait couper ses beaux cheveux pour se coiffer à la Titus, ce qui était alors à la mode. Je trouvai cette
Andromaque énorme ; car elle avait horriblement engraissé. Elle me dit en pleurant qu'elle était bien à plaindre, qu'elle avait perdu dans le chevalier un ami, un
père ; et qu'elle ne s'en consolerait jamais. J'avoue que sa douleur me fit peu d'impression ; car je crus m'apercevoir qu'elle jouait la comédie. Je me trompais
d'autant moins que peu de minutes après, ayant aperçu de la musique sur mon piano, elle se mit à chanter un des airs qui s'y trouvaient.
On sait que lord Nelson à Naples avait été très amoureux d'elle ; elle était restée avec lui en correspondance fort tendre ; et quand j'allai lui rendre sa visite
un matin, je la trouvai rayonnante de joie ; de plus, elle avait placé une rose dans ses cheveux comme Nina. Je ne pus me tenir de lui demander ce que signifiait
cette rose ? - C'est que je viens de recevoir une lettre de lord Nelson, me répondit-elle.
Le duc de Berri et le duc de Bourbon, ayant entendu parler de ses attitudes, avaient un désir extrême de voir ce spectacle qu'elle n'avait jamais voulu donner à
Londres. Je lui demandai de m'accorder une soirée pour les deux princes, et elle y consentit. J'invitai alors quelques autres Français que je savais être fort
curieux d'assister à cette scène ; et le jour venu je plaçai dans le milieu de mon salon un très grand cadre enfermé à droite et à gauche dans deux paravents.
J'avais fait faire une énorme bougie qui répandait un grand foyer de lumière ; je la posai de façon qu'on ne pût la voir, mais qu'elle éclairât lady Hamilton
comme on éclaire un tableau. Toutes les personnes invitées étant arrivées, lady Hamilton prit dans ce cadre diverses attitudes avec une expression vraiment
admirable. Elle avait amené avec elle une jeune fille qui pouvait avoir sept ou huit ans, et qui lui ressemblait beaucoup.
(nb) On m'a dit que cette enfant était la fille de lord Nelson.
Elle la groupait avec elle, et me rappelait ces femmes poursuivies dans l'enlèvement des Sabines du Poussin. Elle passait de la douleur à la joie, de la joie à
l'effroi, avec une telle rapidité que nous étions tous ravis.
Comme je l'avais retenue à souper, le duc de Bourbon, qui était à table à côté de moi, me fit remarquer combien elle buvait de porter.
Il fallait qu'elle y fût bien accoutumée, car elle n'était pas ivre après deux ou trois bouteilles. Long-temps après avoir quitté Londres, en 1815, j'ai appris
que lady Hamilton venait de finir ses jours à Calais, où elle était morte dans l'isolement et la plus affreuse misère.
Nous voilà bien loin de Naples et de 1790 ; j'y reviens.
J'étais dans l'enchantement d'habiter cet hôtel de Maroc, sans parler de l'agrément de mon voisinage. Je jouissais de ma fenêtre de la vue la plus magnifique et
du spectacle le plus réjouissant. La mer et l'île Caprée en face ; à gauche le Vésuve, qui promettait une éruption par la quantité de fumée qu'il exhalait ; à
droite le coteau de Pausilippe, couvert de charmantes maisons, et d'une superbe végétation ; puis ce quai de Chiaja est toujours si animé qu'il m'offrait sans
cesse des tableaux amusants et variés ; tantôt des lazzaroni venaient se désaltérer au jet d'eau qui sortait d'une belle fontaine placée devant mes fenêtres, où
de jeunes blanchisseuses y lavaient leur linge ; le dimanche de jeunes paysannes, dans leurs plus beaux atours, dansaient la tarentelle devant ma maison, en
jouant du tambour de basque, et tous les soirs je voyais les pêcheurs avec des torches dont la vive lumière reflétait dans la mer des lames de feu. Après ma
chambre à coucher se trouvait une galerie ouverte qui donnait sur un jardin rempli d'orangers et de citronniers en fleurs ; mais comme toute chose ici-bas a ses
inconvénients, mon appartement en avait un dont il me fallut bien prendre mon parti. Pendant plusieurs heures de la matinée je ne pouvais ouvrir mes fenêtres sur
le devant, attendu qu'il s'établissait au-dessous de moi une cuisine ambulante où les femmes faisaient cuire des tripes dans de grands chaudrons, avec de l'huile
infecte dont l'odeur montait chez moi. J'étais réduite à regarder la mer à travers mes carreaux. Qu'elle est belle cette mer de Naples ! bien souvent j'ai passé
des heures à la contempler la nuit, quand ses flots étaient calmes et argentés par le reflet d'une lune superbe. Bien souvent aussi j'ai pris un bateau pour faire
une promenade, et jouir du magnifique coup d'oeil que présente la ville, que l'on voit alors tout entière, s'élevant en amphithéâtre. Le chevalier Hamilton avait
sur le rivage un petit cazin où j'allais quelquefois dîner.
(nb) Ceci me rappelle encore un trait du chevalier Hamilton. Dans le cazin dont je parle j'avais fait avec du charbon, sur un dessus de porte, deux petites têtes d'expression, que je fus bien surprise de retrouver en Angleterre chez lord Warwick. Le chevalier avait fait scier le chambranle, et vendu ces croquis : je ne me rappelle plus pour quelle somme.
Il faisait venir de jeunes garçons qui, pour un sou, plongeaient dans la mer pendant plusieurs minutes ; quand je tremblais pour eux, je les voyais remonter
triomphants, leur sou à la bouche.
C'est à Chiaja que se trouve la Villa-Reale, jardin public, bordé par la mer, et qui devient le soir une promenade délicieuse. L'Hercule Farnèse était placé dans
ce jardin ; comme on avait retrouvé les jambes antiques de la statue, elles étaient remises en place de celles qu'avait faites dans le temps Michel-Ange ; mais
celles-ci restaient posées à côté, afin que l'on comparât, en sorte qu'il fallait reconnaître la sublime supériorité de l'antique, même auprès de Michel-Ange.
CHAPITRE VI.
Le baron de Talleyrand. L'île de Caprée. Le Vésuve. Ischia et Procida. Le mont Saint-Nicolas. Portrait des filles aînées de la reine de Naples. Portrait du prince royal. Paësiello. La Nina. Le coteau de Pausilippe. Ma fille, son maître de musique.
Aussitôt que j'étais arrivée à Naples, j'avais été chez M. le baron de Talleyrand, alors ambassadeur de France, qui eut pour moi mille bontés pendant tout mon
séjour. Je retrouvai chez lui madame Silva, Portugaise très aimable, avec laquelle je projetai de faire plusieurs courses intéressantes. Nous allâmes d'abord à
l'île de Caprée. Le comte de la Roche-Aymon et le fils aîné de M. de Talleyrand nous accompagnèrent. Ils avaient engagé deux musiciens, l'un pour chanter et
l'autre pour jouer de la guitare. Nous nous embarquâmes à minuit par un beau clair de lune ; mais la mer était très agitée ; ses vagues énormes dont l'écume
s'amoncelait autour de nous, menaçaient si furieusement notre chétif bateau, qu'à chaque instant je pensais le voir englouti. J'avoue que je mourais de peur. Il
faut dire que je n'avais jamais fait sur mer un aussi long trajet, n'ayant entrepris jusqu'alors que le passage du Mordit dont la traversée est très courte, quand
j'étais en Hollande.
Lorsque nous eûmes pris le large, M. de Talleyrand engagea ses musiciens à chanter ; mais ces deux pauvres jeunes gens étaient pris du mal de mer à un tel point,
qu'il leur était bien impossible de faire de la musique. Ce mal saisit aussi madame Silva et le jeune baron ; M. de la Roche-Aymon et moi, nous n'en fûmes que
très légèrement atteints.
Enfin, après avoir été ballottés sans relâche par ces terribles vagues, nous débarquâmes à l'île de Caprée, un peu après le lever du soleil. Nous ne trouvâmes là
que des pêcheurs qui habitent les creux des rochers sur le bord de la mer. Un d'eux s'offrit pour nous servir de guide, et nous prîmes des ânes ; car nous
voulions monter jusqu'au sommet de l'île. La route que nous gravissions était bordée à notre gauche par des vergers d'orangers et de citronniers en fleurs, des
gazons aromatiques, des bois d'aloès, qui répandaient un parfum délicieux. À notre droite étaient des rochers et des débris d'antiques constructions. Arrivés au
sommet, sur la plate-forme appelée Saint-Michel, nous jouîmes de la vue de la pleine mer terminée par le Vésuve, tout en respirant l'air le plus pur. C'est là
qu'était placé le palais de Tibère ; il n'en reste qu'un seul tronçon de colonne, sur lequel un ermite, qui habite près de ces débris informes, venait de poser
son frugal repas du matin ; et c'était de cette hauteur immense que Tibère faisait jeter non-seulement des esclaves, mais tous ceux qui lui déplaisaient.
On nous fit voir de loin une jolie maison qu'avait fait bâtir un Anglais malade, et que tous les médecins avaient condamné depuis longtemps à Naples. Ayant suivi
le conseil qu'on lui donna d'aller habiter Caprée, il y vécut plus de vingt ans encore sans aucune souffrance.
Après avoir respiré avec délice cet air vivifiant, admiré les sites les plus curieux, nous revînmes à Naples, ravis de notre course, à l'exception pourtant du
jeune baron de Talleyrand, qui reçut une forte réprimande de son père pour avoir fait ce voyage par un aussi mauvais temps et dans un aussi léger bateau.
Ce que je désirais par-dessus tout, c'était de monter sur le Vésuve, et nous résolûmes de faire cette partie avec madame Silva et l'abbé Bertrand.
Je vais copier ici la fin d'une lettre que j'écrivis de Naples à mon ami Brongniart l'architecte, parce que l'impression que m'avait faite le terrible phénomène
était alors bien plus récente et bien plus vive.
«... Maintenant je vais vous parler de mon spectacle favori, du Vésuve. Pour un peu je me ferais Vésuvienne, tant j'aime ce superbe volcan ; je crois qu'il
m'aime aussi, car il m'a fêtée et reçue de la manière la plus grandiose. Que deviennent les plus beaux feux d'artifices, sans en excepter la girande du château
Saint-Ange, quand on songe au Vésuve ?
«La première fois que j'y suis montée, nous fûmes pris, mes compagnons et moi, par un orage affreux, une pluie qui ressemblait au déluge. Nous étions trempés,
mais nous n'en cheminions pas moins sur une hauteur pour voir une des grandes laves qui coulaient à nos pieds. Je croyais toucher aux avenues de l'enfer. Un
brasier qui me suffoquait serpentait sous mes yeux ; il avait trois milles de circonférence. Le mauvais temps nous empêchant d'aller plus loin ce jour-là, outre
que la fumée et la pluie de cendre qui nous couvrait rendaient le sommet du mont invisible, nous montons sur nos mulets et descendons dans les laves noires. Deux
tonnerres, celui du ciel et celui du mont, se mêlaient ; le bruit était infernal, d'autant plus qu'il se répétait dans les cavités des montagnes environnantes.
Comme nous étions précisément sous la nuée, je tremblais, et toute notre cavalcade tremblait comme moi, que le mouvement de notre marche n'attirât sur nous la
foudre. Malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire en regardant un de nos compagnons de voyage, l'abbé Bertrand. Il faut vous dire qu'il est bossu par
derrière et par devant : un grand manteau couvrait son âne et lui, et tous deux étaient tellement confondus ensemble, que, la petite humanité de l'abbé
disparaissant, je ne voyais plus qu'un chameau.
«J'arrivai chez moi dans un état qui faisait pitié : ma robe n'était que cendre détrempée ; j'étais morte de fatigue ; je me sèche et me couche fort
heureusement.
«Bien loin d'être dégoûtée par ce début, quelque jours après je retourne à mon cher Vésuve. Cette fois ma petite brunette était de la partie ; je voulais qu'elle
vît ce grand spectacle. Monsieur de la Chenaye et deux autres personnes en étaient aussi. Il faisait le plus beau temps du monde. Avant la nuit nous étions sur la
montagne pour voir les anciennes laves et le coucher du soleil dans la mer. Le volcan était plus furieux que jamais, et comme au jour on ne distingue point de
feu, on ne voit sortir du cratère, avec des nuées de cendres et de laves, qu'une énorme fumée blanchâtre, argentée, que le soleil éclaire d'une manière admirable.
J'ai peint cet effet, car il est divin.br/>
«Nous montâmes chez l'ermite. Le soleil se couchait, et je vis ses rayons se perdre sous le cap Mysène, Ischia et Procida ; quelle vue ! Enfin la nuit vint, et la
fumée se transforma en flammes, les plus belles que j'aie jamais vues de ma vie. Des gerbes de feu s'élançaient du cratère, et se succédaient rapidement, jetant
de tout côté des pierres embrasées qui tombaient avec fracas. En même temps descendait une cascade de feu qui parcourait l'espace de quatre à cinq milles. Une
autre bouche du cratère placée plus bas était aussi enflammée ; celle-ci produisait une fumée rouge et dorée, qui complétait le spectacle d'une manière effrayante
et sublime. La foudre qui partait du centre de la montagne, faisait retentir tous les environs, au point que la terre tremblait sous nos pas. J'étais bien un peu
effrayée ; mais je n'en témoignais rien à cause de ma pauvre petite qui me disait en pleurant : «Maman, faut-il avoir peur ?» D'ailleurs, j'avais tant à admirer
que ce besoin l'emportait sur mon effroi. Imaginez que nous planions alors sur une immensité de brasiers, sur des champs entiers que ces laves, dans leur course,
mettaient en feu. Je voyais ces terribles laves brûler les arbrisseaux, les arbres, les vignes ; je voyais la flamme s'allumer et s'éteindre, et j'entendais le
bruit des broussailles voisines qu'elles consumaient.
«Cette grande scène de destruction a quelque chose de pénible et d'imposant, qui remue fortement l'âme ; je ne pouvais plus parler en revenant à Naples ; dans le
chemin je ne cessais de retourner la tête pour voir encore ces gerbes et cette rivière de feu. C'est donc à regret que j'ai quitté ce spectacle si grandiose ;
mais j'en jouis par le souvenir, et tous les jours je me représente encore ses différents effets. J'en ai quatre dessins que je vous porterai à Paris. Deux sont
déjà en petite maquette ; on en est très content ici.
«Donnez-moi de vos nouvelles, et de celles de nos amis, etc.»
Depuis lors je suis retournée plusieurs fois sur le Vésuve, un jour entre autres avec M. Lethière,
(nb) M. Lethière, qui a été directeur de l'Académie de Rome, il y a peu d'années, était venu alors à Naples pour y copier quelques tableaux, entre autres la Descente de croix de l'Espagnolet qui est à la Chartreuse et qu'il copia admirablement.
très habile peintre d'histoire, qui était grand amateur du volcan. Je me souviens que ce jour était celui de la Chandeleur. Nous partîmes vers trois heures,
avec deux amis de M. Lethière. Il faisait beau ; mais lorsque nous fûmes arrivés sur la montagne, il s'éleva un brouillard si épais qu'il ressemblait à une énorme
fumée. Tout disparut à nos yeux ; nos compagnons, quoiqu'ils fussent très près de nous, étaient devenus invisibles ; en un mot c'était le néant. Ma petite mourait
de peur, et moi aussi. Pour comble de malheur l'humidité était extrême, et nous fûmes obligés de rester en place pendant une heure et demie. Enfin le brouillard
se dissipant peu à peu, nous découvrit la mer et tout ce qui l'environne jusqu'aux îles les plus lointaines ; cette création fut admirable.
J'avais fait porter notre dîner chez l'ermite, que nous avions invité à le partager. Avant la fin du repas, cet ermite se leva et passa derrière un vieux rideau
qui touchait presque la table. Il resta là tout un quart d'heure ; quand il revint, je lui demandai pour quel motif il nous avait quittés : - C'est, dit-il, que j
e viens de faire ma prière auprès de mon compagnon qui est mort cette nuit, et qui est là sous ce rideau. À ces mots, on peut imaginer si je me lève à mon tour et
si je sors pour aller respirer le grand air.
Nous remontâmes pour voir le coucher du soleil. Son disque brillant d'où partaient d'immenses rayons, se réfléchissait dans la mer. Nous étions dans l'extase à la
vue de ce superbe tableau et de tout ce qui l'encadrait. Nous revînmes à Naples, rapportant nos croquis. M. Lethière avait fait un dessin dans lequel il me
représentait descendant la montagne sur mon âne.
Une des plus charmantes parties que j'aie faites à Naples, c'est un petit voyage de cinq jours que le chevalier me fit entreprendre pour visiter les îles d'Ischia
et de Procida. Nous partîmes à cinq heures du matin. J'étais dans une felouque avec madame Hart, sa mère, le chevalier et quelques musiciens. Il faisait le plus
beau temps du monde ; la mer était calme au point de ressembler à un grand lac. À peu de distance, on voyait le coteau du mont Pausilippe, que le soleil éclairait
d'une façon ravissante. Tout cela m'aurait porté à une douce rêverie, si nos rameurs n'avaient point crié à tue-tête, ce qui vous empêchait de suivre une idée.
À neuf heures et demie nous arrivâmes à Procida, et nous fîmes aussitôt une promenade pendant laquelle je fus frappée de la beauté des femmes que nous
rencontrions sur notre chemin. Presque toutes étaient grandes et fortes, et leurs costumes, ainsi que leurs visages, rappelaient les femmes grecques. Je vis peu
d'habitations agréables, l'île étant généralement cultivée en vignes et en arbres fruitiers. À midi nous allâmes dîner chez le gouverneur ; de la terrasse de son
château, on découvre le cap Mysène, l'Achéron, les Champs-Élysées, enfin, tout ce que Virgile décrit ; ces divers points de vue sont assez rapprochés pour qu'on
puisse en distinguer les détails, et le Vésuve se voit dans le lointain.
Après dîner, nous remontâmes sur la felouque pour aller débarquer à Ischia vers les six heures du soir. Un des plus jolis effets que j'ai vus tout en arrivant,
était celui d'une quantité de maisons bâties çà et là sur les monts, et très éclairées, ce qui présentait à l'oeil comme un second firmament. J'allai joindre
madame Silva, mon aimable Portugaise, pour parcourir avec elle une partie de l'île, qui est charmante ; tout son territoire est volcanique, elle a quinze lieues
d'étendue, et partout on trouve des traces de foyers éteints. La plupart des montagnes, qui sont en très grand nombre et fort près les unes des autres, sont
cultivées. Le mont le plus élevé (Saint-Nicolas) est plus haut que le Vésuve.
Nous trouvions à Ischia une société très aimable, entre autres le général baron Salis ; et le lendemain matin à six heures, nous partîmes au nombre de vingt
personnes, toutes montées sur des ânes, pour aller dîner au mont Saint-Nicolas. On ne peut se faire une idée des chemins qu'il nous fallut prendre ; les sentiers
étaient des ravins profonds pleins d'énormes pierres noircies par le feu ; et les hauteurs de ces ravins étant cultivées, cette terre fertile, près de cette terre
désolée, offrait un contraste étrange. Nous suivîmes entre autres un chemin à pic rempli de laves grosses comme des maisons, qui ressemblait tout-à-fait au chemin
de l'enfer, et cette superbe horreur nous conduisit dans un lieu de délices, sous des berceaux de vignes parfaitement cultivées, et près d'une très belle forêt de
châtaigniers. Là, j'aperçus une seule petite habitation, que mon guide me dit être celle d'un ermite. L'ermite était absent ; je m'assis sur son banc, et je
découvris par une percée de la forêt, la mer et les îles Cyrènes, que la vapeur du matin entourait d'un ton bleuâtre. Je croyais faire un rêve enchanteur ; je me
disais : la poésie est née là ! Il fallut m'arracher à ma ravissante contemplation, il nous restait encore à gravir bien autrement.
Nous arrivâmes dans une espèce de désert, bordé de ravins si profonds, que je n'osais y plonger mes yeux, et mon maudit âne s'obstinait à marcher toujours sur le
bord. Ne pouvant regarder en bas, je me mets à regarder en haut, et je vois la montagne que nous avions à gravir, toute couverte d'affreux nuages noirs. Il
fallait pourtant traverser cela, au risque d'être étouffée cent fois : notez de plus que le chemin était à pic sur la mer, et qu'il ne s'y trouvait pas une seule
habitation. Le coeur me bat encore quand j'y pense. Je suivis pourtant, non sans recommander mon âme à Dieu. Nous mîmes une heure et demie, marchant toujours, à
traverser ces nuages. L'humidité était si grande, que nos vêtements étaient trempés ; on ne se voyait pas à quatre pieds, en sorte que je finis par perdre ma
compagnie. On peut juger de l'effroi que j'éprouvais, quand j'entendis le son d'une petite cloche ; je poussai un grand cri de joie, pensant bien que c'était
celle de l'ermite chez lequel nous devions dîner. C'était elle, en effet, et l'on vint au devant de moi.
Je trouvai toute ma société réunie dans l'ermitage, qui est situé sur la dernière pointe des rochers du mont Saint-Nicolas. Dans ce moment néanmoins, le
brouillard était si épais, qu'il était impossible de rien voir ; mais, presque aussitôt, les nuages se divisent, le brouillard se dissipe, et je me trouve sous un
ciel pur. Je domine ces nuées qui m'avaient tant effrayée, je les vois descendre dans la mer que le soleil traçait en ligne d'opale et d'autres couleurs
d'arc-en-ciel ; quelques nuages argentés embellissaient ce coup d'oeil. On ne distinguait les barques qu'à leurs voiles blanches qui brillaient au soleil. Notre
vue plongeait sur les villages d'Ischia ; mais cette masse de rochers écrasait tellement de sa supériorité tout ce qui fait l'ambition des hommes, que les
châteaux, les maisons, ressemblaient à de petits points blancs ; quant aux individus, ils étaient invisibles : ce que c'est que de nous, mon Dieu !
Nous étions à contempler ce magnifique spectacle, quand le général Salis vint nous avertir que le dîner était servi, nouvelle qui ne nous fut pas indifférente
après tant de fatigues et de tribulations. Ce dîner qu'il nous donnait, pouvait se comparer à ceux de Lucullus ; tout était recherché, rien n'y manquait, au point
que nous eûmes des glaces pour finir. Il fallait voir l'étonnement des trois bons religieux qui habitaient ce rocher et qui profitaient de cet excellent repas ;
ils en gardèrent les restes, ce dont ils paraissaient fort contents.
Après dîner, madame Silva et moi nous fîmes notre sieste en plein air sur des sacs d'orge renversés, où l'odeur des genêts et de mille fleurs nous embaumait.
Puis, nous remontâmes sur nos ânes pour parcourir l'autre côté de l'île. Là, nous vîmes des vergers sans nombre, des sites très pittoresques, et ce chemin nous
conduisit à notre habitation.
Je voulus aller aussi à Poestum ; quoique la distance de Naples ne soit que de vingt-cinq lieues, nous étions prévenus que le voyage est très fatigant, mais on ne
tient pas au désir d'aller admirer des monuments qui ont trois ou quatre mille ans, quand ils se trouvent aussi près de vous. Des trois temples que l'on y voit,
celui de Junon était encore alors bien conservé, au point qu'à l'extérieur il semblait être entier. Ce temple est noble, imposant, comme tout ce qu'ont fait les
anciens, près desquels nous ne sommes que des pygmées. Aussi puis-je dire avoir été fort surprise à Pompeï que nous visitâmes ainsi
qu'Herculanum, de la petitesse des maisons et du temple d'Isis. Il faut croire que la partie découverte était autrefois un faubourg.
Je conduisis aussi ma fille à Portici, dans le muséum, beauté tout-à-fait unique dans le monde ; mais tant d'écrivains l'ont si bien décrit, que je crois inutile
d'en parler ici.
Ces excursions et plusieurs autres ne m'empêchaient pas de travailler beaucoup à Naples. J'avais même entrepris tant de portraits que mon premier séjour dans
cette ville a été de six mois, quoique je fusse arrivée dans l'intention d'y passer six semaines. L'ambassadeur de France, M. le baron de Talleyrand, vint
m'annoncer un matin que la reine désirait que je fisse les portraits de ses deux filles aînées, ce que je commençai tout de suite. Sa Majesté s'apprêtait à partir
pour Vienne où elle allait s'occuper de marier ces princesses. Je me souviens qu'à son retour elle me dit : «J'ai fait un heureux voyage ; je viens de conclure
deux mariages pour mes filles avec un grand bonheur.» L'aînée en effet épousa peu de temps après l'empereur d'Autriche, François II, et la seconde, qui se nommait
Louise, le grand duc de Toscane. Cette dernière était fort laide, et tellement grimacière, que je ne voulais pas finir son portrait. Elle est morte quelques
années après son mariage.
Lorsque la reine fut partie, je peignis aussi le prince royal. L'heure de mes séances à la cour était midi, et pour m'y rendre il me fallait suivre le chemin de
Chiaja, au moment de la plus grande chaleur. Les maisons qui sont bâties à gauche et qui font face à la mer, étant peintes en blanc pur,
le soleil y donnait avec une telle force que j'en étais aveuglée. Pour sauver mes yeux j'imaginai de mettre un voile vert, ce que je n'avais vu faire encore à
personne, et devait paraître assez singulier, car on n'en portait que de blancs ou de noirs ; mais quelques jours après je vis quantité d'Anglaises m'imiter, et
les voiles verts furent à la mode.
(nb) Je me suis aussi très bien trouvé de mon voile vert à Pétersbourg, où la neige est si brillante qu'elle m'aurait fait perdre la vue.
À cette même époque je commençai le portrait de Paësiello. Tout en me donnant séance, il composait un morceau de musique, qu'on devait exécuter pour le retour
de la reine, et j'étais charmée de cette circonstance qui me faisait saisir les traits du grand musicien au moment de l'inspiration.
J'avais quitté mon cher hôtel de Maroc, parce qu'après avoir admiré tout le jour il faut pourtant bien dormir la nuit, et qu'il m'était impossible d'y fermer
l'oeil. Les voitures allaient et venaient sans cesse sur le chemin de Chiaja jusqu'à la grotte de Pausilippe, où l'on fait souvent de mauvais soupers dans les
cabarets. Ce bruit, que j'entendais toutes les nuits, me fit enfin déserter. J'allai m'établir dans un joli cazin baigné par la mer, dont les vagues venaient se
briser sous mes fenêtres. J'étais enchantée ; ce bruit rond et léger me berçait délicieusement ; mais hélas ! huit jours après il survint un orage affreux, une
tempête si violente, que les vagues furieuses montaient jusque dans mon appartement. J'en étais inondée, et la crainte d'une récidive me fit quitter ce charmant
cazin, à mon grand regret. À la vérité, entre le mur et cette maison, il y avait une place sur laquelle les voitures élégantes, les mêmes voitures qui
m'empêchaient de dormir à Chiaja, venaient stationner, pour ce qu'on appelle à Naples faire heure. Mais cela m'était peu incommode. Je me rappelle que le jour de
mon départ la propriétaire ouvrit une armoire dans laquelle j'avais serré mon linge, et se mit à écrire mon nom sur toutes les planches ; comme je lui demandai le
motif de ce qu'elle faisait, elle me répondit gracieusement qu'elle était fière d'avoir logé madame Lebrun, et qu'elle voulait que tout le monde le sût.
Après avoir quitté cette maison, j'allai en louer une tout près de la ville, et je m'y installai la veille de Noël. Dès le soir même, comme j'allais me mettre au
lit, je suis tout à coup assourdie par des pétards sans nombre ; les jeunes garçons qui les tiraient en jetaient dans ma cour, dans mes fenêtres ; ce train-là
dura trois jours et trois nuits. En outre, j'étais gelée dans cet appartement. Je faisais alors le portrait de Paësiello, qui soufflait dans ses doigts ainsi que
moi ; pour nous réchauffer, je fis faire du feu dans mon atelier ; mais comme on s'occupe bien plus en Italie d'obtenir de la fraîcheur que de la chaleur, les
cheminées sont si mal soignées que la fumée nous étouffait. Les yeux de Paësiello en pleuraient, les miens aussi ; et je ne conçois pas comment j'ai pu finir son
portrait.
Paësiello, à cette époque, faisait les délices de l'Italie. J'allais fort souvent au grand Opéra, dans la loge de la comtesse Scawronski. J'assistai à la première
représentation de Nina, qui bien certainement est un chef-d'oeuvre ; mais tel est l'effet de la première impression reçue, que la
musique de Paësiello, toute belle qu'elle était, ne me faisait pas autant de plaisir que celle de Dalayrac ; il faut dire aussi que madame Dugazon n'était point
là pour jouer Nina. Le théâtre de Saint-Charles, où se donnait cet opéra et les autres, est, je crois, le plus vaste de l'Europe. Je m'y
suis trouvée le jour de la fête de la reine ; il était alors magnifiquement éclairé, totalement rempli de monde, et ce coup d'oeil me parut superbe. Je me
souviens d'avoir ri ce jour-là d'une méprise assez plaisante. J'aperçus près de nous la baronne de Talleyrand, chez laquelle je n'avais pas été depuis quelque
temps, et je voulus lui faire ma visite dans sa loge ; la comtesse me dit alors : «Elle éprouve un grand chagrin, l'ambassadrice ; elle a perdu Rigi.» Pensant
qu'il s'agissait d'un ami, je me décide d'autant plus à l'aller trouver ; j'y vais. Je suis en effet frappée du changement de son visage, et je lui vois un air si
triste que je commence à croire qu'un de ses enfants est mort. Je lui dis donc combien je prenais part à son affliction, et lui demande si c'était l'aîné. À ces
mots, malgré son chagrin, elle se mit à rire : c'était son chien qu'elle venait de perdre.
Un de mes grands plaisirs était d'aller me promener sur le beau coteau de Pausilippe, sous lequel est placée la grotte du même nom, qui est un magnifique ouvrage
d'un mille de longueur, et qu'on voit bien avoir été fait par les Romains. Cette côte de Pausilippe est couverte de maisons de campagne, de cazins, de prairies et
de très beaux arbres, autour desquels des vignes s'entrelacent en guirlandes. C'est là qu'est placé le tombeau de Virgile, sur lequel on prétend qu'il pousse des
lauriers ; mais je n'en ai point vu. Les soirs j'allais sur les bords de la mer ; j'y conduisais souvent ma fille, et nous y restions quelquefois assises ensemble
jusqu'au lever de la lune, jouissant de ce bon air et de cette superbe vue, ce qui la reposait de ses études journalières ; car j'avais résolu, tout en courant le
monde, de soigner son éducation autant qu'il serait possible, et je lui avais donné à Naples des maîtres d'écriture, de géographie, d'italien, d'anglais et
d'allemand. Elle préférait cette dernière langue à toutes les autres, et montrait dans ses diverses études une intelligence remarquable. Elle annonçait aussi
quelques dispositions pour la peinture ; mais sa récréation favorite était de composer des romans. Je la trouvais, en revenant de passer mes soirées dans le
monde, une plume à la main, et une autre sur son bonnet ; je l'obligeais alors à se mettre au lit ; mais il n'était pas rare qu'elle se relevât la nuit pour
achever un chapitre ; et je me souviens très bien qu'à l'âge de neuf ans elle a écrit à Vienne un petit roman remarquable par les situations autant que par le
style.
Me trouvant en Italie, on imagine bien que je n'avais point négligé de lui donner un maître de musique. Je prenais moi-même des leçons de ce maître, qui montrait
à merveille, mais qui était bien le plus grand poltron que j'aie rencontré de mes jours. Il nous entretenait sans cesse de ses frayeurs. Comme il ne venait chez
moi qu'à sept heures du soir, il retournait chez lui à neuf, heure à laquelle tout le monde étant au spectacle, les rues de Naples sont fort désertes, sans
excepter la rue de Tolède, qui, dans le jour, est la plus bruyante de toutes. Le pauvre homme me disait un soir : «J'ai eu terriblement peur hier ; j'ai rencontré
un homme dans la rue de Tolède ; heureusement j'ai pris l'autre côté, et j'ai pressé le pas.» Deux jours après il revenait : «Dieu ! que j'ai eu peur ! je me suis
trouvé avec deux hommes dans la rue de Tolède ; je n'ai eu que le temps de passer au milieu et de m'enfuir à toutes jambes.» Enfin une autre fois il me dit :
«J'ai eu bien plus peur vraiment, j'étais seul, tout seul, dans la rue de Tolède.»
CHAPITRE VII.
Je retourne à Rome. La reine de Naples. Je reviens à Naples. La fête de la madone de l'Arca. La fête du pied de la Grotte. La Solfatara. Pouzol. Le cap Mysène. Portrait de la reine de Naples. Caractère de cette princesse. Le Napolitain. Vol d'un lazzaroni. Mon retour à Rome. Mesdames de France, tantes de Louis XVI.
Tous les portraits que j'avais entrepris à Naples étant finis, je retournai à Rome ; mais à peine y étais-je arrivée, que la reine de Naples s'y arrêta en
revenant de Vienne. Comme je me trouvais sur son passage dans la foule, elle m'aperçut, vint à moi, et me pria avec toute la grâce imaginable de revenir à Naples
pour y faire son portrait. Il me fut impossible de refuser, et je ne tardai pas à me remettre en route.
Ce qui me consolait de toutes ces allées et venues, c'est qu'il me restait encore à voir plusieurs choses curieuses dans ce beau pays. Le chevalier Hamilton se
plaisait à m'en faire les honneurs. Et dès que je fus de retour, il s'empressa de me conduire à la fête de la madone de l'Arca, qui par son originalité se
distingue de toutes les fêtes de village. La place de l'église était couverte de marchands de gâteaux ou d'images de la Vierge et de groupes d'habitants, venus
des cantons voisins, dont les divers costumes étaient richement brodés d'or. Tous portaient des thyrses en haut desquels était placée l'image de la madone, ce
qui rappelait les fêtes antiques. Toutefois, cette foule, au lieu de nous donner le spectacle d'une bacchanale, entra dévotement dans l'église pour y entendre la
messe. Le chevalier Hamilton, madame Hart et moi, nous étions placés près d'une petite chapelle où se voyait un tableau de la Vierge, noir comme de l'encre. De
minute en minute, des paysans et des paysannes venaient s'agenouiller devant cette Vierge, et solliciter quelque faveur ou rendre grâce pour celles qu'ils
avaient reçues. Ils exprimaient tous leurs voeux d'une voix si haute, que nous entendions les demandes de chacun. Nous vîmes d'abord un homme beau comme une
statue grecque, le cou nu, qui remerciait la Vierge d'avoir guéri son enfant. Il avait placé cet enfant sur l'autel en face du tableau ; quand il eut fini sa
prière, il le reprit et partit heureux. Après lui, vint une femme qui grondait avec fureur la madone de ce que son mari la maltraitait. J'étouffais de rire ;
mais le chevalier me dit de tout faire pour me contraindre, qu'autrement je serais fort maltraitée moi-même. Il vint ensuite deux jeunes filles, qui se mirent à
genoux en demandant des maris. Enfin, les solliciteurs se succédèrent pendant une heure de la manière la plus plaisante. Dès que chacun d'eux avait parlé, on
sonnait du milieu de l'église une clochette qui leur annonçait vraisemblablement que la prière était exaucée ; car ils s'en allaient tous l'air content.
Après la messe, toutes ces bonnes gens se réunirent sur la place de l'église pour y danser la tarentelle ; c'est là seulement qu'on peut prendre l'idée de cette
danse : ce que j'avais vu jusqu'alors n'en était qu'une faible copie. Ils commencent par former de grands ronds au milieu desquels la tarentelle se danse, au
bruit du tambour de basque et de longues guitares à trois cordes dont ils tirent des sons vifs et harmonieux. On ne saurait décrire ni l'activité, ni
l'expression d'amour, qu'offrent tous leurs mouvements ; aucune danse ne ressemble à cela.
Nous restâmes jusqu'à la fin de la fête, et nous vîmes, en retournant à Naples, les hauteurs couvertes de femmes, dont les unes jouaient du tambour de basque et
les autres dansaient le thyrse à la main : c'était un spectacle charmant.
J'assistai aussi à une autre fête beaucoup plus célèbre que celle dont je viens de parler ; c'est la fête du Pied de Grotte. Elle est
ainsi nommée d'après la tradition qui raconte qu'un jour un ermite, retiré au fond de cette grotte, eut une vision dans laquelle la Vierge lui apparut et lui
ordonna de faire bâtir une chapelle dans cet endroit. Le prêtre en ayant instruit les habitants du canton, la chapelle fut aussitôt bâtie ; et tous les ans la
famille royale s'y rend en grande cérémonie pour y faire sa prière. Les chevau-légers, le régiment de la reine, celui du roi, enfin toutes les troupes, s'y
trouvent rassemblées, ainsi que toute la noblesse en grand gala, et une multitude prodigieuse de gens du peuple. Les cochers qui mènent la famille royale sont
coiffés de perruques à trois marteaux, ou à la Louis XIV. Cette fête est tellement en vénération, que les habitants des petits pays dépendants du royaume de
Naples, font mettre sur les contrats de mariage que l'on mènera leurs filles une fois à la fête de la Vierge du Pied de Grotte.
J'allai voir, avec M. Amaury Duval et M. Sacaut,
(nb) Tous deux étaient alors secrétaires de légation à Naples. M. Amaury Duval est frère de M. Alexandre Duval, l'auteur dramatique.
la Solfatare, qui est encore brûlante. C'était au mois de juin, en sorte que le soleil dardait sur notre tête, tandis que nous marchions sur du feu. De ma vie
je n'ai autant souffert de la chaleur. Pour comble de malheur, j'avais ma fille avec moi ; je la couvrais de ma robe, mais ce secours était si faible, que je
tremblais à chaque instant de la voir tomber sans connaissance. Elle me dit plusieurs fois : «Maman, on peut mourir de chaud, n'est-ce pas ?» Alors, Dieu sait si
j'étais au désespoir de l'avoir emmenée. Enfin, nous aperçûmes sur la hauteur une espèce de chaumière, dans laquelle il nous fut permis, grâce au ciel, de nous
reposer. La chaleur nous avait tellement suffoqués, qu'aucun de nous ne pouvait ni agir, ni parler. Au bout d'un quart d'heure, M. Duval se rappela qu'il avait
une orange dans sa poche, ce qui nous fit pousser un cri de joie ; car cette orange était la manne dans le désert.
Quand nous fûmes tout-à-fait remis, nous descendîmes à Pouzol. C'était un dimanche, les habitants étaient en habits de fête ; je me rappelle encore un jeune
homme, les cheveux bouclés et tellement poudrés, que son énorme catogan avait blanchi son habit de taffetas bleu de ciel ; sa veste était couleur de rose fanée ;
il portait un gros bouquet à sa boutonnière ; enfin, c'était tout-à-fait le beau Léandre de la parade française, et il avait un air si important, si content de
lui-même, qu'il me fit beaucoup rire.
Nous traversâmes toute la ville pour aller dîner au bord de la mer, où l'on nous servit d'excellents poissons. L'amphithéâtre de Pouzol, quoiqu'il soit en
ruines, est encore fort curieux à voir. Il y reste quelques gradins placés en face de la mer, devant de grands rochers creux, et l'on prétend que c'était dans
ces antres que les acteurs anciens jouaient les tragédies avec des masques caractéristiques et des porte-voix. Après le dîner, nous prîmes une barque qui nous
conduisit au promontoire de Mysène. Là, nous foulions aux pieds des morceaux brisés des marbres les plus précieux ; car Mysène a été détruite de fond en comble
par les Lombards et les Sarrazins : il n'y reste que le grand souvenir de Pline.
Que de lieux de délices ne sont plus maintenant que des lieux de mort ! Bayes ! si renommé chez les Romains qui venaient y prendre les eaux, Bayes n'est plus
qu'un amas de ruines informes sur lesquelles plane un air infect ; aussi le rivage de cette mer est-il désert. On voit encore à Bayes les restes de trois
temples, celui de Vénus, de Mercure et de Diane, dont les eaux du lac Averne couvrent aujourd'hui les soubassements. Mais il ne reste pas même de vestiges de ces
palais magnifiques, de ces belles terrasses : la mer a tout englouti.
Sitôt que j'avais été de retour à Naples, j'avais commencé le portrait de la reine ; bien loin qu'il m'arrivât le même inconvénient qu'avec Paësiello, il faisait
alors si cruellement chaud, qu'un jour qu'elle me donnait séance, nous nous endormîmes toutes deux. Je prenais plaisir à faire ce portrait. La reine de Naples,
sans être aussi jolie que sa soeur cadette, la reine de France, me la rappelait beaucoup ; son visage était fatigué, mais l'on pouvait encore juger qu'elle avait
été belle ; ses mains et ses bras surtout étaient la perfection pour la forme et pour le ton de la couleur des chairs. Cette princesse, dont on a dit et écrit
tant de mal, était d'un naturel affectueux et très simple dans son intérieur ; sa générosité était vraiment royale : le marquis de Bombelles, ambassadeur à
Venise en 1790, fut le seul ambassadeur français qui refusa de prêter serment à la Constitution ; la reine ayant appris que, par cette conduite noble et
courageuse, M. de Bombelles, père d'une famille nombreuse, était réduit à la position la plus cruelle, lui écrivit de sa propre main une lettre de félicitation.
Elle ajoutait que tous les souverains devant se regarder comme solidaires en reconnaissance pour les sujets fidèles, elle le priait d'accepter une pension de
douze mille francs.
(nb) Trois des enfants de M. de Bombelles ont aujourd'hui dans le monde des positions brillantes. L'aîné, le conte Louis de Bombelles, est ministre d'Autriche en Suisse ; le second, le comte Charles, est grand-maître de la maison de Marie-Louise ; et le troisième, le comte Henri, est ministre d'Autriche à Turin.
Outre ce trait, j'en connais plusieurs autres qui font honneur à son coeur : elle aimait à soulager la misère, elle ne craignait pas de monter au cinquième
étage pour secourir des malheureux, et j'ai su positivement que ses bienfaits ont sauvé de la prison, de la mort peut-être, une mère de famille et quatre enfants
dont le père venait de faire banqueroute. Voilà cette soi-disant mégère contre qui, sous Bonaparte, on exposait, dans les rues de Paris, les gravures les plus
infâmes et les plus obscènes. Il fallait bien la calomnier, on voulait sa couronne. On sait qu'elle fut trahie par ceux mêmes qu'elle avait toujours honorés de
son amitié et de sa confiance. La femme qu'elle affectionnait le plus correspondait avec le conquérant qui parvint enfin, par de viles menées, à détrôner la
soeur de Marie-Antoinette, pour mettre à sa place madame Murat.
La reine de Naples avait un grand caractère et beaucoup d'esprit. Elle seule portait tout le fardeau du gouvernement. Le roi ne voulait point régner ; il restait
presque toujours à Caserte, occupé de manufactures, dont les ouvrières, disait-on, lui composaient un sérail.
La reine ayant appris que je m'apprêtais à retourner à Rome, me fit demander, et me dit : «J'ai bien du regret que Naples ne puisse vous retenir.» Alors elle
m'offrit son petit cazin au bord de la mer, si je voulais rester ; mais je brûlais de revoir encore Rome, et je refusai avec toute la reconnaissance que
m'inspirait tant de bonté. Enfin, après qu'elle m'eut fait payer magnifiquement, lorsque j'allai prendre un dernier congé, elle me remit une belle boîte de vieux
laque qui renfermait son chiffre entouré de très beaux brillants. Ce chiffre vaut dix mille francs ; mais je le garderai toute ma vie.
Tout magnifique que soit le pays que j'allais quitter, il n'aurait pas été dans mon goût d'y passer ma vie. Selon moi, Naples doit être vue comme une lanterne
magique ravissante, mais pour y fixer ses jours, il faut s'être fait à l'idée, il faut avoir vaincu l'effroi qu'inspirent les volcans ; quand on songe que tout
ce qui habite les lieux d'alentour vit dans l'attente ou d'une éruption, ou d'un tremblement de terre, sans parler de la peste, qui pendant les chaleurs existe à
deux ou trois lieues de là. En outre, les lacs où l'on met rouir le lin produisent un air infect qui donne aux habitants de ces belles campagnes la fièvre et la
mort. Tous ces inconvénients sont graves, on en conviendra ; mais aussi, s'ils n'existaient pas, qui ne voudrait habiter ce délicieux climat ?
Le chevalier Hamilton, qui, depuis près de vingt ans, était ambassadeur d'Angleterre à Naples, connaissait parfaitement les moeurs et les usages de la haute
société de cette ville. Ce qu'il m'en rapportait, je l'avoue, était peu favorable à la noblesse napolitaine, mais, depuis cette époque, sans douter, tout a
beaucoup changé. Il me contait sur les plus grandes dames mille histoires, que je m'abstiens de répéter, comme trop scandaleuses. Selon lui, les Napolitaines
étaient d'une ignorance surprenante ; elles ne lisaient rien, quoiqu'elles fissent semblant de lire ; car un jour étant arrivé chez l'une d'elles, et lui
trouvant un livre à la main, il reconnut, en s'approchant, que la dame tenait ce livre sens dessus dessous. Privées de toute espèce d'instruction, plusieurs
d'entre elles, selon lui, ne savaient pas qu'il existât un autre pays que Naples, et leur unique occupation était l'amour qui, pour elles, changeait souvent
d'objet.
Ce dont j'ai pu juger par moi-même, c'est que les dames napolitaines gesticulent beaucoup en parlant. Elles ne font d'autre exercice que celui de se promener en
voiture, jamais à pied. Tous les soirs elles sont au spectacle et reçoivent leurs visites dans leur loge ; comme elles n'écoutent que l'aria, c'est là que
s'établissent les conversations d'une manière beaucoup moins confortable, selon moi, que dans un salon.
Les gens de la basse classe, à Naples, poussent au dernier degré l'exagération dans leurs cris et dans leurs gestes. J'ai vu un jour passer sous mes fenêtres, à
Chiaja, l'enterrement d'un homme du peuple, que suivaient les amis et connaissances du mort ; hommes et femmes gémissaient de la façon la plus lamentable. Une
femme surtout (c'était la veuve) poussait des cris affreux en se tordant les bras. Un pareil désespoir me faisait peur et pitié ; mais on m'assura que ces
cheveux épars et ces hurlements étaient d'usage.
Un enterrement bien plus touchant que j'ai vu à la Torre del Greco, c'était celui d'un jeune enfant que l'on portait dans sa bière,
très paré et le visage découvert ; on lui jetait des fleurs et des dragées des fenêtres sous lesquelles il passait, et je ne puis dire combien ce spectacle
serrait le coeur.
Si l'on veut juger toute l'expression des visages napolitains, il faut aller sur le chemin qui conduit à l'église de Saint-Janvier, le jour que s'opère le
miracle de la sainte ampoule. Les habitants de Naples et des environs se rendent en foule sur ce chemin, où les voitures stationnent à droite et les piétons à
gauche. Le désir, l'impatience, se peignaient d'une manière si étrange sur tous ces visages, attendu que le miracle tardait un peu, qu'il m'en prenait envie de
rire, quand heureusement on vint me dire de rester calme, si je ne voulais pas me faire lapider par la multitude. Enfin le miracle s'opère ; il est annoncé ;
alors on ne voit plus une figure qui ne peigne la joie, le ravissement avec une telle vivacité, une telle véhémence, qu'il est impossible de décrire ce tableau.
La partie de la population napolitaine la plus curieuse à observer, ce sont les lazzaroni. Ces gens ont simplifié la vie, au point de se passer de logement et
presque de nourriture ; car ils n'ont d'autre habitation que les marches des églises, et leur frugalité égale leur paresse, ce qui n'est pas peu dire. On les
trouve étendus à l'ombre des murs ou sur les bords de la mer. À peine sont-ils vêtus, et leurs enfants sont tous nus jusqu'à l'âge de douze ans. J'étais d'abord
un peu scandalisée et fort effrayée de les voir jouer ainsi sur le quai de Chiaja, où passent continuellement des voitures ; car ce chemin est la promenade
accoutumée de tout le monde à Naples, et même celle des princesses.
La misère des lazzaroni ne les porte pas à se faire voleurs ; ils sont peut-être trop paresseux pour cela, surtout ayant besoin de si peu de chose pour vivre. La
plupart des vols se commettent à Naples par les domestiques de louage, qui sont, en général, de forts mauvais sujets, le rebut de toutes les grandes villes des
différentes nations. Je n'ai entendu parler, pendant mon séjour, que d'un seul vol, commis par un lazzaroni, et l'on peut dire qu'il porte un caractère de
retenue qui équivaut à l'innocence. Le baron de Salis, un jour qu'il donnait un grand dîner, se rendait à sa cuisine ; comme il descendait doucement l'escalier,
il s'arrêta à la vue d'un homme qui, se croyant seul, s'approche du pot-au-feu, y prend un morceau de boeuf et l'emporte. Le baron s'était contenté de le suivre
des yeux ; car toute son argenterie était étalée sur une table ; le lazzaroni l'avait très bien vue, et pourtant le pauvre homme bornait son larcin au morceau de
boeuf qu'il emportait.
Je fis mes adieux à cette belle mer de Naples, à ce charmant coteau de Pausilippe, à ce terrible Vésuve, et je partis pour revoir une troisième fois ma chère
Rome, et pour admirer encore Raphaël dans toute sa gloire. Là j'entrepris de nouveau un grand nombre de portraits, ce qui me satisfaisait médiocrement, à dire
vrai. J'avais regretté à Naples, et je regrettais surtout à Rome de ne pas employer mon temps à faire quelques tableaux dont les sujets m'inspiraient. On m'avait
nommé membre de toutes les académies de l'Italie, ce qui m'encourageait à mériter des distinctions aussi flatteuses, et je n'allais rien laisser dans ce beau
pays qui pût ajouter beaucoup à ma réputation. Ces idées me revenaient souvent en tête ; j'ai plus d'une esquisse dans mon portefeuille, qui pourraient en
fournir la preuve ; mais, tantôt le besoin de gagner de l'argent, puisqu'il ne me restait pas un sou de tout ce que j'avais gagné en France ; tantôt la faiblesse
de mon caractère, me faisait prendre des engagements, et je me séchais à la portraiture. Il en résulte qu'après avoir dévoué ma jeunesse au travail, avec une
constance, une assiduité, assez rares dans une femme, aimant mon art autant que ma vie, je puis à peine compter quatre ouvrages (portraits compris) dont je sois
réellement contente.
Plusieurs des portraits que je fis néanmoins pendant mon dernier séjour à Rome me procurèrent quelques satisfactions, entre autres, celle de revoir Mesdames de
France, tantes de Louis XVI, qui, dès qu'elles furent arrivées, me firent venir et me demandèrent de les peindre. Je n'ignorais pas qu'une femme artiste, qui
s'est toujours montrée mon ennemie, je ne sais pourquoi, avait essayé, par tous les moyens imaginables, de me noircir dans l'esprit de ces princesses ; mais
l'extrême bonté avec laquelle elles me traitèrent m'assura bientôt du peu d'effet qu'avaient produit ces viles calomnies. Je commençai par faire le portrait de
madame Adélaïde ; je fis ensuite celui de madame Victoire.
Cette princesse, en me donnant sa dernière séance, me dit : «Je reçois une nouvelle qui me comble de joie ; car j'apprends que le roi est parvenu à sortir de
France, et je viens de lui écrire, en mettant seulement sur l'adresse : À Sa Majesté le roi de France. On saura bien le trouver,»
ajouta-t-elle en souriant.
Je rentrai chez moi bien contente, et j'annonçai cette heureuse nouvelle à la gouvernante de ma fille, qui pensait comme moi ; mais dans la soirée nous
entendîmes chanter mon domestique, homme très morose, qui ne chantait jamais, et que nous connaissions pour être révolutionnaire. Nous nous disons aussitôt : «Il
est arrivé quelque malheur au roi !» ce qui ne nous fut que trop confirmé le lendemain, quand nous apprîmes l'arrestation à Varennes, et le retour à Paris. La
plupart de nos domestiques étaient vendus aux jacobins pour nous épier, ce qui peut expliquer comment ils étaient mieux instruits que nous de tout ce qui se
passait en France ; d'ailleurs beaucoup d'entre eux allaient attendre l'arrivée du courrier, qui leur en disait beaucoup plus que nous n'en apprenions par nos
lettres.
CHAPITRE VIII.
Je quitte Rome. La cascade de Terni. Le cabinet de Fontana à Florence. Sienne. Sa cathédrale. Parme. Ma sibylle. Mantoue. Jules Romain.
Je quittai Rome le 14 avril 1792. En montant en voiture, je pleurais amèrement. J'enviais le sort de tous ceux qui restaient, et sur la route, je ne pouvais
rencontrer des voyageurs sans m'écrier : «Ils sont bien heureux ceux-ci, ils vont à Rome !»
J'allai coucher le premier jour à Civita-Castellana. En sortant de cette ville, le lendemain, nous vîmes de superbes rochers, puis nous
entrâmes dans des gorges de montagnes où nous marchions au milieu des précipices ; en tout, ce pays me parut le plus triste du monde. Il n'en fut pas de même du
chemin qui conduit à Narni ; ce chemin est délicieux, des vallons remplis de vignes en berceaux, des haies de genêts et de chèvre-feuilles en fleurs ; tout cela
réjouissait les yeux. Plus loin, à la vérité, nous retrouvâmes des montagnes de l'aspect le plus austère et le plus sauvage, dont les cyprès et quelques vieux
pins font le principal ornement. Ces rochers nous enveloppèrent jusqu'à Narni ; mais à peine a-t-on traversé cette ville, dont l'aspect
est très pittoresque, que l'on jouit du plus magnifique coup d'oeil. La scène a complètement changé : la route plonge sur la plus belle et la plus riche vallée,
où s'étend à perte de vue une rivière bordée de peupliers ; de la hauteur où nous étions, cette rivière semblait un petit ruisseau argenté, tant l'espace à
travers lequel elle serpente est immense. Des monts lointains terminent l'horizon ; le soleil couchant éclairait leurs cimes, ce qui produisait un effet
enchanteur.
Nous passâmes devant trois grandes croix noires qui se détachaient sur le fond dont je parle, et dont l'immensité donnait à ces monuments religieux un tel
caractère, qu'ils me firent éprouver une sensation indicible. La seule chose que je puisse regretter, après avoir parcouru cette belle route, c'est de n'avoir
pas vu le pont d'Auguste, que mon voiturin, très mauvais cicerone, négligea de me faire remarquer.
Nous côtoyâmes cette superbe vallée jusqu'à Terni, où nous couchâmes, et le lendemain matin, quoique le temps fût très couvert, je voulus gravir la montagne pour
aller voir la fameuse cascade. Je partis avec ma fille, deux ânes, Germain, et deux petits bonshommes qui nous montraient le chemin. Brunette, une baguette à la
main, ne cessait de fouetter son âne et le mien, en sorte que, perçant le brouillard du matin, nous ne tardâmes pas à arriver sur le plateau qui mène à la
cascade. Là nous nous reposâmes sur un beau gazon enrichi de fleurs et d'arbres divers. Une seule petite maison, un troupeau, un berger, c'est tout ce que nous
trouvâmes dans ce lieu charmant, où l'on respire l'air le plus pur en jouissant de la plus belle vue du monde. J'aurais bien désiré avoir là ma chaumière ; je
m'y plaisais tant ! Il n'en fallut pas moins continuer notre chemin pour aller voir la cascade. En traversant une roche coupée, nous approchâmes de ce large
torrent dont la chute est si imposante ; ensuite nous entrâmes dans un petit pavillon carré pour voir sous un autre aspect cette masse d'eau qui tombe
bouillonnante, et dont la vapeur nous environnait. Ensuite nous descendîmes dans la grotte antique où jadis passait la cascade. On ne peut rien voir d'aussi
curieux que les différentes pétrifications qui s'y trouvent ; elles ressemblent en grand à celles que l'on observe à Tivoli. Je dessinai l'entrée si pittoresque
de cette grotte, et je m'emparai de quelques petits morceaux pétrifiés.
Ma curiosité sur la cascade n'étant pas encore satisfaite, et le temps se trouvant favorable, car le soleil commençait à percer les nuages, je descendis au bord
de la rivière, formée par cet énorme torrent, pour jouir d'un point de vue dont mon imagination s'était flattée ; j'espérais voir en face la chute d'eau, mais je
ne la vis qu'en partie. Il est vrai que j'en fus dédommagée par le spectacle qu'offre cette grande nappe du bas, et le chemin qui y conduit. À gauche étaient des
rochers ornés et nuancés par mille arbustes en fleurs ; à droite, sur la rivière courante, de petites îles garnies d'arbres légers, qui forment des bocages
charmants. Toutes ces îles sont séparées par des cascades multipliées, dont l'eau ruisselait et brillait comme des diamants au soleil, qui avait alors tout son
éclat. Il était midi, et la chaleur était si forte que, lorsqu'il nous fallut remonter les rochers pour aller retrouver nos ânes, que nous avions laissés à trois
milles de là, j'étais anéantie de fatigue. Brunette n'en pouvait plus ; enfin nous parvînmes à rejoindre nos montures qui nous rapportèrent à Terni pour dîner.
Les campagnes de Terni sont riches et belles, la ville est bien bâtie ; mais, soit dans les églises, soit ailleurs, je n'ai rien trouvé de bien remarquable,
sinon les restes des fondations d'un grand temple antique.
Je ne restai qu'un jour à Terni. Le lendemain, nous passâmes la Somma, une des plus hautes montagnes des Apennins. Je me rappelle qu'en la descendant, nous vîmes
dans une tour, près du chemin, plusieurs bergères qui chantaient en choeur une musique suave et délicieuse ; ces bonnes fortunes ne sont pas rares en Italie.
Le soir j'arrivai à Spolète, et j'allai voir le lendemain l'Adoration des Rois, grande composition de Raphaël : ce tableau, n'étant pas terminé, indique
parfaitement la méthode du divin maître : Raphaël peignait d'abord les têtes et les mains ; quant à ses draperies, il en essayait d'abord les tons avant de les
terminer.
On voit sur la montagne, à Spolète, le temple de la Concorde, dont les beaux fragments antiques sont arrangés avec symétrie les uns sur les autres. Les colonnes,
leurs chapiteaux, sont du plus beau travail grec. On voit aussi dans cette ville un superbe aqueduc d'une hauteur immense.
Après Spolète, nous allâmes à Trévi, à Cétri, puis nous nous arrêtâmes à Foligno. Là, je trouvai encore un tableau de Raphaël, un des plus beaux et des plus
originaux qu'il ait faits ; il représente la Vierge sur des nuages, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. L'enfant est plein de naïveté et semble en relief ; la
Vierge est d'une noblesse du plus grand style ; le saint Jean, le cardinal placé à gauche, sont peints tout-à-fait dans le genre de Vandick, et les autres
figures sont aussi d'une grande vérité.
Comme j'arrivais à Perruge, qui est une belle et célèbre ville, où il reste quelques fortifications et quelques tombeaux antiques, on me décida à aller voir le
combat d'un taureau contre des chiens. Ce spectacle, qui n'a lieu que tous les cinq ou six ans en mémoire d'une sainte, se donne dans une espèce d'arène, à la
manière des anciens ; je puis dire qu'il ne me réjouit pas du tout.
En sortant de Perruge, on trouve des campagnes charmantes, que nous traversâmes pour aller dîner en face du lac Trasimène ; puis, nous allâmes à Cise
, où l'on voit sur la montagne une grande forteresse surmontée d'une tour, et plus haut encore, tout-à-fait sur la cime, une abbaye ; enfin, à la Combuccia, Arezzo, Levane et Pietre-Fonte, pour arriver à Florence.
Ce fut pour moi une grande jouissance, dès que je me retrouvai dans cette ville, d'aller revoir tant de chefs-d'oeuvre auxquels je n'avais pu donner qu'un coup
d'oeil en passant pour aller à Rome. J'entrepris aussitôt une copie du portrait de Raphaël, que je fis avec amour, comme disent les
Italiens, et qui depuis, n'a jamais quitté mon atelier.
Un souvenir de Florence qui m'a poursuivie bien longtemps, est celui de la visite que je fis alors au célèbre Fontana. Ce grand anatomiste, comme on sait, avait
imaginé de représenter jusque dans les moindres détails, l'intérieur du corps humain, dont toutes les parties sont si ingénieuses et si sublimes. Il me fit voir
son cabinet, qui était rempli de pièces d'anatomie, faites en cire couleur de chair. Ce que j'observai d'abord avec admiration, ce sont tous les ligaments
presque imperceptibles qui entourent notre oeil, et une foule d'autres détails particulièrement utiles à notre conservation ou à notre intelligence. Il est bien
impossible de considérer la structure du corps de l'homme, sans être persuadé de l'existence d'une divinité. Quoi que aient osé dire quelques misérables
philosophes, dans le cabinet de M. Fontana il faut croire et se prosterner. Jusqu'ici je n'avais rien vu qui m'eût fait éprouver une sensation pénible ; mais,
comme je remarquais une femme couchée de grandeur naturelle, qui faisait véritablement illusion, Fontana me dit de m'approcher de cette figure, puis, levant une
espèce de couvercle, il offrit à mes regards tous les intestins, tournés comme sont les nôtres. Cette vue me fit une telle impression, que je me sentis près de
me trouver mal. Pendant plusieurs jours, il me fut impossible de m'en distraire, au point que je ne pouvais voir une personne sans la dépouiller mentalement de
ses habits et de sa peau, ce qui me mettait dans un état nerveux déplorable. Quand je revis M. Fontana, je lui demandai ses conseils pour me délivrer de
l'importune susceptibilité de mes organes. - J'entends trop, lui dis-je, je vois trop et je sens tout d'une lieue. - Ce que vous regardez comme une faiblesse, me
répondit-il, c'est votre force et c'est votre talent ; d'ailleurs, si vous voulez diminuer les inconvénients de cette susceptibilité, ne peignez plus. On croira
sans peine que je ne fus pas tentée de suivre son conseil ; peindre et vivre n'a jamais été qu'un pour moi, et j'ai bien souvent rendu grâce à la Providence de
m'avoir donné cette vue excellente, dont je m'avisais de me plaindre comme une sotte au célèbre anatomiste.
De Florence, je me rendis à Sienne, et je n'ai jamais oublié la charmante soirée que j'ai passée en arrivant dans cette ville, où je ne suis restée que très peu
de temps. Mon habitude a toujours été, dès que je descends dans une auberge, et que j'ai commandé mon souper, d'aller faire une petite course à pied, qui me
délasse de la voiture. Le soleil allait se coucher quand je partis pour me promener dans les environs de Sienne, et pour reconnaître les lieux. Assez près de mon
auberge, j'aperçois une porte ouverte, qui me laisse voir un enclos et un assez grand canal ; je descends la marche de cette porte, et je m'assieds dessus pour
respirer la fraîcheur, dont j'avais grand besoin. Là, j'entendis bientôt un concert nature, que les nôtres sont bien loin d'égaler. Divers bruits harmonieux me
berçaient délicieusement ; à gauche, c'était celui de la cascade qui alimentait le canal ; puis un léger vent agitait les branches des énormes peupliers plantés
sur le bord de l'eau ; et mille oiseaux par leurs chants, faisaient leurs adieux au jour. Une pluie fine se mit à tomber à petit bruit sur les feuilles ; mais
bien loin qu'elle me fît déloger, elle me sembla si bien d'ensemble avec toute cette douce musique, que, pendant plus de deux heures, j'oubliai mon souper. La
fille de l'auberge, après m'avoir cherchée longtemps, finit par me trouver là, et vint m'arracher à mes jouissances. Si les propriétaires de ce bel enclos
lisent par hasard ceci, et qu'ils reconnaissent les lieux, je les remercie aujourd'hui du plaisir qu'ils m'ont procuré à leur insu.
Le lendemain je fis quelques courses dans la ville, qui est très belle et très bien située, sur une hauteur. On y voit des palais et des maisons gothiques ;
entre autres la maison de sainte Catherine et celle de je ne sais quel saint. L'hôtel-de-ville renferme des peintures antiques ; les Augustins, une fort belle
bibliothèque, et la superbe église bâtie par Vauvitelli, où se trouvent des tableaux de Romanelli, de Carlo Maratte et de Pietre Pérugin ; mais ce qu'on peut
admirer avant tout, c'est la cathédrale. Cette belle église est gothique, extrêmement vaste, et revêtue de marbre en dedans et en dehors. Sa voûte est couleur
d'azur, parsemée d'étoiles d'or ; les vitres du haut sont toutes peintes, et le pavé même est remarquable en ce que les sujets de l'Ancien-Testament y sont
tracés. Elle est ornée par douze statues en marbre, représentant les douze apôtres, par de belles fresques, par des tableaux du Calabrèse, du Pérugin, etc., et
plusieurs des chapelles ont été décorées par le Bernin.
Dès que je fus revenue à Parme, où je n'avais passé que très peu de jours, en allant à Rome, on m'y reçut de l'Académie, à qui je donnai une petite tête que je
venais de faire d'après ma fille. Dans la même semaine j'éprouvai aussi dans cette ville une satisfaction non moins vive. J'emportais avec moi le tableau de la
Sibylle que j'avais fait à Naples, d'après lady Hamilton ; mon projet était de le rapporter en France, où je comptais alors rentrer bientôt. Comme ce tableau
était encore fraîchement peint, en arrivant à Parme, pour qu'il ne jaunisse pas, je le mis au jour sous châssis, attaché seulement dans l'une de mes chambres. Un
matin, j'étais à faire ma toilette quand on m'annonça que sept à huit élèves peintres venaient me faire une visite. On les fit entrer dans la chambre où se
trouvait placée ma Sibylle, et quelques minutes après j'allai les y recevoir. Après m'avoir parlé de tout le désir qu'ils avaient eu de me connaître, ils me
dirent qu'ils seraient heureux de voir quelques-uns de mes ouvrages. - Voici un tableau que je viens de finir, répondis-je en montrant la Sibylle. Tous
témoignèrent d'abord une surprise bien plus flatteuse que n'auraient pu l'être des paroles ; plusieurs s'écrièrent qu'ils avaient cru ce tableau fait par un des
maîtres de leur école, et l'un d'eux se jeta à mes pieds, les larmes aux yeux. Je fus d'autant plus touchée, d'autant plus contente de cette épreuve, que ma
Sibylle a toujours été un de mes ouvrages de prédilection. Les lecteurs, en lisant ce récit, m'accusent peut-être de vanité : je les supplie de réfléchir qu'un
artiste travaille toute sa vie pour avoir deux ou trois moments pareils à celui dont je parle.
Je restai quelques jours à Parme pour revoir les églises, la bibliothèque, le théâtre, qui est bâti par Vignola, et rappelle tout-à-fait l'antique ; c'est grand
dommage qu'il n'ait pas été plus soigné ; quoiqu'il soit immense, il ne s'y perd pas un son. Je vis là des danseurs qu'on devrait appeler des
tourneurs ; car ils ne faisaient pas un seul pas, et ne cessèrent de tourner comme des totons.
Je visitai aussi tous les palais qu'on me dit renfermer des objets d'arts ; dans l'un d'eux, je ne sais lequel, je vis des plafonds d'Allegrini admirables. Je ne
pouvais contempler tant de belles collections particulières, sans regretter que ce beau luxe, ce luxe de si bon goût, n'existât point en France. On peut à peine
compter à Paris trois ou quatre cabinets d'amateurs, et combien encore diffèrent-ils de ceux des seigneurs italiens !
Je quittai Parme le 1er juillet 1792 ; la nature alors était dans toute sa beauté, et ma sortie de la ville m'offrit le coup d'oeil de la plus belle campagne
qu'on puisse voir. Sans doute le beau ciel de l'Italie aide à la magie du spectacle ; néanmoins, ces prairies à perte de vue, parsemées d'arbres, autour desquels
la vigne grimpe en s'entrelaçant ; ces mille ruisseaux serpentant dans de riches vallons que terminent de hautes montagnes ou des collines boisées ; ce grand
chemin bordé de chênes, qui souvent sont baignés par des canaux dont mille fleurs champêtres ornent les bords ; tout cela ravirait sous quelque ciel que ce fût.
Je voulus aller à Mantoue, qui méritait bien une visite, et comme patrie de Virgile, et comme aînée du Capitole, car on prétend qu'elle a été bâtie par les
Étrusques ou Toscans, trois cents ans avant la fondation de Rome. Cette ville, située au milieu d'un lac formé par le Mincio, est grande et belle. Sa magnifique
cathédrale est de Jules Romain, qui, comme on sait, était à la fois peintre, architecte et sculpteur. Jules Romain et le Primatice ont enrichi Mantoue de
chefs-d'oeuvre en tout genre. Toutes les salles du palais ducal sont ornées par ces deux grands peintres et par Gonzalès. Ce palais est immense et l'un des plus
riches que l'on puisse voir sous le rapport des arts.
On vous fait voir à Mantoue la maison de Jules Romain ; elle est située en face du palais Gonzalès, qui est construit aussi sur les dessins de ce célèbre maître.
Il y a à Mantoue une Académie des beaux-arts et un musée de statues. L'église Saint-André renferme plusieurs beaux monuments, et la bibliothèque de nombreux
manuscrits. Le palais du T. est aussi très remarquable par les peintures à fresque de Jules Romain et du Primatice. Ces fresques représentent des sujets
héroïques et l'histoire de Psyché.
Jules Romain est mort à Mantoue en 1546 ; mais son nom vit encore avec toute sa gloire dans cette ville, où il a laissé un plus grand nombre de chefs-d'oeuvre
que partout ailleurs.
CHAPITRE IX.
Venise. M. Denon. Le mariage du doge avec la mer. Madame Marini. Les palais. Le Tintoret. Paccherotti. Improvisateur. Le cimetière. Vicence. Padoue. Vérone. Les conversazione.
Je brûlais du désir de voir Venise, où j'arrivai la veille de l'Ascension. Quoi qu'il m'eût été dit jusque alors sur l'aspect extraordinaire de cette ville,
mes yeux seuls m'en donnèrent la juste idée, et j'avoue qu'il me surprit autant qu'il me charma. À la première vue on croit n'apercevoir qu'une ville submergée ;
mais bientôt ces superbes palais, bâtis dans le style gothique, dont ces beaux canaux baignent les murs, offrent l'effet le plus grandiose et le plus ravissant
par son originalité. J'admirai beaucoup le pont du Rialto qui est d'une seule arche de quatre-vingt-neuf pieds de longueur, et je me
souviens qu'en passant dessus, je vis un pauvre homme, bien vieux, raclant sur un mauvais violon, et faisant chanter un petit garçon de cinq ou six ans qui
sanglotait. Peut-être ce pauvre enfant mourait-il de faim ; aussi je m'empressai de lui donner une petite somme ; car sous ce beau ciel et dans cette belle
ville, je voulais que tout le monde chantât gaiement. De même, je fus quelque temps sans m'accoutumer à cette quantité de barques noires qui remplacent les
voitures, et dans lesquelles on s'embarque et l'on débarque continuellement à la porte de toutes les maisons. J'aurais voulu que leur couleur fût moins triste ;
mais les ambassadeurs seuls ont des barques de toutes les couleurs.
M. Denon, que j'avais connu à Paris, ayant appris mon arrivée, vint me voir aussitôt. Son esprit et ses connaissances dans les arts faisaient de lui le plus
aimable cicerone, et je me réjouis beaucoup de cette rencontre. Dès le lendemain, jour de l'Ascension, il me conduisit sur le canal où
se faisait le mariage du doge avec la mer. Le doge et tous les membres du sénat étaient sur un bâtiment doré en dedans et en dehors, appelé le
Bucentaure ; mille barques dont plusieurs portaient des musiciens, l'entouraient. Le doge et les sénateurs étaient vêtus de noir et coiffés de perruques
blanches à trois marteaux. Lorsque le Bucentaure fut arrivé au lieu fixé pour la célébration du mariage, le doge tira de son doigt un
anneau qu'il jeta dans la mer, et dans le même instant, mille coups de canon instruisirent la ville et ses environs de cet hymen solennel, qui se termine par une
messe.
Une foule d'étrangers assistaient à cette cérémonie. Je trouvai là, entre autres, le prince auguste d'Angleterre, ainsi que la charmante princesse Joseph Monaco,
qui s'apprêtait alors à retourner en France pour retrouver ses enfants, et que j'ai revue à Venise pour la dernière fois.
Le soir de la fête, nous allâmes voir la lutte des gondoliers. On ne saurait se faire une idée de l'adresse et de l'activité de cette espèce d'hommes ; c'est un
spectacle fort amusant. Plus tard, la place Saint-Marc fut illuminée ainsi que la foire qui l'entoure. L'illumination et la foire ont lieu pendant quinze jours.
Le lendemain, M. Denon me présenta à son amie, madame Marini, qui depuis a épousé le comte Albridgi. Elle était aimable et spirituelle. Le soir même, elle me
proposa de me mener au café, ce qui me surprit un peu, ne connaissant pas l'usage du pays ; mais je le fus bien davantage quand elle me dit : «Est-ce que vous
n'avez point d'ami qui vous accompagne ?» Je répondis que j'étais venue seule avec ma fille et sa gouvernante. «Eh bien, reprit-elle, il faut au moins que vous
ayez l'air d'avoir quelqu'un ; je vais vous céder M. Denon, qui vous donnera le bras, et moi je prendrai le bras d'une autre personne ; on me croira brouillée
avec lui, et ce sera pour tout le temps que vous séjournerez ici ; car vous ne pouvez pas aller sans un ami.»
Tout étrange qu'était cet arrangement, il me convint beaucoup, puisqu'il me donnait pour guide un de nos Français les plus aimables, non sous le rapport de la
figure, il est vrai, car M. Denon, même très jeune, a toujours été fort laid, ce qui, dit-on, ne l'a pas empêché de plaire à une grand nombre de jolies femmes.
Quoi qu'il en soit, mon ami me conduisit d'abord au palais pour y voir les chefs-d'oeuvre que Venise possède, et qui sont en grand
nombre. Dans la plus grande salle des bâtiments de la confrérie, on s'arrête avec délice devant les belles pages à fresques peintes par le Tintoret. Le
Crucifiement surtout est admirable, et ce n'est qu'à Venise qu'on peut apprécier ce grand peintre, qui réunit dans ses belles compositions le dessin, la couleur
et l'expression. Il faut aussi remarquer, dans la première salle, la Fuite en Égypte : le paysage en est superbe.
Nous visitâmes ensuite les églises, qui sont remplies des plus beaux ouvrages du Tintoret, de Paul Véronèse, des Bassan et du Titien. C'est dans l'église de
Saint-Jean et Saint-Paul, qu'on voit le martyre de saint Pierre, composé de trois figures et de deux anges ; toutes ces figures sont pleines d'expression, et le
paysage est ravissant. L'église Saint-Marc, dont le lion est le symbole, est du style gothique. Les arcs de la façade sont soutenus par une quantité de colonnes
en marbre et en porphyre ; les chevaux dorés, si fameux, ajoutent à ces ornements ; mais ces chevaux, quoique antiques, sont bien loin d'être parfaits.
(nb) On les a vus à Paris.
Quant à l'intérieur de l'église, il est impossible de détailler toutes les richesses qu'il renferme en tout genre ; ces voûtes d'or, ces parois de jaspes, de
porphyre, d'albâtre, de vert antique, ces tableaux, ces bas-reliefs, font de Saint-Marc un véritable trésor.
M. Denon me mena aussi chez un ancien sénateur ; nous vîmes là une belle Danaé du Corrége, sujet que ce peintre a répété plusieurs fois, et douze portraits au
pastel de la Rosalba, qui sont admirables pour la couleur et la vérité. Ces portraits étant ceux de la famille du sénateur, n'ont jamais été déplacés, et ils
sont conservés à tel point, qu'ils ont encore toute leur fraîcheur. Un seul suffirait pour rendre un peintre célèbre.
La société que je fréquentais le plus à Venise était celle de l'ambassadrice d'Espagne, qui avait mille bontés pour moi. Elle me mena au spectacle pour le début
d'une belle actrice âgée de quinze ans au plus, que son chant et surtout son expression, rendaient étonnante. J'assistai aussi au dernier concert que donnait
Paccherotti, ce célèbre chanteur, modèle de la grande et belle méthode italienne. Il avait encore tout son talent ; mais depuis le jour dont je parle, il n'a
jamais chanté en public. Je puis dire néanmoins qu'aucune musique n'égalait celle que j'ai entendue de même à Venise dans une église. Elle était exécutée par des
jeunes filles, et ces chants si simples, si harmonieux, chantés par des voix si belles et si fraîches, semblaient vraiment célestes ; les jeunes filles étaient
placées dans des tribunes élevées et grillées ; on ne pouvait les voir, en sorte que cette musique venait du ciel, chantée par des anges.
Après le concert de Paccherotti, on nous prévint qu'il y avait, dans une salle près du théâtre, un improvisateur fameux. Je n'en avais jamais entendu, et cet
homme me fit l'effet d'un énergumène ; il courait de long en large, criant ses improvisations d'une telle force, qu'il en suait à grosse goutte ; il débitait si
vite outre cela, que ma fille, qui parlait fort bien l'italien, n'entendait pas un mot. Il nous faisait peur, tant il avait l'air furieux ; quant à moi, je le
crus fou, et tout son talent me parut se réduire à une pantomime effrayante.
M. Denon, ayant vu ma Sibylle, me pria instamment de la lui laisser exposer chez lui, afin de la montrer à ses connaissances. Il s'ensuivit que beaucoup
d'étrangers allèrent voir ce tableau, qui eut du succès à Venise, à ma vive satisfaction. M. Denon m'avait aussi priée de faire le portrait de son amie, madame
Marini, et je pris grand plaisir à peindre cette jolie femme, attendu qu'elle avait infiniment de physionomie.
Avant de quitter Venise, je voulus voir le fameux cimetière qui est situé aux environs de la ville. Un ami de M. Denon m'offrit de m'y conduire, et nous
convînmes de faire cette course au clair de lune. Le soir même nous prîmes une barque qui nous conduisit en face du cimetière des Anglais. Celui-ci est fort
simple ; les tombes sont de pierre ou de marbre blanc, toutes debout. La lune, entourée de nuages, cessait parfois de donner sa lumière, et ces tombes alors
paraissaient se mouvoir.
Notre but principal était d'entrer dans l'enceinte des tombeaux vénitiens, dont la plupart datent de la fondation de Venise ; mais, hélas ! la porte était
fermée. Nous fîmes une partie du tour de l'enceinte, et nous eûmes le bonheur de trouver un pan de mur abattu. Nous profitâmes aussitôt des pierres tombées pour
en former un escalier qui nous facilita l'entrée de ce vaste séjour des morts. L'aspect de ce lieu vénérable nous imposa le plus profond silence. Nous marchâmes
en tous sens à travers ces tombes colossales dont nous ne pouvions apprécier les détails à la pâle clarté de la lune, et quand nous eûmes vu tout ce qu'il nous
était possible de voir, nous pensâmes à retourner à Venise ; mais il fallait pour cela retrouver notre brèche. Pendant près d'une heure nous la cherchâmes
inutilement. Aucune habitation n'est voisine du cimetière ; nous entendions seulement la cloche d'une église assez lointaine, dont le son était fort
mélancolique. Nous ne trouvions pourtant pas très gai de rester là toute la nuit. Enfin j'aperçus la brèche, et nous sortîmes, charmés d'aller retrouver des
vivants. Nous ne rencontrâmes que deux soldats en faction, qui nous laissèrent passer sans crier qui vive ! Ils nous prirent sans doute
pour deux amants, ce qui est toujours fort respecté en Italie. Nous nous hâtâmes de rejoindre notre barque, et nous ne rentrâmes dans la ville qu'à trois heures
du matin.
J'ai conservé de Venise un souvenir agréable, quoique depuis j'y aie perdu trente-cinq mille francs ; voici comment : j'avais placé sur sa banque mes économies
de Rome et de Naples, que ma négligence m'empêcha de retirer à temps. M. Sacaut, que j'avais connu à Naples secrétaire d'ambassade auprès du baron de Talleyrand,
et qui sous la république a été ministre de France à Florence, avait la bonté de s'occuper de mes affaires, afin que je pusse me livrer entièrement à ma peinture
; comme il prévoyait mieux que moi ce qui devait bientôt se passer en Europe, il ne cessait de me conseiller d'écrire à Venise pour retirer mes fonds. «Bah ! lui
disais-je, des républicains n'attaqueront pas une république.» Il vint un matin, entre autres, comme il se trouvait sur ma table plusieurs lettres que je venais
d'écrire pour Paris. «J'espère bien, dit-il, que vous avez là une lettre pour Venise ? - Non. - À qui donc écrivez-vous tout cela ? - À mes amis. - Est-ce qu'il
y a des amis ? répondit-il en hochant la tête.» On voit que le bon monsieur Sacaut n'était pas sentimental ; mais il était mon maître en prudence et en politique
; car lorsque l'armée française, commandée par le général Bonaparte, s'empara de Venise, les chevaux dorés, les tableaux, les trésors furent emportés ainsi que
la banque. J'appris que Bonaparte avait dit à M. Haler, le banquier, qu'il voulait que l'on conservât mes fonds, et que l'on m'en payât la rente ; mais, ainsi
qu'il arrive souvent en pareil cas, Bonaparte éloigné, les assertions réitérées de M. Haler ne purent faire respecter l'ordre du général ; mon argent fut
transporté à Milan, et je n'ai jamais touché qu'un revenu de deux cent cinquante francs pour un fonds de quarante mille. Venise n'en est pas moins une ville bien
curieuse à voir, et que je suis charmée d'avoir vue.
Je m'arrêtai à Vicence, qui date sa fondation de 380 ans avant J.-C. Ses beaux palais, parmi lesquels on remarque celui des comtes Chieracati, ont pour la
plupart été bâtis par le Palladio, et sont d'une élégance remarquable. La rotonde du marquis de Capra mérite aussi d'être citée. Elle est située sur une
éminence, et Palladio en a fait un temple, aux quatre côtés duquel se trouvent quatre péristyles, ayant chacun six colonnes qui soutiennent un fronton. Au milieu
est une salle ronde, entourée d'une galerie qui joint ces péristyles, dont les quatre points de vue sont admirablement diversifiés.
À la Madone del Monte, on plane sur de belles campagnes, enrichies des plus beaux arbres. Dans l'intérieur de cette église, on voit un magnifique tableau de Paul
Véronèse ; il est d'une si belle couleur, et peint avec une telle vérité, que les figures se détachent du fond. À Sainte-Corone, le Baptême de Jésus, par Jean
Bellin, est parfait pour le dessin.
Le théâtre de Vicence est du style antique. C'est le chef-d'oeuvre du Palladio, qui l'a construit d'après les proportions et sur les dessins de Vitruve.
La traversée de la Brenta offre l'aspect le plus agréable. D'un côté, ses bords sont ornés d'une multitude de palais du style de Palladio, qui font l'effet de
temples, et dont les formes grandioses se répètent dans les eaux.
Je suis allée dîner dans l'un de ces palais, chez le marquis *** ; l'escalier même était d'un style qui me charma. Le propriétaire de cette belle habitation me
fit une galanterie à laquelle j'étais loin de m'attendre ; il me reçut dans une galerie où se trouvait posé, sur une table, une très grande quantité de gravures
; une seule était placée sens dessus dessous sur toutes les autres ; la curiosité me porta bien vite à la retourner, et je vis mon portrait que l'on venait de
graver d'après celui que j'avais donné à Florence.
On voit encore à Vicence la maison du Palladio, qui est un modèle d'élégance et de simplicité.
Padoue est aussi situé sur les bords de la Brenta. Cette ville est bien ancienne, s'il faut en croire les habitants qui prétendent qu'elle a été bâtie par
Antenor le Troyen. Le palais de justice ou l'hôtel-de-ville, est une des plus belles fabriques de l'Europe. Le salon a cent pas de long sur quarante de large ;
il est couvert de plomb, sans autre soutien que la muraille ; on y voit les douze signes du zodiaque, et dans une niche, une Vierge qui a beaucoup de simplicité
et de naturel.
On trouve aux Augustins des fresques de Montigni, dont les figures et tous les accessoires sont de la plus grande finesse. L'église Saint-Antoine, qui est de
style gothique, renferme un nombre infini de tombeaux, de bas-reliefs, et tant de marbre travaillé qu'elle en est fatigante ; mais les fresques de Gioto, qu'on y
voit, sont très bien composées ; l'attitude simple et l'expression des figures se rapprochent du style des anciens. La couleur est souvent celle du Titien, sans
pourtant en avoir la perfection. En sortant du cloître, on remarque plusieurs tombeaux très anciens, dont les figures sont pleines de simplicité, et la statue
équestre d'Érasme de Narni, général vénitien.
Dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, on admire les Évangélistes dans le désert, un des plus beaux tableaux du Guide ; à la cathédrale, dans la sacristie, une
Vierge du Titien, bien conservée ; à Saint-Jean, plusieurs fresques du Titien, représentant divers miracles. Les têtes, pleines d'expression, sont d'une belle
couleur, et la touche, le ton du paysage et du ciel, sont admirables. Une autre fresque gothique est aussi très remarquable par la vérité des têtes et l'attitude
des personnages.
Je passai toute une semaine à Vérone ; c'est une grande ville, dont les rues sont spacieuses et bien alignées, et les maisons fort belles. J'allai voir d'abord
les restes de l'amphithéâtre, qui a été bâti sous le règne d'Adrien, et que les Gaulois ont détruit ; puis le dôme de l'église, qui est fort belle, et dans
laquelle se trouve un tombeau antique, dont les ornements sont du plus fin travail. Comme, en Italie, les églises sont ouvertes toute la journée, je fis ma
tournée. J'entrai dans celle de Saint-Georges, où le maître-autel est décoré d'un beau tableau de Paul Veronèse, et d'un autre tableau de ce peintre, à droite en
entrant. J'y vis aussi une Vierge et deux évêques de Chieralino, ainsi qu'un groupe d'anges ; mais ce que je remarquai surtout du même maître, est un tableau de
trois figures qui représente un concert ; outre qu'il est peint avec le plus grand soin, les figures sont pleines de grâce et de naïveté.
L'église de Sainte-Amastrasie est tout-à-fait de style gothique, avec des colonnes d'une belle proportion, qui produisent un grand effet ; toutefois, je lui
préfère celle de Saint-Zemon. Celle-ci est très vaste, et le jour, qui l'éclaire seulement par en haut, lui donne un aspect mystérieux et mélancolique. Je me
trouvais seule dans ce temple silencieux, et je me plaisais à me livrer aux idées religieuses et douces qui s'emparaient de mon âme.
Tous les soirs, pendant mon séjour à Vérone, j'allais à la Conversazione (on sait que c'est ainsi qu'on appelle les assemblées en
Italie) : là, nous étions réunis en assez grand nombre dans une galerie, les femmes assises de chaque côté, et les hommes se promenant au milieu. La vivacité, la
gesticulation italienne, rendent ces réunions assez piquantes à observer ; en outre, j'y rencontrais la comtesse Marioni, sa soeur, et la marquise de Strozi, qui
toutes trois étaient fort spirituelles.
Pendant les huit jours que j'ai passés à Vérone, j'ai délogé deux fois. Je m'étais d'abord installée dans un petit appartement, après avoir demandé si l'on n'y
entendait point de bruit. «Aucun,» avait répondu l'hôtesse. Voilà que le lendemain matin, à six heures, j'entends sur ma tête un bacchanal épouvantable : on
sautait, on jouait du violon ; je demande ce que ce peut être ? - Madame, me dit mon hôtesse, ce n'est rien de fâcheux. Le maître de danse de la ville loge ici
dessus, et tous les jours les jeunes gens viennent prendre leur leçon pendant deux heures, voilà tout. Je trouvai que c'était assez pour me décider à chercher
ailleurs.
CHAPITRE X.
Turin. La reine de Sardaigne. Madame, femme de Louis XVIII. Je m'établis dans la ferme de Porporati. Affreuses nouvelles de la France. Les émigrés. M. de Rivière vient me rejoindre. Je vais à Milan. La Cène de Léonard de Vinci. La Madone del Monte. Le lac Majeur. Je pars pour Vienne. M. et madame Bistri.
Mon désir étant de rentrer en France, je gagnai Turin dans cette intention. Mesdames de France, tantes de Louis XVI, quand je les avais peintes à Rome,
sachant que je devais repasser par Turin, avaient eu la bonté de me donner des lettres pour madame Clothilde, leur nièce, reine de Sardaigne. Elles lui mandaient
qu'elles désiraient beaucoup avoir son portrait fait par moi ; en conséquence, dès que je fus établie je me présentai chez Sa Majesté. Elle me reçut fort bien,
mais quand elle eut pris lecture des lettres de madame Adélaïde et de madame Victoire, elle me dit qu'elle était bien fâchée de refuser ses tantes ; mais,
qu'ayant renoncé entièrement au monde, elle ne se ferait pas peindre. Ce que je voyais d'elle, en effet, me semblait parfaitement d'accord avec ses paroles et sa
résolution ; cette princesse s'était fait couper les cheveux ; elle avait sur sa tête un petit bonnet qui, de même que toute sa toilette, était le plus simple du
monde. Sa maigreur me frappa d'autant plus que je l'avais vue très jeune, avant son mariage, et qu'alors son embonpoint était si prodigieux, qu'on l'appelait en
France le gros Madame. Soit qu'une dévotion trop austère, soit que la douleur que lui faisaient éprouver les malheurs de sa famille,
eût causé ce changement, le fait est qu'elle n'était plus reconnaissable. Le roi vint la rejoindre dans le salon où elle me recevait ; ce prince était de même si
pâle, si maigre, que tous deux faisaient peine à voir.
J'allai aussitôt chez Madame, femme de Louis XVIII. Non seulement elle me reçut à merveille, mais elle arrangea pour moi des courses pittoresques dans les
environs de Turin, qu'elle me fit faire avec sa dame de compagnie, madame de Gourbillon et le fils de cette dame. Ces environs sont très beaux ; mais notre début
en fait d'excursion ne fut pas très heureux. Nous nous mîmes en route par une chaleur extrême pour aller voir une chartreuse, qui est située sur de hautes
montagnes. Comme à moitié chemin cette montagne est très rapide, nous fûmes obligés de la gravir à pied, et je me souviens que nous passâmes devant une fontaine,
de l'eau la plus limpide, dont les gouttes brillaient comme des diamants, que les paysans nous dirent avoir une grande vertu pour plusieurs maladies.
Après avoir grimpé si longtemps que nous en étions exténués, nous arrivâmes enfin à la chartreuse, mourant de chaud et de faim. Le couvert était déjà mis pour
les religieux et pour les voyageurs, ce qui nous fit une grande joie ; car on peut juger que nous attendions le dîner avec impatience. Comme il tardait à venir,
nous pensions que l'on faisait de l'extraordinaire pour nous, attendu que madame nous recommandait aux religieux dans les lettres qu'elle nous avait données pour
eux. Enfin on servit d'abord un plat de grenouilles au blanc, que je pris pour une fricassée de poulet ; mais dès que j'en eus goûté, il me fût impossible d'en
manger, quelque faim que j'eusse. Puis on apporta trois autres plats, frits et grillés, sur lesquels je comptais beaucoup ; hélas ! ce n'était encore que des
grenouilles, si bien que nous ne mangeâmes que du pain sec, et ne bûmes que de l'eau, ces religieux ne buvant et ne donnant jamais de vin. Mon plus grand désir
alors aurait été d'obtenir une omelette ; mais il n'y avait point d'oeufs dans la maison.
Au retour de ma visite à cette chartreuse, je vis Porporati, qui voulut encore que j'allasse loger chez lui. Il me proposa d'habiter la ferme qu'il possédait à
deux lieues de Turin, où il avait quelques chambres très simples, mais commodes. J'acceptai cette offre avec joie, détestant habiter la ville, et j'allai
aussitôt m'établir avec ma fille et sa gouvernante dans ce réduit, qui me charma. La ferme était située en pleine campagne, entourée de prairies et de petites
rivières bordées d'arbres divers assez élevés, qui formaient de charmants bocages. Du matin au soir j'allais me promener avec délice dans des lieux enchanteurs
et solitaires ; mon enfant jouissait comme moi de cet air pur, de cette vie douce et tranquille que nous menions ; pour comble de bonheur, je n'entendais d'autre
bruit que celui d'un torrent qui était à une demi-lieue de là, et que j'allai voir. C'était une énorme chute d'eau qui tombait de roche en roche, et qu'entourait
un bois de haute futaie. Nous allions le dimanche à la messe par un chemin charmant ; la petite église avait un porche très joli, et là nous étions comme en
plein air : entouré de cette belle nature, il semble que l'on prie mieux. Le soir, mon spectacle favori était celui du soleil couchant, environné de ses beaux
nuages dorés et couleur de feu, espèce de nuages que l'on ne voit qu'en Italie. Ce moment était celui de mes méditations, de mes châteaux en Espagne ; je
m'abandonnais alors à la douce pensée de revoir bientôt la France, me berçant de l'espoir que la révolution devait enfin se terminer. Hélas ! ce fut dans cette
situation si paisible, dans cet état d'esprit si heureux, que le coup le plus cruel vint me frapper. La charrette qui apportait les lettres étant arrivée un
soir, le voiturier m'en remit une de mon ami M. de Rivière,
(nb) Frère de ma belle-soeur.
qui m'apprenait les affreux événements du 10 août, et me donnait des détails épouvantables. J'en fus bouleversée ; ce beau ciel, cette belle campagne, se
couvrirent à mes yeux d'un voile funèbre. Je me reprochai l'extrême quiétude, les douces jouissances que je venais de goûter ; dans l'angoisse que j'éprouvais
d'ailleurs, la solitude me devenait insupportable, et je pris le parti de retourner aussitôt à Turin.
En entrant dans la ville, que vois-je, mon Dieu ? les rues, les places encombrées d'hommes, de femmes de tout âge, qui se sauvaient des villes de France, et
venaient à Turin chercher un asile. Ils arrivaient par milliers, et ce spectacle était déchirant. La plupart d'entre eux n'emportaient ni paquets, ni argent, ni
même de pain ; car le temps leur avait manqué pour songer à autre chose qu'à sauver leur vie. On m'a cité depuis la duchesse de Villeroi, alors très âgée, que sa
femme de chambre, qui possédait une petite somme, venait de nourrir dans la route à raison de dix sous par jour. Les enfants criaient la faim à faire pitié ;
plusieurs femmes grosses, qui n'étaient jamais montées en charrette, n'avaient pu supporter les cahots et accouchaient avant terme. Enfin on ne saurait rien voir
de plus déplorable. Le roi de Sardaigne envoya des ordres pour qu'on logeât ces infortunés et qu'on leur donnât à manger ; mais il n'y avait point de place pour
tous. Madame fit aussi porter de nombreux secours ; nous parcourûmes la ville, accompagnés de son écuyer, cherchant des logements et des vivres pour ces
malheureux, sans pouvoir en trouver autant qu'il en fallait. Je n'oublierai jamais l'impression que me fit un ancien militaire décoré de la croix de Saint-Louis,
et qui pouvait avoir soixante-six ans. Il était encore bel homme, de l'aspect le plus noble. Appuyé contre une borne dans un coin de rue isolée, il ne demandait
rien à personne : il serait plutôt mort de faim, je crois, que de s'y décider, mais le malheur profond empreint sur sa figure appelait l'intérêt dès la première
vue. Nous allâmes droit à lui, nous lui donnâmes le peu d'argent qui nous restait, et l'infortuné nous remercia par des sanglots. Le lendemain il fut logé dans
le palais du roi, ainsi que plusieurs autres émigrés ; car il n'y avait plus de place dans la ville.
On peut juger combien le cruel spectacle que je venais de voir redoublait mes inquiétudes sur ce qui pouvait se passer à Paris. Il m'était impossible de me
calmer ; je ne vivais pas ; d'autant plus que je ne voyais point arriver M. de Rivière, qui m'avait écrit de l'attendre à Turin. Enfin l'instant qu'il avait fixé
pour me rejoindre était dépassé de quinze jours quand il arriva, si horriblement changé que j'avais peine à le reconnaître. Ce qu'il venait de voir se passer
sous ses yeux, en effet, était bien capable d'affecter à la fois l'esprit et le corps d'un homme ; il me raconta qu'au moment où il traversait le pont de
Beauvoisin, on y massacrait tous les prêtres, avec une fureur dont il ne saurait me donner une idée. Il avait été obligé de rester à Chambéry pour se faire
soigner d'une fièvre ardente, causée par les atrocités dont il avait été témoin.
Je n'osai qu'en tremblant demander des nouvelles de ma mère, de mon frère, de M. Lebrun et de tous mes amis. Cependant M. de Rivière me rassura un peu, en me
disant que ma mère ne quittait plus Neuilly, que M. Lebrun restait assez tranquille à Paris, et que mon frère et sa femme étaient cachés. Quant à mes amis et à
mes connaissances, le danger ne les avait point encore atteints ; mais beaucoup d'entre eux étaient inquiétés.
On imagine bien que je renonçai au projet d'aller à Paris. Je me décidai à rester à Turin, c'est-à-dire fort près de cette ville, pour être plus à portée des
nouvelles. En conséquence, je louai une petite maison (ce qu'on appelle une vigne) sur le coteau de Montcarlier, qui domine le Pô. M. de Rivière vint habiter
avec moi cette solitude, où nous ne pouvions rencontrer que de bons paysans, si pieux et si calmes, que ces braves gens réjouissaient le coeur et consolaient
l'esprit. Nous avions un clos, entouré de berceaux de vignes et de figuiers. Nous montions souvent la forêt qui était au-dessus de mon habitation ; plusieurs
sentiers nous menaient à de petites chapelles, situées de distance en distance sur la hauteur du coteau, dans lesquelles nous allions les dimanches entendre la
messe. J'avoue que les églises champêtres m'ont toujours vue prier avec plus de ferveur que les autres. Je me souviens que mon amie, madame de Verdun, me
grondait souvent de ne point me montrer assez assidue au service divin. Certes, si je n'allais pas en France régulièrement à la messe, ce n'est point par
irréligion ; mais dans les églises de Paris, où il y a foule, je ne suis pas assez à Dieu. J'y vois des couleurs, des draperies, une multitude d'expressions
diverses de physionomies, des effets de soleil ; enfin, comme la peinture m'y poursuit, je ne puis prier aussi bien que je le fais dans une église de village.
Le séjour que M. de Rivière fit dans cette solitude remit peu à peu sa santé. Quant à moi, je repris ma palette. Je peignis une baigneuse, d'après ma fille, et
je vendis tout de suite ce tableau au prince Ysoupoff, qui vint me trouver dans ma Thébaïde.
Quand je fus résolue à retourner à Milan, ne sachant comment reconnaître les bons soins que Porporati avait pris de moi, j'imaginai de lui faire le portrait de
sa fille, qu'il adorait avec raison. Il en fut si enchanté qu'il grava ce portrait aussitôt et m'en donna plusieurs charmantes épreuves.
À moitié chemin, sur la route de Milan, je fus arrêtée deux jours comme Française. J'écrivis tout de suite pour demander un permis de séjour, que le comte de
Wilsheck, ambassadeur d'Autriche à Milan, me fit obtenir. J'allai l'en remercier dès que je fus installée, et je fus reçue par lui avec autant de bonté que de
distinction. Il m'engagea beaucoup à me rendre à Vienne, m'assurant que ma présence y causerait une grande satisfaction. Comme les nouvelles que nous recevions
de France m'obligeaient d'ajourner indéfiniment mon retour à Paris, je ne tardai pas à me décider, ainsi qu'on le verra, à suivre ce conseil.
Je fus reçue à Milan de la manière la plus flatteuse ; le soir même de mon arrivée, les jeunes gens des premières familles de la ville vinrent me donner une
sérénade sous mes fenêtres. Je me contentais d'écouter avec grand plaisir, ne soupçonnant pas le moins du monde que je fusse l'objet de cette galanterie
italienne, quand mon hôtesse monta pour me le dire, et m'assurer de l'extrême désir que l'on avait de me garder dans la ville au moins pendant quelque temps.
Afin de témoigner ma reconnaissance d'un pareil accueil, je crus devoir m'établir pour plusieurs jours à Milan, où d'ailleurs je désirais voir les tableaux des
grands maîtres, et beaucoup d'autres choses curieuses.
Je visitai d'abord le réfectoire de l'église des Grazie, où se trouve la fameuse Cène, peinte sur mur par Léonard de Vinci. C'est un
des chefs-d'oeuvre de l'école italienne ; mais en admirant ce Christ, si noblement représenté, tous ces personnages, peints avec tant de vérité et de caractère,
je gémissais de voir un aussi superbe tableau altéré à ce point ; il a d'abord été couvert de plâtre, puis repeint dans plusieurs parties. Toutefois on pouvait
juger de ce qu'était cette belle composition avant ces désastres, puisque, vue d'un peu loin, elle produisait encore un effet admirable.
(nb) Depuis j'ai su que ce chef-d'oeuvre avait été bien autrement dégradé. On m'a dit que, pendant les dernières guerres de Bonaparte en Italie, les soldats s'amusaient à tirer des coups de fusils à balles dans la Cène de Léonard de Vinci ! Maudits soient ces barbares !
Je m'empressai, comme on peut le croire, d'aller voir les cartons de l'école d'Athènes, tracés par Raphaël, et je les contemplai longtemps avec délices. Puis je
trouvai aussi à la bibliothèque Ambroisine une collection de dessins très précieux ; car plusieurs sont de Raphaël, de Léonard de Vinci et d'autres grands
maîtres. Ces dessins ne sont point terminés, mais tout y est indiqué avec autant d'esprit que de sentiment ; plus finis, ils auraient perdu de leur piquante
originalité. On voit dans cette bibliothèque Ambroisine une grande quantité de médailles antiques, les plus intéressants manuscrits et des trésors en pierres
rares et en marbres précieux.
Je fis différentes excursions aux environs de Milan, une entre autres à la montagne de la Madone del Monte, où l'on voit à gauche, sur
la hauteur, un temple ; puis de distance en distance de petites chapelles dans lesquelles se trouvent tous les sujets de la passion. Les figures, grandes comme
nature, sont sculptées. Elles ne sont pas d'un travail très fin ; mais elles ont une grande vérité d'expression ; une Vierge surtout, sculptée, plus grande que
nature, qui est représentée seule et montant au ciel, a beaucoup de majesté et une très belle pose.
Je suis montée jusqu'au sommet de cette montagne, d'où l'on découvre une vue magnifique et si étendue, que les monts voisins paraissent des vallons. Dans le
lointain, à différentes distances, on aperçoit trois lacs. Celui de Côme, le plus éloigné de tous, est entouré de montagnes vaporeuses. Les deux autres,
reflétant le ciel, étaient d'un bleu d'azur. Les tons variés des vallons d'un vert tendre, et des montagnes d'un vert foncé, font un repoussoir admirable pour le
lointain. Sur le haut de ce Calvaire se trouve une église, environnée de sites enchanteurs, et d'une étendue immense ; en descendant, je m'arrêtais souvent pour
contempler cette belle végétation, ces beaux arbres et ce chemin pittoresque. En général, la nature de cette contrée est une des plus riches de l'Italie, et les
environs de Milan sont si ravissants, que je ne cessais d'en faire des croquis.
Quelques jours après j'allai au lac Majeur, dont la large étendue est environnée de montagnes boisées, et au milieu duquel se trouvent deux îles,
l'isola Bella et l'isola Madre. J'ai habité la première, en ayant reçu la permission du prince Boromée, à qui
elle appartient. L'isola Bella n'a rien de pittoresque ; elle est en partie entourée de murailles garnies d'espaliers de pêches. L'autre île est, dit-on, plus
jolie ; mais comme je m'embarquais dans l'intention de m'y rendre, le lac était si furieux que je fus obligée de renoncera mon projet, et de profiter d'un moment
de calme pour regagner la terre, d'autant que l'on m'assurait qu'il n'était pas rare de se trouver en danger sur ce lac.
De retour à Milan, j'allai voir la cathédrale qui est fort belle, et différentes curiosités que renferment les palais, qui sont bien loin d'être aussi riches en
tableaux que les palais de Parme, et surtout ceux de Bologne.
Les promenades, aux environs de la ville, se font en voiture ; les femmes y sont extrêmement parées, ce qui me rappelait notre Longchamp et notre ancien
boulevard du Temple. En tout Milan me faisait bien souvent penser à Paris, tant par son luxe que par sa population. La salle de spectacle (la Scala), où j'ai
entendu d'excellente musique, est immense. Je ne crois pas qu'il en existe de plus grande ; sous ce rapport, celle de Naples peut seule lui être comparée.
Je suis allée à plusieurs beaux concerts ; car Milan possède toujours quelque fameux chanteur et quelques grandes cantatrices. Au dernier, je me trouvais placée
à côté d'une Polonaise très belle et très aimable, nommée la comtesse Bistri. Comme nous nous étions mises à causer ensemble, je lui parlai de mon prochain
départ pour Vienne. Elle me dit qu'elle et son mari allaient aussi se rendre dans cette ville, mais plus tard. Cependant tous deux me témoignèrent un grand désir
de faire route avec moi, en sorte qu'ils eurent la bonté d'avancer l'époque de leur voyage, et comme j'allais en voiturin, ils poussèrent l'obligeance jusqu'à ne
pas prendre la poste, afin de ne jamais me quitter sur le chemin.
Il m'aurait été impossible de trouver des compagnons de voyage plus aimables. Ils me comblaient de soins, et l'on peut dire que le mari et la femme étaient d'une
bonté rare, au point qu'ils emmenèrent avec eux un pauvre vieux prêtre émigré, et un autre jeune prêtre, qu'ils avaient trouvés en route, et qui venaient
d'échapper au massacre de Pont de Beauvoisin. Quoique madame Bistri n'eût pour voiture qu'une diligence à deux places, ils mirent le vieillard entre eux deux, et
le jeune homme derrière la voiture. Ils soignèrent ces deux infortunés, dont ils étaient les anges tutélaires, comme des amis, comme des parents les plus proches.
Je fus tellement édifiée de leur conduite envers ces deux malheureux, que je ne puis exprimer à quel point elle m'attacha à cet excellent ménage, que j'ai vu
constamment à Vienne.
En faisant route pour la capitale de l'Autriche, nous traversâmes une partie du Tyrol. Ce chemin est grandiose et pittoresque. On y voit des rochers d'une
majesté imposante, embellis par la plus active végétation, et par des chutes d'eau, brillantes comme du cristal, qui vont alimenter des torrents. Nous
parcourûmes aussi une partie de la Styrie ; à mi-côte de ses montagnes, on aperçoit çà et là des habitations champêtres et quelques châteaux, qui sont du plus
charmant effet. En tout, le chemin occupa mes yeux agréablement, depuis Milan jusqu'à Vienne.
CHAPITRE XI.
Je me loge à Vienne avec monsieur et madame Bistri. La comtesse de Thoun ; ses soirées. La comtesse Kinski. Casanova. Le prince Kaunitz. Le baron de Strogonoff. Le comte de Langeron. La comtesse de Fries, ses spectacles. La comtesse de Schoenfeld.
Nous arrivâmes enfin dans la bonne ville de Vienne, où deux années et demie de ma vie devaient s'écouler d'une manière si agréable, que j'ai toujours su gré
au comte de Wilsheck de m'avoir engagée à faire ce voyage. Comme monsieur, madame de Bistri et moi, nous ne voulions pas nous quitter, il nous fut impossible de
trouver à nous loger dans la ville. Nous fûmes obligés d'aller nous établir dans un des faubourgs (qui sont plus grands que la ville), et là, je fis le portrait
de l'aimable comtesse de Bistri, qui était une fort belle femme.
Peu de jours après mon arrivée, j'allai dans la ville porter les lettres de recommandation que m'avait données le comte de Wilsheck. Dans le nombre, il s'en
trouvait une pour le célèbre prince Kaunitz, qui avait été ministre sous Marie-Thérèse. Mais je me rendis d'abord chez la comtesse de Thoun. Elle m'invita
aussitôt à ses soirées, où se réunissaient les plus grandes dames de Vienne, et cette maison aurait suffi pour me faire connaître toute la haute société de la
ville. J'y trouvais aussi beaucoup d'émigrés de notre pauvre France : le duc de Richelieu, le comte de Langeron, la comtesse de Sabran et son fils, la famille de
Polignac, et plus tard l'aimable et bon comte de Vaudreuil, que je fus bien joyeuse de revoir.
Je n'ai jamais vu, rassemblées dans un salon, un aussi grand nombre de jolies femmes qu'il s'en trouvait dans celui de madame de Thoun. La plupart de ces dames
apportaient leur ouvrage, et s'établissaient autour d'une grande table, faisant de la tapisserie. On m'appelait quelquefois pour me consulter sur les effets, sur
les nuances ; mais comme ce qui me fait le plus de mal aux yeux est de les attacher sur des couleurs vives, à la lueur des lampes ou des bougies, j'avoue que je
donnais souvent mon avis sans regarder. En général, j'ai toujours soigné mes yeux avec une grande prudence, et je m'en suis fort bien trouvée, puisque,
maintenant encore, je peins sans être obligée de prendre des lunettes.
Parmi les jolies femmes dont j'ai parlé, il y en avait surtout trois remarquables par leur beauté : la princesse Linoski ; la femme de l'ambassadeur de Russie,
le comte de Rasowmoffski, et la charmante comtesse Kinski, née comtesse Diedrochsten. Cette dernière avait tous les charmes qu'on peut avoir ; sa taille, sa
figure, toute sa personne enfin était la perfection : aussi fus-je bien surprise quand on me raconta son histoire, qui vraiment ressemble à un roman. Les parents
du comte Kinski et les siens avaient arrangé entre eux de marier les jeunes gens, qui ne se connaissaient point. Le comte habitait je ne sais quelle ville
d'Allemagne, et n'arriva que pour la célébration du mariage. Aussitôt après la messe, il dit à sa jeune et charmante femme : «Madame, nous avons obéi à nos
parents ; je vous quitte à regret ; mais je ne puis vous cacher que depuis longtemps je suis attaché à une femme sans laquelle je ne puis vivre, et je vais la
rejoindre.» La chaise de poste était à la porte de l'église ; cet adieu fait, le comte monte en voiture, et retourne vers sa Dulcinée.
La comtesse Kinski n'était donc ni fille, ni femme, ni veuve, et cette bizarrerie devait surprendre quiconque la regardait ; car je n'ai point vu de personne
aussi ravissante. Elle joignait à sa grande beauté l'esprit le plus aimable, et un coeur excellent ; un jour qu'elle me donnait séance, je fis demander quelque
chose à la gouvernante de ma fille, qui entra dans mon atelier avec un air si gai, que je lui demandai ce qu'elle avait. «Je viens, répondit-elle, de recevoir
une lettre de mon mari, qui me mande que l'on m'a mise sur la liste des émigrés. Je perds mes huit cents francs de rente ; mais je m'en console, car me voilà sur
la liste des honnêtes gens.» La comtesse et moi, nous fûmes touchées d'un désintéressement aussi honorable. Quelques minutes après, madame Kinski me dit que ma
robe de peinture lui semblait si commode, qu'elle voudrait bien en avoir une pareille (elle savait déjà que la gouvernante de ma fille me faisait ces blouses).
J'offris de lui en prêter une. «Non, reprit-elle, j'aimerais bien mieux que vous la fissiez faire par madame Charot (c'était le nom de la gouvernante) ;
j'enverrai la toile nécessaire.» Peu de jours après, je lui remis la robe. Aussitôt notre séance finie, la comtesse court à la chambre de madame Charot et lui
donne dix louis ; la bonne refuse ; mais l'aimable comtesse les pose sur la cheminée et s'enfuit comme un oiseau, bien contente d'avoir au moins rendu à cette
brave femme un quartier de la pension perdue.
Ma coutume étant, lorsque j'arrivais dans une ville, de faire mes premières visites aux artistes, je n'avais pas tardé à aller voir Casanova, peintre très
renommé dans le genre des batailles.
(nb) Avant la révolution, on voyait au palais Bourbon plusieurs grands et beaux tableaux de lui, qui représentaient les batailles du prince de Condé, père du duc de Bourbon.
Il pouvait avoir soixante ans, mais il avait encore beaucoup de vigueur, quoiqu'il portât deux ou trois paires de lunettes les unes sur les autres. Il
travaillait alors à divers grands tableaux, représentant les hauts faits du prince de Nassau. Dans l'un, on voyait le prince terrassant un lion ; dans un autre,
il écrasait un tigre ; enfin, tous étaient de cette force, ce qui donnait une terrible idée du personnage qui, pour avoir fait réellement ces prodiges de valeur
et beaucoup d'autres encore, n'en avait pas moins l'air le plus doux et le plus tranquille qu'on puisse voir. Quant aux tableaux dont je parle, ils avaient de
l'effet, de la couleur, mais ils n'étaient point terminés.
Casanova avait beaucoup d'esprit et d'originalité. Il était très bavard, et je l'ai vu nous amuser extrêmement aux dîners du prince Kaunitz, par des histoires
qui souvent n'avaient aucune vérité, et qui devaient tout leur comique à l'imagination vive et bizarre du conteur. Il avait la repartie prompte et heureuse. Un
jour que nous dînions chez le prince de Kaunitz, la conversation roulant sur la peinture, on parla de Rubens, et quand on eut fait l'éloge de son immense talent,
quelqu'un dit que son instruction, qui était aussi prodigieuse, l'avait fait nommer ambassadeur. À ces mots, une vieille baronne allemande prend la parole, et
dit : «Comment ! un peintre ambassadeur ! c'est sans doute un ambassadeur qui s'amusait à peindre. - Non, madame, répond Casanova, c'est un peintre qui s'amusait
à être ambassadeur.»
Casanova avait gagné énormément d'argent ; mais son désordre était tel, qu'il ne lui en restait pas.
En sortant de chez lui, je portai toutes mes lettres de recommandation. Je trouvai le prince de Kaunitz que je désirais beaucoup connaître. Ce grand ministre
était alors âgé de quatre-vingt-trois ans au moins ; il était grand, très maigre, et se tenait fort droit. Il me reçut avec une bonté parfaite, et m'engagea pour
dîner le lendemain. Comme on ne se mettait à table chez lui qu'à sept heures, et que j'avais l'habitude de dîner seule chez moi à deux heures et demie, cette
invitation et celles qui suivirent, tout en me flattant, me contrariaient un peu : je n'aimais ni à dîner aussi tard, ni à dîner avec tant de monde ; car sa
table, composée en grande partie d'étrangers, était toujours de trente couverts, souvent plus. Dès le premier jour dont il est question, je pris le parti de
dîner chez moi avant de me rendre chez lui, ce que je m'efforçai de cacher autant qu'il m'était possible, en mettant une demi-heure à manger un oeuf à la coque,
mais ce petit manège, dont il s'aperçut, le contraria ; et cela, joint au soin que je pris par la suite pour esquiver quelques-unes de ses invitations, causait
les seules querelles qu'il m'ait jamais faites, attendu qu'il ne tarda pas à me prendre en grande amitié, ce dont j'étais fort reconnaissante. Il ne m'appelait
jamais autrement que sa bonne amie, et il voulut que ma Sibylle restât exposée dans son salon pendant plus de quinze jours, durant lesquels on le vit faire les
honneurs de ce tableau à la ville et à la cour avec une grâce toute affectueuse pour moi.
Le prince de Kaunitz, malgré son grand âge, avait encore une forte tête et un esprit plein de verve. Son goût, son jugement exquis, sa haute raison, étonnaient
tous ses convives. Il recevait son monde admirablement ; son unique faiblesse était de conserver la prétention de monter à cheval mieux que personne. Il
m'invita, ainsi que plusieurs autres amis, à venir le voir caracoler dans son manège. La vérité est qu'il s'en acquittait parfaitement bien, et d'une manière
fort surprenante à son âge. Il montait à la française : son costume et sa personne me rappelaient les cavaliers du temps de Louis XIV, tels que nous les voyons
représentés dans les beaux tableaux de Wouvermans.
Le prince de Kaunitz jouissait à Vienne de la plus grande existence ; la gloire qu'il avait acquise comme ministre y vivait encore avec lui. Le premier jour de
l'an et celui de sa fête, une foule immense se rendait chez lui pour le complimenter ; nul ne s'en dispensait, et l'on aurait pu le croire empereur ces deux
jours-là : aussi ai-je été bien surprise de l'indifférence des Viennois pour la perte de leur célèbre compatriote. J'étais encore à Vienne quand le prince de
Kaunitz mourut après une courte maladie ; à peine eut-on l'air d'être sensible à la disparition de ce grand homme. Quant à moi, j'en fus très affligée. Je me
souviens qu'étant allée peu de temps après, voir pour la seconde fois un cabinet de figures en cire fort curieux, je fus saisie à la vue de celle du prince de
Kaunitz couché, revêtu des habits qu'il portait, coiffé comme il avait l'habitude de l'être, enfin absolument tel que je l'avais vu si souvent chez lui. Ce
spectacle, auquel je ne m'attendais nullement, me fit la plus douloureuse impression ; car je ne connais rien de si pénible à voir, que les traits exacts de
quelqu'un que l'on a aimé, privés d'activité et de vie.
Peu de jours après mon arrivée à Vienne, je fis connaissance avec le baron et la baronne de Strogonoff, qui me prièrent tous deux de faire leurs portraits. La
première se faisait aimer par sa douceur et son extrême bienveillance : quant à son mari, il possédait un charme supérieur pour animer la société ; il faisait
les délices de Vienne en donnant des soupers, des spectacles, des fêtes, où chacun se pressait de se faire inviter. J'ai peu connu d'hommes plus aimables, plus
gais, que le baron de Strogonoff. Quand le désir de rire et de s'amuser lui prenait, il inventait toutes les folies imaginables. Un jour entre autres, sachant
que plusieurs personnes de sa société et moi, devions aller visiter le cabinet de figures en cire que je n'avais pas encore vu alors, il s'excusa sous un
prétexte de ne pouvoir nous accompagner, et, prenant l'avance, il va se placer dans ce cabinet derrière un piédestal, de manière qu'il ne laissait voir que sa
tête. En parcourant la galerie des portraits, nous passons devant lui ; mais il avait donné à ses yeux une telle fixité, et tant d'immobilité à tous ses traits,
qu'aucun de nous ne le reconnaît. Après avoir visité les autres salles, nous repassons une seconde fois sans le reconnaître davantage ; mais alors voilà qu'il
remue et qu'il parle ; nous fûmes tous effrayés, et surtout bien surpris de notre méprise. Elle prouve au reste combien, lorsque l'on peint une personne, sa
physionomie ajoute à la ressemblance ; c'est pourquoi il faut bien se garder de donner des séances trop longues, ou de laisser un modèle s'ennuyer.
J'ai rarement vu jouer la comédie par des amateurs aussi bien que chez la baronne de Strogonoff. Les premiers rôles étaient remplis par le comte de Langeron, qui
jouait les amoureux avec autant de grâce que de facilité, et qui avait une véritable passion pour la comédie. M. de Rivière jouait les rôles comiques d'une
manière étonnante. Au reste, cet aimable homme
(nb) M. de Rivière ayant embrassé plus tard la carrière de la diplomatie, est mort en 1833, à Paris, où il était ministre de Hesse-Cassel.
possédait tous les talents ; aussi Doyen disait-il que M. de Rivière était un petit nécessaire de société. Le fait est qu'il peignait très bien, et copiait
tous mes portraits, en grande miniature à l'huile ; il chantait fort agréablement ; il jouait du violon, de la basse, et s'accompagnait sur le piano. Il avait de
l'esprit, un tact parfait, et un coeur si excellent, qu'en dépit de ses distractions, qui étaient fréquentes et nombreuses, il obligeait ses amis avec autant de
zèle que de succès. M. de Rivière était petit, mince, et il a toujours conservé l'air si jeune, qu'âgé de soixante ans, sa taille et sa tournure ne lui en
donnaient que trente.
Quant à M. de Langeron, je ne puis le faire mieux connaître, qu'en plaçant ici le portrait qu'il a tracé de lui-même, avec la plus grande vérité, et qu'il ajouta
à son rôle, dans la dernière pièce qu'il a jouée à Vienne, avant le départ du baron de Strogonoff. Ces vers donneront l'idée la plus juste de ce brave et aimable
Français, qui, grâce à notre révolution, est mort chez les Russes, gouverneur d'Odessa.
Portrait de M. de Langeron, fait par lui-même, et ajouté au rôle de Dorlange, dans la comédie des Châteaux en Espagne.
Je veux pour m'amuser faire ici mon portrait,
En bien tout comme en mal ressemblant trait pour trait.
Du moins ce sera gai si ce n'est pas trop sage.
Je dois à la nature et j'acquis par l'usage,
De la facilité, du babil, du jargon,
Plus de superficie en un mot que de fond ;
Aussi, légèrement je glisse sur les choses,
Et n'approfondis point les effets et les causes.
Je suis bon, confiant jusques à l'abandon ;
Aussi, je fus souvent trompé, mais pourquoi non ?
J'aime mieux me livrer, hélas ! que de tout craindre ;
Bien plus que le trompé, le trompeur est à plaindre.
J'ai toujours adoré l'honneur et l'amitié ;
Pour ces dieux j'ai tout fait, j'ai tout sacrifié.
Quant à mon caractère, il est léger sans doute ;
Mais heureux sur ma foi, car de rien je ne doute
Et toujours trouve à tout un remède assuré ;
Si quelque chose enfin ne va pas à mon gré,
On bien si le malheur veut verser sur ma vie
Ses poisons, ses dégoûts ou sa mélancolie,
Les rêves et l'espoir viennent avec gaîté,
Dans mon coeur tenir lieu de la réalité.
Je fus d'aimer le sexe accusé par l'envie ;
Je ne m'en défends pas, je l'aime à la folie,
Et l'aimerai demain plus encor qu'aujourd'hui.
Valons-nous dans le fait quelque chose sans lui ?
On m'a dit bien souvent que j'étais trop volage.
Oui, je suis, j'en conviens, plus étourdi que sage,
Et mon esprit errant en projets, en amours,
Est tout comme mon corps, il voyage toujours.
On m'a souvent aussi reproché, ce me semble,
D'avoir aimé parfois plusieurs femmes ensemble.
Eh bien ! c'était tromper, dit-on... Non, car je croi
Que je les adorais toutes de bonne foi.
Du véritable amour j'ai cru que dans ma vie,
J'avais connu deux fois la triste frénésie.
Je m'en plaignais au sort ; mais en me tâtant bien,
J'ai vu, je l'avouerai, qu'il n'en fut jamais rien.
Ai-je tort ? Le profit est moindre que la peine.
J'ai cinq ans de l'hymen porté l'aimable chaîne ;
Pendant trois, j'ai vécu comme un franc étourdi ;
Mais on m'a vu depuis un excellent mari.
Quelle en est la raison ? Elle existe en mon ame ;
Je suis sensible et bon, un ange était ma femme.
J'ai connu la faveur sans en être enivré.
J'ai connu le malheur sans en être altéré.
J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup la guerre ;
Comme le mouvement elle m'est nécessaire.
Je l'ai faite souvent, sans profit, sans projet,
J'ai plus cherché la gloire enfin que l'intérêt.
Je suis fat, ce n'est pas ma faute en vérité ;
Je le suis devenu parce qu'on m'a gâté.
Être stable, est pour moi dans les choses futures,
Pour l'être, j'aime trop encor les aventures.
Je serai, j'en suis sûr, avant qu'il soit longtemps,
Le meilleur des maris, le meilleur des amans ;
Mais j'ai besoin d'user ma fureur vagabonde,
Et quelque temps encor de parcourir le monde.
Ce portrait de M. de Langeron était celui de beaucoup de jeunes gens de la cour de France à l'époque de la révolution. Chez la plupart d'entre eux, quelque peu
d'étourderie se joignait à la franchise, à la bravoure, et surtout à je ne sais quelle grâce d'esprit qui, s'il faut le dire, a totalement disparu depuis que
nous sommes devenus si profonds. Le chevalier de Boufflers, le vicomte de Ségur, le comte Louis de Narbonne, étaient des modèles de cette grâce d'esprit dont je
parle. Je ne connais pas de mot de courtisan plus fin que la repartie du dernier à l'empereur Bonaparte, qui, parlant de madame de Narbonne, lui disait : «Votre
mère ne m'aime pas ; je le sais. - Sire, répondit le comte, elle n'en est encore qu'à l'admiration.»
La maison du baron de Strogonoff n'était pas la seule à Vienne où l'on jouât la comédie de société. La comtesse de Fries, veuve du fameux banquier de ce nom,
avait une très jolie salle de spectacle, dans laquelle je l'ai vue parfaitement bien jouer les rôles de caractères. Sa fille, mademoiselle de Fries, avait une
très belle voix, et chantait à merveille, en sorte que l'on donna un jour pour elle un petit opéra à trois acteurs. Tout alla fort bien d'abord ; la scène se
passait dans une île déserte, où deux amanys s'étaient réfugiés. Mademoiselle de Fries jouait le rôle de la jeune fille, M. de Rivière celui de l'amant, et tous
deux chantaient admirablement ; mais vers la fin de la pièce, le père de l'amante arrive dans une barque. On avait collé une barbe de coton autour de la bouche
et du menton de celui qui remplissait ce rôle ; dès que ce jeune homme se mit à chanter, voilà que cette barbe se détache et lui entre dans la bouche de telle
sorte, qu'il en fut suffoqué. Nous l'entendions crier d'une voix étouffée : J'avale ma barbe ! j'avale ma barbe ! et quoique ce grotesque accident n'eût aucune
suite fâcheuse, l'opéra en resta là.
Mademoiselle de Fries était excellente musicienne, et quand je fis son portrait, je voulus la peindre en Sapho, chantant, et s'accompagnant de la lyre. Son
visage, sans être joli, avait infiniment d'expression. Sa soeur, la comtesse de Schoenfeld, était très jolie, et fashionable autant qu'on puisse l'être, au point
que sa mère, madame de Fries, ayant un jour donné, dans une pièce, un rôle à son neveu, qui n'avait point l'air distingué, comme je me trouvais placée au
spectacle à côté de madame de Schoenfeld, je lui demandai qui était ce monsieur ? - C'est le neveu de ma mère, répondit-elle, ne pouvant se décider à dire :
C'est mon cousin.
CHAPITRE XII.
Je vais me loger dans la ville. Portraits que je fais à Vienne. Bienfaisance des Viennois. Musée royal. Le Prater. Schoenbrunn. Beaux parcs des environs de Vienne. Les bals. Le jour de l'an. Le prince d'Esterhazy. La princesse maréchale Lubomirska. La comtesse de Rombec. Mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Mort de madame de Polignac.
Monsieur et madame Bistri devant retourner en Pologne, j'allai louer un logement dans l'intérieur de Vienne. Je n'aurais pu d'ailleurs continuer à habiter un
faubourg ; car pour me rendre à la ville, il me fallait traverser les remparts, les glacis, où le vent constant et furieux élevait une énorme poussière qui me
faisait très mal aux yeux ; aussi le dicton de Vienne est-il qu'il y a dans cette ville trois causes de mort : le vent, la poussière et la valse. Le fait est que
la traversée de ces remparts était alors une horrible chose ; maintenant, m'a-t-on dit, ils sont plantés de beaux arbres, et cet endroit sec et aride est devenu
une immense et superbe promenade.
Je m'établis dans un logement à ma convenance, et j'y fis aussitôt le portrait de la fille de l'ambassadeur d'Espagne, mademoiselle de Kaguenek, qui était âgée
de seize ans et très jolie, ainsi que ceux du baron et de la baronne de Strogonoff. Ma Sibylle, que l'on venait en foule voir chez moi, ne contribua pas peu,
j'imagine, à décider beaucoup de personnes à me demander de les peindre ; car j'ai beaucoup travaillé à Vienne. En tout, il me serait difficile d'exprimer toute
la reconnaissance que je conserve du bon accueil que j'ai reçu dans cette ville. Non seulement les Viennois ont témoigné de l'affection pour ma personne, mais
ils mettaient de la coquetterie à placer mes tableaux d'une manière qui leur fût favorable. Je me souviens, par exemple, que le prince Paar, à qui l'on avait
porté le grand portrait que je venais de faire de sa soeur, l'aimable et bonne comtesse Dubuquoi, m'invita à venir voir ce portrait chez lui. Je trouvai le
tableau placé dans son salon, et comme les boiseries étaient peintes en blanc, ce qui tue la peinture, il avait fait poser une large draperie verte qui entourait
tout le cadre et retombait dessous. En outre, pour le soir, il avait fait faire un candélabre à plusieurs bougies, portant un garde-vue, et disposé de façon que
toute la lumière ne se reflétait que sur le portrait. Il est inutile de dire combien un peintre doit être sensible à ce genre de galanterie.
La bonne compagnie de Vienne et la bonne compagnie de Paris étaient alors exactement la même pour le ton et pour les usages. Quant au peuple, nulle part je ne
l'ai vu avoir cet air de bonheur et d'aisance, qui n'a cessé de me réjouir les yeux pendant mon séjour dans cette grande ville. Soit à Vienne, soit dans les
campagnes qui l'environnent, je n'ai jamais rencontré un mendiant ; les hommes de peine, les paysans, les rouliers, tous sont bien vêtus. On juge d'abord qu'ils
vivent sous un gouvernement paternel. Il est bien vrai qu'il en est ainsi ; et de plus, les riches familles viennoises, dont quelques-unes ont des fortunes
colossales, dépensent leurs revenus de la manière la plus honorable et la plus utile aux pauvres. On fait prodigieusement travailler, et la bienfaisance est une
vertu commune à toutes les classes aisées. Un de mes grands sujets d'étonnement a été, la première fois que j'allai au spectacle à Vienne, de voir plusieurs
dames, entre autres la belle comtesse Kinski, tricoter de gros bas dans leurs loges ; je trouvais cela fort étrange ; mais quand on m'eut dit que ces bas étaient
pour les pauvres, j'ai pris plaisir depuis, à voir les plus jeunes et les plus jolies femmes travailler ainsi, d'autant qu'elles tricotent tout en s'occupant
d'autre chose, sans même regarder leur ouvrage et avec une vitesse prodigieuse.
Vienne, dont l'étendue est considérable, si l'on y comprend ses trente-deux faubourgs, est remplie de fort beaux palais. Le Musée impérial possède des tableaux
des plus grands maîtres que j'ai bien souvent été admirer ainsi que tous ceux du prince Lichtenstein. Cette dernière galerie se compose de sept salles, dont une
ne renferme que des tableaux de Vandick, et les autres, plusieurs beaux Titien, Caravage, Rubens, Canaletti, etc., etc. ; il se trouve aussi quelques
chefs-d'oeuvre de ce grand maître dans le Musée impérial.
On a dit avec raison que le Prater était une des plus belles promenades connues. Elle consiste en une longue et magnifique allée dans laquelle circulent un grand
nombre de voitures élégantes, et de chaque côté sont, beaucoup de personnes assises, ainsi qu'on en voit dans la grande allée des Tuileries. Mais ce qui rend le
Prater plus agréable et plus pittoresque, c'est que son allée conduit à un bois, peu ombragé et plein de cerfs, si apprivoisés, qu'on les approche sans les
effrayer. On voit encore une autre promenade sur les bords du Danube, où tous les dimanches se réunissent diverses sociétés bourgeoises pour y manger des poulets
frits. Le parc de Schoenbrunn est aussi très fréquenté, surtout le dimanche. Ses belles allées, et les repos pittoresques que l'on trouve sur les hauteurs à
l'extrémité du parc, en font une promenade charmante. On y rencontre fort souvent de jeunes couples se promenant en tête-à-tête, ce que l'on respecte en
s'éloignant ; car presque toujours ces promenades à Schoenbrunn sont des préludes de mariages convenus.
Les environs de Vienne en général sont grandioses. On remarque surtout le parc du maréchal Lansdon, du maréchal Lassi, et celui du comte de Cobentzel. Tous les
trois sont superbes, et dans un tout autre genre que les parcs anglais. Ces derniers sont plus uniformes, plus plats, et par conséquent moins pittoresques. Ceux
des environs de Vienne ont des montagnes naturelles, boisées dans le haut ; il s'y trouve des ravins profonds, que l'on traverse sur des ponts d'une forme
élégante, des rivières naturelles et des cascades brillantes qui descendent avec rapidité des hauteurs.
À Vienne, je suis allée à plusieurs bals, particulièrement à ceux que donnait l'ambassadeur de Russie, le comte de Rasowmoffski, qu'on pouvait appeler des fêtes
charmantes. On y dansait la valse avec une telle fureur, que je ne pouvais concevoir comment toutes ces personnes, en tournant de la sorte, ne s'étourdissaient
pas au point de tomber ; mais hommes et femmes sont tous si bien habitués à ce violent exercice, qu'ils ne s'en reposent pas un seul moment, tant que dure le
bal. On dansait souvent aussi la polonaise, beaucoup moins fatigante ; car cette danse n'est autre chose qu'une promenade pour laquelle
on marche tranquillement deux à deux. Celle-ci convient à merveille aux jolies femmes, dont on a tout le temps d'admirer la taille et le visage.
Je voulus aussi voir un grand bal de la cour. L'empereur François II avait épousé en secondes noces Marie-Thérèse des Deux-Siciles, fille de la reine de Naples.
J'avais peint cette princesse en 1792 ; mais je la retrouvais si changée qu'en la revoyant dans ce bal, j'eus peine à la reconnaître. Son nez s'était allongé, et
ses joues s'étaient aplaties au point qu'elle ressemblait alors à son père. Je regrettai pour elle qu'elle n'eût pas conservé les traits de sa mère, qui, je
crois l'avoir déjà dit, rappelait beaucoup notre charmante reine de France.
Il se donnait à Vienne de superbes concerts, et j'en ai entendu plusieurs. Dans l'un d'eux, on exécuta d'abord, à grand orchestre et avec une rare perfection,
une des plus belles symphonies d'Haydn ; puis je vis s'approcher du piano une ancienne cantatrice du temps de Marie-Thérèse, à qui j'aurais bien donné cent ans,
quoiqu'elle me parût, à ma grande surprise, s'apprêter à chanter. Je tremblais que la pauvre vieille ne pût faire entendre deux notes de suite ; mais dès qu'elle
eut commencé le récitatif, son âge, sa laideur, tout disparut ; son visage prit une expression superbe, et elle chanta si parfaitement bien, que nous étions tous
dans l'admiration. J'avoue que je fus stupéfaite ; je croyais assister à l'opération d'un miracle.
Le premier jour de l'an est très brillant à Vienne. On voit alors une grande quantité de Hongrois dans leur élégant costume, ce qui leur sied à merveille,
attendu qu'en général ils sont grands et bien faits. Un des plus remarquables était le prince d'Esterhazy ; je l'ai vu passer, monté sur un cheval richement
caparaçonné, couvert d'une housse parsemée de diamants. L'habit du prince était d'une richesse analogue, et comme il faisait grand soleil, les yeux étaient
vraiment éblouis d'une telle magnificence.
Une société fort agréable, était celle des Polonaises ; presque toutes sont aimables et jolies, et j'ai peint quelques-unes des plus belles. On les trouvait
réunies le plus souvent chez la princesse Lubomirska, que j'avais connue à Paris, à l'époque où je fis le portrait de son neveu en Amour de la gloire, et chez
laquelle j'allais beaucoup à Vienne. Elle tenait une des maisons les plus brillantes de cette ville, où elle donnait de très beaux concerts et des bals
charmants. J'ai vu aussi une grande réunion de Polonaises chez la princesse Czartorinska, qui recevait à merveille. Son mari était fort aimable, et leur fils,
que je connus alors, a été depuis ministre à Pétersbourg.
Une personne que je retrouvais avec bonheur à Vienne, c'était madame la comtesse de Brionne, princesse de Lorraine. Elle avait été parfaite pour moi dès ma plus
grande jeunesse, et je repris la douce habitude d'aller souvent souper chez elle, où je rencontrais fréquemment ce vaillant prince de Nassau, si terrible dans un
combat, si doux et si modeste dans un salon.
Je fréquentais aussi beaucoup la maison de la comtesse de Rombec, soeur du comte de Cobentzel. Madame de Rombec était la meilleure des femmes ; elle avait de
l'esprit et un naturel parfait, mettant son bonheur à soulager les malheureux : c'était chez elle que se faisaient toutes les quêtes, que se tiraient toutes les
loteries destinées à secourir les infortunés ; elle mettait à ces bonnes oeuvres tant de grâce et de zèle, qu'il était impossible de ne pas lui ouvrir sa bourse.
J'ai remarqué, au reste, que les quêtes faites dans les salons, sont un des moyens les plus efficaces pour venir au secours des pauvres. Aussi en ai-je trouvé
l'usage établi dans tous les pays que j'ai parcourus. Je me souviens qu'à Rome, où je passais souvent la soirée chez la douce et bonne lady Cliford, je la vis un
soir se lever, une bourse à la main, et faire le tour de son cercle, qui était fort nombreux. Lorsqu'elle approcha de moi, voyant que j'avais préparé mon
offrande : «Non, me dit-elle, je quête pour un de nos compatriotes que nous ne connaissons pas, mais qui vient de perdre au jeu tout ce qu'il possédait ; c'est à
nous seuls de le secourir.» Je trouvai ce mot bien anglais.
La comtesse de Rombec réunissait dans son salon la société la plus distinguée de Vienne. C'est chez elle que j'ai vu le prince Metternich avec son fils, qui
depuis est devenu premier ministre, mais qui n'était alors qu'un fort beau jeune homme. J'y ai retrouvé l'aimable prince de Ligne ; il nous racontait le charmant
voyage qu'il avait fait en Crimée avec l'impératrice Catherine II, et me donnait le désir de voir cette grande souveraine. J'y rencontrai aussi la duchesse de
Guiche, dont le charmant visage n'avait pas changé. Sa mère, madame de Polignac, habitait constamment une campagne voisine de Vienne. C'est là qu'elle apprit la
mort de Louis XVI, qui l'affecta au point que sa santé en fut très altérée ; mais lorsqu'elle reçut l'affreuse nouvelle de celle de la reine, elle y succomba. Le
chagrin la changea au point que sa charmante figure était devenue méconnaissable, et que l'on pouvait prévoir sa fin prochaine. Elle mourut en effet peu de temps
après, laissant sa famille et plusieurs amis qui ne l'avaient pas quittée, inconsolables de sa perte.
Il est certain que je puis juger combien ce qui venait de se passer en France dut être affreux pour elle, par la douleur que j'en éprouvai moi-même. Je n'appris
rien par les journaux, car je n'en lisais plus depuis le jour qu'ayant ouvert une gazette chez madame de Rombec, j'y trouvai les noms de neuf personnes de ma
connaissance, qu'on avait guillotinées ; on prenait même grand soin dans ma société de me cacher tous les papiers-nouvelles. J'appris donc l'horrible événement
par mon frère, qui me l'écrivit sans ajouter aucun détail. Le coeur navré, il me dit seulement que Louis XVI et Marie-Antoinette étaient morts sur l'échafaud !
Depuis, par pitié pour moi, je me suis toujours gardée de faire la moindre question sur tout ce qui a pu accompagner ou précéder cet affreux assassinat, en sorte
que je ne saurais rien de plus aujourd'hui sans un fait dont je parlerai plus tard.
CHAPITRE XIII.
Huitzing. La princesse Lichtenstein. Les corbeaux. Je me décide à aller en Russie. Le prince de Ligne me prête le couvent de Caltemberg que je vais habiter. Vers du prince de Ligne. Portrait en vers du prince de Ligne par M. de Langeron.
Sitôt que le printemps était venu, j'avais loué une petite maison dans un village des environs de Vienne, où j'avais été m'établir. Ce village, nommé
Huitzing, touchait presque le parc de Schoenbrunn. La famille de Polignac l'habitait, et quoique sa situation le rendît agréable dès ce temps, j'ai su depuis,
par madame de Rombec, qu'il s'est fort embelli, et qu'elle-même y possédait une habitation ressemblante à la maison carrée de Nîmes.
J'apportai à Huitzing le grand portrait que je faisais alors de la princesse Lichtenstein pour le terminer. Cette jeune princesse était très bien faite ; son
joli visage avait une expression douce et céleste, qui me donna l'idée de la représenter en Iris. Elle était peinte en pied, s'élançant dans les airs. Son
écharpe, aux couleurs de l'arc-en-ciel, l'entourait, en voltigeant autour d'elle. On imagine bien que je la peignis les pieds nus ; mais lorsque ce tableau fut
placé dans la galerie du prince, son mari, les chefs de la famille furent très scandalisés de voir que l'on montrât la princesse sans chaussure, et le prince me
raconta qu'il avait fait placer dessous le portrait une jolie petite paire de souliers, qui, disait-il aux grands parents, venaient de s'échapper et de tomber à
terre.
Les bords du Danube sont superbes et m'offraient tous les moyens de satisfaire mon goût pour les promenades solitaires et pittoresques. J'en découvris une un
jour, où, de l'autre côté de la rive, en face de moi, s'élevait un superbe groupe d'arbres, que les nuances de l'automne enrichissaient de tons riches et variés,
et d'où j'apercevais à gauche, dans le lointain, la haute montagne du Caltemberg. Charmée de ce magnifique paysage, je m'établis sur les bords du fleuve, je
prends mes pastels, et je me mets à peindre ces beaux arbres et ce qui les environne. Tout près d'eux était une cahute en planches, et je voyais sur le Danube un
petit bateau, qu'un homme dirigeait fort doucement dans l'intention de tuer des corbeaux. Quelques minutes ensuite, effectivement, cet homme tire son coup de
fusil, abat un de ces oiseaux, qu'il prend et qu'il place sur la planche de son bateau ; mais dans l'instant même une énorme nuée de corbeaux arrive à
tire-d'aile ; leur nombre était tel, que l'homme eut peur et courut se cacher dans sa petite baraque, en quoi je pense qu'il agit prudemment ; car je n'ai pas le
moindre doute que les corbeaux, furieux du meurtre de leur camarade, ne l'eussent assailli de manière à le tuer. L'homme enfui, ces pauvres bêtes s'approchèrent
du corbeau blessé à mort, le prirent, et l'emportèrent sur les branches d'un des plus grands arbres. Alors commencèrent des cris, des croassements si violents,
qu'on ne peut en donner une idée. Je restai deux ou trois heures à peindre les arbres où ils étaient perchés, et lorsque j'eus fini mon étude, leur fureur
n'était point calmée. Cette scène, qui me surprit beaucoup, me jeta dans je ne sais quelle rêverie sur l'espèce humaine, qui, je dois l'avouer, était toute à
l'avantage des corbeaux.
J'étais heureuse à Vienne autant qu'il est possible de l'être loin des siens et de son pays. L'hiver, la ville m'offrait une des plus aimables et des plus
brillantes sociétés de l'Europe, et quand le beau temps revenait, j'allais jouir avec délice du charme de ma petite retraite. Je ne pensais donc nullement à
quitter l'Autriche avant qu'il fût possible de rentrer en France sans danger, lorsque l'ambassadeur de Russie et plusieurs de ses compatriotes me pressèrent
vivement d'aller à Pétersbourg où l'on m'assurait que l'impératrice me verrait arriver avec un extrême plaisir. Tout ce que le prince de Ligne m'avait dit de
Catherine II m'inspirait un grand désir de voir cette souveraine. Je pensais avec raison, d'ailleurs, que le plus court séjour en Russie compléterait la fortune
que je m'étais promis de faire avant de retourner à Paris ; je me décidai donc à faire ce voyage.
Je m'occupais de mes préparatifs pour quitter Vienne, et j'allais me mettre en route dans peu de jours, quand le prince de Ligne vint me voir. Il me conseilla
d'attendre la fonte des neiges, et pour m'engager à rester encore, il m'offrit d'aller habiter, sur la montagne de Caltemberg, l'ancien couvent qui lui avait été
donné par l'empereur Joseph II. Connaissant mon goût pour les lieux élevés, il me tenta en me parlant de Caltemberg comme de la plus haute montagne des environs
de Vienne, et je ne résistai pas à l'envie d'y passer quelque temps.
J'allai donc prendre avec ma fille, sa gouvernante et M. de Rivière, le chemin horrible et rocailleux qui conduit à ce couvent. Nous le fîmes à pied, les cahots
de la cariole n'étant pas supportables, en sorte que nous arrivâmes très fatigués. Le gardien et sa femme, à qui le prince nous avait fortement recommandés,
eurent pour nous les soins les plus empressés. Tous les bâtiments qu'avaient occupés anciennement les religieux existaient encore. On prépara aussitôt nos
chambres, qui n'étaient autre chose que de petites cellules distantes les unes des autres. Pendant ces arrangements, j'allai me reposer sur un banc, d'où l'on
avait une vue magnifique. Je planais sur le Danube, coupé par des îles qu'embellissait la plus belle végétation, et sur des campagnes à perte de vue ; enfin
c'était l'immensité, et l'on peut remarquer que les religieux avaient le bon esprit d'habiter toujours des lieux fort élevés. Privés des jouissances du monde, au
moins goûtaient-ils le charme qu'on éprouve à respirer un air pur en contemplant une nature grandiose. Je le goûtais moi-même alors, d'autant plus qu'il faisait
un temps admirable. Je me reposai promptement de mes fatigues ; et je courus de l'autre côté de la montagne, où, de la lisière d'un bois, j'apercevais dans le
fond un village très peuplé que traversait une petite rivière courante et limpide ; enfin, j'étais ravie de me trouver là : je préférais la cellule que j'allais
habiter à tous les salons du monde, et je bénissais ce bon prince de Ligne en regrettant bien qu'il ne fût pas témoin de mon bonheur.
Je suis restée trois semaines dans ce beau lieu. M. de Rivière, plus citadin que moi, allait souvent à la ville, mais nous n'en avons pas moins fait ensemble de
charmantes promenades sur la montagne. Ma fille venait quelquefois s'asseoir avec moi sur le banc dont j'ai parlé, où nous attendions le clair de lune. Je me
souviens qu'un soir, l'heure de son coucher approchant, elle me dit : «Maman, tu trouves que cela fait rêver ; pour moi, je trouve que cela donne envie de
dormir.»
Les grandes salles du couvent étaient restées intactes dans leur construction ; depuis, le prince les a fait meubler pour y donner de très belles fêtes. Les bals
durant une partie de la nuit, les dames restaient tout habillées, et se couchaient sur les divans qui entouraient ces immenses salons. Pour mon goût, Caltemberg,
tel qu'il était quand je l'ai habité, me plaisait infiniment mieux qu'à l'époque où se donnaient toutes ces fêtes. Je retrouve des vers que le prince de Ligne
m'adressa lorsque j'allai m'établir sur sa charmante montagne.
À MADAME LEBRUN.
Pour avoir fait à l'empyrée
Le même vol que Prométhée,
Vous méritez punition.
À ce mont soyez attachée.
Par un vautour au lieu d'être ici déchirée,
De vous nous voulons bien avoir compassion ;
De caresses soyez mangée :
Par notre amour soyez clouée ;
Et par notre admiration
Pour toujours en ces lieux fixée.
Près de votre habitation
De la voûte azurée
Dont vous semblez être échappée,
Oubliez votre nation,
Par votre génie honorée,
Mais à présent, pays de désolation !
Que ma montagne fortunée
Par la fière possession
Des talents dont la terre est ravie, étonnée,
Soit par nos chants à jamais célébrée.
Certes, on peut dire qu'une trop flatteuse exagération a dicté ces vers à l'aimable prince de Ligne ; mais en voici faits sur lui-même, pour lesquels le poète n'a laissé parler que la vérité.
Vers faits sur le prince de Ligne par M. de Langeron, en 1790.
De Mars et d'Apollon tu vois le favori,
Et de Vénus le serviteur fidèle.
Es-tu bon citoyen ? ce sera ton ami.
Es-tu soldat ? ce sera ton modèle.
Es-tu triste ? ses soins calmeront ta douleur.
Es-tu femme ? bientôt il sera ton vainqueur.
CHAPITRE XIV.
Je quitte Vienne. Prague. Les églises. Budin. Dresde. Les promenades. La galerie. Raphaël. La forteresse de Koenigsberg. Berlin. Reinsberg. Le prince Henri de Prusse.
Après avoir séjourné à Vienne deux ans et demi, j'en partis le dimanche 19 avril 1795 pour me rendre à Prague où j'arrivai le 23 avril, par une route très
belle.
Ce que nous remarquâmes d'abord en entrant dans la capitale de la Bohême, ville grande et bien bâtie, ce fut le pont placé sur la rivière qui traverse la ville
et qui va se jeter dans l'Elbe. Ce pont est très beau et très long ; car il a vingt-quatre arches.
Je commençai par aller voir les églises. La première que je visitai, Saint Thomas, est assez belle. J'y ai admiré un beau tableau de Rubens, qui représente le
martyre de saint Thomas ; puis un autre du Caravage, qui est très noirci, mais qui a de beaux détails.
On trouve au maître-autel de la cathédrale un superbe tableau de Gérard de la Notte, qui représente sainte Anne écrivant, et la Vierge tenant l'enfant Jésus. Ces
trois figures sont de la plus grande vérité. Le style en est parfait, de même que celui des draperies. Le fond aussi est du plus grand effet. L'arcade du milieu
fait illusion et perce la toile ; les bas-reliefs sont extrêmement soignés ; enfin cet ouvrage est un des plus finis de ce maître. À gauche du maître-autel, on
voit un tableau de Lairesse, représentant un martyr ; les figures du second et du troisième plan sont d'une finesse extraordinaire ; le fond en est fort bien
composé et bien peint.
Cette cathédrale renferme les tombeaux de trois empereurs couchés, qui sont d'un beau travail. Une chapelle toute en argent, dans laquelle est saint Népomucène ;
un superbe dais, soutenu par quatre anges plus grands que nature, en argent aussi ; un petit bas-relief, représentant le saint, que des guerriers jettent du haut
en bas des remparts. De plus on conserve dans l'église la cotte de mailles en fer de saint Népomucène, et beaucoup de personnes viennent baiser cette relique
historique.
Le palais de l'archiduchesse Marianne est très grand et très beau ; il me rappelait celui du roi de Naples.
La vieille ville est sur une montagne, et la nouvelle dans la plaine ; mais j'ai eu peu de temps pour les parcourir ; car je ne suis restée qu'un jour à Prague,
désirant arriver à Dresde le plus tôt possible.
Sur notre route, nous passâmes à Budin dont les environs sont charmants. Cette ville est déserte, ses fortifications sont en ruine ; on n'y rencontre que des
vieillards, quelques femmes et des enfants, mais encore en très petit nombre.
Enfin nous arrivâmes à Dresde, après avoir passé la Corniche, chemin fort étroit, sur une grande hauteur, d'où l'on côtoie l'Elbe qui coule dans un fond très
spacieux. Dresde est une jolie ville, bien bâtie, mais à cette époque elle était très mal pavée ; l'Elbe la traverse. Ses environs sont charmants, principalement
le Plaone, d'où l'on découvre une vue superbe ; mais malheureusement tous ces beaux lieux sont infectés de l'odeur des pipes. C'est là que les bourgeois
viennent, surtout le dimanche, faire des parties de plaisir ; beaucoup y apportent leur dîner, et sitôt leur repas terminé, ils se mettent tous à fumer, ce qui
désenchantait, pour moi, ces délicieuses promenades. Cet inconvénient, à la vérité, n'existe pas dans plusieurs beaux jardins que j'ai parcourus, et qui sont en
grand nombre. Je citerai principalement le Brill, le parc Antoine, le grand jardin de l'électeur et le jardin de Hollande, comme les plus remarquables.
J'allai à l'église catholique pour voir un très beau tableau de Mengs, qui représente l'Ascension, et le lendemain de mon arrivée, je visitai enfin cette fameuse
galerie de Dresde, unique dans le monde. Sa vue ne dément point sa grande célébrité ; il est bien certain que c'est la plus belle de l'Europe. J'y suis retournée
bien souvent, toujours plus convaincue de sa supériorité, en admirant le nombre immense de chefs-d'oeuvre qu'elle renferme.
Ces chefs-d'oeuvre sont trop connus par une foule d'ouvrages divers propres à en donner l'idée pour que j'entre ici dans aucuns détails. Je dirai seulement que
là comme partout on reconnaît combien Raphaël s'élève au-dessus de tous les autres maîtres. Je venais de visiter plusieurs salles de la galerie, lorsque
j'arrivai devant un tableau qui me saisit d'une admiration au-dessus de toutes celles que peut faire éprouver l'art du peintre. Il représente la Vierge, placée
sur des nuages, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Cette figure est d'une beauté, d'une noblesse dignes du divin pinceau qui l'a tracée. Le visage de l'enfant,
qui est charmant, porte une expression à la fois naïve et céleste ; les draperies sont du dessin le plus correct et d'une belle couleur. À la droite de la
Vierge, on voit un saint dont le caractère de vérité est admirable ; ses deux mains surtout sont à remarquer. À gauche est une jeune sainte, la tête baissée, qui
regarde deux anges placés en bas du tableau. Sa figure est pleine de beauté, de candeur et de modestie. Les deux petits anges sont appuyés sur leurs mains, les
yeux levés vers les personnages qui se trouvent au-dessus d'eux, et leurs têtes ont une ingénuité et une finesse dont il est impossible de donner l'idée par des
mots.
(nb) Ce tableau de Raphaël a été fort bien gravé à Dresde par Schender.
Après être restée très longtemps en adoration devant ce chef-d'oeuvre, je repassai pour sortir de la galerie par les mêmes salles que je venais de traverser.
Les meilleurs tableaux des plus grands maîtres avaient perdu, pour moi, quelque chose de leur perfection ; car j'emportais l'image de cette admirable composition
et de cette divine figure de Vierge ! Rien ne peut se comparer dans les arts à la noble simplicité, et toutes les figures que je revoyais me semblaient grimacer
un peu.
Ce qui rend cette galerie de Dresde aussi admirable, c'est qu'elle renferme des chefs-d'oeuvre des grands maîtres de toutes les écoles. On peut dire que toute la
peinture est là, et que l'art ne possède pas un nom célèbre qui n'y soit inscrit. Tout en évitant de donner ici un catalogue, je parlerai d'un saint Jérôme de
Rubens, qui m'a semblé un de ses ouvrages supérieurs, et d'une salle remplie de portraits et de tableaux de la Rosalba, qui sont d'une vérité enchanteresse. Les
pastels notamment ont une grâce et un moelleux qui rappelle tout-à-fait le Corrège.
L'électeur me fit prier d'exposer dans cette belle galerie ma Sibylle, qui voyageait avec moi, et pendant une semaine toute la cour y vint voir mon tableau. Je
m'y rendis moi-même le premier jour, afin de témoigner combien j'étais vivement touchée et reconnaissante de cette haute faveur, que j'étais loin d'attendre et
de mériter.
La bibliothèque de Dresde est très belle ; on y voit, outre des livres rares, une grande quantité de porcelaines très précieuses, et de très beaux antiques.
Le trésor est un des plus riches que l'on connaisse en diamants et en perles fines.
Une chose fort curieuse à voir, ce sont les salles qui renferment les armes, les costumes des anciens rois et chevaliers. On vous montre le chapeau de
Pierre-le-Grand, ainsi que son épée, le casque et la cuirasse d'Auguste, ancien roi de Pologne : cette cuirasse est si lourde qu'on ne peut concevoir comment ce
prince a pu la porter ; car maintenant il faut trois hommes pour la soulever.
Nous allâmes voir la fameuse forteresse de Koenigstein, et ma fille fut de cette partie. Notre chemin nous conduisit à un petit village nommé Krebs, bâti sur une
montagne, entouré de collines très fertiles, et de beaux bois de cyprès et de sapins. Nous nous y arrêtâmes pour jouir d'une superbe vue, qui vous montre, à
droite, la ville de Dresde, Pilnitz, l'Elbe, des montagnes lointaines, et à gauche la magnifique forteresse de Koenigstein. Brunette aimait tellement ce hameau,
qu'elle aurait voulu y rester, disant que l'on serait heureux là, loin des villes.
Nous arrivâmes à la forteresse de Koenigstein, l'une des plus belles du monde, tant par sa situation que par ses ouvrages. Il s'y trouve un puits si profond
qu'il faut trente secondes pour entendre tomber dans l'eau ce qu'on y jette. L'eau de ce puits est très bonne à boire. Tout concourt à faire de cette place forte
un lieu de défense admirable ; de son immense hauteur, elle plane sur un pays de culture en blé, et sur d'excellents pâturages. Elle est entourée de canons, et
le magasin à poudre est placé au milieu d'un bois qui la touche.
Dans l'intention sans doute de nous prémunir contre les dangers que nous pouvions courir à une telle élévation, on nous raconta dans cette forteresse plusieurs
événements arrivés par suite d'imprudence : une nourrice et son enfant étaient tombés de trois cents pieds dans l'Elbe ; on sauva l'enfant, mais la femme fut
tuée. Le vent est si furieux sur cette hauteur, qu'un jour il enleva un soldat qui n'avait pas eu la précaution de quitter son manteau, et, par un bien heureux
hasard, ce soldat ne se fit aucun mal. Une autre fois, un jeune page eut l'imprudence de s'endormir sur un roc qui n'a pas quatre pieds de large et tout au plus
huit pieds de long. Heureusement ce jour-là l'électeur donnait à dîner à Koenigstein ; il aperçut l'étourdi qu'il fit lier avec des cordes, et rentrer par la
fenêtre.
La vue que l'on découvre de cette belle forteresse est d'une immensité vraiment prodigieuse.
Étant très pressée de me rendre à Pétersbourg, j'allai directement de Dresde à Berlin, où je ne suis restée que cinq jours, car mon projet était d'y revenir et
d'y séjourner à mon retour de Russie, pour y voir la charmante reine de Prusse.
Berlin, comme on sait, est une très belle ville, mais pas assez peuplée pour sa grandeur, ce qui rend les rues un peu tristes ; elle est traversée par la Sprée,
qui va se jeter dans l'Ebre, et plusieurs édifices y sont très remarquables. Le palais du roi est superbe ; celui du prince Henri est aussi fort beau. On en peut
dire autant des bâtiments de l'arsenal et de l'église catholique qui a la forme de la rotonde, et d'un grand nombre de palais. La salle de la comédie se trouve
placée entre deux églises. Les dehors de la salle de l'Opéra, qui est très grande, sont simples et d'une belle architecture.
La plus belle rue de Berlin a un mille de longueur. Elle est parfaitement alignée, et l'on trouve à son extrémité une porte ornée de huit colonnes, qui conduit à
Charlottenbourg. Ce parc est magnifique, plus grand que le Prater et le Casino de Florence. On s'y promène à pied, à cheval et en voiture. En allant à cette
belle promenade, on peut voir une charmante maison de plaisance du prince Ferdinand, qui se nomme Belle-Vue.
Charlottenbourg est un village à trois quarts d'heure de chemin de Berlin. Le roi y possède un château superbe, dont les appartements sont fort curieux.
Quelques-uns sont modernes, d'autres gothiques, chinois, japonais, et l'ordonnance de tous est de très bon goût. Le théâtre a quatre-vingt-trois pieds de
profondeur. Il s'y trouve aussi quelques tableaux remarquables, entre autres un de Charles Lebrun, qui représente une Vierge montant au ciel, dans lequel un des
apôtres est le portrait du peintre.
J'ai admiré à Berlin une superbe collection de porcelaines. Le palais du roi renferme de fort beaux tableaux, un grand nombre de statues antiques, qui pour la
plupart sont remarquables, et le lit de noce de plusieurs rois de Prusse. Mais ce qu'on y voit avec plus d'intérêt que toute autre chose, c'est la chambre du
grand Frédéric. La mémoire de ce prince vous suit partout à Berlin et à Potsdam, où je suis allée aussi m'asseoir sur le banc où s'asseyait le grand capitaine.
C'est de là qu'il jouissait de la plus belle vue du monde, en se livrant sans doute à ces hautes pensées qui importaient tant au sort de l'Europe.
Après avoir séjourné cinq jours à Berlin, je partis le 28 mai 1795 pour aller à Reinsberg, résidence du prince Henri, située à vingt lieues de la capitale. Nous
fîmes cette route fort lentement, le chemin n'étant que sable. On côtoie plusieurs forêts et des plaines bien cultivées ; en général, le Brandebourg a de belles
campagnes jusqu'à Reinsberg. J'allais avoir la joie de retrouver la marquise de Sabran et le chevalier de Boufflers. C'était même sur une lettre que cette
aimable femme m'avait adressée à Berlin, dans laquelle elle me disait que le prince Henri ne me pardonnerait point d'aller en Russie sans m'arrêter chez lui, que
je m'étais décidée à ce petit voyage. J'eus tout lieu d'être persuadée que madame de Sabran m'avait dit vrai quand je vis le prince accourir au-devant de ma
voiture pour me recevoir avec une bonté sans égale. Quoique je fusse en habit de voyage, il voulut me présenter aussitôt à ses parents et parentes (la famille
Ferdinand), sans me donner le temps de faire ma toilette. Je crus m'apercevoir que les dames en étaient au moins étonnées ; mais le bon prince se chargea de
toutes les excuses, ce qui était d'autant plus juste, à dire vrai, qu'il était le seul coupable.
Le château est très bien situé, et divisé en deux parties, dont la famille Ferdinand habitait la plus grande. Le lendemain, le prince Henri me promena dans son
parc, qui est immense et très beau. Par amour pour les braves guerriers qui combattaient avec lui dans la guerre de Sept-Ans, le prince y avait fait élever une
énorme pyramide sur laquelle tous leurs noms sont inscrits. Un autre monument était un temple dédié à l'amitié, et couvert d'inscriptions en prose, aussi tristes
qu'affectueuses, sur les amis qu'il avait perdus. Mais ce qui me toucha surtout, ce fut la vue d'une colonne, au bas de laquelle sont des vers en l'honneur du
dévouement et de la mort généreuse de Malesherbes. Je n'aurais pas connu le coeur noble et bon du prince Henri, que ce trait me l'aurait fait connaître.
Le prince me fit faire aussi une charmante promenade sur son lac, au milieu duquel est une île qu'on prétend avoir été habitée par Rémus
dont elle porte le nom.
La comtesse de Sabran, son fils et le chevalier de Boufflers étaient établis à Reinsberg ; ils y sont encore restés très longtemps après mon départ. Le prince
leur avait donné des terres, et le chevalier s'était fait cultivateur. On menait dans ce beau lieu la vie la plus douce et la plus agréable. Il y avait une
troupe de comédiens français, qui appartenait au prince. On a donné pendant mon séjour quelques comédies assez bien jouées, et plusieurs concerts ; car le maître
avait conservé toute sa passion pour la musique.
Je ne puis dire combien j'étais triste de quitter cet excellent prince, que je ne devais, hélas ! jamais revoir, et que je regretterai toute ma vie. L'accueil
que j'en avais reçu, les bontés dont il m'avait comblée pendant mon séjour chez lui, tout me rendait cette séparation pénible. Ses attentions pour moi ne se
ralentirent pas un instant, et dès que j'eus quitté Reinsberg, je fus touchée au dernier point, en découvrant la quantité de provisions qu'il avait fait mettre
dans ma voiture, sachant que je ne trouverais rien jusqu'à Riga. On avait placé des comestibles et des bouteilles de vin dans les poches et dans les coffres ;
j'y trouvai de quoi nourrir tout un régiment prussien, et certes le bon prince dut être bien assuré que je ne mourrais pas d'inanition en route.
En quittant Reinsberg, nous prîmes le chemin de la Prusse qui conduit à Koenigsberg. Les petites villes que l'on trouve en route sont très bien bâties ; la
plupart des campagnes sont fertiles ; mais ce chemin si sablonneux me donnait bien de l'ennui. Nous ne pouvions faire qu'une poste en sept heures, ce qui m'a
obligée souvent à marcher la nuit. Avant d'arriver de Mariaverde à Koenigsberg, on voit la mer, et fort près du chemin, qui est très étroit, la Hafft. Je mis dix
jours pour aller de Reinsberg à Koenigsberg, d'où je repartis aussitôt pour Memel. Loin de s'améliorer, la route devient alors plus affreuse. Jour et nuit nous
marchions dans des sables horribles, côtoyant la Hafft de si près que la moitié de la voiture était penchée dans cette rivière. Enfin j'arrivai à Riga, et je m'y
reposai plusieurs jours en attendant nos passeports pour Pétersbourg.
CHAPITRE XV.
Peterhoff. Pétersbourg. Le comte d'Esterhazy. Czarskozelo. La grande-duchesse Elizabeth, femme d'Alexandre. Catherine II. Le comte Strogonoff. Kaminostroff. Esprit hospitalier des Russes.
J'entrai à Pétersbourg le 25 juillet 1795, par le chemin de Peterhoff, qui m'avait donné une idée avantageuse de la ville ; car ce chemin est bordé des deux
côtés par de charmantes maisons de campagne, entourées de jardins du meilleur goût dans le genre anglais. Les habitants ont tiré parti du terrain, qui est très
marécageux, pour orner ces jardins, où se trouvent des kiosques, de jolis ponts, etc., par des canaux et des petites rivières qui les traversent. Il est
malheureux qu'une humidité effroyable vienne le soir désenchanter tout cela ; même avant le coucher du soleil, il s'élève un tel brouillard que l'on se croit
entouré d'une épaisse fumée presque noire.
Toute magnifique que je me représentais Pétersbourg, je fus ravie par l'aspect de ses monuments, de ses beaux hôtels et de ses larges rues, dont une, que l'on
nomme la Perspective, a une lieue de long. La belle Néva, si claire, si limpide, traverse la ville chargée de vaisseaux et de barques, qui vont et viennent sans
cesse, ce qui anime cette belle cité d'une manière charmante. Les quais de la Néva sont en granit, ainsi que ceux de plusieurs grands canaux que Catherine a fait
creuser dans l'intérieur de la ville. D'un côté de la rivière se trouvent de superbes monuments, celui de l'Académie des arts, celui de l'Académie des sciences
et beaucoup d'autres encore, qui se reflètent dans la Néva. On ne peut rien voir de plus beau, au clair de lune, que les masses de ces majestueux édifices, qui
ressemblent à des temples antiques. En tout, Pétersbourg me transportait au temps d'Agamemnon, tant par le grandiose de ses monuments que par le costume du
peuple, qui rappelle celui de l'ancien âge.
Quoique j'aie parlé plus haut du clair de lune, ce n'est pas qu'à l'époque de mon arrivée il me fût possible d'en jouir ; car au mois de juillet on n'a pas à
Pétersbourg une heure de nuit ; le soleil se couche vers dix heures et demie du soir ; la brune dure jusqu'au crépuscule, qui commence vers minuit et demi, en
sorte que l'on y voit toujours clair, et j'ai souvent soupé à onze heures avec le jour.
Mon premier soin fut de me reposer ; car depuis Riga les chemins avaient été ce qu'on imagine de plus effroyables;
(nb) L'empereur Alexandre a fait rétablir cette route depuis que j'ai quitté la Russie : elle est fort belle maintenant.
de grosses pierres posées les unes sur les autres nous donnaient à chaque pas des secousses d'autant plus violentes, que ma voiture était une des plus rudes
du monde, et les auberges étant trop mauvaises sur cette route pour qu'il fût possible de s'y arrêter, nous avions marché de cahot en cahot jusqu'à Pétersbourg
sans prendre de repos.
J'étais bien loin de me sentir remise de toutes mes fatigues, car je n'habitais Pétersbourg que depuis vingt-quatre heures, lorsqu'on m'annonça l'ambassadeur de
France, le comte d'Esterhazy. Il me dit qu'il allait informer tout de suite l'impératrice de mon arrivée, et prendre en même temps ses ordres pour ma
présentation. Un instant après, je reçus la visite du comte de Choiseul-Gouffier. Tout en causant avec lui, je lui témoignai le bonheur que j'aurais à voir cette
grande Catherine ; mais je ne lui dissimulai pas la peur et l'embarras que j'éprouverais lorsque je serais présentée à cette princesse si imposante. «Rassurez-vous,
me répondit-il ; lorsque vous verrez l'impératrice, vous serez étonnée de son air de bonhomie ; car, ajouta-t-il, c'est vraiment une bonne femme.»
J'avoue que cette expression me surprit ; je ne pouvais croire à sa justesse, d'après ce que j'avais entendu dire jusqu'alors. Il est vrai que le prince de
Ligne, en nous faisant avec tant de charme la narration de son voyage en Crimée, nous avait conté plusieurs choses qui prouvaient que cette grande princesse
avait autant de grâce que de simplicité dans ses manières ; mais une bonne femme, on en conviendra, n'était pas le mot propre.
Quoi qu'il en soit, le soir même, M. d'Esterhazy, en revenant de Czarskozelo, où l'impératrice était établie, vint me prévenir que Sa Majesté me recevrait le
lendemain à une heure. Une présentation aussi prompte, que je n'avais pas espérée, me jeta dans un extrême embarras ; je n'avais que des robes de mousseline très
simples, n'en portant point d'autres habituellement, et il était impossible de faire faire une robe parée du jour au lendemain. M. d'Esterhazy m'avait dit qu'il
viendrait me prendre à dix heures précises, pour me mener déjeuner avec sa femme, qui habitait aussi Czarskozelo, en sorte que, lorsqu'il arriva à l'heure
indiquée, je partis assez inquiète de ma toilette, qui vraiment n'était pas une toilette de cour. En entrant chez madame d'Esterhazy, en effet, je remarquai bien
son étonnement. Toute sa politesse ne put l'empêcher de me dire : «Madame, est-ce que vous n'avez pas apporté une autre robe ?» Je devins cramoisie, et
j'expliquai comment le temps m'avait manqué pour me faire faire une robe plus convenable. Son air mécontent de moi redoubla mon anxiété, au point que j'eus
besoin de m'armer de tout mon courage quand le moment d'aller chez l'impératrice arriva.
M. d'Esterhazy me donnait le bras, et nous traversions une partie du parc, lorsqu'à la fenêtre d'un rez-de-chaussée j'aperçus une jeune personne qui arrosait un
pot d'oeillets. Elle avait dix-sept ans au plus ; ses traits étaient fins et réguliers, et son ovale parfait ; son beau teint n'était pas animé, mais d'une
pâleur tout-à-fait en harmonie avec l'expression de son visage, dont la douceur était angélique. Ses cheveux blond cendré flottaient sur son cou, sur son front.
Elle était vêtue d'une tunique blanche, attachée par une ceinture nouée négligemment autour d'une taille fine et souple comme celle d'une nymphe. Telle que je
viens de la peindre, elle se détachait sur le fond de son appartement, orné de colonnes, et drapé en gaze rose et argent, d'une manière si ravissante que je
m'écriai : C'est Psyché ! C'était la princesse Élizabeth, femme d'Alexandre. Elle m'adressa la parole, et me retint assez longtemps pour me dire mille choses
flatteuses ; puis elle ajouta :-«Il y a bien longtemps, madame, que nous vous désirions ici, au point que j'ai rêvé souvent que vous y étiez arrivée.» Je la
quittai à regret, et j'ai toujours conservé le souvenir de cette charmante apparition.
J'arrivai chez l'impératrice un peu tremblante, et me voilà tête à tête avec l'autocrate de toutes les Russies. M. d'Esterhazy m'avait dit qu'il fallait lui
baiser la main, et conséquemment à cet usage elle avait ôté un de ses gants, ce qui aurait dû me le rappeler ; mais je l'oubliai complètement. Il est vrai que
l'aspect de cette femme si célèbre me faisait une telle impression, qu'il m'était impossible de songer à autre chose qu'à la contempler. J'étais d'abord
extrêmement étonnée de la trouver très petite ; je me l'étais figurée d'une grandeur prodigieuse, aussi haute que sa renommée. Elle était fort grasse, mais elle
avait encore un beau visage, que ses cheveux blancs et relevés encadraient à merveille. Le génie paraissait siéger sur son front large et très élevé. Ses yeux
étaient doux et fins, son nez tout-à-fait grec, son teint fort animé, et sa physionomie très mobile.
Elle me dit aussitôt avec un son de voix plein de douceur, un peu gras pourtant : «Je suis charmée, madame, de vous recevoir ici ; votre réputation vous avait
devancée. J'aime beaucoup les arts, et surtout la peinture. Je ne suis pas connaisseur, mais amateur.» Tout ce qu'elle ajouta pendant cet entretien, qui fut
assez long, sur le désir qu'elle avait que je pusse me plaire assez en Russie pour y rester longtemps, portait le caractère d'une si grande bienveillance, que ma
timidité disparut, et lorsque je pris congé, j'étais entièrement rassurée. Seulement je ne me pardonnais pas de n'avoir pas baisé sa main, qui était très belle
et très blanche, d'autant plus que M. d'Esterhazy m'en fit des reproches. Quant à ma toilette, elle ne me parut pas y faire la moindre attention, ou peut-être
était-elle moins difficile sous ce rapport que notre ambassadrice.
Je parcourus une partie des jardins de Czarskozelo, qui sont une vraie féerie. L'impératrice y avait une terrasse qui communiquait à ses appartements, sur
laquelle elle entretenait une grande quantité d'oiseaux ; on me dit que tous les matins elle venait leur donner la béquée, et que c'était un de ses grands
plaisirs.
Tout de suite après m'avoir reçue, Sa Majesté témoigna l'intention de me faire passer l'été dans cette belle campagne. Elle commanda aux maréchaux-des-logis
(dont l'un était le vieux prince Bariatinski) de me donner un appartement dans le château, désirant m'avoir près d'elle afin de me voir peindre. Mais j'ai su
depuis que ces Messieurs ne se soucièrent nullement de me placer aussi près de l'impératrice ; et malgré ses ordres réitérés, ils soutinrent toujours qu'ils
n'avaient aucun logement disponible. Ce qui me surprit au dernier point, lorsqu'on m'instruisit de ce détail, c'est qu'on me dit que ces courtisans, me croyant
du parti du comte d'Artois, craignaient que je ne fusse venue pour faire remplacer M. d'Esterhazy par un autre ambassadeur. Il est vraisemblable que M.
d'Esterhazy s'entendait de tout cela avec eux ; mais certes, il fallait bien peu me connaître pour ne pas savoir que j'étais trop occupée de mon art pour pouvoir
donner du temps à des affaires politiques, lors même que je n'aurais pas eu l'aversion que j'ai toujours ressentie pour tout ce qui ressemble à l'intrigue. Au
reste, à part l'honneur de me trouver logée chez la souveraine, et le plaisir d'habiter un aussi beau lieu, tout était gêne et contrariété pour moi dans un
établissement à Czarskozelo. J'ai toujours eu le plus grand besoin de jouir de ma liberté, et, pour vivre selon mon goût, j'aimais infiniment mieux loger chez
moi.
L'accueil que je recevais en Russie, d'ailleurs, était bien fait pour me consoler d'une petite tracasserie de cour. Je ne saurais dire avec quel empressement,
avec quelle bienveillance affectueuse, un étranger se voit recherché dans ce pays, surtout s'il possède quelque talent. Mes lettres de recommandation me
devinrent tout-à-fait inutiles ; non seulement je fus aussitôt invitée à passer ma vie dans les meilleures et les plus agréables maisons, mais je retrouvais à
Pétersbourg plusieurs anciennes connaissances, et même d'anciens amis. D'abord le comte de Strogonoff, véritable amateur des arts, dont j'avais fait le portrait
à Paris, dans ma très grande jeunesse. Nous nous revîmes tous deux avec un plaisir extrême. Il possédait à Pétersbourg une superbe collection de tableaux, et
près de la ville, à Kaminostroff, un charmant cazin à l'italienne, où il donnait tous les dimanches un grand dîner. Il vint me chercher pour m'y conduire, et je
fus enchantée de cette habitation : le cazin donnait sur le grand chemin, et des fenêtres on voyait la Néva. Le jardin, dont on n'apercevait pas les limites,
était dans le genre anglais. Une quantité de barques arrivaient de tout côté, amenant du monde qui descendait chez le comte Strogonoff ; car beaucoup de
personnes, qui n'étaient point du dîner, venaient se promener dans le parc. Le comte permettait aussi à des marchands de s'y installer avec leurs boutiques, ce
qui animait ce beau lieu par une foire amusante, attendu que les costumes des divers pays voisins étaient pittoresques et variés.
Vers les trois heures, nous montâmes sur une terrasse couverte et entourée de colonnes, où le jour arrivait de toute part. D'un côté, nous jouissions de la vue
du parc, et de l'autre, de celle de la Néva, chargée de mille barques plus ou moins élégantes. Il faisait le plus beau temps du monde ; car l'été est superbe en
Russie, où souvent au mois de juillet j'ai eu plus chaud qu'en Italie. Nous dînâmes sur cette même terrasse, et le dîner fut splendide, au point que l'on nous
servit au dessert des fruits magnifiques et d'excellents melons, ce qui me parut devoir être un grand luxe. Dès que nous fûmes à table, une musique d'instruments
à vent délicieuse se fit entendre. Elle exécuta surtout l'ouverture d'Iphigénie d'une manière ravissante. Aussi fus-je bien surprise
quand le comte Strogonoff me dit que chacun des musiciens ne donnait qu'une note ; il m'était impossible de concevoir comment tous ces sons particuliers
arrivaient à former un ensemble vraiment parfait, et comment l'expression pouvait naître d'une exécution aussi machinale.
Après le dîner, nous fîmes une promenade charmante dans le parc ; puis, vers le soir, nous remontâmes sur la terrasse d'où nous vîmes tirer, dès que la nuit fut
venue, un très beau feu d'artifice que le comte avait fait préparer. Ce feu, répété dans les eaux de la Néva, était d'un effet magique. Enfin, pour terminer les
plaisirs de cette journée, arrivèrent, dans deux petits bateaux très étroits, des Indiens qui se mirent à danser devant nous. Cette danse consistait à faire de
si légers mouvements sans bouger de place, qu'elle nous divertit beaucoup.
La maison du comte de Strogonoff était bien loin d'être la seule qui fût tenue avec autant de magnificence. À Pétersbourg comme à Moscou, une foule de seigneurs
qui possèdent des fortunes colossales, se plaisent à tenir table ouverte, au point qu'un étranger connu, ou bien recommandé, n'a jamais besoin d'avoir recours au
restaurateur.
(nb) Dans les derniers temps de mon séjour à Pétersbourg, le prince Nariebskin, grand écuyer, tenait constamment une table ouverte de vingt-cinq à trente couverts pour les étrangers.
Il trouve partout un dîner, un souper, il n'a que l'embarras du choix. J'ai eu toute la peine possible à me dispenser d'aller souvent dîner en ville ; mes
séances, et le besoin que j'ai de dormir en sortant de table, pouvaient seuls me faire pardonner mes refus, tant les Russes sont enchantés que l'on vienne dîner
chez eux.
Ce caractère hospitalier existe aussi dans l'intérieur de la Russie où la civilisation moderne n'a point encore pénétré. Lorsque les seigneurs russes vont
visiter leurs terres, qui généralement sont situées à de grandes distances de la capitale, ils s'arrêtent en chemin dans les châteaux de leurs compatriotes, où,
sans être connus personnellement du maître de la maison, eux, leurs gens et leurs bêtes sont reçus et traités à merveille, quand ils devraient y rester un mois.
De plus, j'ai vu un voyageur qui venait de parcourir ce vaste pays avec deux de ses amis. Tous les trois avaient traversé les provinces les plus reculées ainsi
qu'on aurait pu le faire dans l'âge d'or, au temps des patriarches. Partout on les avait logés et nourris avec tant de bonté que leur bourse était devenue
inutile. Ils ne parvenaient seulement pas à faire accepter le pourboire aux gens qui les avaient servis et qui avaient soigné leurs chevaux. Leurs hôtes, qui
pour la plupart étaient des négociants ou des cultivateurs, s'étonnaient beaucoup de la vivacité de leurs remerciements. «Si nous étions dans votre pays,
disaient-ils, bien certainement vous en feriez autant pour nous.» Hélas !
CHAPITRE XVI.
Le comte de Cobentzel. La princesse Dolgorouki. Les tableaux vivants. Potemkin. Madame de With. Je suis volée. Doyen. M. de L***.
Je profitais du reste de la belle saison pour courir un peu les campagnes ; car l'été finit en Russie au mois d'août et il n'y a point d'automne. J'allais
souvent me promener à Czarkozelo, dont le parc, bordé par la mer, est une des belles choses qu'on puisse voir. Il est rempli de monuments que l'impératrice
appelait ses caprices. On y voit un superbe pont de marbre dans le style du Palladio ; des bains turcs, trophées des victoires de Romazoff et d'Orloff ; un
temple à trente-deux colonnes, puis la colonnade et le grand escalier d'Hercule. Ce parc a des allées d'arbres superbes. En face du château est un long et large
gazon au bout duquel se trouve une cerisaie où je me souviens d'avoir mangé des cerises excellentes.
Le comte de Cobentzel désirait beaucoup me faire faire connaissance avec une femme dont j'avais entendu vanter l'esprit et la beauté, la princesse Dolgorouki. Je
reçus d'elle un billet d'invitation pour aller dîner à Alexandrowski où elle avait une maison de campagne, et le comte vint me prendre pour m'y conduire avec ma
fille. Cette maison fort grande était meublée sans aucune recherche ; mais la rivière terminait le jardin, et c'était un grand plaisir pour moi que la vue de ce
passage continuel de barques, dans lesquelles les rameurs chantaient en choeur. Les chants du peuple russe ont une originalité un peu barbare ; mais ils sont
mélancoliques et mélodieux.
La beauté de la princesse Dolgorouki me frappa. Ses traits avaient tout le caractère grec mêlé de quelque chose de juif, surtout de profil. Ses longs cheveux
châtain foncé, relevés négligemment, tombaient sur ses épaules ; sa taille était admirable, et toute sa personne avait à la fois de la noblesse et de la grâce
sans aucune affectation. Elle me reçût avec tant d'amabilité et de distinction, que je cédai volontiers à la demande qu'elle me fit de rester huit jours chez
elle. L'aimable princesse Kourakin, avec qui je fis connaissance alors, était établie dans cette maison, où ces deux dames et le comte de Cobentzel faisaient
ménage commun. La société était fort nombreuse, et personne ne songeait à autre chose qu'à s'amuser. Après dîner nous faisions des promenades charmantes dans des
barques fort élégantes, ornées de rideaux de velours cramoisi à crépines d'or. Des musiciens nous devançaient dans une barque plus simple, nous charmant par leur
chant, car ce chant était toujours d'une justesse parfaite, même dans les sons les plus élevés. Le jour de mon arrivée nous eûmes de la musique le soir, et le
lendemain un spectacle charmant. On donna Le Souterrain de Dalayrac. La princesse Dolgorouki jouait le rôle de Camille ; le jeune de la
Ribaussière
(nb) Celui qui depuis a été ministre en Russie.
celui de l'enfant, et le comte de Cobentzel celui du jardinier. Je me souviens que pendant la représentation, un courrier arriva de Vienne, chargé de dépêches
pour le comte, qui était ambassadeur d'Autriche à Pétersbourg, et qu'à la vue d'un homme costumé en jardinier, il ne voulait pas lui remettre ses dépêches, ce
qui éleva dans la coulisse une contestation fort plaisante.
Le petit théâtre était charmant, je voulus en profiter pour composer des tableaux vivants. Il nous arrivait sans cesse du monde de Pétersbourg ; je choisissais
mes personnages entre les plus beaux hommes et les plus belles femmes, et je les costumais en les drapant avec des schals de cachemire que nous avions à
profusion. Je préférais les sujets graves ou ceux de la Bible à tout autre. Je représentai aussi de souvenir plusieurs tableaux connus, tels que la famille de
Darius, qui réussit à merveille ; mais celui qui obtint le plus grand succès fut celui d'Achille à la cour de Lycomède ; je me chargeai du personnage d'Achille,
car le plus souvent je m'habillais de manière qu'un casque et un bouclier suffisent pour me composer un costume fort exact. Les tableaux vivants amusaient
extrêmement la société. L'hiver suivant ils servirent à varier les divertissements du soir dans les salons de Pétersbourg. Chacun voulait s'y trouver placé, et
je me voyais forcée de contrarier quelques dames qui désiraient beaucoup être en exhibition.
Au bout de huit jours qui ne m'avaient paru qu'un moment, il me fallut, à mon grand regret, quitter la maison de la très aimable princesse Dolgorouki ; car
j'avais pris une foule d'engagements pour des portraits à faire. Toutefois, je venais de former à Alexandrowski plusieurs liaisons qui me furent infiniment
agréables pendant tout mon séjour en Russie.
Le comte de Cobentzel était passionnément amoureux de la princesse Dolgorouki, sans qu'elle répondît le moins du monde à son amour ; mais l'insouciance avec
laquelle elle recevait ses soins ne parvenait point à l'éloigner, et, comme dit une chanson, il préférait ses rigueurs à toutes les faveurs des autres femmes. Ne
pouvant espérer d'autre bonheur que celui de la voir, il voulait au moins jouir de celui-là dans toute sa latitude : soit à la campagne, soit à la ville, il ne
la quittait jamais. Dès que ses dépêches, qu'il faisait avec une grande facilité, étaient expédiées, il volait chez elle, et s'était complètement fait son
esclave. On le voyait courir au moindre mot, au moindre geste de sa divinité. Voulait-on jouer la comédie, il prenait le rôle qu'elle lui donnait, même lorsque
ce rôle ne convenait point du tout à son physique. Car le comte de Cobentzel, qui paraissait avoir cinquante ans, était fort laid et louchait horriblement. Il
était assez grand, mais très gros, ce qui ne l'empêchait pas d'être fort actif, surtout lorsqu'il s'agissait d'exécuter les ordres de sa bien-aimée princesse. Au
reste il avait de l'esprit, il était habile ; sa conversation était animée par mille anecdotes qu'il racontait à merveille, et je l'ai toujours connu pour le
meilleur et le plus obligeant des hommes.
Ce qui pouvait donner à la princesse Dolgorouki de l'indifférence pour les soins de M. de Cobentzel comme pour ceux de beaucoup d'autres adorateurs, c'est
qu'elle en avait reçu de si brillants, que les souverains les plus épris d'une femme n'en avaient jamais rendu de pareils. Le fameux Potemkin, celui qui voulait
que l'on rayât le mot impossible de la grammaire, l'avait aimée passionnément, et la magnificence avec laquelle il lui témoignait son
amour surpasse tout ce que nous lisons dans les Mille et une Nuits. Lorsqu'en 1791, après avoir fait son voyage en Crimée,
l'Impératrice retourna à Pétersbourg, le prince Potemkin resta pour commander l'armée où plusieurs généraux avaient amené leurs femmes. Ce fut alors qu'il eut
occasion de connaître la princesse Dolgorouki. Elle se nommait aussi Catherine, et le jour de cette fête arrivé, le prince donna un grand dîner, soi-disant en
l'honneur de l'Impératrice. Il avait placé la princesse à table à côté de lui. Au dessert on apporta des coupes de cristal remplies de diamants que l'on servit
aux dames à pleines cuillerées. La reine du festin paraissant remarquer cette magnificence : - «Puisque c'est vous que je fête, lui dit-il tout bas, comment vous
étonnez-vous de quelque chose ?» Rien ne lui coûtait pour satisfaire un désir, un caprice de cette femme adorée. Ayant appris qu'elle manquait de souliers de
bal, qu'habituellement elle faisait venir de France, Potemkin fit partir pour Paris un exprès, qui courut jour et nuit et rapporta des souliers. Une chose qui
était bien connue aussi de tout Pétersbourg, c'est que, pour offrir à la princesse Dolgorouki un spectacle qu'elle désirait voir, il avait fait donner l'assaut à
la forteresse d'Otshakoff plus tôt qu'il n'était convenu, et peut-être qu'il n'était prudent de le faire.
Lorsque j'arrivai à Pétersbourg il y avait déjà plusieurs années que le prince Potemkin était mort ; mais on y parlait encore de lui comme d'un enchanteur. On
peut prendre une idée de ce qu'il avait d'extraordinaire et de grandiose dans l'imagination, en lisant ce qu'ont écrit le prince de Ligne et le comte de Ségur du
voyage qu'il fit faire à l'impératrice en Crimée. Ces palais, ces villages en bois, bâtis sur toute la route comme par un coup de baguette ; cette immense forêt
qu'il brûle pour donner un feu d'artifice à Sa Majesté, tout ce voyage enfin, a quelque chose de fantastique. Sa nièce, la comtesse Scawronski, me disait à
Vienne : «Si mon oncle vous avait connue, il vous aurait comblée d'honneurs et de richesses.» Il est certain qu'en toute occasion cet homme si célèbre se
montrait généreux jusqu'à la prodigalité, magnifique jusqu'à la folie. Tous ses goûts étaient dispendieux, toutes ses habitudes royales, au point qu'ayant
possédé une fortune qui dépassait celle de certains souverains, le prince de Ligne m'a dit l'avoir vu quelquefois sans argent.
La faveur, la puissance, avaient habitué le prince Potemkin à satisfaire aussitôt ses plus légères volontés. On cite un trait qui le prouve admirablement. Comme
on parlait un jour chez lui de la grandeur d'un de ses aides-de-camp, il dit qu'un officier de l'armée russe, qu'il nomma, était encore d'une plus haute taille.
Tous ceux qui connaissaient cet officier n'en étant pas convenus, il fit partir aussitôt un exprès avec ordre d'amener ce militaire, qui se trouvait alors à huit
cents lieues de là. Lorsque celui-ci apprit qu'on venait le chercher de la part du prince, sa joie fut extrême ; car il se persuada qu'il venait d'être nommé à
quelque grade supérieur. On peut donc imaginer son désappointement, quand à son arrivée au camp, on le fit se mesurer avec l'aide-de-camp de Potemkin, après quoi
il fallut s'en retourner bien tristement, le tout n'ayant d'autre résultat pour lui que la fatigue d'un aussi long voyage.
On sent bien que l'homme qu'une si longue faveur avait accoutumé pour ainsi dire à régner à côté de la souveraine, ne pouvait survivre à la pensée d'une
disgrâce. Lorsqu'on lui écrivit que le nouveau favori (le jeune Platon Zouboff) paraissait prendre un empire absolu sur l'esprit de l'impératrice, il se hâta de
quitter l'armée pour voler à Pétersbourg. Comme il y arrivait, Catherine venait d'envoyer au prince Repnin, qui le remplaçait dans le commandement des troupes,
l'ordre de traiter de la paix, à laquelle Potemkin s'était toujours opposé. Irrité autant qu'on peut l'être, il repart à l'instant dans l'espoir d'arrêter la
signature ; mais c'est pour apprendre à Yassy que la paix était conclue. Cette nouvelle lui porta le coup fatal ; déjà souffrant, il tomba mortellement malade,
ce qui ne l'empêcha pas de se remettre aussitôt en route pour Pétersbourg. En peu d'heures, son mal fit de tels progrès, qu'il lui devint impossible de supporter
le mouvement de la voiture ; on l'étendit sur un pré, couvert de son manteau, et là, Potemkin rendit le dernier soupir, le 15 octobre 1791, dans les bras de la
comtesse Branitska, sa nièce. Je n'ai jamais oublié qu'un jour, que je demandais à une vieille princesse Galitzin, qui parlait fort mal français, comment était
mort cet homme si célèbre. Elle me répondit : «Hélas, ma chère ! ce grand prince qui avait tant de diamants, tant d'or, est mort sur l'herbette.»
La princesse Dolgorouki n'a pas été la seule beauté dont le prince se soit montré épris. On l'a vu aussi éperdument amoureux d'une charmante Polonaise, nommée
d'abord madame de With, et mariée depuis à un Potoski, pour laquelle il déploya de même tout ce que la galanterie a de plus recherché. Entre plusieurs traits de
magnificence, on cite que, voulant lui faire accepter un cachemire de fort grand prix, il imagina de donner une fête où se trouvaient deux cents femmes, et fit
tirer après le dîner une loterie à laquelle toutes ces dames gagnèrent chacune un cachemire, trop heureux qu'il était de faire tomber à ce prix le plus beau
shall dans les mains de la plus belle. Longtemps avant cette époque, j'avais vu madame de With à Paris, elle était alors extrêmement jeune et aussi jolie qu'on
puisse l'être, mais passablement vaine de sa charmante figure. J'ai entendu conter que, comme on lui parlait sans cesse de ses beaux yeux, quelqu'un s'informant
de sa santé, un jour qu'ils étaient un peu enflammés, elle répondit naïvement : «J'ai mal à mes beaux yeux.» Il est possible, à la vérité, qu'elle ne sut pas
très bien notre langue, quoique en général toutes les Polonaises parlent le français à merveille, et même sans aucun accent.
Sous le rapport de la fortune, les premiers temps de mon séjour en Russie ne furent point heureux pour moi. On peut en prendre une idée par la copie d'une lettre
que j'écrivais à madame Vigée, ma belle-soeur, moins de deux mois après mon arrivée.
Pétersbourg, ce 10 septembre.
Il faut bien, ma chère Suzette, que je te mette au courant de tous mes soucis et tribulations. Je suis installée dans un appartement qui me convient assez,
attendu que j'y ai un fort bel atelier ; mais il est très humide, la maison n'étant bâtie que depuis trois ans, et n'ayant pas encore été habitée, ce qui me fait
prévoir un déménagement pour la fin de la belle saison. Cette contrariété, à laquelle je devrais être habituée, n'est malheureusement pas la seule. Entre autres
qui l'accompagnent, il vient de m'arriver un événement qui m'a donné beaucoup de tracas. Peu de temps après mon arrivée, je fus invitée à passer la soirée chez
la princesse Menzicoff, où l'on donnait un très joli spectacle. En revenant chez moi vers une heure du matin, je trouve sur mon escalier la gouvernante de ma
fille, toute effarée et toute pâle : «Ah ! madame, s'écria-t-elle, vous venez d'être volée de tout votre argent !» Tu sens bien que je fus fort saisie. Puis,
elle me conte que mon petit domestique allemand avait fait ce mauvais coup ; qu'on avait trouvé sous son lit et sur lui des paquets de mon or ; qu'il en avait
même jeté un peu sur l'escalier, afin de faire croire que le petit Russe était le voleur ; enfin, qu'il venait d'être emmené par les gens de la police, qui,
après avoir compté les pièces, les avaient emportées comme preuve du délit. Je commençai par dire à madame Charrot qu'elle avait eu grand tort de laisser
emporter mes pièces d'or, et j'avais bien raison ; car maintenant que l'affaire est finie, on m'a bien rendu le nombre de ces pièces, mais non leur valeur :
j'avais des Doppio, des quadruples de Vienne, pour lesquels on ne m'a donné que de mauvais ducats, en sorte que j'ai perdu tout juste la moitié de trente mille
cinq cents livres. Cependant, ce n'était pas cela qui m'inquiétait le plus alors, c'était ce malheureux enfant, qui, selon la loi du pays, allait être pendu. Il
est fils des concierges de ce couvent de Caltemberg, que le prince de Ligne m'a prêté à Vienne. L'homme et la femme sont les plus honnêtes gens du monde, ils ont
eu mille soins de moi, en sorte que je ne pouvais supporter l'idée de voir pendre leur fils. Je courus chez le gouverneur, et je le suppliai de sauver ce
misérable jeune homme en le faisant partir sans bruit. Mais le comte Samoeloff ne voulut pas céder à mes instances, disant que l'impératrice était instruite du
vol, et qu'elle en était outrée. Je ne puis te dire ce qu'il m'en a coûté de prières, de démarches, pour obtenir enfin la certitude qu'on le ferait partir par
mer, ce qui fut exécuté.
Pour en revenir à mes quinze mille francs, je les regrette d'autant plus que je viens d'en perdre quarante-cinq mille d'un autre côté ; Voici comment : pendant
le premier mois de mon séjour ici, j'avais gagné quinze mille roubles.
(nb) Le rouble valait trois francs.
On m'a conseillé de les placer aussitôt chez un banquier qui me paraissait un fort honnête homme. Cet honnête homme vient de faire banqueroute, et je n'aurai
rien de mes quinze mille roubles. Tu dois reconnaître là cette destinée que tu sais ? Il m'a été impossible jusqu'ici de conserver la moindre chose de ce que je
gagne ; j'attends avec résignation un temps plus heureux.
Pour changer de discours, je te dirai que je viens de voir mon plus ancien ami, Doyen le peintre, si bon, si spirituel ! l'impératrice l'aime beaucoup. Elle est
venue à son secours ; car il a émigré sans aucune fortune, n'ayant laissé en France qu'une maison de campagne qu'on lui a prise. Il a sa place au spectacle tout
près de la loge de l'impératrice, qui, m'a-t-on dit, cause souvent avec lui.
J'ai retrouvé aussi avec plaisir la baronne de Strogonoff, que je voyais beaucoup à Vienne, où j'ai fait son portrait et celui de son mari. Il vient de m'arriver
chez elle une petite aventure que je veux te conter parce qu'elle te fera rire. Il faut te dire qu'un jour à Vienne, pendant qu'elle me donnait séance, elle me
parla de ce souper grec, dont tu peux te souvenir, en ajoutant le plus simplement du monde qu'elle savait que ce souper m'avait coûté soixante mille francs. Je
fis un grand saut sur ma chaise en entendant cela, puis je me pressai de lui conter tous les détails de la chose, et de lui prouver que j'avais dépensé quinze
francs. - Vous m'étonnez bien, me dit-elle quand elle fut persuadée que je disais vrai ; car à Pétersbourg, nous tenions le fait d'un de vos compatriotes,
monsieur de L***, qui se dit fort lié avec vous, et qui prétend avoir été un des convives. Je répondis, ce qui était exact, que je ne connaissais M. de L*** que
de nom, et nous n'en parlâmes plus alors.
Peu de jours après mon arrivée à Pétersbourg, où certainement M. de L*** n'avait pas cru que je viendrais jamais, la baronne de Strogonoff fut indisposée ;
j'allai la voir, et comme j'étais assise auprès de son lit, on annonça M. de L*** ; vite, je me cache derrière les rideaux, on fait entrer le personnage, et la
baronne lui dit : - Eh bien ! vous devez être bien content ; car madame Lebrun vient d'arriver ? Puis avec malice elle veut le ramener sur ses liaisons avec moi,
et sur le souper grec. Mon homme alors commence à balbutier, la baronne le poussant toujours de questions, lorsque enfin je me montre ; je vais à lui :
«Monsieur, lui dis-je, vous connaissez donc beaucoup madame Lebrun ? Il est forcé de répondre que oui. - Voilà qui est bien étrange, repris-je, car c'est moi,
Monsieur, qui suis madame Lebrun, celle que vous avez calomniée, et je vous rencontre aujourd'hui pour la première fois de ma vie.» À ces mots il fut saisi au
point que ses jambes tremblaient sous lui. Il prit son chapeau, sortit, et depuis on ne l'a point revu ; car il a été consigné à la porte des meilleures
maisons.
Une chose, triste c'est de remarquer, ainsi que j'ai pu le faire trop souvent, que dans un pays étranger, des Français seuls sont capables de chercher à nuire à
leurs compatriotes, même en employant la calomnie. Partout, au contraire, on voit les Anglais, les Allemands, les Italiens, se soutenir et s'appuyer entre eux
mutuellement.
Adieu, ma bonne Suzette, je t'embrasse et je t'aime de tout mon coeur. J'embrasse aussi mon frère, et ta chère petite, qui est si jolie et si intéressante.
CHAPITRE XVII.
Je peins les deux jeunes grandes-duchesses, filles de Paul. Platon Zouboff. La grande duchesse Elisabeth. La grande duchesse Anne, femme de Constantin. Madame Narischkin. Un bal à la cour. Un gala. Les dîners à Pétersbourg.
Ainsi que je l'avais prévu, je ne tardai pas à déménager, et j'allai loger sur la grande place du palais impérial. Quand l'impératrice fut rentrée en ville, je
la voyais tous les matins ouvrir un vasistas, et jeter de la mie de pain à des centaines de corbeaux qui chaque jour, à l'heure fixe ;
venaient chercher leur pitance. Le soir, vers les dix heures, quand ses salons étaient illuminés, je la voyais encore faire venir ses petits enfants et quelques
personnes de sa cour, pour jouer avec eux à la main-chaude ou à cache-cache.
Dès que Sa Majesté fut de retour de Czarkozelo, le comte de Strogonoff vint me commander, de sa part, les portraits des deux grandes-duchesses Alexandrine et
Hélène. Ces princesses pouvaient avoir treize ou quatorze ans, et leurs visages étaient célestes, bien qu'avec des expressions toutes différentes. Leur teint
surtout était si fin et si délicat qu'on aurait pu croire qu'elles vivaient d'ambroisie. L'aînée, Alexandrine, avait la beauté grecque, elle ressemblait beaucoup
à Alexandre ; mais la figure de la cadette, Hélène, avait infiniment plus de finesse. Je les avais groupées ensemble, tenant et regardant le portrait de
l'impératrice ; le costume était un peu grec, mais très modeste. Je fus donc assez surprise quand Zouboff, le favori, me fit dire que Sa Majesté était
scandalisée de la manière dont j'avais costumé les deux grandes-duchesses dans mon tableau. Je crus tellement à ce mauvais propos, que je me hâtai de remplacer
mes tuniques par les robes que portaient les princesses, et de couvrir les bras de tristes amadis.
(nb) On appelait ainsi alors les manches longues.
La vérité est que l'impératrice n'avait rien dit ; car elle eut la bonté de m'en assurer la première fois que je la revis. Je n'en avais pas moins gâté
l'ensemble de mon tableau, sans compter que les jolis bras que j'avais faits de mon mieux, ne s'y voyaient plus. Je me souviens que Paul, devenu empereur, me fit
un jour des reproches d'avoir changé le costume que j'avais d'abord donné à ses deux filles. Je lui racontai alors comment la chose s'était passée, sur quoi, il
leva les épaules en disant : «C'est un tour que l'on vous a joué.» Au reste, ce ne fut point le seul, car Zouboff ne m'aimait pas. Sa malveillance pour moi me
fut encore prouvée dans une autre occasion. Voici comment. On venait en foule chez moi voir les portraits des grandes-duchesses et mes autres ouvrages. Comme je
ne voulais point perdre toutes mes matinées, j'avais fixé le dimanche matin pour ouvrir mon atelier, ainsi que je l'ai toujours fait dans les divers pays que
j'ai habités. J'ai déjà dit que j'étais logée en face du palais, en sorte que les voitures de toutes les personnes qui venaient de faire leur cour à
l'impératrice tournaient pour venir aussitôt s'arrêter à ma porte. Zouboff, qui ne pouvait concevoir, apparemment, que la foule se portât chez un peintre pour y
voir des tableaux, dit un jour à Sa Majesté : «Voyez, madame, on va aussi faire sa cour à madame Lebrun ; ce sont sûrement des rendez-vous que l'on se donne chez
elle.» Heureusement pour moi, la petitesse glissa sur l'esprit élevé auquel elle s'adressait, et l'impératrice ne fit pas plus d'attention à ce qu'il y avait
d'inconvenant ou de perfide dans ces paroles de son favori ; mais le prince de Nassau, qui les entendit, vint me les rapporter tout de suite, et il en était
indigné.
Pourquoi Zouboff ne m'aimait pas, c'est ce que je n'ai jamais pu savoir au juste. À la vérité, il s'était fait le protecteur de Lampi, peintre habile pour les
portraits, que j'avais trouvé établi à Pétersbourg ; mais Lampi lui-même a toujours été fort bien pour moi. Le lendemain de mon arrivée, il vint me faire une
visite et m'engager à dîner chez lui. Je me souviens même que ce dîner fut très recherché, et que pendant tout le repas, nous fûmes réjouis par une excellente
musique d'harmonie. Quoiqu'on m'eût assuré d'abord que j'exciterais la jalousie de Lampi, j'ai su depuis au contraire, d'une manière certaine, qu'il louait mes
ouvrages, au point de dire, en voyant les mains d'un portrait que j'avais fait du baron de Strogonoff, qu'il ne pourrait pas faire aussi bien.
Il se peut aussi que le favori fût mal disposé pour moi, parce que je ne parus jamais rechercher sa faveur. J'avais même négligé pendant six de mois de porter
une lettre de recommandation que j'avais pour sa soeur. Zouboff aimait que l'on recherchât son appui ; mais un orgueil que je ne crois pas blâmable m'a toujours
fait craindre que l'on pût attribuer à la protection les succès que je désirais obtenir ; soit à tort, soit à raison, je n'ai jamais voulu devoir qu'à ma palette
ma réputation et ma fortune. Zouboff devait avoir peine à comprendre une pareille façon d'agir, lui qui voyait toute une cour à ses pieds. Enivré de sa faveur
qui de plus en plus devenait éclatante, on m'a dit qu'il traitait souvent avec une extrême insolence les ministres et les seigneurs. Dès le matin, les plus
grands personnages de la cour attendaient dans ses antichambres l'instant où sa porte s'ouvrait ; car il avait un lever, comme Louis XIV, après lequel on se
retirait, heureux d'avoir assisté à la toilette de Platon Zouboff, surtout s'il vous avait honoré d'un sourire.
Dès que j'eus fini les portraits des jeunes grandes-duchesses, l'impératrice me commanda celui de la grande-duchesse Élizabeth, mariée depuis peu à Alexandre.
J'ai déjà dit quelle ravissante personne était cette princesse ; j'aurais bien voulu ne point représenter sous un costume vulgaire une aussi céleste figure, j'ai
même toujours désiré faire un tableau historique d'elle et d'Alexandre, tant les traits de tous deux étaient nobles et réguliers. Toutefois, ce qui venait de
m'arriver pour les portraits des grandes-duchesses ne me permettant pas de me livrer à mon inspiration, je la peignis en pied, dans le grand costume de cour,
arrangeant des fleurs près d'une corbeille qui en était remplie. Je me rendis chez elle pour les séances, et l'on me fit entrer dans son divan,/p>
(nb) On appelle ainsi d'immenses salons dont un large divan fait le tour.
drapé en velours bleu clair, garni de grandes crépines d'argent. Le fond de cette salle était tout en glaces d'une prodigieuse dimension, en face desquelles
se trouvaient les fenêtres, en glaces aussi, en sorte qu'elles répétaient d'une manière vraiment magique la vue de la Néva couverte de vaisseaux. La
grande-duchesse ne tarda pas à paraître, vêtue d'une tunique blanche, ainsi que je l'avais déjà vue une première fois ; c'était encore Psyché, et son abord si
doux, si gracieux, joint à cette charmante figure, la faisait chérir doublement.
Quand j'eus fini son grand portrait, elle m'en fit faire encore un autre pour sa mère, dans lequel je la peignis avec un schall violet, transparent, appuyée sur
un coussin. Je puis dire que plus la grande-duchesse Élisabeth m'a donné de séances, plus je l'ai trouvée bonne et attachante. Un matin, tandis qu'elle posait,
il me prit un étourdissement, et des scintillations telles que mes yeux ne pouvaient plus rien fixer. Elle s'en alarma, et courut vite elle-même chercher de
l'eau, me frotta les yeux, me soigna avec une bonté inimaginable, et dès que je fus rentrée chez moi, on vint de sa part savoir de mes nouvelles.
Je fis aussi dans le même temps le portrait de la grande-duchesse Anne, femme du grand-duc Constantin. Celle-ci, née princesse de Cobourg, sans avoir un visage
aussi céleste que celui de sa belle-soeur, n'en était pas moins jolie à ravir. Elle pouvait avoir seize ans, et la plus vive gaîté régnait sur tous ses traits.
Ce n'était pourtant pas que cette jeune princesse ait jamais connu le bonheur en Russie. Si l'on peut dire qu'Alexandre tenait de sa mère par sa beauté et par
son caractère, on sait qu'il n'en était pas ainsi de Constantin, qui ressemblait beaucoup à son père, sans être pourtant tout-à-fait aussi laid, et qui se
montrait comme lui prodigieusement enclin à la colère. Il est bien vrai que par moments Constantin a témoigné de l'obligeance et de la bonté ; quand il aimait,
par exemple, il aimait bien ; mais à l'exception de quelques personnes qui avaient trouvé le chemin de son coeur, ses emportements, sa violence, le rendaient
redoutable à tous ceux qui l'approchaient. Entre différents traits bizarres que l'on racontait de lui, on disait que le soir de ses noces, au moment de monter
chez sa femme, il entra dans une fureur horrible contre un soldat de garde à la porte, qui n'exécutait pas assez strictement sa consigne. Cette scène se
prolongea d'une manière si étrange que toutes les personnes de sa cour qui l'accompagnaient ne pouvaient concevoir qu'il restât aussi longtemps à maltraiter un
factionnaire, au lieu d'aller rejoindre la jeune et jolie femme qu'il avait épousée le matin. Quelque temps après son mariage, il devint très jaloux de son frère
Alexandre, ce qui amenait de fortes querelles entre lui et la duchesse Anne, indignée de ses soupçons. Les choses allèrent au point qu'il en résulta, comme on
sait, un divorce. La princesse alla rejoindre d'abord sa famille, et lorsque, beaucoup plus tard, je suis allée en Suisse, elle y était établie.
Tout porte à croire que la grande-duchesse Élisabeth, cet ange de beauté, n'a pas été plus heureuse que sa belle-soeur à conserver le coeur d'un époux. L'amour
d'Alexandre pour une charmante Polonaise qu'il a mariée au prince Narischkin est connu de toute l'Europe. J'ai vu madame Narischkin, bien jeune, à la cour de
Pétersbourg. Elle et sa soeur y arrivèrent après la mort de leur père, qui fut tué lors de la dernière guerre de Pologne. L'aînée des deux pouvait avoir seize
ans. Elles étaient ravissantes à voir, elles dansaient avec une grâce parfaite, et bientôt l'une fit la conquête d'Alexandre et l'autre celle de Constantin.
Madame Narischkin était la plus régulièrement belle ; sa taille fine et souple, son visage tout-à-fait grec la rendait extrêmement remarquable ; mais elle
n'avait pas, à mes yeux, ce charme céleste de la grande-duchesse Élisabeth.
En général, à cette époque, la cour de Russie était composée d'un si grand nombre de femmes charmantes, qu'un bal chez l'impératrice offrait un coup-d'oeil
ravissant. J'ai assisté au plus magnifique qu'elle ait donné. L'impératrice, très parée, était assise dans le fond de sa salle, entourée des premiers personnages
de la cour. Près d'elle se tenaient la grande-duchesse Marie, femme de Paul, Paul, Alexandre, qui était superbe, et Constantin, tous debout. Une balustrade
ouverte les séparait de la galerie où l'on dansait.
La danse n'était autre chose que des polonaises, où je pris place d'abord avec le jeune prince Bariatinski, afin de faire ainsi le tour du bal, après quoi je
m'assis sur une banquette pour mieux voir toutes les danseuses. Il me serait impossible de dire quelle quantité de jolies femmes je vis alors passer devant moi ;
mais la vérité est qu'au milieu de toutes ces beautés, les princesses de la famille impériale l'emportaient encore. Toutes les quatre étaient habillées à la
grecque, avec des tuniques qu'attachaient sur leurs épaules des agrafes en gros diamants. Je m'étais mêlée de la toilette de la grande-duchesse Élisabeth, en
sorte que son costume était le plus correct ; cependant les deux filles de Paul, Hélène et Alexandrine, avaient sur la tête des voiles de gaze bleu clair, semée
d'argent, qui donnaient à leurs visages je ne sais quoi de céleste.
La magnificence de tout ce qui entourait l'impératrice, la richesse de la salle, le grand nombre de belles personnes, cette profusion de diamants, l'éclat de
mille bougies, faisaient véritablement de ce bal quelque chose de magique.
Peu de jours après, je retournai à la cour pour voir un gala. Lorsque j'arrivai dans la salle,
(nb) Cette salle était garnie de chaque côté par des gradins, sur lesquels, les jours de bal, se plaçaient les habitants de Pétersbourg qui n'étaient pas de la cour.
toutes les dames invitées étaient déjà debout, près de la table, qui venait d'être servie. Peu d'instants après, on ouvrit une grande porte à deux battants, et l'impératrice parut. J'ai dit qu'elle était petite de taille, et pourtant, les jours de représentation, sa tête haute, son regard d'aigle, cette contenance que donne l'habitude de commander, tout en elle enfin avait tant de majesté, qu'elle me paraissait la reine du monde ; elle portait les grands cordons de trois ordres, et son costume était simple et noble ; il consistait en une tunique de mousseline brodée en or, que serrait une ceinture de diamants, et dont les manches, très amples, étaient plissées en travers dans le genre asiatique. Par-dessus cette tunique, était un dolman de velours rouge à manches très courtes. Le bonnet qui encadrait ses cheveux blancs, n'était pas orné de rubans, mais de diamants de la plus grande beauté.
(nb) Ce costume était habituellement celui de Catherine. Seulement elle ne portait de diamants que les jours de bal ou de gala, et changeait l'étoffe du dolman selon la saison.
Dès que Sa Majesté eut pris place, toutes les dames s'assirent à table, et posèrent, comme tout le monde fait, leur serviette sur leurs genoux, tandis que
l'impératrice attacha la sienne avec deux épingles, ainsi qu'on l'attache aux enfants. Elle s'aperçut bientôt que ces dames ne mangeaient point, et leur dit tout
à coup : - Mesdames, vous ne voulez pas suivre mon exemple, aussi faites-vous semblant de manger. Moi, j'ai pris pour toujours le parti d'attacher ma serviette ;
car autrement, je ne puis même manger un oeuf sans en jeter sur ma collerette.
Je la vis en effet dîner de fort bon appétit. Cette belle musique d'harmonie dont j'ai parlé, se fit entendre pendant tout le repas ; les musiciens étant placés
au bout de la salle, dans une large tribune. J'avoue que c'est pour moi une chose charmante, que de la musique quand on est à table. C'est la seule qui m'ait
jamais fait désirer d'être très grande dame ou très riche ; car je préfère la musique à toutes les causeries de gens qui dînent, quoique l'abbé Delille ait dit
souvent, «que les morceaux caquetés se digéraient beaucoup mieux.»
À propos de dîners, je dirai ici que bien certainement le plus triste que j'aie fait à Pétersbourg, eut lieu chez cette soeur de Zouboff, chez laquelle j'avais
négligé de porter ma lettre de recommandation. Six mois de mon séjour en Russie s'étaient passés lorsque je la rencontrai en sortant du spectacle. Elle vint à
moi et me dit d'un air fort aimable, qu'elle attendait toujours une lettre que l'on m'avait remise pour elle. Ne sachant pas trop comment m'excuser, je lui
répondis que j'avais égaré cette lettre ; mais que je la chercherais de nouveau et m'empresserais de la lui porter. Je vais en effet un matin chez la comtesse
D***, qui m'engage à dîner pour le surlendemain. On dînait alors à deux heures et demie dans toutes les maisons de Pétersbourg ; je me rendis donc chez la
comtesse à l'heure fixe, avec ma fille qu'elle avait invitée aussi. On nous introduisit dans un salon fort triste, sans que j'eusse aperçu sur mon passage aucun
apprêt de dîner. Une heure, deux heures se passent ; mais il n'est pas plus question de se mettre à table que si nous venions de prendre le café ; enfin, je vois
entrer deux domestiques qui déploient plusieurs tables de jeu, et quoiqu'il me parût un peu étrange que l'on mangeât dans un salon, je me flatte qu'ils vont
servir ; point du tout, ces gens sortent, et quelques minutes après, une partie des convives se mettent à jouer. Vers six heures, ma pauvre fille et moi, nous
étions tellement affamées, qu'en nous regardant toutes deux dans une glace, nous nous fîmes peur et pitié. Je me sentais tout-à-fait mourante ; ce ne fut qu'à
sept heures et demie qu'enfin l'on vint nous dire que l'on était servi ; mais nos pauvres estomacs avaient trop souffert ; il nous fut impossible de manger.
J'appris alors que la comtesse D*** étant intimement liée avec lord Wilford, ne dînait, pour lui complaire, qu'à l'heure où l'on dîne à Londres. Le fait est que
la comtesse aurait dû m'en avertir ; mais peut-être la soeur du favori s'était-elle persuadé que tout l'univers savait à quelle heure elle se mettait à table.
En général, rien ne me contrariait autant que de dîner en ville ; j'étais cependant parfois obligée de le faire, surtout en Russie, où l'on risque de fâcher
tout-à-fait les maîtres de maison si l'on refuse trop souvent leurs invitations. Les dîners me plaisaient d'autant moins qu'ils étaient habituellement fort
nombreux. Au reste, la plus grande magnificence présidait à ces repas ; la plupart des seigneurs avaient de très bons cuisiniers français, et la chère était
exquise. Un quart d'heure avant de se mettre à table, un domestique apporte sur un plateau des liqueurs de toute espèce avec de petites tartines de pain
beurrées. On ne prend guère de liqueur après le dîner ; mais toujours du vin de Malaga excellent.
Il est d'usage que les grandes dames chez elles passent à table avant les personnes invitées, en sorte que la princesse Dolgorouki et d'autres venaient me
prendre le bras afin de me faire passer en même temps qu'elles ; car il est impossible de pousser plus loin que les dames russes la politesse bienveillante qui
fait le charme de la bonne compagnie. J'irai même jusqu'à dire qu'elles n'ont point cette morgue que l'on peut reprocher à quelques-unes de nos dames françaises.
CHAPITRE XVIII.
Le froid à Pétersbourg. Le peuple russe. La douceur de ses moeurs. Sa probité. Son intelligence. Les femmes de marchands russes. Le comte Golovin. La débâcle de la Néva. Les salons de Pétersbourg. Le théâtre. Madame Hus. Mandini. La comtesse Strogonoff. La princesse Kourakin.
On ne s'apercevrait point à Pétersbourg de la rigueur du climat, si, l'hiver arrivé, on ne sortait pas de chez soi, tant les Russes ont perfectionné les moyens
d'entretenir de la chaleur dans les appartements. À partir de la porte cochère, tout est chauffé par des poêles si excellents, que le feu qu'on entretient dans
les cheminées n'est autre chose que du luxe. Les escaliers, les corridors, sont à la même température que les chambres, dont les portes de communication restent
ouvertes sans aucun inconvénient. Aussi lorsque l'empereur Paul, qui n'était alors que grand-duc, vint en France sous le nom de prince du Nord, il disait aux
Parisiens : «À Pétersbourg nous voyons le froid ; mais ici nous le sentons.» De même quand, après avoir passé sept ans et demi en Russie, je fus de retour à
Paris, où la princesse Dolgorouki se trouvait aussi, je me rappelle qu'un jour étant allée la voir, nous avions un tel froid toutes deux devant sa cheminée que
nous nous disions : «Il faut aller passer l'hiver en Russie pour nous réchauffer.»
On ne sort qu'en prenant de telles précautions, que les étrangers mêmes souffrent à peine de la rigueur du climat. Chacun, dans sa voiture, a de grandes bottes
de velours fourrées, et des manteaux doublés d'épaisses fourrures. À dix-sept degrés on ferme le spectacle, et tout le monde reste chez soi. Je suis la seule
peut-être qui, ne me doutant pas un jour du froid qu'il faisait, imaginai d'aller faire une visite à la comtesse Golovin, le thermomètre étant à dix-huit. Elle
logeait assez loin de chez moi, dans la grande rue qu'on appelle la Perspective, et depuis ma maison jusqu'à la sienne, je ne rencontrai pas une seule voiture,
ce qui m'étonnait beaucoup ; mais j'allais toujours. Le froid était tel, que d'abord je croyais les glaces de ma voiture ouvertes. Lorsque la comtesse me vit
entrer dans son salon, elle s'écria : «Mon Dieu ! comment sortez-vous ce soir ? ne savez-vous donc pas qu'il y a près de vingt degrés ?» À ces mots je pense à
mon pauvre cocher, et sans ôter ma pelisse, je cours regagner ma voiture, et retourne bien vite chez moi. Mais ma tête avait été saisie par le froid, au point
que j'en étais étourdie. On me la frotta avec de l'eau de Cologne pour la réchauffer, autrement je serais devenue folle.
Une chose tout-à-fait surprenante, c'est le peu d'impression que semble faire une aussi rigoureuse température sur les gens du peuple. Bien loin que leur santé en souffre, on a remarqué que c'est en Russie qu'il existe le plus de centenaires. À Pétersbourg comme à Moscou, les grands seigneurs et toutes les notabilités de l'empire vont à six et à huit chevaux ; leurs postillons sont de petits garçons de huit à dix ans, qui mènent avec une adresse et une dextérité surprenantes. On en met deux pour conduire huit chevaux, et c'est une chose curieuse de voir ces petits bons-hommes, vêtus assez légèrement, et quelquefois même leur chemise toute ouverte sur leur poitrine, rester gaiement exposés à un froid qui bien certainement ferait périr en peu d'heures un grenadier prussien ou français. Moi, qui me contentais de deux chevaux à ma voiture, je m'étonnais de même de la douceur et de la résignation des cochers ; jamais ils ne se plaignent. Par les temps les plus rigoureux, lorsqu'ils attendent leurs maîtres, soit au spectacle, soit au bal, ils restent tous là sans bouger, on les voit seulement battre du pied sur leurs sièges pour se réchauffer un peu, tandis que les petits postillons vont s'étendre sur le bas des escaliers
(nb) À la vérité on a soin de donner aux cochers des habits et des gants fourrés, et quand le froid dépasse les degrés ordinaires, si quelque seigneur veut recevoir ou donner un bal, il leur fait distribuer du bois pour qu'ils établissent des feux de bivouac dans les cours et dans la rue.
Le peuple russe est laid en général, mais il a une tenue à la fois simple et fière, et ce sont les meilleures gens du monde. On ne rencontre jamais un homme
ivre, quoique leur boisson habituelle soit de l'eau-de-vie de grain. La plupart se nourrissent de pommes de terre, et force ail mêlé d'huile, qu'ils mangent avec
leur pain, en sorte qu'ils infectent, bien qu'ils aient l'usage de se baigner tous les samedis. Cette pauvre nourriture ne les empêche pas de chanter à tue-tête
en travaillant ou en menant leurs barques, et ce peuple m'a bien souvent rappelé ce qu'au commencement de la révolution disait un soir chez moi le marquis de
Chastellux : «Si on leur ôte leur bandeau, ils seront bien plus malheureux !»
Les Russes sont adroits et intelligents, car ils apprennent tous les métiers avec une facilité prodigieuse ; plusieurs même obtiennent du succès dans les arts.
Je vis un jour chez le comte de Strogonoff, son architecte qui avait été son esclave. Ce jeune homme montrait tant de talent, que le comte le présenta à
l'empereur Paul, qui le nomma un de ses architectes, et lui commanda de bâtir une salle de spectacle sur des plans qu'il avait faits. Je n'ai point vu cette
salle finie, mais on m'a dit qu'elle était fort belle. En fait d'esclaves devenus artistes, je n'avais pas été aussi heureuse que le comte. Comme je me trouvais
sans domestique, lorsque celui que j'avais amené de Vienne m'eut volé, le comte de Strogonoff me donna un de ses esclaves, qu'il me dit savoir arranger la
palette et nettoyer les brosses de sa belle-fille, quand elle s'amusait à peindre. Ce jeune homme que j'employais en effet à cet usage, au bout de quinze jours
qu'il me servait, se persuada qu'il était peintre aussi, et ne me donna point de repos que je n'eusse obtenu sa liberté du comte, afin qu'il pût aller travailler
avec les élèves de l'Académie. Il m'écrivit sur ce sujet plusieurs lettres qui sont vraiment curieuses de style et de pensées. Le comte, en cédant à ma prière,
me dit : «Soyez sûre qu'avant peu il voudra me revenir.» Je donne vingt roubles à ce jeune homme, le comte lui en donne au moins autant, en sorte qu'il court
aussitôt acheter l'uniforme des élèves en peinture, avec lequel il vient me remercier d'un air triomphant. Mais, deux mois après environ, il revint m'apporter un
grand tableau de famille si mauvais, que je ne pouvais le regarder, et qu'on lui avait payé si peu, que le pauvre jeune homme, les frais soldés, y perdait huit
roubles de son argent. Ainsi que le comte l'avait prévu, un pareil désappointement le fit renoncer à sa triste liberté.
Les domestiques sont remarquables par leur intelligence. J'en avais un qui ne savait pas un mot de français, et moi, je ne savais pas un mot de russe ; mais nous
nous entendions parfaitement sans le secours de la parole. En levant le bras, je lui demandais mon chevalet, ma boîte à couleurs, enfin je lui figurais les
différents objets dont j'avais besoin. Il comprenait tout et me servait à merveille. Une autre qualité bien précieuse que je trouvais en lui, c'était une
fidélité à toute épreuve : on m'envoyait très souvent des billets de banque en paiement de mes tableaux, et lorsque j'étais occupée à peindre, je les posais près
de moi sur une table ; en quittant mon travail, j'oubliais constamment d'emporter ces billets, qui restaient là souvent trois ou quatre jours sans que jamais il
en ait soustrait un seul. Il était en outre d'une sobriété rare, je ne l'ai pas vu ivre une fois. Ce bon serviteur se nommait Pierre ; il pleura lorsque je
quittai Pétersbourg, et moi je l'ai toujours vivement regretté.
Le peuple russe en général a de la probité et sa nature est douce. À Pétersbourg, à Moscou, non-seulement on n'entend jamais parler d'un grand crime, mais on
n'entend parler d'aucun vol. Cette conduite honnête et paisible surprend dans des hommes encore à peu près barbares, et beaucoup de personnes l'attribueront à
l'esclavage ; mais moi, je pense qu'elle tient à ce que les Russes sont extrêmement dévots. Peu de temps après mon arrivée à Pétersbourg, j'allai voir à la
campagne la belle-fille de mon ancien ami le comte de Strogonoff. Sa maison à Kaminostroff était située à droite du grand chemin qui bordait la Néva. Je
descendis de voiture, j'ouvris une petite barrière en treillage qui donnait entrée dans le jardin que je traversai, et j'arrivai dans un salon au
rez-de-chaussée, dont je trouvai la porte toute grande ouverte. Il était donc très facile d'entrer chez la comtesse de Strogonoff ; aussi, quand je l'eus trouvée
dans un petit boudoir et qu'elle me montra ses appartements, je fus très surprise de voir tous ses diamants près d'une fenêtre qui donnait sur le jardin, et par
conséquent à peu près sur le grand chemin.tCela me parut d'autant plus imprudent, que les dames russes ont l'usage d'étaler leurs diamants et leurs bijoux dans
de grandes montres couvertes d'un verre, telles qu'on en voit chez les bijoutiers. - Madame, lui dis-je, ne craignez-vous pas d'être volée ? - Jamais,
répondit-elle, voilà la meilleure des polices. Et elle me montra placées au-dessus de l'écrin, plusieurs images de la Vierge et de saint Nicolas, patron du pays,
devant lesquelles brûlait une lampe. Il est de fait que, durant les sept années et plus que j'ai passées en Russie, j'ai toujours reconnu qu'en toute occasion
l'image de la Vierge, ou d'un saint, et la présence d'un enfant, ont toujours quelque chose de sacré pour un Russe.
Les gens du peuple, lorsqu'ils vous adressent la parole, ne vous nomment pas autrement (selon votre âge) que mère, père, frère ou
soeur, sans que cet usage excepte l'empereur, l'impératrice et toute la famille impériale.
On ne voit pas à Pétersbourg de filles publiques se promener dans la ville ; elles habitent un quartier qui leur est assigné, et sont de si mauvais genre que les
gens comme il faut ne vont jamais chez elles. Je n'ai pas entendu dire non plus, qu'il y eût des filles entretenues comme à Paris, si ce n'étaient quelques
actrices.
Dans la classe supérieure à celle du peuple, il existe un grand nombre de personnes aisées et même riches. Les femmes de marchands, par exemple, dépensent
beaucoup pour leur toilette, sans que cela paraisse apporter aucune gêne dans le ménage. Elles sont surtout coiffées avec une magnificence fort élégante. Sur
leurs bonnets dont les papillons sont le plus souvent ornés de perles fines, elles portent une large draperie qui de leur tête retombe sur leurs épaules et sur
leur dos, jusqu'en bas des reins. Cette espèce de voile produit sur le visage un demi jour, dont il faut avouer qu'elles ont besoin, attendu que toutes, je ne
sais pourquoi, mettent du blanc, du rouge, et peignent leurs sourcils en noir, de la manière la plus ridicule.
Plusieurs fermiers sont aussi fort riches. Je me souviens qu'arrivant un jour pour dîner chez le comte Golovin, je trouvai dans le salon un grand et gros homme
qui avait tout-à-fait l'air d'un paysan renforcé. Quand on eut annoncé le dîner, je vis cet homme se mettre à table avec nous, ce qui me parut extraordinaire, et
je demandai à la comtesse qui il était : «C'est, me dit-elle, le fermier de mon mari, qui vient lui prêter soixante mille roubles pour que nous puissions
satisfaire à quelques dettes ; l'obligeance de ce bon fermier vaut bien le dîner que nous lui donnons.» Rien n'était plus naturel en effet ; ce qui pouvait me le
paraître un peu moins, c'est que le comte Golovin, avec une fortune aussi considérable que la sienne, pût avoir besoin de l'argent de son fermier ; mais je n'en
étais plus à apprendre avec quelle facilité les seigneurs russes dépensent leur revenu ; il faut dire, à la vérité, qu'ils sont infiniment plus magnifiques que
les Français. Il résulte toutefois de ce luxe extraordinaire, auquel le nôtre ne peut être comparé, que, pour être payé quand ils vous doivent, il faut aller
chez eux vers le 1er janvier, ou vers le 1er juillet, époques où ils touchent le revenu de leurs terres ; autrement, on court risque de les trouver sans argent.
Tant que je suis restée dans l'ignorance de cet usage, j'ai souvent attendu le paiement des portraits que j'avais faits. Au reste, le comte Golovin dont je
parle, était le meilleur homme du monde ; mais il n'avait aucun ordre. Par exemple, il acceptait tous les placements qu'on lui offrait ; car pour son malheur, on
avait beaucoup de confiance en lui. Il tenait compte exactement de l'intérêt à dix pour cent, (taux ordinaire à Pétersbourg), puis au lieu de faire valoir ces
fonds de manière ou d'autre, il les gardait dans une cassette, pour s'en servir s'il s'en présentait l'occasion ; en sorte qu'on m'a dit qu'à sa mort, lorsque
l'on ouvrit cette cassette, on y trouva de quoi payer la plus grande partie de ce qu'il devait.
La comtesse Golovin était une femme charmante, pleine d'esprit et de talents, ce qui suffisait souvent pour nous tenir compagnie ; car elle recevait peu de
monde. Elle dessinait très bien, et composait des romances charmantes, qu'elle chantait en s'accompagnant du piano. De plus, elle était à l'affût de toutes les
nouvelles littéraires de l'Europe, qui, je crois, étaient connues chez elle aussitôt qu'à Paris. Elle avait pour amie intime la comtesse Tolstoi qui était belle
et bonne, mais beaucoup moins animée que la comtesse Golovin ; et peut-être ce contraste dans leur caractère avait-il formé et cimenté leur liaison.
Lorsque le mois de mai arrive à Pétersbourg, il ne s'agit encore ni de fleurs printanières dont l'air soit embaumé, ni de ce chant du rossignol tant chanté par
les poètes. La terre est couverte de neige à moitié fondue ; la Doga apporte dans la Néva des glaçons aussi gros que d'énormes rochers amoncelés les uns sur les
autres, et ces glaçons ramènent le froid qui s'était adouci après la débâcle de la Néva. On peut appeler cette débâcle une belle horreur, le bruit en est
épouvantable ; car près de la bourse, la Néva a plus de trois fois la largeur de la Seine au pont Royal;
(nb) Il a toujours été impossible d'établir un pont d'une rive à l'autre ; aucun ne résisterait aux glaçons de la Doga. La communication entre les deux bords n'existe que par un pont de bateaux qu'on retire au moment de la débâcle. J'ai vu pourtant au palais des beaux-arts le modèle d'un pont d'une seule arche qu'un esclave russe à fait d'instinct, n'ayant reçu nulle éducation. Ce modèle est admirable. Il faut que de fortes raisons empêchent de l'exécuter.
que l'on imagine donc l'effet que produit cette mer de glace, se fendant de toutes parts. En dépit des factionnaires que l'on place alors tout le long des
quais pour empêcher le peuple de sauter de glaçon en glaçon, des téméraires s'aventurent sur la glace devenue mouvante pour gagner l'autre bord. Avant
d'entreprendre ce dangereux trajet, ils font le signe de la croix, et s'élancent bien persuadés que, s'ils périssent, c'est qu'ils y sont prédestinés. Au moment
de la débâcle, le premier qui traverse la Néva en bateau, présente une coupe en argent, remplie d'eau de la Néva, à l'empereur, qui la lui rend remplie d'or.
On ne décalfeutre pas encore les fenêtres à cette époque, et la Russie n'a point de printemps ; mais aussi la végétation se presse pour regagner le temps perdu.
On peut dire à la lettre que les feuilles poussent à vue d'oeil. J'allai un jour, à la fin du mois de mai, me promener avec ma fille au jardin d'été, et voulant
nous assurer si tout ce qu'on nous avait dit sur la rapidité de la végétation était vrai, nous remarquâmes des feuilles d'arbustes qui n'étaient encore qu'en
bourgeons. Nous fîmes un tour d'allée, puis étant revenues aussitôt à la place que nous venions de quitter, nous trouvâmes les bourgeons ouverts, et les feuilles
entièrement étendues.
Les Russes tirent parti, même de la rigueur de leur climat pour se divertir. Par le plus grand froid, il se fait des parties de traîneaux, soit de jour, soit de
nuit aux flambeaux. Puis, dans plusieurs quartiers, on établit des montagnes de neige sur lesquelles on va glisser avec une rapidité prodigieuse, sans aucun
danger ; car des hommes, habitués à ce métier, vous lancent du haut de la montagne, et d'autres vous reçoivent en bas.
Une des belles cérémonies qu'on puisse voir est celle de la bénédiction de la Néva. Elle a lieu tous les ans, et c'est l'archimandrite qui donne la bénédiction
en présence de l'empereur, de la famille impériale et de tous les grands dignitaires. Comme à cette époque la glace de la Néva a pour le moins trois pieds
d'épaisseur, on y pratique un grand trou dans lequel, après la cérémonie, chacun vient puiser de l'eau bénite. Assez souvent on voit des femmes y plonger de
petits enfants ; parfois il arrive à ces malheureuses mères de laisser échapper la pauvre victime du préjugé ; mais alors, au lieu de pleurer la perte de son
enfant, la mère se félicite du bonheur de l'ange qui s'en va prier pour elle. L'empereur est obligé de boire le premier verre d'eau, que l'archimandrite lui
présente.
J'ai déjà dit qu'il faut aller dans la rue pour s'apercevoir qu'il fait froid à Pétersbourg. Les Russes ne se contentent pas de donner à leurs appartements la
température du printemps, plusieurs salons sont entourés de grands paravents vitrés, derrière lesquels sont placés des caisses et des pots remplis des plus
belles fleurs que donne chez nous le mois de mai.
L'hiver, les appartements sont éclairés avec le plus grand luxe. On les parfume avec du vinaigre chaud dans lequel on jette des branches de menthe, ce qui donne
une odeur très agréable et très saine. Toutes les pièces sont garnies de longs et larges divans, sur lesquels les femmes et les hommes s'établissent ; j'avais si
bien pris l'habitude de ces sièges que je ne pouvais plus m'asseoir sur un fauteuil.
Les dames russes saluent en s'inclinant, ce qui me paraissait plus noble et plus gracieux que nos révérences. Elles ne sonnaient point leurs domestiques, mais
les appelaient en frappant dans leurs mains, comme on dit que font les sultanes dans le sérail. Toutes avaient à la porte de leur salon un homme en grande
livrée, qui restait toujours là, pour ouvrir aux visites ; car je crois avoir remarqué qu'à cette époque l'usage n'était pas de les annoncer. Mais ce qui m'a
paru plus étrange, c'est de voir quelques-unes de ces dames faire coucher une femme esclave sous leur lit.
Tous les soirs j'allais dans le monde. Non-seulement les bals, les concerts, les spectacles, étaient fréquents, mais je me plaisais dans ces réunions
journalières, où je retrouvais toute l'urbanité, toute la grâce d'un cercle français ; car, pour me servir de l'expression de la princesse Dolgorouki, il semble
que le bon goût a sauté à pieds joints de Paris à Pétersbourg. Les maisons ouvertes ne manquaient pas, et dans toutes on était reçu de la manière la plus aimable.
On se réunissait vers les huit heures, et l'on soupait à dix. Dans l'intervalle, on prenait du thé comme partout ailleurs ; mais le thé en Russie est si
excellent que moi, qu'il incommode et qui ne puis en prendre, j'étais embaumée par son parfum. Je buvais au lieu de thé de l'hydromel. Cette boisson, qui est
charmante, se fait avec de bon miel et des petits fruits qui viennent dans les bois de la Russie ; on la laisse pendant un certain temps à la cave avant de la
mettre en bouteille ; je la trouve bien préférable au cidre, à la bière, et même à la limonade.
Deux maisons extrêmement recherchées étaient celles de la princesse Michel Galitzin
(nb) La princesse Galitzin a fait plusieurs séjours à Paris, où elle a marié une de ses filles à un Français, M. le comte de Caumont.
et de la princesse Dolgorouki ; il existait même entre ces deux dames, relativement à leurs soirées, une sorte de rivalité. La première, moins belle que la
princesse Dolgorouki, était plus jolie. Elle avait infiniment d'esprit, mais fantasque à l'excès. Elle vous boudait tout à coup sans aucun motif, puis l'instant
d'après vous disait les choses les plus aimables et les plus flatteuses. Le comte de Choiseul-Gouffier en était amoureux fou au point que les caprices, l'humeur
bizarre qu'il lui fallait supporter, ne faisaient qu'augmenter son amour. Il était curieux de le voir saluer la princesse jusqu'à terre lorsqu'elle arrivait
après lui dans un salon ; mais tel était autrefois le respect que l'on marquait à la femme que l'on ne voulait pas afficher, et cela, quel que fût l'amour qu'on
avait pour elle. De nos jours, il est vrai, on n'affiche pas davantage, mais c'est par indifférence.
Les soupers de la princesse Dolgorouki étaient charmants ; elle y réunissait le corps diplomatique, les étrangers les plus marquants, et chacun s'empressait de
s'y rendre, tant la maîtresse de maison était aimable. Aussi n'avais-je pas tardé à répondre aux avances qu'elle avait bien voulu me faire, et je la voyais très
souvent. Elle me donnait toujours au spectacle une place dans sa loge, qui était fort près du théâtre, en sorte que je pouvais apprécier parfaitement dans la
tragédie le jeu si noble de madame Hus, dont le son de voix était enchanteur, et dans la comédie le jeu si fin de mademoiselle Suzette, qui jouait les rôles de
soubrettes. Les acteurs et les actrices de Pétersbourg étaient tous Français, et sans égaler les grands comédiens que Paris possédait alors, ils avaient pour la
plupart beaucoup de talent, et jouaient avec un ensemble parfait. Nous ne tardâmes pas d'ailleurs à voir arriver un homme qui, quoique jeune, avait déjà fait les
délices de l'Italie et de la France. C'était Mandini, que l'on peut dire avoir réuni pour le théâtre tous les avantages imaginables. Il était beau ; il était
grand acteur, et il chantait admirablement.
(nb) Il arrivait de Paris où plusieurs personnes peuvent encore se souvenir de l'avoir entendu.
Comme il ne pouvait point jouer les opéras français, on monta l'été chez la princesse Dolgorouki plusieurs opéras italiens, qui furent représentés sur le
petit théâtre d'Alexandrowski. On donnait naturellement à Mandini les premiers rôles, dans lesquels il était si ravissant, qu'il fallait que les dames et les
seigneurs qui le secondaient, eussent fait l'entier sacrifice de leur amour-propre.
Aucune femme, je crois, n'avait plus de dignité dans sa personne et dans ses manières que la princesse Dolgorouki ; comme elle avait vu ma Sibylle, dont elle
était enthousiasmée, elle désira que je fisse son portrait dans ce genre, et j'eus le plaisir de la satisfaire entièrement. Le portrait fini, elle m'envoya une
fort belle voiture, et mit à mon bras un bracelet, fait d'une tresse de cheveux, sur laquelle des diamants sont arrangés de manière qu'on y lit :
Ornez celle qui orne son siècle. Je fus extrêmement touchée de la grâce et de la délicatesse d'un pareil présent.
Je voyais aussi très fréquemment le comte de Strogonoff, son fils et sa belle-fille. Cette dernière était jeune, jolie et très spirituelle. Son mari, qui avait
vingt-cinq ans au plus, était un homme charmant. Une actrice qui venait de Paris lui tourna la tête. La comtesse s'aperçut de son infidélité, et comme elle
l'aimait beaucoup, elle en souffrit excessivement sans jamais lui en parler. Le jeune comte entretenait avec faste cette actrice, qui s'appelait mademoiselle
Lachassaigne ; il eut d'elle un enfant, et lui fit alors six mille roubles de pension. Lorsque la guerre avec les Français eut lieu, il fut tué ; mais la jeune
comtesse continua la pension de six mille roubles à l'actrice. Ce trait me semble à la fois si noble et si bon qu'il suffit à son éloge.
La bonne, la charmante princesse Kourakin recevait peu ; mais chaque soir elle se réunissait à la société, le plus souvent chez la princesse Dolgorouki, où
c'était un bonheur pour moi de la rencontrer. Il était tout-à-fait impossible de la voir deux fois sans l'aimer. Son esprit, son naturel, sa bonté, je ne sais
quoi de naïf dans son caractère qui me faisait l'appeler l'enfant de sept ans ; tout en elle me charmait, tout lui gagnait les coeurs ; et je ne veux pas que
l'on croie ici que la tendre amitié que j'ai sentie pour elle m'engage à flatter sa mémoire. La princesse Kourakin est venue à Paris où elle est restée
longtemps ; madame de Bawr, M. de Sabran, M. Briffaut l'ont connue, ont été ses amis : ils peuvent dire si mes regrets m'aveuglent, et si la société n'a point
perdu en elle un de ses plus aimables ornements.
CHAPITRE XIX.
Le lac de Pergola. L'île de Krestowski. L'île de Zelaguin. Le général Melissimo. Dîner turc. J'écris à Cléry, valet-de-chambre de Louis XVI. Sa réponse. Je fais le portrait de Marie-Antoinette pour madame la duchesse d'Angoulême. Lettre que m'écrit madame la duchesse d'Angoulême.
Une grande jouissance avait lieu pour moi lorsque, après avoir respiré pendant plusieurs mois un air glacé ou l'air des poêles, je voyais arriver l'été. La promenade alors me semblait une chose délicieuse, et je me pressais de parcourir les beaux environs de Pétersbourg. J'allais très souvent au lac de Pergola,
(nb) Ce lieu appartenait à madame de Schouvaloff, femme de l'auteur de l'Épitre à Ninon. Sa fille a épousé le comte Diedrestein, frère de la belle comtesse Kinski.
seule avec mon bon domestique russe, prendre ce que j'appelais un bain d'air. Je me plaisais à contempler ce beau lac si limpide, qui réfléchissait vivement
les arbres qui l'environnaient. Puis je montais sur les hauteurs dont il est entouré. D'un côté j'avais la mer pour horizon, et je distinguais les voiles des
vaisseaux, éclairées par le soleil. Là régnait un silence qui n'était troublé que par le chant de mille oiseaux, ou souvent par celui d'une petite cloche
lointaine. Cet air pur, ce lieu sauvage et pittoresque, me charmait. Mon bon Pierre, qui faisait réchauffer mon petit dîner, ou qui cueillait des bouquets de
fleurs champêtres pour me les apporter, me faisait penser à Robinson dans son île avec Vendredi.
J'allais souvent aussi me promener de très grand matin avec ma fille à l'île de Krestowski. L'extrémité de cette île parait joindre la mer sur laquelle
naviguaient de grandes barques. L'horizon n'avait point de bornes, et cette vue était calme et belle. Nous y allâmes au soir pour voir danser les paysannes
russes, dont le costume est si pittoresque. Puis un jour du mois de juillet de je ne sais quelle année, pendant laquelle la chaleur fut plus forte qu'en Italie,
je me souviens que la mère
(nb) La princesse Bariatinski. Elle avait été jolie comme un ange, et son esprit fin et naturel la rendait une des plus aimables femmes de Pétersbourg.
de la princesse Dolgorouki, ne pouvant la supporter, s'était établie dans sa cave ; sa dame de compagnie, moins susceptible, restait sur les marches élevés,
et lui faisait la lecture. Mais pour en revenir à l'île de Krestowski, comme nous faisions une promenade en bateau, nous rencontrâmes une multitude d'hommes et
de femmes, se baignant tous pêle-mêle. Nous vîmes même de loin des jeunes gens tout nus à cheval, qui allaient ainsi se baigner avec leurs chevaux. Dans tout
autre pays un grand scandale naîtrait de pareilles choses ; mais il en est autrement là où règne l'innocence de la pensée. Aucune indécence ne se passait,
personne ne songeait à mal ; car le peuple russe a vraiment l'ingénuité de la première nature. Dans les familles, l'hiver, le mari, la femme, les enfants, se
couchent ensemble sur leur poêle ; si le poêle ne suffit pas, ils s'étendent sur des bancs de bois, rangés autour de leur hangard, enveloppés seulement de leur
peau de mouton. Enfin ils ont conservé les moeurs des anciens patriarches.
Une des promenades qui me charmaient le plus, était celle de l'île de Zelaguin, qui, pour avoir été un très beau jardin anglais, n'en était pas moins abandonnée
alors. Toutefois il y restait encore de très beaux arbres, des allées charmantes, un temple, entouré de superbes saules pleureurs et de petites rivières
courantes, quelques masses de fleurs qui réjouissaient les yeux, des ponts dans le genre anglais, et des arbres verts magnifiques. Je ne concevais pas comment on
avait abandonné ce lieu qui pouvait devenir le plus délicieux du monde ; depuis mon retour en France, en effet, j'ai appris qu'Alexandre l'a fait soigner, et
qu'il en a fait un des beaux jardins que l'on puisse voir. Il y avait dans cette île des vues si belles et si pittoresques que j'en ai dessiné une grande
quantité et pour jouir tout à mon aise de cette charmante promenade, je louai presque en face, sur les bords de la Neva, une petite maison de bois.
La situation de cette maisonnette était délicieuse et d'une gaieté ravissante, en ce que la plupart des barques qui allaient et venaient sans cesse sur la
rivière me donnaient un concert perpétuel de musique vocale ou d'instruments à vent. Tout près de moi, le général Melissimo, grand-maître de l'artillerie,
habitait une fort jolie maison, et j'étais charmée de ce voisinage ; car le général était le meilleur et le plus obligeant des hommes. Comme il avait séjourné
longtemps en Turquie, sa maison offrait un modèle, non-seulement du luxe, mais du confortable oriental. Il s'y trouvait une salle de
bain, éclairée par en haut, et dans le milieu de laquelle était une cuve assez grande pour contenir une douzaine de personnes. On descendait dans l'eau par
quelques marches ; le linge qui servait à s'essuyer en sortant du bain, était posé sur la balustrade en or qui entourait la cuve, et ce linge consistait en de
grands morceaux de mousseline de l'Inde brodés en bas de fleurs et d'or, afin que la pesanteur de cette bordure pût fixer la mousseline sur les chairs, ce qui me
parut une recherche pleine de magnificence. Autour de cette salle régnait un large divan, sur lequel on pouvait s'étendre et se reposer après le bain, outre
qu'une des portes ouvrait sur un charmant petit boudoir dont le divan formait un lit de repos. Ce boudoir donnait sur un parterre de fleurs odoriférantes, et
quelques tiges venaient toucher la fenêtre. C'est là que le général nous donna un déjeuner en fruits, en fromage à la crème, et en excellent café moka, qui
régala beaucoup ma fille. Il nous invita une autre fois à un très bon dîner, et le fit servir sous une belle tente turque qu'il avait rapportée de ses voyages.
On avait dressé cette tente sur la pelouse fleurie qui faisait face à la maison. Nous étions une douzaine de personnes, toutes assises sur de magnifiques divans
qui entouraient la table : on nous servit une quantité de fruits parfaits au dessert : enfin ce dîner fut tout-à-fait asiatique, et la manière dont le général
recevait donnait encore du prix à toutes ces choses. J'aurais seulement désiré chez lui qu'on ne tirât point tout près de nous des coups de canon au moment où
nous nous mettions à table, mais on me dit que c'était l'usage chez tous les généraux d'armée.
Je ne louai qu'un été ma petite maison sur la Neva ; l'été suivant, le jeune comte de Strogonoff me prêta une maison charmante à Kaminostroff, où je me plaisais
beaucoup. Tous les matins, j'allais seule me promener dans une forêt voisine, et je passais mes soirées chez la comtesse Golovin, qui était établie tout à côté
de moi. Je trouvais là le jeune prince Bariatinski, la princesse Tarente et plusieurs autres personnes aimables. Nous causions, ou nous faisions des lectures
jusqu'au moment du souper ; enfin mon temps se passait le plus agréablement du monde.
La paix et le bonheur dont je jouissais, ne m'empêchaient pas néanmoins de penser bien souvent à la France et à ses malheurs. J'étais surtout poursuivie par le
souvenir de Louis XVI et de Marie-Antoinette, au point qu'un de mes désirs les plus vifs était de faire un tableau qui les représentât dans un des moments
touchants et solennels qui avaient dû précéder leur mort. J'ai déjà dit que j'avais évité soigneusement la connaissance de ces tristes détails, mais alors il me
fallait bien les connaître, si je voulais intéresser. Je savais que Cléry s'était réfugié à Vienne après la mort de son auguste maître, je lui écrivis, et je
l'instruisis de mon désir, en le priant de m'aider à l'exécuter. Fort peu de temps après, je reçus de lui la lettre suivante, que j'ai toujours gardée, et que je
copie mot pour mot.
Madame,
La connaissance parfaite que vous avez des personnages de l'auguste famille de Louis XVI m'avait fait dire à madame la comtesse de Rombeck que personne autre
que vous ne pourrait rendre les scènes déchirantes qu'a eu à éprouver cette malheureuse famille, dans le cours de sa captivité. Des faits aussi intéressants
doivent passer à la postérité, et le pinceau de madame Lebrun peut seul les y transmettre avec vérité.
Parmi ces scènes de douleur, on pourrait en peindre six :
1° Louis XVI dans sa prison, entouré de sa famille, donnant des leçons de géographie et de lecture à ses enfants ; la reine et madame Élisabeth occupées en ce
moment à coudre et à raccommoder leurs habits ;
2° La séparation du roi et de son fils, le 11 décembre, jour que le roi parut à la convention pour la première fois, et qu'il a été séparé de sa famille jusqu'à
la veille de sa mort.
3° Louis XVI interrogé dans la tour, par quatre membres de la convention, et entouré de son conseil : MM. de Malesherbes, de Sèze et Tronchet ;
4° Le conseil exécutif annonçant au roi son décret de mort, et la lecture de ce décret par Gronvelle ;
5° Les adieux du roi à sa famille la veille de sa mort ;
6° Son départ de la tour pour marcher au lieu du supplice.
Celui de ces faits qui paraît généralement toucher le plus les âmes sensibles, est le moment des adieux. Une gravure a été faite en Angleterre sur ce sujet ;
mais elle est bien loin de la vérité, tant dans la ressemblance des personnages que des localités.
Je vais tâcher, madame, de vous donner les détails que vous désirez pour faire une esquisse de ce tableau. La chambre où s'est passée cette scène peut avoir
quinze pieds carrés ; les murs sont recouverts en papier en forme de pierre de taille, ce qui représente bien l'intérieur d'une prison. À droite, près de la
porte d'entrée, est une grande croisée, et comme les murs de la tour ont neuf pieds d'épaisseur, la croisée se trouve dans un enfoncement d'environ huit pieds de
large ; mais en diminuant vers l'extrémité où l'on aperçoit de très gros barreaux. Dans l'embrasure de cette croisée est un poêle de faïence de deux pieds et
demi de large sur trois pieds et demi de haut ; le tuyau passe sous la croisée, et il est adossé à la partie gauche de l'embrasure et au commencement. De la
croisée au mur de face, il peut y avoir huit pieds ; à ce mur et près du poêle est une lampe-quinquet et qui éclairait toute la salle, la scène s'étant passée de
nuit, c'est-à-dire à dix heures du soir. Le mur de face peut avoir quinze pieds ; une porte à deux venteaux le sépare ; mais elle se trouve plus du côté droit
que du gauche. Cette porte est peinte en gris ; un des venteaux doit être ouvert pour laisser apercevoir une partie de la chambre à coucher. On doit voir la
moitié de la cheminée qui se trouve en face de la porte ; une glace est dessus, une partie d'une tenture de papier jaune, une chaise près de la cheminée, une
table devant ; une écritoire, des plumes, du papier et des livres, sont sur la table. La partie gauche de la salle est une cloison en vitrage ; aux deux
extrémités sont deux portes vitrées ; derrière cette cloison est une petite pièce qui servait de salle à manger. C'est dans cette salle que le roi assis et
entouré de sa famille leur a fait part de ses dernières volontés. C'est en sortant de cette petite salle à manger, le roi s'avançant vers la porte d'entrée,
comme pour reconduire sa famille, que cette scène doit être prise, et ce fut aussi le moment le plus douloureux.
Le roi était debout, tenant par la main droite la reine, qui à peine pouvait se soutenir ; elle était appuyée sur l'épaule droite du roi ; le dauphin, du même
côté, se trouve enlacé dans le bras droit de la reine qui le presse vers elle ; il tient avec ses petites mains celle droite du roi et la gauche de la reine, les
baise et les arrose de ses larmes. Madame Élisabeth est au côté gauche du roi, pressant de ses deux mains le haut du bras du roi, et levant les yeux remplis de
larmes vers le ciel ; Madame Royale est devant elle, tenant la main gauche du roi, en faisant retentir la salle des gémissements les plus douloureux. Le roi
toujours calme, toujours auguste, ne versait aucune larme ; mais il paraissait cruellement affecté de l'état douloureux de sa famille. Il lui dit avec le son de
voix le plus doux, mais plein d'expressions touchantes : Je ne vous dis point adieu, soyez assurée que je vous verrai encore demain matin, à
sept heures ? - Vous nous le promettez, dit la reine, pouvant à peine articuler.-Oui, je vous le promets, répondit le roi ;
adieu.-Dans ce moment les sanglots redoublèrent, Madame Royale tomba presque évanouie aux pieds du roi qu'elle tenait embrassé ; madame
Élisabeth s'occupa vivement de la soutenir. Le roi fit un effort bien pénible sur lui-même, il s'arracha de leurs bras et rentra dans sa chambre. Comme j'étais
près de madame Élisabeth, j'aidai cette princesse à soutenir Madame Royale pendant quelques degrés ; mais on ne me permit pas de suivre plus loin, et je rentrai
près du roi. Pendant cette scène, quatre officiers municipaux, dont deux très mal vêtus et le chapeau sur la tête, se tenaient dans l'embrasure de la croisée, se
chauffant au poêle sans se mouvoir. Ils étaient décorés d'un ruban tricolore avec une cocarde au milieu.
Le roi était vêtu d'un habit brun mélangé, avec un collet de même, une veste blanche de piqué de Marseille, une culotte de casimir gris et des bas de soie gris,
des boucles d'or, mais très simples, à ses souliers, un col de mousseline, les cheveux un peu poudrés, une boucle séparée en deux ou trois, le toupet en vergette
un peu longue, les cheveux de derrière noués en catogan.
La reine, Madame Royale et madame Élisabeth étaient vêtues d'une robe blanche de mousseline, des fichus très simples en linon, des bonnets absolument pareils
faits en forme de baigneuses, garnis d'une petite dentelle, un mouchoir garni aussi de dentelle, noué dessus le bonnet en forme de marmotte.
Le jeune prince avait un habit de casimir d'un gris verdâtre, une culotte ou pantalon pareille, un petit gilet de basin blanc rayé, l'habit décolleté et à
revers, le col de la chemise uni et retombant dessus le collet de l'habit, le jabot de batiste plissé, des souliers noirs noués avec un ruban, les cheveux blonds
sans poudre, tombant négligemment et bouclés sur le front et sur les épaules, relevés en natte derrière, et ceux de devant tombaient naturellement et sans
poudre. Les cheveux de la reine étaient presque tous blancs, ceux de Madame du beau blond clair, et ceux de madame Élisabeth aussi blonds, mais de nuance plus
foncée. Voilà à peu près, madame, les détails que je puis vous donner sur ce sujet ; s'ils ne remplissent point vos désirs, daignez me faire d'autres questions,
et je tâcherai d'y répondre. Il me reste une grâce à vous demander, c'est que tous ces détails restent entre nous. Comme j'ai des notes où tous ces faits sont
écrits, je ne voudrais point qu'ils soient connus avant leur impression
(nb) Tout le monde sait que les mémoires de Cléry ont paru.
J'espère que quelque jour vous reviendrez habiter cette ville ; et si vous désirez faire d'autres tableaux sur ces tristes événements, je suis fort aise de pouvoir vous être agréable en quelque chose. En attendant, je vous prie d'agréer, madame, les respectueux hommages
De votre très humble et très obéissant serviteur,
CLÉRY.
Vienne, le 27 octobre 1796.
Cette lettre me fit une si cruelle impression que je reconnus l'impossibilité d'entreprendre un ouvrage pour lequel chaque coup de pinceau m'aurait fait
fondre en pleurs. Je renonçai donc à mon projet ; toutefois j'eus le bonheur, pendant mon séjour en Russie, de retracer encore des traits augustes et chéris ;
voici à quelle occasion. Le comte de Cossé arriva à Pétersbourg, venant de Mitau où il avait laissé la famille royale. Il me fit une visite pour m'engager à me
rendre auprès des princes, qui me verraient, me dit-il, avec plaisir. J'éprouvai dans le moment un bien vif chagrin ; car, ma fille étant malade, je ne pouvais
la quitter, et de plus j'avais à remplir des engagements pris, non seulement avec des personnages marquants, mais avec la famille impériale, pour plusieurs
portraits, ce qui ne me permettait pas de quitter avant quelque temps Pétersbourg. J'en exprimai toute ma peine à M. de Cossé, et comme il ne repartait pas tout
de suite, je fis aussitôt de souvenir le portrait de la reine, que je le priai de remettre à madame la duchesse d'Angoulême, en attendant que je pusse aller
moi-même recevoir les ordres de Son Altesse Royale.
Cet envoi me procura la jouissance de recevoir de Madame la lettre que je joins ici, et que je conserve comme un témoignage qui m'est bien cher, de sa
satisfaction.
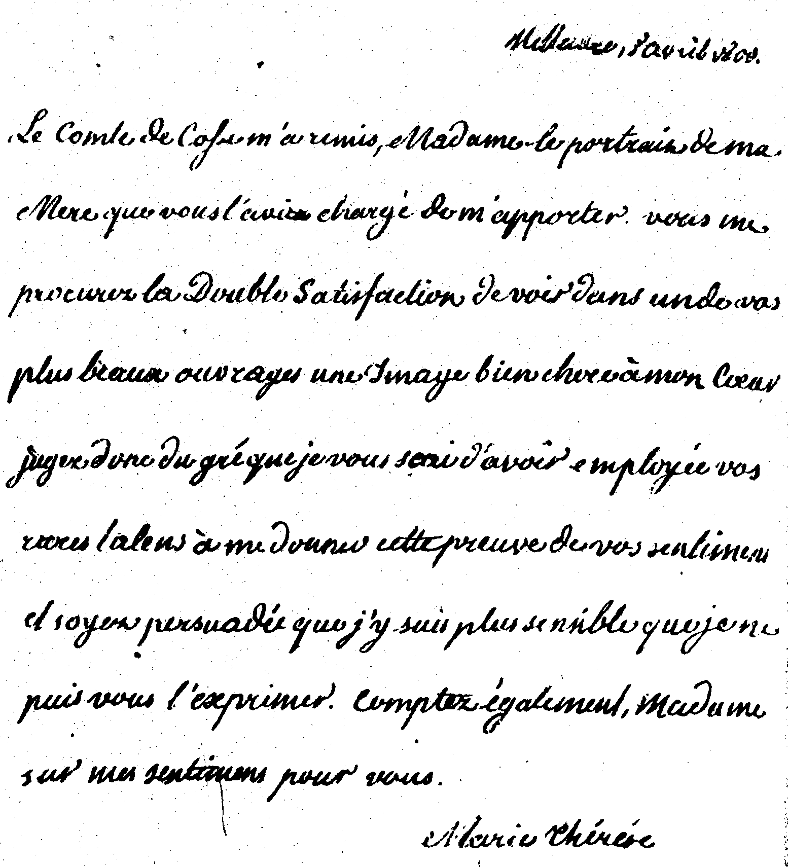
Dès que j'eus repris ma liberté, je courus à Mitau ; mais j'eus le malheur de n'y plus retrouver la famille royale.
CHAPITRE XX.
Catherine. Le roi de Suède. Le bal masqué. Mort de Catherine. Ses funérailles.
On vivait si heureux sous le règne de Catherine, que je puis affirmer avoir entendu bénir, par les petits comme par les grands, celle à qui la nation devait tant de gloire et tant de bien-être. Je ne parlerai point de conquêtes dont l'orgueil national était si prodigieusement flatté, mais du bien réel et durable que cette souveraine a fait à son peuple. Durant l'espace de trente-quatre ans qu'elle a régné, son génie bienfaisant a créé ou protégé tout ce qui était utile, comme tout ce qui était grandiose. On la voyait ériger à la mémoire de Pierre Ier un monument immortel, faire bâtir deux cent trente-sept villes en pierres, disant que les villages en bois qui brûlaient si souvent lui coûtaient beaucoup ; couvrir la mer de ses flottes ; établir partout des manufactures et des banques, si propices au commerce, à Pétersbourg, à Moscou et à Tobolsck ; accorder de nouveaux privilèges à l'Académie ; fonder des écoles dans toutes les villes et les campagnes ; faire creuser des canaux ; élever des quais de granit ; donner un code de lois ; enfin, introduire l'inoculation que sa volonté puissante était seule capable de faire adopter par les Russes.
(nb) Elle se fit inoculer la première pour donner l'exemple ; elle fonda aussi un établissement pour les enfants trouvés.
Tous ces bienfaits sont dus à Catherine seule ; car elle n'a jamais accordé à personne aucune véritable autorité ; elle dictait elle-même les dépêches à ses ministres, qui n'étaient réellement que ses secrétaires. On raconte que la comtesse de Bruce, qui longtemps a été son amie intime, lui disait un jour : - Je remarque que les favoris de Votre Majesté sont bien jeunes. - Je les veux ainsi, répondit-elle : s'ils étaient d'un âge raisonnable, on dirait qu'ils me gouvernent. Zouboff, en effet, qui fut le dernier, avait tout au plus vingt-deux ans. Il était grand, mince, bien fait, et il avait des traits réguliers. Je l'ai vu pour la première fois à un bal de la cour, donnant le bras à l'impératrice, qui se promenait. Il portait à sa boutonnière le portrait de Catherine, entouré de superbes diamants, et elle paraissait le traiter avec une grande bonté ; néanmoins on s'accordait à dire que celui de ses favoris qu'elle avait le plus aimé, était Lanskoi. Elle le pleura longtemps. Elle lui avait fait élever un tombeau près du château de Czarskozelo, où l'on m'a assuré qu'elle allait très souvent seule, au clair de lune. Au reste, Catherine-le-Grand, comme l'appelle le prince de Ligne, s'était fait homme ; on ne peut parler de ses faiblesses que comme on parle de celles de François Ier ou de Louis XIV, faiblesses qui n'influèrent nullement sur le bonheur de leurs sujets.
(nb) Je suis très fâchée que madame la duchesse d'Abrantès, qui a fait paraître récemment un ouvrage sur Catherine II, ou n'ait pas lu ce qu'ont écrit le prince de Ligne et le comte de Ségur, ou ne se soit pas soumise à ces deux témoignages irrécusables. Elle aurait plus justement apprécié, admiré, ce qui distingue cette grande impératrice, considérée comme souveraine, et elle aurait respecté davantage la mémoire d'une femme dont notre sexe peut s'enorgueillir sous tant de rapports importants.
Catherine II aimait tout ce qui était grandiose dans les arts. Elle avait fait construire à l'Ermitage les salles du Vatican, et copier les cinquante tableaux de Raphaël dont ces salles sont ornées. Elle avait aussi décoré l'Académie des beaux-arts de copies en plâtre des plus belles statues antiques, et d'un grand nombre de tableaux des différents maîtres. L'Ermitage qu'elle avait créé et placé tout près de son palais,
(nb) Le palais que Catherine habitait à Pétersbourg est d'une architecture lourde, mais les appartements sont vastes et beaux.
était un modèle de bon goût sous tous les rapports. On sait qu'elle écrivait le français avec la plus grande facilité (j'ai vu à la bibliothèque le manuscrit
original du code de lois qu'elle a donné aux Russes entièrement écrit de sa main, et dans notre langue). Son style, m'a-t-on dit, était élégant et très concis,
ce qui me rappelle un trait de laconisme que l'on m'a cité d'elle, que je trouve charmant. Quand le général Souwaroff eut gagné la bataille de Varsovie,
Catherine fit partir aussitôt un courrier pour lui, et ce courrier ne portait à l'heureux vainqueur qu'une enveloppe de lettre, sur laquelle elle avait écrit de
sa main : Au maréchal Souwaroff.
Cette femme dont la puissance était si grande, était dans son intérieur la plus simple et la moins exigeante des femmes. Elle se levait à cinq heures du matin,
allumait son feu, puis faisait son café elle-même. On racontait même qu'un jour, ayant allumé ce feu sans savoir qu'un ramoneur venait de monter dans la
cheminée, le ramoneur se mit à jurer après elle et à la gratifier des plus grosses invectives, croyant s'adresser à un feutier. L'impératrice se hâta d'éteindre,
non sans rire beaucoup de se voir traitée ainsi.
Dès que l'impératrice avait déjeuné, elle écrivait ses lettres, préparait ses dépêches, restant ainsi seule jusqu'à neuf heures. Alors elle sonnait ses valets de
chambre, qui quelquefois ne répondaient point à sa sonnette. Un jour, par exemple, impatientée d'attendre, elle ouvrit la porte de la salle où ils se tenaient,
et les trouvant établis à jouer aux cartes, elle demanda pourquoi ils ne venaient pas quand elle sonnait ; sur quoi l'un d'eux répondit tranquillement qu'ils
avaient voulu finir leur partie, et il n'en fut pas davantage. Une autre fois, la comtesse de Bruce, qui avait ses entrées chez elle à toute heure, arrive un
matin, et la trouve seule, appuyée sur sa toilette. - Votre Majesté est bien isolée, lui dit la comtesse. - Que voulez-vous, répond l'impératrice, mes femmes de
chambre m'ont toutes abandonnée. Je venais d'essayer une robe qui allait si mal, que j'en ai pris de l'humeur ; alors, elles m'ont plantée là. Il n'y a pas
jusqu'à Reinette (la première femme de chambre), qui ne m'ait quittée, et j'attends qu'elles soient défâchées.
Le soir, Catherine réunissait autour d'elle quelques-unes des personnes de sa cour qu'elle affectionnait le plus. Elle faisait venir ses petits enfants, et l'on
jouait à colin-maillard, à la main chaude, etc., jusqu'à dix heures que Sa Majesté allait se coucher. La princesse Dolgorouki, qui était du nombre des
favorisées, m'a dit souvent par combien de gaieté et de bonhomie l'impératrice animait ces réunions. Le comte Stackelberg était des petites soirées, ainsi que le
comte de Ségur, dont Catherine avait distingué l'esprit et l'amabilité. On sait que, lorsqu'elle rompit avec la France, et qu'elle congédia cet ambassadeur,
(nb) Le comte d'Esterhazy, envoyé par Louis XVIII, était l'ambassadeur de France reconnu à la cour de Pétersbourg quand j'y arrivai.
elle lui témoigna tout le regret qu'elle avait de le perdre ; - «Mais, ajouta-t-elle, je suis aristocrate ; il faut que chacun fasse son métier.»
Le nom des personnes que l'impératrice invitait aux petites soirées dont je viens de parler, aussi bien que la présence des jeunes grands-ducs et
grandes-duchesses, semblaient devoir être une garantie suffisante de la décence qui régnait dans ces réunions. Il n'en parut pas moins à Pétersbourg un libelle
affreux dans lequel on accusait Catherine de présider tous les soirs aux plus dégoûtantes orgies. L'auteur de cet infâme écrit fut découvert et chassé de la
Russie ; mais il faut malheureusement avouer, à la honte de l'humanité, que ce libelliste, qui était un émigré français, distingué par son esprit, avait d'abord
intéressé l'impératrice à ses malheurs, au point qu'elle l'avait logé convenablement, et lui faisait une pension de douze mille roubles !
Beaucoup de personnes ont attribué la mort de Catherine au vif chagrin que lui fit éprouver la rupture du mariage projeté entre sa petite-fille, la
grande-duchesse Alexandrine, et le jeune roi de Suède. Ce prince arriva à Pétersbourg avec son oncle le duc de Sudermanie, le 14 août 1796. Il n'avait que
dix-sept ans ; sa taille était élancée, son air doux, noble et fier, ce qui le faisait respecter malgré son jeune âge. Son éducation ayant été très soignée, il
montrait une politesse tout-à-fait obligeante. La princesse qu'il venait épouser, âgée de quatorze ans, était belle comme un ange, et il en devint aussitôt très
amoureux. Je me souviens qu'étant venu chez moi voir le portrait que j'avais fait d'elle, il regardait ce portrait avec tant d'attention, que son chapeau
s'échappa de sa main.
L'impératrice ne désirait rien tant que ce mariage ; mais elle exigeait que sa petite-fille pût avoir dans le palais de Stockholm et une chapelle et un clergé de
sa religion, et le jeune roi, malgré tout son amour pour la duchesse Alexandrine, refusait de consentir à ce qui dérogeait aux lois de son pays. Sachant que
Catherine avait fait venir le patriarche pour le fiancer après le bal qui se donnait le soir, le roi ne se rendit pas à ce bal, en dépit des courses multipliées
de M. de Marcoff pour le presser d'y venir. Je faisais alors le portrait du comte Diedrestein ; lui et moi allions souvent à ma fenêtre pour voir si le jeune roi
céderait à tant d'instances et prendrait le chemin du bal ; il ne céda point. Enfin, d'après ce que j'ai su de la princesse Dolgorouki, tout le monde était
réuni, lorsque l'impératrice entr'ouvrit la porte de sa chambre, et dit, d'une voix très altérée : «Mesdames, il n'y aura pas de bal ce soir.» Le roi de Suède et
le duc de Sudermanie quittèrent Pétersbourg le lendemain matin.
Que ce soit ou non le chagrin que lui causa cet événement, qui abrégea les jours de Catherine, la Russie ne tarda pas à la perdre. Le dimanche qui précéda sa
mort, j'allai, le matin après la messe, présenter le portrait que j'avais fait de la grande-duchesse Élisabeth. L'impératrice vint à moi, m'en fit compliment,
puis me dit : «On veut absolument que vous fassiez mon portrait, je suis bien vieille ; mais enfin, puisqu'ils le désirent tous, je vous donnerai la première
séance d'aujourd'hui en huit.» Le jeudi suivant, elle ne sonna pas à neuf heures ainsi qu'elle faisait ordinairement. On attendit jusqu'à dix heures et même un
peu plus ; enfin la première femme de chambre entra. Ne voyant pas l'impératrice dans sa chambre, elle alla au petit cabinet de garde-robe, et dès qu'elle en
ouvrit la porte, le corps de Catherine tomba à terre. On ne pouvait savoir à quelle heure l'attaque d'apoplexie l'avait frappée ; toutefois le pouls battait
encore, on ne perdit donc pas toute espérance aussitôt ; mais de mes jours je n'ai vu une alarme aussi vive se propager aussi généralement. Pour mon compte, je
fus tellement saisie quand on vint me dire tout bas cette terrible nouvelle, que ma fille, qui était convalescente, s'aperçut de mon état et s'en trouva mal.
Je courus, après mon dîner, chez la princesse Dolgorouki où le comte de Cobentzel, qui allait toutes les dix minutes au palais savoir ce qui se passait, venait
nous en instruire. L'anxiété allait toujours croissant ; elle était affreuse pour tout le monde ; car non-seulement on adorait Catherine, mais on avait une telle
peur du règne de Paul !
Vers le soir, Paul arriva d'un lieu voisin de Pétersbourg qu'il habitait presque toujours. Lorsqu'il vit sa mère étendue sans connaissance, la nature reprit un
moment ses droits ; il s'approcha de l'Impératrice, lui baisa la main et versa quelques larmes. Enfin Catherine II expira à neuf heures du soir, le 17 novembre
1796. Le comte de Cobentzel, qui lui vit rendre le dernier soupir, vint nous dire aussitôt qu'elle n'existait plus.
J'avoue que je ne sortis pas de chez la princesse Dolgorouki sans une grande frayeur, attendu que l'on entendait dire généralement qu'il y aurait une révolution
contre Paul. La foule immense que je vis en rentrant chez moi, sur la place du château, n'était pas propre à me rassurer ; néanmoins tout ce monde était si
tranquille que je pensai bientôt, avec raison, que nous n'avions rien à craindre pour le moment. Le lendemain matin, le peuple se rassembla de nouveau sur la
place, exprimant son désespoir, sous les fenêtres de Catherine, par les cris les plus déchirants. On entendait les vieillards, les jeunes gens, les enfants
appeler leur matusha (leur mère), s'écrier en sanglotant qu'ils avaient tout perdu. Cette journée fut d'autant plus affligeante qu'elle
était de triste augure pour le prince qui montait sur le trône.
Le corps de l'impératrice resta exposé pendant six semaines dans une grande salle du château, illuminée jour et nuit,
(nb) C'était dans cette même salle que j'avais vu donner les bals. Aussi je ne saurais dire quel effet me fit éprouver pendant six semaines cette illumination que je voyais tous les soirs en rentrant chez moi.
et magnifiquement décorée. Catherine était étendue sur un lit de parade entouré d'écussons portant les armes de toutes les villes de l'empire. Son visage
était découvert, sa belle main posée sur le lit. Toutes les dames (dont quelques-unes étaient alternativement de service auprès du corps) allaient baiser cette
main, ou faisaient le semblant. Pour moi, je ne l'avais point baisée vivante, je ne voulus pas la baiser morte, et j'évitai même de regarder le visage, qui me
serait resté si tristement dans l'imagination.
Sitôt après la mort de sa mère, Paul avait fait déterrer Pierre III, son père, inhumé depuis trente-cinq ans dans le couvent d'Alexandre Newski. On n'avait
trouvé dans le cercueil que des os et la manche de l'uniforme de Pierre. Paul voulut que l'on rendît à ces restes les mêmes honneurs qu'à ceux de Catherine. Il
les fit exposer au milieu de l'église de Cazan, et le service fut fait par de vieux officiers, amis de Pierre III, que son fils s'était pressé de faire revenir,
et qu'il combla d'honneurs et de bienfaits.
L'époque des funérailles arrivée, on transporta avec pompe le cercueil de Pierre III, sur lequel son fils avait fait placer une couronne, près de celui de
Catherine, et tous deux furent conduits ensemble à la citadelle, celui de Pierre marchant le premier ; car Paul voulait au moins humilier la cendre de sa mère.
Je vis de ma fenêtre cette lugubre cérémonie comme on voit un spectacle des premières loges. Le cercueil de l'empereur défunt était précédé par un chevalier de
la garde, armé de pied en cap d'une armure d'or ; celui qui marchait devant le cercueil de l'impératrice n'avait qu'une armure de fer,
(nb) Le chevalier qui portait l'armure d'or est mort de fatigue.
et les assassins de Pierre III, sur l'ordre de son fils, étaient obligés de porter les coins de son drap mortuaire. Paul suivait le cortège à pied, tête nue, avec sa femme et toute la cour, qui était très nombreuse et dans le plus grand deuil. Les dames avaient de longues robes à queue et d'immenses voiles noirs qui les entouraient. Il leur fallut marcher ainsi dans la neige par un froid horrible, depuis le palais jusqu'à la forteresse,
(nb) C'est dans la forteresse que sont enterrés tous les souverains russes. Le tombeau de Pierre Ier que l'on y voit est le plus simple du monde.
qui est à une fort grande distance de l'autre côté de la Néva. Au retour, j'en vis quelques-unes qui étaient mourantes de fatigue.
Le deuil se porta six mois. Les femmes sans cheveux, ayant des bonnets à pointe avancés sur le front, qui ne les embellissaient pas du tout ; mais ce léger
désagrément était bien peu de choses, comparé aux vives inquiétudes que faisait naître dans tout l'empire la mort de Catherine II.